 |
HISTORIE DIVINE DE JÉSUS CHRIST |
LIBRAIRIE FRANÇAISE |
FRENCH DOOR |
JOSEPH VON HAMMER PURGSTALL'HISTOIREDE L'EMPIRE OTTOMAN
|
LIVRES |
13-24 |
25-30 |
||
31-36 |
37-41 |
42-45 |
46-48 |
|
49-52 |
53-56 |
57-60 |
61-66 |
|
64-67 |
68-73 |
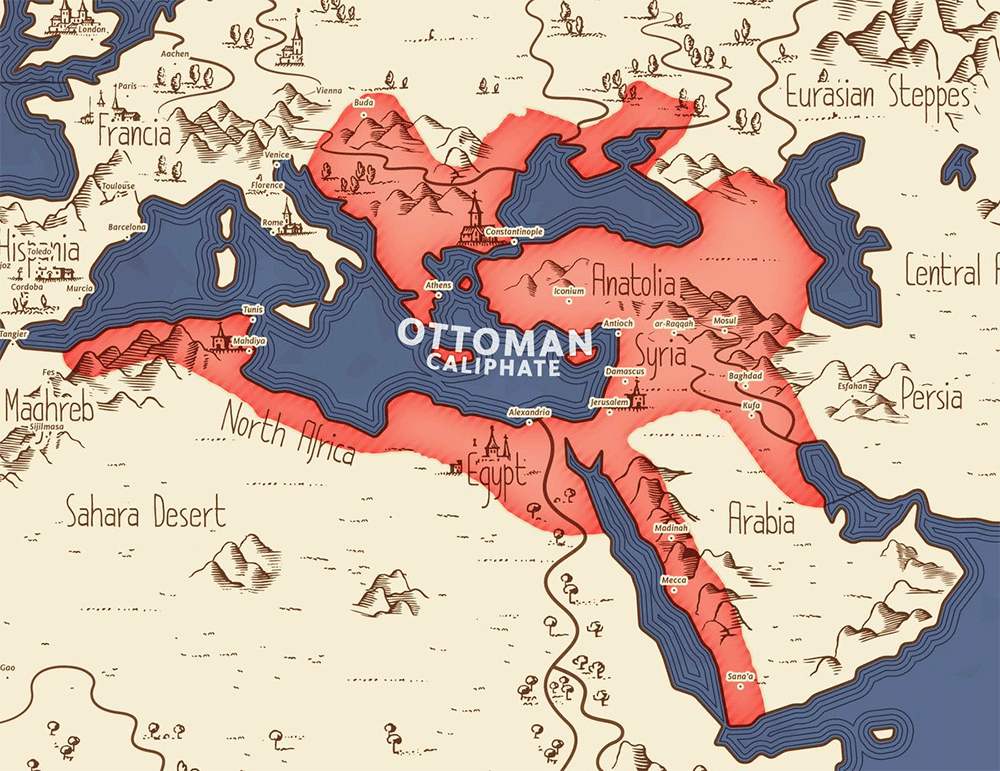 |
PRÉFACE.
Trente ans se sont écoulés depuis que Jean de Müller
m’engageait à me consacrer à l'étude de l'histoire, à m'appliquer de préférence
à celle d'Orient, à suivre surtout les destinées des Ottomans; il m'exhortait à
subordonner la connaissance des langues aux recherches et aux écrits
historiques. Dieu le veuille! répondis-je, en considérant l'importance du
sujet, la grandeur et l’abondance des matières, la longueur de Œuvre, la
difficulté des travaux préparatoires, et les obstacles à surmonter pour se
procurer les secours nécessaires. L’empire ottoman, dont le berceau apparaît à
la sortie du moyen âge, dont la jeunesse, l’âge viril et la vieillesse remplissent
les trois siècles de l'histoire moderne, est un vaste corps d’une haute
importance dans l'histoire du monde. Ses destinées sont étroitement liées à
celles des Etats voisins en Asie et en Europe, et agissent sur les mouvements
de tous les États d'Europe et d'Afrique, depuis la mer du Nord jusqu'à la
Méditerranée, des rivages de la Bretagne et de la Scandinavie aux colonnes
d’Hercule et aux cataractes du Nil. Ce colosse puissant, un pied en Europe,
l'autre en Asie, tenant sous lui le passage pour la navigation et le commerce
entre ces deux divisions du monde, quand l'heure de sa chute aura sonné,
couvrira de ses débris trois parties de la terre. Fondé sur les ruines de la
puissance des Césars d’Orient, l’Empire Ottoman comprend encore aujourd’hui une
plus vaste étendue que l'empire byzantin au temps de sa plus grande splendeur,
et quoiqu’il ait à peine atteint la moitié de la durée de son devancier, il
offre déjà les trois phases de la croissance, de la vigueur et de la
décrépitude. Aux trois anciens empires d’Assyrie, des Mèdes et des Perses, ont
succédé, dans le moyen âge et les temps modernes, ceux des Arabes, des Mongols
et des Turcs, comparables aux premiers en grandeur et en puissance et placés
sur un théâtre historique plus assuré. L’histoire du califat, qui, comme celle
des empereurs mongols, n’a pas encore trouvé d’écrivain en Europe, a aussi
comme elle sur l’histoire ottomane l’avantage de présenter un tout complet.
Mais outre la grande incertitude résultant du grand éloignement de temps et de
lieu, ces histoires: n’offrent pas non plus les secours et les sources nécessaires,
sources à peine connues de nom, et qui ne sont pas toutes à la portée de
l'écrivain. L’histoire ottomane, au contraire, a l'avantage d’être plus
rapprochée de nous, soit pour les temps, soit pour l'espace; elle offre
l'immense intérêt d’une liaison immédiate entre le passé et le présent; il est
possible de réunir tous les matériaux. Jusqu’ici cependant l'ignorance de leur
existence, leur dispersion, la difficulté d’en approcher, les grands frais à
faire pour en disposer, ont empêché qu'on en tirât parti en Europe.
De deux cents ouvrages turcs, arabes et persans traitant
de l’histoire ottomane en général, ou de l’une de ses parties, ou qui offrent
un ensemble de matériaux pour cet objet, le grand orientaliste anglais, sir
Williams Jones, n’en a connu lui-même qu'une douzaine; et dans les
bibliothèques publiques de Constantinople même on trouve tout au plus vingt ou
trente volumes historiques. Pendant trente années, je n’ai reculé devant aucune
peine, aucune dépense, pour arriver et puiser aux sources, et quand
l'acquisition de l'objet utile à mes études ne pouvait avoir lieu, je faisais
en sorte de pouvoir au moins le consulter. Dans ce but, j’ai, pendant mes deux
séjours à Constantinople, et dans mes voyages au Levant, non-seulement visité
assidûment les bibliothèques et les librairies, mais encore depuis lors, par
mes correspondances actives, j’ai cherché et découvert des ouvrages historiques
à Constantinople, à Bagdad, à Alep et au Caire. Dans ce but, j’ai consulté pour
mes travaux, en Allemagne, les bibliothèques de Vienne, Berlin et Dresde; en
Angleterre, celles de Cambridge et d'Oxford; à Paris, la bibliothèque Royale et
celle de l’Arsenal; en Italie, celle de Saint-Marco à
Venise, l'Ambrosiana à Milan, la Lorenziana et la Magliabechiana à Florence, celle du Musco Borbonico à Naples, la Vaticana, Barberini, et de Maria sopra Minerva à Rome, et à
Bologne, la bibliothèque si riche de Marsigli. Sans
autre ressource que mon traitement, sans le secours des Académies orientales
ou des Sociétés asiatiques, sans la protection des riches et des grands, j'ai,
par trente ans de recherches et de dépenses, formé , pour mon sujet, une
collection de matériaux, telle que nulle bibliothèque en Europe ou en Asie ne
peut en offrir d’aussi complète. Qu’il me soit permis de rendre ici hommage à
la générosité du dernier internonce S. E. M. le comte de Lutzow,
qui m’a fait présent de quatre excellents ouvrages historiques, et aux soins
constants de mon ami l’interprète I. et R. M. le chevalier de Raab, pour m’en
procurer beaucoup d’autres. Je dois d’autant plus de remercîments à ce dernier
que, dans les sept dernières années, il m’a fait trouver quantité d’ouvrages
que j'avais en vain cherchés pendant vingt ans, et que sans lui je n’aurais pu
combler les lacunes d’une œuvre classique dont l'achèvement était indispensable
A la composition de cette histoire. Enfin grâces soient rendues à la libéralité
des ministres de Prusse et de Saxe, et aux gardiens des bibliothèques royales
qui veulent bien permettre et offrir la communication à l’étranger de leurs
trésors littéraires.
Pendant que j'attendais du temps et des circonstances la
possession complète des matériaux qui me manquaient, je m’occupais soit A
étudier et mettre en œuvre ceux que j’avais déjà sous la main, soit à faire des
travaux préparatoires sur la chronologie, la géographie et la littérature. Au
moyen de ces travaux et de la connaissance acquise du peuple et de son gouvernement,
par mes voyages et mes peines, je tâchais de me rendre digne du but élevé que
je voulais atteindre. De tous les ouvrages historiques de l'Orient que j’ai pu
découvrir, il n’en est aucun que je n’aie lu et mis à profit; de toutes les
histoires ottomanes dont l'acquisition était possible il n’en est aucune que je
n’aie achetée. Les résultats de mes travaux préparatoires sur la topographie,
la bibliographie, la statistique et l'histoire sont en partie imprimés et mis
sous Ira yeux du public, en partie encore manuscrits. Par ces études, ces
exercices préliminaires, d'un côté se révèle à l'historien une source abondante
où il puise la connaissance des temps, des lieux, du gouvernement et de la littérature,
et de plus il peut faire écouler l’immense superflu dans lequel il eût été
noyé.
Malgré tant de soins, l'amas de notions chronologiques,
philologiques et biographiques entassées par les historiens précédents était si
énorme, il fallait tant de rectifications et d’éclaircissements, qu'il était
impossible de passer ces pièces sous silence; j’ai dû les citer comme documents
à l’appui des changements que je voulais introduire dans les mots et dans les
choses. Il était surtout nécessaire de classer ces matériaux, de peur que les
historiens à venir, les trouvant épars sur leur chemin, ne fussent disposés
comme les précédents à les prendre pour d'excellentes pièces de construction;
pour que le lecteur n'en fût pas embarrassé, je les ai rejetés A la fin de
chaque volume en forme d’appendice. Il en est autrement pour la citation des
autorités sur lesquelles s'appuie le texte. Aujourd'hui aucun écrivain n'est
bien venu à demander qu'on le croie sur parole. En tout temps l'historien a dû
étudier et puiser aux sources; notre époque incrédule exige encore qu’il les
cite. Le lecteur ne se sent pas obligé d’ajouter une foi aveugle aux récits de
l’historien; il faut encore que celui-ci produise des témoignages authentiques.
On demande la preuve de ce qu'il dit, et aucun moderne ne peut avoir la
prérogative des anciens, qui étaient crus sur parole. Mais si le lecteur a
presque complètement le droit d’exiger ces garanties, l’écrivain, de son côté,
doit réclamer toute confiance à la bonne foi dans les citations, tant que le
contraire n'est pas démontré. Tout soupçon de traduction infidèle ou de
citation inexacte qui n’est fondé que sur un scepticisme inconsidéré retombe
sur son auteur chaque fois que le
passage mis en doute est cité dans le texte original) comme une injuste attaque
à la réputation de l'écrivain. Pour satisfaire à cette exigence qui demande les
documents dans le texte original, il faudrait grossir cette histoire d’autant
d’infolios qu'elle aura d'in-octavos; et d’ailleurs,
tant que les historiens ottomans ne seront pas comme les Byzantins imprimés
dans leur texte et ensuite traduits pour former une masse énorme de volumes,
les pièces ne pourront être citées que d’après les manuscrits existants; encore
faudra-t-il renoncer à les produire dans le texte original, aussi longtemps
que les lettres turques ne seront pas familières à nos imprimeurs comme les
lettres grecque.
Ainsi, dans le petit nombre de cas où les citations du
texte paraîtront nécessaires, elles ne seront données que d'après la
prononciation. Ainsi sera fait pour les passades encore peu connus de la
tradition ou de la loi qui servent aux Moslimes de
bases fondamentales pour leurs transactions, et qui sont jetés par leurs
écrivains au milieu des faits de l'histoire. Dans le corps et au bas des pages
de l'histoire, on ne trouve que les dates, et les numéros des feuillets ou des
pages des pièces originales, ouvrages imprimés ou manuscrits, qui ne se trouvent
que dans ma collection: car j'espère que ce trésor de sources pour l'histoire
ottomane, rassemblé à force de peines, de temps et d'argent, ne sera pas
dispersé après ma mort, qu'il sera au contraire conservé, mis à la disposition
du public, pour être un témoignage de ma scrupuleuse exactitude dans la
composition de cet ouvrage. La chronologie et la topographie doivent former le
cadre de tout tableau historique. A chaque page le lecteur aura sous les yeux
l'époque des événements, et le lieu où ils se sont passés.
Sans la chronologie et la géographie, l'histoire marche
en aveugle. Ainsi cheminent les écrivains précédents de l'histoire turque: c’est
ce qui est prouvé dans beaucoup de cas par les historiens ottomans; dans
beaucoup d’autres, l'inexactitude de ces derniers ressort évidemment de leur
comparaison avec les Byzantins ou d’autres contemporains dignes de foi. Sans
les travaux chronologiques et géographiques du bibliographe fameux connu sous
le nom de Katib-Tschelebi ou Hadschi-Chalfa,
l'écrivain qui entreprendrait cette histoire s’avancerait le plus souvent dans
les ténèbres. Beaucoup de documents géographiques sont donnés dans le texte; un
plus grand nombre se trouve dans les notes et éclaircissements. Les
rectifications les plus importantes, d'après les découvertes les plus modernes,
sont données dans une petite carte annexée à chaque volume. Les Tables
chronologiques d'Hadschi Chalfa,
sa Géographie d'Asie et de Rumilie, sont les seuls
ouvrages turcs qui puissent servir de guides pour les lieux et les dates; mais
jusqu’ici les historiens européens n’en ont point fait usage. Ils peuvent
s’excuser sur leur ignorance de la langue ou le manque de traduction; mais ce
qu’on ne peut leur pardonner, c’est que nul d’entre eux n’ait consulté
sérieusement et avec un esprit de critique les Byzantins imprimés et publiés,
ces historiens impartiaux de toute l'époque qui embrasse les sept derniers
empereurs byzantins et les sept premiers sultans leurs contemporains. Plusieurs
même ont plus d’une fois prouvé qu’ils ignoraient leur existence.
Qui croirait que Cantemir et Petit de Lacroix, qui,
jusqu’ici, ont passé en Europe pour les meilleurs historiens des Ottomans, n’ont
consulté que le seul Chalcondylas, et qu’ils ont néglige tous les autres
écrivains de Byzance ses contemporains? Qui croirait que le premier ne sait
rien du siège de Constantinople par Murad II? que la prise de Thessalonique par
le même sultan est restée inconnue au second, quoique Ducas,
Phranze, et Chalcondylas lui-même, en parlent, quoique les Byzantins Joannes Canano et Anagnosta aient laissé
des ouvrages spéciaux sur ces deux événements? Qui croirait que Cantemir et
Petit de Lacroix, quoique tous deux orientalistes, ont défiguré les vrais noms
orientaux jusqu'à les rendre méconnaissables? que le premier, en particulier, a
entassé une multitude d'erreurs philologiques, qui dénotent la plus grande
ignorance des principes fondamentaux de l'arabe, du persan et du turc? Qui
croirait enfin que Gibbon, l’unique écrivain classique sur les premières
époques de l'histoire ottomane, qui joint à la connaissance la plus étendue des
sources le plus haut esprit de critique historique et le plus grand art de
style au jugement le plus sain, mérite plusieurs fois les reproches de légèreté
et de négligence, reproches qu'il aurait pu éviter par une étude superficielle
des Byzantins?
Je serai plus d une fois obligé dans le cours de cette
histoire, et surtout dans la première époque, de corriger les fautes
philologiques, chronologiques et géographiques des écrivains européens, mes
devanciers, afin que mon silence ne semble pas les autoriser, ou de peur d’occasionner
ainsi la propagation des erreurs. Ce travail ingrat sera surtout nécessaire
pour les neuf Byzantins ( 1° Pachymère,
2º Nicephorus Gregoras, 3°
Joannes Cantacuzène, 4° Ducas, 5° Chronicon Brève, 6° Joaones Canano, 7°
Joannes Anagnosta, 8° Chalcondylas, 9° Georgia Phranza, Chronicon ) qui ont traité toute la première période et le commencement de la
suivante en contemporains et surtout en écrivains de bonne foi, mais qui ne
sont cependant pas toujours dignes de croyance â cause de leurs préjugés et de
leur ignorance des langues et des faits. Ils méritent qu'on relève leurs
inexactitudes, ou qu’on leur rende justice en redressant les erreurs de leurs
copistes, éditeurs ou traducteurs.
Bien des historiens européens qui ont écrit plus tard sur
l'empire ottoman sont rarement dignes d’un tel travail, et encore moins ces
nombreux auteurs qui, à chaque guerre des Turcs, ont inondé l'Europe de leurs
futiles écrits. C'est pour cette raison qu'en avançant il y aura beaucoup moins
de matériaux historiques à déblayer, et le lecteur devenant plus familier avec
les noms et les choses, l'auteur se débarrassera d’une masse de notes et
d’éclaircissements nécessaires dans les commencements. Les lecteurs qui
voudraient s’épargner la peine de les examiner peuvent aussi facilement omettre
la lecture de tout le premier livre, qui traite des temps primitifs de
l'histoire des Turcs, et donne ensuite un léger aperçu de l'empire seldschukide
de l'Asie Mineure, sur les ruines duquel s’est élevé l'empire ottoman.
Toutefois, cet aperçu, l'historien ne pouvait se dispenser de le donner comme
une introduction à l’histoire ottomane.
Outre les sources pour la plupart dérobées aux regards du
public, l'auteur a pu encore en consulter d’autres où personne n'avait puisé :
ce sont les archives d’État depuis les premiers temps où l'empire ottoman
influait puissamment sur les nations voisines par ses rapports hostiles ou
pacifiques, jusqu'à nos jours, où, faible et à demi renversé, il se soutint à
peine et grâce à la longanimité de ces mêmes nations. De toutes les puissances
européennes, il en est deux seulement dont l’histoire est tout d'abord étroitement
unie à celle de l’empire ottoman : ce sont Venise et l’Autriche.
Il n’en est aucune contre laquelle les Turcs aient entrepris tant de guerres,
avec lesquelles ils aient conclu autant d'armistices et de traités; aussi les
archives de l'Autriche et de Venise sont bien plus importantes pour l’histoire
que celles des autres puissances européennes, et offrent la mine la plus
féconde. Les autres nations n'ont eu avec les Turcs que des rapports plus
tardifs, plus éloignés et plus faibles. Pour mieux écrire l’histoire spéciale
des relations diplomatiques de l'Autriche avec la Porte, j'ai obtenu sans
difficulté la communication de tous les rapports des ambassadeurs vénitiens et
autrichiens, de tous les traités de paix, des pièces de la chancellerie secrète
de la cour et de l'État et des archives de l'État, de la cour et de la maison
impériale, où sont conservées les anciennes archives de l'Empire, de la Hongrie
et de Venise. J’ai aussi consulté les archives du conseil de guerre. Enfin,
j'ai entièrement parcouru l'an passé, dans les archives de Venise, les plus
anciens traités conclus entre cette ville, les empereurs byzantins et les
sultans ottomans.
Possédant les sources et les secours nécessaires, habitué
dès longtemps par mes études, mes voyages et mes occupations aux mœurs de
l'Orient et, en particulier, à celles des Ottomans, consacré dès ma jeunesse
aux relations politiques et scientifiques de l'Autriche et de la Turquie, je
trouvai encore, outre ma vocation à écrire cette histoire, vocation qu’avait
réveillée en moi Jean de Müller, je trouvai, dis-je, de nouveaux moyens
d'exécution dans mes fonctions d’interprète de cour; car, des documents tirés
des sources ottomanes, les plus importants ont été envoyés à Vienne par des
ambassadeurs impériaux ou des officiers d'ambassade (Veranzius, Leupolsdorf, Busbek), ou
traduits par des interprètes impériaux (Gaultier Spiegel, Bratutti);
et la base de toutes les connaissances européennes, relativement à cette
histoire, a été mise au jour sur l’ordre de l’empereur Ferdinand Ier par son
interprète.
Maintenant, j’oserai dire quelques mots sur l’esprit qui
m’a dirigé et qui, au reste, doit encore mieux ressortir de la lecture de mon
ouvrage. J’ai écrit sous le sentiment profond d'une Providence éternelle et
juste, dont l'action plane sur le chaos de l'histoire sans que l’homme sache
d’où il vient ni où il va. J’ai pris la plume sans partialité pour les
personnes ou pour les peuples, pour les nations ou les religions; mais avec
amour pour tout ce qui est grand et beau, avec haine pour tout ce qui est mal;
sans animosité pour les Grecs ou contre les Turcs, sans prédilection pour les
musulmans et les chrétiens, mais avec amour pour la force régulière, pour un
gouvernement bien ordonné, pour les devoirs de la justice, pour les
établissements publics et philanthropiques, pour l’avancement des sciences ;
avec haine enfin pour la révolte, l’oppression, la cruauté ou la tyrannie.
 |
 |
 |