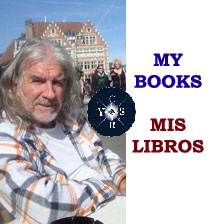 |
BIZANTIUM |
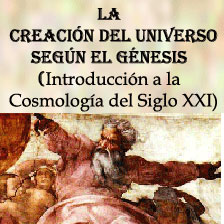 |
Louis Brehier. Le monde byzantin :Vie et mort de ByzanceLIVRE TROISIÈME. Agonie et mort de ByzanceChapitre premierLa dernière renaissance et son échec (1204-1389)
Après la prise de Constantinople, l’Empire
byzantin semblait à jamais détruit. Sur ses ruines s’élevait la puissance des
Francs qui s’étaient partagé son territoire et en commençaient la colonisation,
que de nouveaux apports de l’Occident pouvaient rendre définitive. Bien placé
pour diriger la croisade et lutter contre l’islam, le nouvel État semblait
devoir résoudre la question d’Orient au profit des Occidentaux et celle de
l’union des Églises à la satisfaction du Saint-Siège. Des possibilités infinies
s’ouvraient pour les vainqueurs et Innocent III lui-même, dont la volonté
n’avait pas été respectée, voyait dans la chute de Constantinople un dessein de
la Providence qui dépassait les prévisions humaines, et s’associait à
l’enthousiasme général.
Mais la tradition impériale de Byzance
était si puissante que l’État byzantin ne périt pas et se reforma en Asie
Mineure, où pendant un demi-siècle des souverains de premier ordre
travaillèrent à le reconstituer. Véritables rassembleurs des terres
helléniques, les empereurs de Nicée parvinrent, grâce à une politique
audacieuse et habile, à diviser leurs ennemis et à restaurer la puissance de
l’Empire, incomplètement sans doute, mais de manière à lui assurer encore plus
de trois siècles d’existence et à sauver de l’anéantissement la nationalité
hellénique. Leur tâche fut d’ailleurs facilitée par la décadence rapide de
l’Empire latin, qui s’avéra vite incapable de remplir la mission que tous
avaient rêvée pour lui au lendemain de la victoire .
1. L’Empire à Nicée et le rassemblement des terres helléniques (1204-1261)
Après la fuite de Murzuphle le 13 avril
1204, un gendre d’Alexis III, Théodore Lascaris, qui avait déjà le titre de
despote , fut élu basileus à
Sainte-Sophie mais, s’enfuyant de Constantinople à l’approche des Francs, il
s’établit d’abord à Brousse, puis à Nicée avec l’appui du sultan
d’Iconium . Excellent chef de
guerre, il avait donné des preuves de ses capacités dans l’expédition contre
Ivanko en 1200 et pendant les deux sièges de Constantinople. Nicée devint ainsi
un centre de ralliement pour tous les dignitaires civils et ecclésiastiques qui
avaient fui Constantinople : bâtie au débouché de routes importantes, à
l’extrémité d’un grand lac, protégée par des défenses naturelles et des
fortifications puissantes, en façade sur la mer et sur la plaine fertile de
Bithynie, riche des souvenirs des deux conciles œcuméniques, aucune cité ne
pouvait être mieux choisie pour abriter ce qui restait encore de l’État
byzantin . Théodore Lascaris
parvint à s’y maintenir malgré deux tentatives des Francs pour l’en déloger
(fin 1204, fin 1206) . En 1208 un nouveau
patriarche, élu, après l’abdication volontaire de son prédécesseur, par tous
les évêques que Lascaris avait pu rassembler, le couronna basileus dans la
cathédrale de Nicée et, dans un manifeste adressé à tous les Grecs, il se posa
en continuateur de la tradition impériale .
Cependant le pouvoir de Théodore conservait
un caractère précaire. Il n’avait pu vivre que grâce à la faiblesse de l’Empire
latin, mais, de plus, son autorité était loin de s’imposer aux Grecs. Les
immenses territoires encore unifiés à la mort de Manuel sous la domination byzantine,
étaient partagés en une multitude de pouvoirs autonomes, royaumes,
principautés, fiefs, villes libres formant un enchevêtrement inextricable
d’États, les uns conquis par les Francs, les autres obéissant à des Grecs qui
s’étaient déclarés indépendants. Réduire à l’unité des éléments si disparates
était une tâche impossible.
L’Empire démembré. — Le
démembrement de l’Empire, que nous avons vu déjà très avancé sous Alexis III,
fut achevé après la conquête de Constantinople, mais les Francs furent bien
incapables d’appliquer à la lettre le traité de partage qu’ils avaient conclu
avec Venise en mars 1204, soit par suite de leurs désaccords , soit à cause des résistances
qu’ils éprouvèrent de la part des Grecs et de la grande défaite que leur infligea
le tsar bulgare Kaloïan, devant Andrinople (24 avril 1205) . Cette organisation de
l’Empire latin eut le caractère d’un condominium entre les Francs, dont tous
les possesseurs de fiefs devaient l’hommage à l’empereur, et la république de
Venise dispensée de cet hommage.
L’empereur eut son domaine, composé d’une
partie de Constantinople , de la Thrace jusqu’à
la Maritza, des îles voisines et des territoires de Bithynie disputés à
Théodore Lascaris. Toutes ces terres étaient inféodées à des barons ou à des
chevaliers suivant l’importance de leur troupe . Le principal
feudataire était Boniface de Montferrat, mis en possession de Thessalonique (automne
1204) où il se fit couronner roi . Son domaine comprenait
en principe la Macédoine et la Grèce, mais il était à conquérir. A la suite de
sa campagne victorieuse en Grèce (automne 1205), il donna en fief la Béotie et
l’Attique au Bourguignon Otton de la Roche avec le titre de seigneur
d’Athènes , distribua d’autres
fiefs à ses compatriotes lombards et investit Guillaume
de Champlitte, parent du comte de Champagne, du Péloponnèse dont la conquête
avait été commencée par Geoffroi de Villehardouin, neveu du maréchal de Champagne,
avec l’aide d’un archonte byzantin, Jean Cantacuzène, maître de la Messénie . Il y avait longtemps
que toutes ces régions n’obéissaient plus à Constantinople, mais étaient au
pouvoir des nobles : le plus puissant d’entre eux, Léon Sgouros, faisait
peser sa tyrannie sur le Péloponnèse et la Grèce et c’était à lui que s’était
heurté Boniface de Montferrat dans sa campagne récente . En deux ans
(1205-1207), Guillaume de Champlitte et Geoffroi de Villehardouin avec quelques
centaines de chevaliers achevèrent presque entièrement la conquête du Péloponnèse,
dont Geoffroi fut élu seigneur après le départ de Champlitte, rappelé en France
pour recueillir l’héritage de son frère (1210) . La nouvelle conquête
divisée en douze grands fiefs avait reçu une organisation régulière et devint
comme une nouvelle France établie au milieu des populations helléniques .
En face des possessions franques, dans
lesquelles l’autorité était comme éparpillée entre un trop grand nombre de
chefs pour agir efficacement, Venise était devenue la puissance prépondérante
et tenait l’Empire latin dans sa dépendance. Maîtresse d’une partie de Constantinople,
elle y avait installé un véritable vice-roi, le podestat, « despote et
seigneur du quart et demi de l’Empire », étroitement placé sous l’autorité
de la métropole , et de plus, avec la
possession de Sainte-Sophie, elle s’était arrogé le monopole de l’élection au
patriarcat en dépit de la résistance d’Innocent III, qui, tout en refusant de
ratifier cet abus, confirma de fait l’élection des deux premiers patriarches
vénitiens .
Mais surtout les territoires que Venise
s’était réservés dans le partage de l’Empire ou qu’elle avait acquis dans la
suite, l’occupation d’une série d’îles, de ports, d’escales, qui formaient une
chaîne ininterrompue de l’Adriatique à Constantinople, avaient fait d’elle la
plus grande puissance maritime et commerciale de l’Orient et elle avait délogé
ses rivaux, les Génois, de toutes les possessions qu’ils occupaient sous les
empereurs byzantins . Maîtresse de la
Dalmatie, elle avait obtenu pour sa part les îles Ioniennes, l’Épire qu’elle ne
put occuper, la Morée dont Geoffroi de Villehardouin lui fit hommage et où elle
occupa les ports de Coron et de Modon, les Cyclades, Gallipoli, Rodosto,
Arcadiopolis, Héraclée, toutes les positions importantes permettant de
contrôler la navigation . En outre Boniface de
Montferrat lui céda la Crète, dont Alexis IV l’avait investi à Corfou, en
échange de son appui pour obtenir Thessalonique , et la possession de
cette grande île, qui ne fut d’ailleurs complète qu’après de longues luttes
avec les Génois qui s’y étaient établis, achevait d’assurer à Venise la
maîtrise de la Méditerranée orientale . Une autre acquisition
importante fut celle de la suzeraineté de Nègrepont (Eubée), dont l’un des
trois feudataires lombards (terciers) que le marquis de Montferrat y avait
installés fit hommage de ses domaines à la république .
Ne pouvant, sauf la Crète, coloniser tous
ces territoires directement, Venise prit le parti de concéder les îles en fiefs
à ses patriciens. Ce fut ainsi que Céphalonie et Zante, qui appartenaient au
royaume de Sicile, tombèrent entre les mains d’un Orsini qui en fit hommage à
la république en 1209 , qu’un Marco Dandolo,
cousin du doge Henri, fit la conquête de Gallipoli . Mais l’établissement
le plus remarquable fut celui de l’Archipel, conquis en 1207 par Marco Sanudo,
neveu par sa mère d’Henri Dandolo : après s’être emparé de Naxos, repaire
des pirates génois (1205-1207), dont il fit sa capitale, il donna en fiefs les
autres Cyclades aux aventuriers qui l’avaient aidé dans sa conquête .
La dispersion des forces helléniques. — Enfin, non
seulement l’Empire avait été démembré par les vainqueurs de Constantinople,
mais les régions helléniques qui échappèrent à la conquête se constituèrent en
principautés autonomes éloignées les unes des autres et ne se soucièrent
nullement de reconnaître l’autorité de l’empereur de Nicée.
Un bâtard du sébastocrator Jean l’Ange,
oncle d’Isaac II et d’Alexis III, Michel l’Ange, qui s’était attaché à la
fortune du marquis de Montferrat, s’échappa pendant la marche de Boniface sur
Thessalonique, gagna Durazzo, épousa la fille du gouverneur, enrôla une troupe
de Skipétars (Albanais), de Vlaques et de Bulgares, transforma ces rudes
montagnards à moitié brigands en soldats réguliers (armatoles, estradiots), parvint
à empêcher les Vénitiens de s’établir en Épire, qu’il occupa lui-même. Il y
annexa 1’Acarnanie et 1’Étolie, ainsi qu’une partie de la Thessalie. Son État
s’étendit de Durazzo au golfe de Lépante, mais il se contenta du titre de
despote, et avant sa mort en 1214, il avait désigné comme successeur son frère
utérin Théodore, fils légitime de Jean l’Ange, réfugié à Nicée . Entouré d’États latins
et slaves, menacé par Venise, Michel avait eu une politique équivoque, portant
son hommage suivant les circonstances à l’empereur latin Henri (1209) et lui
faisant la guerre l’année suivante, pour se retourner du côté de Venise .
Avant de quitter Nicée, Théodore avait
prêté serment de fidélité à Lascaris et, dès son arrivée en
Épire, il attaqua les territoires francs ; comme son frère,
il fit d’Arta, sa capitale, le refuge des Grecs qui fuyaient la domination latine,
mais il ne garda pas longtemps les promesses qu’il avait faites à Nicée et
prétendit à son tour représenter la légitimité impériale.
A l’extrémité opposée du monde byzantin,
dans l’ancien thème de Chaldia, sur la côte du Pont, deux petits-fils du
basileus Andronic Comnène, Alexis et David, sauvés du massacre de la famille du
tyran, furent établis par leur tante maternelle, la reine de Géorgie Thamar,
après la prise de Constantinople par les croisés, l’un Alexis à Trébizonde,
l’autre David à Héraclée en Paphlagonie . Depuis longtemps cette
région n’avait plus que des liens très faibles avec Constantinople. Trébizonde
avait été occupée par les Turcs de 1074 à la fin de 1075 . Le stratège Théodore
Gabras, qui les chassa du thème de Chaldia, gouverna Trébizonde « comme
son bien propre » en prince indépendant
jusqu’en 1098 . A plus forte raison
Alexis et David Comnène ne songèrent pas un instant à se soumettre à Théodore
Lascaris, qui les attaqua (hiver de 1213-1214), s’empara d’Héraclée et
d’Amastris et ne leur laissa sur la côte paphlagonienne que Sinope .
Le nouvel État comprenait donc le massif
montagneux du Pont, percé de vallées longitudinales parallèles, aux
communications transversales difficiles , et la côte de la mer
Noire, depuis Dioscurias, à la frontière des Abasges, jusqu’à l’embouchure de
l’Halys . Trébizonde, vieille
colonie grecque, dont les maisons s’étageaient sur une colline dominant la mer,
avec son acropole puissamment fortifiée et ses ports dont l’aménagement datait
de l’empereur Hadrien , était comme la
sentinelle avancée de l’hellénisme en face des peuples caucasiques ; en
même temps métropole religieuse, attachée au culte de son patron, saint Eugène,
martyr sous Dioclétien, qui avait pris la même importance que saint Démétrius à
Thessalonique ; enfin la plus
grande place commerciale de la côte asiatique de la mer Noire, au débouché des
routes de caravanes d’Asie centrale et en communications régulières avec
Kherson et les ports de Crimée . Il y avait donc là le
cadre d’un puissant État, comme l’avait montré dans l’Antiquité le royaume de
Mithridate et comme le comprirent les Comnènes, qui, se considérant comme les
représentants de la dynastie légitime, prirent le titre pompeux de
« basileus et autocrator des Romains Grand Comnène » . L’existence d’un État
indépendant à Trébizonde, malgré les bons rapports qu’il eut dans la suite avec
Constantinople, n’en fut pas moins le principal obstacle au rétablissement de
l’unité byzantine.
Constitution territoriale de l’État de
Nicée.
— Entouré d’ennemis, Lascaris se défendit avec énergie, en prenant même parfois
l’offensive et agissant autant par la diplomatie que par les armes.
Une alliance avec le tsar bulgare Kaloïan
(février 1207) lui permit de s’emparer
de Cyzique, grâce aux navires du pirate calabrais Jean Stirion, et d’empêcher
l’empereur Henri de Flandre d’aller défendre Andrinople contre les Bulgares.
Bien que Lascaris eût été obligé d’évacuer ses conquêtes, Henri, désireux de
séparer ses adversaires, les lui rétrocéda en lui accordant une trêve de deux
ans (mai-juin 1207) .
L’empereur latin prit sa revanche en 1210
en poussant contre Nicée le sultan d’Iconium Kaï-Khosrou , exhorté d’autre part à
attaquer Théodore par le basileus détrôné, Alexis III, qui, après avoir couru
mainte aventure, s’était réfugié à Iconium et croyait pouvoir avec
cet appui se substituer à son gendre. A la suite d’un combat sanglant devant Antioche
du Méandre, le sultan fut tué au cours d’un duel avec Lascaris et son armée se
débanda. Alexis III, capturé, alla finir ses jours dans un monastère de Nicée
et les fils de Kaï-Khosrou, qui se disputaient sa succession, signèrent une
trêve avec Lascaris . Celui-ci annonça cette
victoire à toutes les provinces de l’Empire en exprimant l’espoir qu’on serait
débarrassé bientôt « de ces chiens de Latins » . En outre il profita
des troubles du sultanat d’Iconium pour élargir ses frontières aux dépens des
Turcs en Carie, en Cappadoce, jusqu’à la Galatie et à la mer Noire .
Délivré des Turcs, l’empereur de Nicée
attaqua l’Empire latin en renouvelant son alliance avec les Vlacho-Bulgares,
mais l’empereur Henri, avec des troupes inférieures en nombre, lui infligea une
défaite décisive à Lopadion en Mysie (15 octobre 1211) . Les Francs envahirent
son territoire jusqu’à Pergame, mais, faute de troupes suffisantes, Henri
accorda la paix à son adversaire. D’après le traité de janvier 1212, l’Empire
latin conservait le nord-ouest de la Bithynie, avec le port d’Adramyttion au
sud, et reconnaissait à Lascaris la possession de Nicée, Brousse et la région
entre Adramyttion et Smyrne .
L’empereur Henri, mort le 11 juin 1216, eut
pour successeur son beau-frère Pierre de Courtenai, comte d’Auxerre, qui, sacré
à Rome par Honorius III, ne put même pas arriver jusqu’à Constantinople, mais
fut fait prisonnier par les troupes du despote d’Épire Théodore, après avoir
assiégé inutilement Durazzo, et mourut peu après sa sortie de prison
(1217) . Avec une véritable
souplesse Théodore Lascaris essaya de profiter de ce désarroi de l’Empire latin
pour préparer sa rentrée pacifique à Constantinople et après des négociations
avec Yolande, veuve de Pierre de Courtenai, il épousa en troisième noces une de
ses filles .
Il s’était d’ailleurs ménagé des chances de
rapprochement avec les Occidentaux en faisant dès 1207 des avances à Innocent
III et en se plaignant de l’hostilité des Latins. La réponse du pape ne fut
guère encourageante , mais les rapports
entre Rome et Nicée ne furent pas interrompus et en 1213-14 Théodore avait envoyé
à Constantinople Nicolas Mesarites, métropolite d’Éphèse, discuter de l’union
religieuse avec le légat d’Innocent III, le cardinal Pélage, sans d’ailleurs
obtenir le moindre résultat . Une autre occasion
s’offrit bientôt à Théodore de s’insinuer dans les affaires de l’Empire latin.
La régente Yolande étant morte en 1220, Constantinople se trouva un moment sans
empereur et sans patriarche . Théodore fit valoir
les droits de sa femme en exigeant pour elle une part de l’héritage de Pierre
de Courtenai et appuya sa revendication d’une menace d’attaque au moment où un
frère de Pierre, Robert de Courtenai, élu empereur, arrivait à Constantinople.
Menacé à la fois par le despote d’Épire et l’empereur de Nicée, Robert préféra
traiter avec son beau-frère et signa avec lui un pacte d’amitié : des
échanges de prisonniers eurent lieu, une fille de Théodore fut fiancée au
nouvel empereur latin et de nouvelles
discussions sur l’union religieuse furent engagées .
Théodore Lascaris allait envoyer sa fille à
Constantinople quand il mourut au début de 1222 . Il avait transformé le
précaire établissement de Nicée en un État viable, il s’était fait reconnaître
comme le successeur légitime des empereurs byzantins, il avait fait de son État
la principale puissance territoriale d’Asie Mineure et pris une hypothèque sur
l’Empire latin.
L’État byzantin en Europe. — Mort à l’âge
de 45 ans, Théodore Lascaris ne laissait que des filles, dont l’une était
mariée à Jean Vatatzès, d’une famille noble originaire de Didymotika et
apparentée aux Doukas. Écartant du trône ses quatre frères, ce fut à son gendre
que Théodore laissa l’Empire . Aucun choix ne pouvait
être meilleur.
Théodore avait reconstitué l’État byzantin
en Asie Mineure : Jean Vatatzès étendit sa domination en Europe et
commença à encercler Constantinople. De 1222 à 1254 il acheva de faire de
l’État de Nicée une puissance politique et militaire, mais, son action s’étendant
sur un théâtre plus vaste, il eut à lutter contre des difficultés nouvelles.
Il se heurta d’abord à la rivalité du
despote d’Épire Théodore qui, après avoir traité avec Venise, attaqua le
royaume de Thessalonique, tombé dans un état précaire depuis la mort de
Boniface de Montferrat (1207) et le gouvernement de son jeune fils
Démétrius . Celui-ci alla en vain
en Italie demander secours à Honorius III, dont les objurgations n’arrêtèrent
pas Théodore, qui s’empara de Thessalonique en 1223 et s’y fit couronner
basileus par l’archevêque d’Ochrida, après s’être fait proclamer à Arta, par
les évêques du despotat, « sauveur après Dieu et libérateur des Grecs du
joug latin et bulgare », malgré les protestations de Jean Vatatzès et des
évêques de l’État de Nicée .
Cette scission du monde byzantin était une bonne fortune pour l’Empire latin. Robert de Courtenai chercha d’abord à arrêter les progrès du despotat d’Épire, mais ses troupes furent battues devant Serrès, dont Théodore s’empara (1224) . Une offensive de Robert contre Nicée n’eut pas de meilleurs résultats. Jean Vatatzès arrêta l’invasion franque par sa victoire de Poimanon : parmi ses prisonniers se trouvaient deux frères de Lascaris, réfugiés à Constantinople, qui eurent les yeux crevés. Jean Vatatzès profita de sa victoire pour s’emparer de la péninsule de Troade et, avec la flotte qu’il avait construite, des îles de la côte d’Asie : Chio, Samos et Lesbos . Enfin pour la première fois il fit débarquer en Europe un corps de troupes destiné à couper la route de Constantinople à Théodore d’Épire. Les habitants d’Andrinople chassèrent la garnison franque et accueillirent les soldats de Nicée, mais Théodore d’Épire, déjà maître de la Thrace, réussit par ses intrigues à se faire ouvrir les portes de la ville, et l’armée de Vatatzès battit en retraite. L’attaque de Constantinople par les
Épirotes semblait prochaine : les coureurs de Théodore arrivaient
jusqu’aux portes de la ville. Pris entre deux ennemis, l’empereur Robert fit la
paix avec Vatatzès en lui abandonnant ses conquêtes (1225) . Mais ce fut une
diversion bulgare qui sauva momentanément Constantinople. Théodore d’Épire
avait conclu une alliance avec le tsar Jean Asên II, puis, avec sa mauvaise foi
ordinaire, avait envahi des territoires bulgares. Jean Asên attaqua les
Épirotes entre Andrinople et Philippopoli et leur infligea une déroute
complète. Après cette victoire de Klokonitza (1230), où Théodore d’Épire était
fait prisonnier, le tsar bulgare s’empara d’Andrinople, de presque toute la Macédoine
et de l’Albanie jusqu’à Durazzo. Théodore était réduit à l’Épire, à Thessalonique
et à la Thessalie .
Jean Asên avait travaillé encore plus pour
Nicée que pour Constantinople dont l’empereur Robert, parti pour l’Occident en
1228 afin de susciter le départ d’une croisade, était mort à son retour,
laissant le trône à son jeune frère Baudouin II, âgé de 11 ans . Par le traité de Rieti
(avril 1229) l’ex-roi de Jérusalem Jean de Bryenne, qui passait pour l’un des
plus braves chevaliers d’Occident, fut élu par les barons de Romania baile de l’Empire avec le titre
d’empereur . Arrivé à
Constantinople (1231), il était résolu à relever l’Empire latin, et Jean
Vatatzès, redoutant une nouvelle croisade, s’était mis en rapport avec le pape
Grégoire IX : des conférences en vue de l’union des Églises se tinrent à
Nicée (1232-1234), mais sans aboutir à un résultat . Cependant, après avoir
passé deux ans à recruter une armée, Jean de Bryenne débarqua à Lampsaque
(1233). Vatatzès, avec des forces réduites, son armée étant en expédition
contre Rhodes, ne put que harceler les Francs et leur couper les vivres, et
après avoir pris un château près de Cyzique, Jean de Bryenne battit en retraite
et se rembarqua : le grand effort qu’il avait fait n’avait servi qu’à
montrer son impuissance .
En revanche Jean Vatatzès développait
chaque jour davantage son action politique et militaire. Par une législation
excellente : encouragements à l’agriculture et à l’industrie indigène du
tissage, création de fiefs militaires pour assurer la défense des frontières,
relations commerciales avec les Turcs d’Iconium, il avait donné à son État une
prospérité qui lui assurait des ressources régulières . Sa diplomatie était
des plus actives et depuis 1229 il était en relations avec l’empereur Frédéric
II, gendre de Jean de Bryenne, mais brouillé avec lui depuis qu’il l’avait
forcé à lui céder la couronne de Jérusalem . Enfin Vatatzès avait
créé une flotte de guerre qui croisait dans l’Archipel et qui, après avoir
occupé Lesbos, Chio, Samos, Cos et Rhodes, osa attaquer la Crète vénitienne en
1233, mais ne put conserver les territoires conquis . Il n’est donc pas
étonnant qu’après la retraite de Jean de Bryenne l’empereur de Nicée ait
cherché à organiser une contre-offensive pour reprendre Constantinople.
Mais, ne trouvant pas ses forces
suffisantes pour agir seul, Vatatzès fit alliance avec le tsar Jean Asên, qui
conservait un ressentiment contre les barons de Romania : après lui avoir
offert la tutelle de Baudoin II en 1228, on lui avait préféré Bryenne . L’alliance entre
Vatatzès et Asên fut scellée par les fiançailles de la fille du tsar avec
Théodore, fils du basileus . Le mariage fut célébré
à Gallipoli, dont Vatatzès avait chassé la garnison vénitienne, puis les deux
alliés, divisant leurs forces, s’emparèrent des places tenues par les Francs
jusqu’à la Maritza, ravagèrent le nord de la Thrace et se retrouvèrent chargés
de butin devant Constantinople . Les alliés attaquèrent
en même temps les murs terrestres et maritimes, mais le vieux Jean de Bryenne
avec de faibles forces dirigea lui-même la sortie et mit en déroute les
assaillants, tandis qu’une escadre vénitienne détruisait la flotte de Vatatzès
(été de 1235). L’opération, recommencée avec de nouveaux navires l’hiver
suivant, ne réussit pas mieux, grâce aux renforts amenés par Geoffroi de
Villehardouin, prince de Morée, et à la victoire navale du baile vénitien de
Constantinople, qui coula à l’entrée du Bosphore dans la mer Noire la nouvelle
flotte des alliés .
Ce gros échec fut pour Jean Vatatzès le
début d’une série de difficultés et d’épreuves qui, loin de le décourager, ne
firent que tendre davantage ses efforts. Avant sa mort à l’âge de 89 ans (23
mars 1237) , Jean de Bryenne avait
envoyé Baudouin II en Occident chercher des secours ; Grégoire IX avait
publié des bulles de croisade pour la Romanie et tenté d’empêcher
Vatatzès d’attaquer l’Empire latin ; mais l’empereur
de Nicée avait répondu à ces exhortations par une lettre dans laquelle il
attaquait la primauté romaine et la légitimité des empereurs latins , puis il avait resserré
son alliance avec Frédéric II en s’engageant à reconnaître sa suzeraineté, s’il
recouvrait Constantinople . A ce moment l’empereur
germanique, qui rêvait la domination de la chrétienté, était engagé en plein
dans sa lutte contre le pape et contrariait autant qu’il le pouvait ses préparatifs
de croisade . D’autre part Vatatzès
se voyait abandonné par son allié, le tsar Jean Asên, qui, poussé par sa femme,
nièce de Baudoin II, s’alliait avec l’Empire latin, demandait à Grégoire IX
l’envoie d’un légat pour se réconcilier avec Rome, et assiégeait la garnison
que Vatatzès avait laissée à Tzurulon (Tchorlou) afin d’avoir toujours un pied
en Europe. Mais la réconciliation avec Rome n’eut pas lieu et la garnison de
Tzurulon se défendit avec acharnement. Ayant appris la mort de sa femme, de son
fils et de son patriarche, le tsar leva le siège de la ville et peu après se
réconcilia avec Vatatzès, qui eut ainsi la chance d’échapper à une action
combinée des Bulgares et des Francs (fin 1238) .
Vatatzès n’eut à subir que l’offensive de
Baudouin II, qui revint d’Occident à la tête d’une armée de croisés, à laquelle
il joignit des auxiliaires Comans, poussés vers l’ouest par l’invasion
mongole , mais la croisade se
borna à la prise de Tzurulon et à la destruction de la flotte grecque par une
escadre française (1240) , et vers le 24 juin
1241 une trêve de 2 ans fut conclue entre les deux empereurs . La mort de Jean Asên
(24 juin 1241), qui laissait pour successeur un enfant de 9 ans, eut pour
résultat un affaiblissement de la Bulgarie , dont Vatatzès profita
pour conduire lui-même par terre et par mer une expédition contre
Thessalonique.
Thessalonique appartenait toujours au
despote d’Épire Théodore, fait prisonnier et aveuglé par Jean Asên en 1230,
puis remis en liberté en 1238 : il avait confié le pouvoir à son fils
Jean, qui continuait à porter le titre de basileus. Vatatzès attira Théodore à
Nicée, le reçut fort bien, mais le mit sous bonne garde et l’emmena dans son
expédition . Pour la première fois
un empereur de Nicée, après avoir traversé l’Hellespont, suivit les côtes de
Thrace avec son armée et sa flotte, mais il ne put prendre la ville, dont il
avait organisé le blocus, rappelé par la nouvelle que les Mongols de
Gengis-khan avaient envahi l’Asie Mineure et battu le sultan d’Iconium. Du
moins avant son départ il détermina Théodore d’Épire à aller trouver son fils
et à le faire renoncer au titre de basileus .
L’attaque du sultanat de Roum par une armée
mongole venue de Perse ne fut qu’un courant secondaire de l’immense invasion
qui faillit submerger l’Europe et le Proche-Orient, après avoir soumis la Russie
et l’Arménie, en poussant devant elle le peuple des Comans qui émigra en
Hongrie et y apporta le trouble et la confusion (1237-1241) . Les Mongols écrasèrent
l’armée turque près d’Erzindjian (26 juin 1243) . Le sultan Kaï-Khosrou
II dut se reconnaître le vassal du grand Khan et la domination mongole atteignit
la frontière de l’État de Nicée, mais les Mongols n’attaquèrent pas les
Grecs : le principal résultat de leur invasion fut la décadence de l’État
seldjoukide qui cessa d’être un danger pour Nicée et où les Mongols firent
régner une véritable terreur . Moins heureux que
Vatatzès, qui signa un traité d’alliance avec Kaï-Khosrou , l’empereur Trébizonde
Manuel dut transporter aux Mongols la vassalité qu’il avait à l’égard du sultan
d’Iconium et se rendre à Karakoroum pour assister, comme les autres vassaux, à
l’assemblée générale (qouriltaï) qui élut le grand Khan Gouyouk en 1246 .
Après avoir songé un moment à s’allier au
sultan d’Iconium , Baudouin II était
reparti chercher des secours en Occident et avait entrepris la tâche difficile
de réconcilier Frédéric II avec le pape Innocent IV. Il avait assisté au
concile de Lyon (juin-juillet 1245) et il ne devait revenir à Constantinople
qu’en octobre 1248, après avoir échoué dans ses démarches . Pendant ce temps
Vatatzès avait resserré son alliance avec Frédéric II en épousant l’une de ses
bâtardes âgée de 12 ans, Constance, qu’il avait eue de Bianca Lancia . Les circonstances favorisaient
l’empereur de Nicée et il comprit qu’il n’en trouverait jamais de plus favorables
pour accomplir le dessein de toute sa vie, la reconstruction de l’Empire :
l’heure des réalisations était arrivée et il passa les dix dernières années de
son règne (1244-1254) à achever cette œuvre de restauration.
Il trouva bientôt l’occasion d’agir. Le
tsar bulgare Koloman étant mort en 1246, laissant le trône à son jeune frère encore
mineur, Vatatzès occupa les places macédoniennes de Serres, Melnic, Skoplje, la
Pélagonie jusqu’à Prilep et obtint de la régente Irène un traité qui lui
confirmait ces acquisitions . Peu après (décembre
1246) un complot des habitants lui livrait la capitale de la Macédoine, Thessalonique,
dont il confirmait les privilèges, tandis que le despote Démétrios, qui avait
succédé à son frère Jean, était interné en Asie . Puis, la trêve signée
avec Constantinople étant expirée, Vatatzès profita de l’absence de Baudouin
pour reprendre Tzurulon, véritable clef de la péninsule de Constantinople
(1247) , Baudouin II, revenu
d’Occident sans troupes et sans argent (octobre 1248), ne put que se résigner à
la perte de cette importante position.
Serrant de près Constantinople, Vatatzès en
préparait l’attaque lorsqu’il dut envoyer une expédition pour reprendre l’île
de Rhodes aux Génois qui l’avaient occupée (1249). Vers 1204 un magnat grec,
Léon Gabalas, s’était installé dans l’île en se déclarant indépendant, mais en
1233 Vatatzès l’avait obligé à reconnaître sa suzeraineté et son frère, Jean
Gabalas, était resté fidèle à l’Empire grec . Malgré un renfort de
chevaliers français que Guillaume de Villehardouin, revenant de Chypre où il
avait vu saint Louis, amena aux Génois, ceux-ci durent capituler .
La dernière campagne de Jean Vatatzès fut
dirigée en 1252 contre les despotes d’Épire, le vieux Théodore l’Aveugle, resté
en possession d’un apanage qui comprenait Vodéna et Ostrovo, et son neveu,
Michel II, toujours maître de l’Épire, de la Thessalie, de l’Étolie et de
quelques villes de la Macédoine occidentale . Bien qu’il eût signé
un traité d’amitié avec Vatatzès et fiancé son fils à une fille du prince
héritier de Nicée , Michel II, poussé par
son oncle, attaqua les villes frontières de l’État de Vatatzès. Celui-ci
concentra des troupes à Thessalonique, s’empara de Vodena, résidence du vieux
Théodore, et attaqua en plein hiver Michel II, qui s’enfuit dans les montagnes,
poursuivi par les cavaliers d’Alexis Stratégopoulos, mais fut trahi par le
gouverneur de Castoria, qui le livra à Vatatzès . Par le traité signé à
Larissa Michel dut céder à l’État de Nicée Prilep, Veles, Kroai en Albanie et
toutes les villes occupées par l’armée de Vatatzès : le vieux despote Théodore
fut emprisonné et le fils de Michel, livré en otage, fut de nouveau fiancé à la
petite-fille de Vatatzès .
La plus grande partie de la Macédoine avait été ainsi recouvrée ; Vatatzès mit les territoires conquis en état de défense et plaça à la tête des villes des gouverneurs d’élite . Il restait à reprendre l’attaque de Constantinople, mais il semble que Vatatzès ait trouvé ses seules forces insuffisantes pour une pareille entreprise et qu’il ait cherché à y rentrer par des voies pacifiques. Tel est le sens de ses négociations avec
Innocent IV. Les premières ouvertures vinrent du pape qui chercha inutilement à
rompre l’alliance avec Frédéric II, mais le trouva disposé à reprendre les
conversations relatives à l’union . Des ambassades furent
échangées, au grand mécontentement de Frédéric II qui tança son gendre , fit arrêter ses ambassadeurs
et les emprisonna . Après la mort de
Frédéric II (13 décembre 1250) , les pourparlers
reprirent entre Rome et Nicée dans des conditions d’autant plus favorables que
Vatatzès n’eut que des rapports hostiles avec l’héritier de l’empereur
germanique et que, pour recouvrer
Constantinople, il avait décidé le patriarche et le clergé à faire au pape le
maximum de concessions ; en échange de la remise de la ville impériale,
l’autorité du pape serait reconnue, le clergé grec lui prêterait le serment
d’obédience, sa juridiction d’appel serait admise. Telles sont quelques-unes
des conditions que les archevêques de Sardes et de Cyzique portèrent au pape au
début de 1254. Innocent IV accueillit favorablement cette ambassade et prit des
mesures qui donnaient satisfaction à certains desiderata des Grecs, offrant de
se porter arbitre entre Vatatzès et Baudouin II et d’aller tenir un concile à
Constantinople . Le plus grand désir de
conciliation se manifestait des deux côtés, mais Jean Vatatzès mourut le 3
novembre 1254 et Innocent IV, le 7
décembre suivant. Le nouveau pape, Alexandre IV, envoya bien une ambassade à
Théodore II en 1256, mais l’entente ne put se faire et les négociations furent
rompues .
L’empereur de Nicée sur la défensive. — La mort de
Jean Vatatzès retarda de sept ans la reprise de Constantinople. Son fils
Théodore II Lascaris, qui prit le nom de son aïeul maternel, passa son règne
très court (novembre 1254 - août 1258) à défendre les conquêtes paternelles,
plus étendues que solides. Age de 32 ans à son avènement, il n’avait pris
jusque-là aucune part à l’exercice du pouvoir, mais il était zélé, instruit,
travailleur, bon chef de guerre, regardé par les érudits de son entourage,
Georges Acropolites et Nicéphore Blemmydès, comme le souverain rêvé , mais il ne tarda pas à
les décevoir par son caractère fantasque, violent et autoritaire . Hostile à la noblesse,
il avait pour principal ministre un de ses compagnons d’enfance d’humble
origine, Georges Muzalon, dont il fit son favori et qu’il créa grand-domestique
en comblant de titres sa famille et ses amis et en destituant de vieux
serviteurs pour attribuer leurs places au favori ou à son clan, ce qui exaspéra
les nobles .
Tranquille du côté du sultan de Roum, avec
lequel il renouvela l’alliance conclue par Vatatzès , Théodore put laisser
Georges Muzalon à Nicée et aller repousser la tentative du tsar bulgare Michel
pour reprendre les villes qu’il avait dû céder à l’État de Nicée en 1246. Il
fallut pour cela deux campagnes (1255-1256) dans lesquelles se manifesta
l’indiscipline des chefs byzantins, qui aurait abouti à un désastre si le jeune
basileus n’avait pas rétabli lui-même la situation : au printemps de 1256
deux de ces chefs, qui avaient attaqué l’ennemi contrairement aux ordres reçus,
ne purent supporter le choc des Comans enrôlés par Michel ; l’un s’enfuit,
l’autre fut pris. A cette nouvelle, Théodore accourut à marches forcées à
Bulgarophygon , mit l’ennemi en
déroute et lui infligea un nouveau désastre au passage de la Maritza . Le tsar Michel demanda
la paix par l’entremise de son beau-père, le prince russe de Galicie
Rostislav : toutes les villes prises par les Bulgares furent restituées à
Théodore qui obtint en plus la forteresse de Tzepaina, défendant l’accès de la
Thrace . Peu après,
l’assassinat successif de Michel et de son cousin Koloman II par des boyards
mit fin à la dynastie des Asên : le Serbe Constantin Tach, petit-fils
d’Étienne Nemanja, proclamé tsar, répudia sa femme et épousa une fille de
Théodore II (1257).
La guerre d’Épire qui suivit la défaite
bulgare fit moins d’honneur au basileus, qui la provoqua. En septembre 1256
Théodora, femme du despote Michel II, lui ayant amené son fils afin d’accomplir
son mariage avec la fille de Théodore II, suivant l’accord de 1250, le basileus
la força avant la cérémonie à signer un traité qui lui abandonnait les villes
de Durazzo et de Servia Michel II, qui avait dû
ratifier le traité, se vengea en soutenant la révolte du gouverneur d’El-Bassan
en Albanie et en attaquant les garnisons des villes impériales. Théodore II,
sujet à ce moment à des attaques d’épilepsie, se contenta d’envoyer en
Macédoine Michel Paléologue, mais, comme il se défiait de lui, il lui donna une
armée trop faible (1257). Paléologue ne put empêcher le despote d’occuper les
places de Macédoine, de capturer le gouverneur de Prilep, Georges Acropolites
et de l’emprisonner à Arta . Théodore, impuissant,
voulut faire excommunier tous les Grecs d’Occident par le patriarche Arsène et
ne renonça à cette malencontreuse solution que sur les remontrances de
Nicéphore Blemmydès . Par contre la situation
de Michel II fut renforcée par son alliance avec Manfred, maître des
Deux-Siciles et d’une partie de l’Italie . Manfred épousa une
fille du despote qui lui apporta probablement en dot les villes de Durazzo,
Avlona, Belgrade . Ce retour de la
puissance sicilienne dans la péninsule balkanique devait avoir les suites les
plus néfastes pour l’Empire byzantin et mettre obstacle à sa restauration
intégrale.
Théodore II par ses fautes avait perdu une
partie des conquêtes de Vatatzès : par les maladresses de son gouvernement
intérieur il s’aliéna la noblesse sans avoir la force de la réduire à
l’obéissance et compromit irrémédiablement l’avenir de l’enfant qui devait lui
succéder. Une des familles les plus importantes de la noblesse était celle des
Paléologues qui, depuis la fin du xie siècle, avait fourni à l’Empire de nombreux chefs de guerre et hommes d’État,
souvent alliés à la dynastie régnante . Son chef, Andronic
Paléologue, avait épousé une petite-fille d’Andronic Ier et avait
reçu de Vatatzès la dignité de grand domestique et le gouvernement de
Thessalonique ; son fils Michel était à la même époque gouverneur de
Serrès et de Melnic . La situation
importante de cette famille et sa parenté avec la dynastie déchue excitaient la
jalousie et la méfiance. Sous Vatatzès, Michel Paléologue fut accusé d’aspirer
à l’Empire et le tribunal voulait le soumettre à l’épreuve du fer rouge . Vatatzès se contenta
d’un serment de fidélité , mais Théodore II, qui
le reconnaissait comme l’un de ses meilleurs généraux et le nomma grand
connétable et gouverneur de Bithynie, avait contre lui des préventions qui se
manifestaient par une attitude hostile et des menaces fréquentes .
Les choses en vinrent à un tel point qu’en
1256 Paléologue, craignant pour ses jours, se réfugia auprès du sultan
d’Iconium, alors aux prises avec les Mongols et qu’il aida à les repousser ; mais les troupes
du sultan ayant été battues dans une autre rencontre, le territoire du sultanat
de Roum fut ravagé et Kaï-Khosrou fit appel au secours du basileus conformément
à leur traité d’alliance, en lui cédant les places de Laodicée et de
Chonae : Théodore, qui l’accueillit à Sardes, lui donna quelques
troupes ; puis, se voyant
lui-même aux prises avec le despote d’Épire, avec des généraux incapables, il
prit le parti de rappeler Michel Paléologue, lui envoya des lettres de sûreté,
le rétablit dans ses fonctions et dignités et, comme on l’a vu,
lui confia le commandement de l’expédition d’Épire, mais avec des troupes insuffisantes.
Il semble, d’après Pachymère, que la
rancune du basileus contre les Paléologues ne tarda pas à se manifester de
nouveau. Une nièce de Michel, accusée d’incantations magiques, aurait été mise
à la torture et Michel lui-même arrêté, mais le silence d’Acropolites et de
Grégoras sur ces faits rend ce témoignage suspect . Il n’en est pas moins
certain que la conduite de Michel Paléologue après la mort du basileus montre
la mésintelligence profonde qui régnait entre eux.
Atteint d’une maladie grave due à une
dégénérescence physique et dont il notait lui-même les progrès dans ses lettres
avec un véritable stoïcisme, Théodore II Lascaris mourut au mois d’août 1258 à
l’âge de 37 ans, laissant pour lui succéder un enfant de 8 ans .
L’usurpation de Michel Paléologue et la
reprise de Constantinople (1278-1261). — Avant sa mort,
Théodore II avait décidé que, pendant la minorité de Jean IV, la régence serait
exercée par Georges Muzalon et avait fait prêter serment à son favori par tous
les dignitaires . Sentant son
impopularité, Muzalon avait demandé au Sénat d’élire comme régent celui qui
paraîtrait le plus digne, mais, sur les instances des nobles, avait conservé
ses pouvoirs. Or, neuf jours plus tard, pendant qu’on célébrait à Magnésie les
obsèques du basileus défunt, les mercenaires francs envahirent l’église et
égorgèrent Georges Muzalon et ses frères . C’était là le résultat
d’un complot, dont Acropolites désigne les auteurs comme des nobles disgraciés
ou mutilés sous le règne précédent, mais la suite des faits permet de regarder
comme son principal organisateur Michel Paléologue, qui, avec une véritable
duplicité, avait engagé Muzalon à conserver le pouvoir et qui avait su
s’assurer le concours des mercenaires francs, dont il était le chef .
Cette journée sanglante fut en effet le
point de départ de sa fortune. Dans une assemblée des grands tenue pour
désigner un nouveau régent, toutes les candidatures s’effacèrent devant la
sienne et il reçut le titre de mégaduc avec le droit de puiser
dans le trésor, dont le patriarche Arsène lui remit les clefs . Cette ascension
continua par l’élévation de Michel au rang de despote, premier degré de la
hiérarchie . Il ne lui restait plus
qu’à conquérir le trône, bien qu’à part les insignes impériaux, il eût déjà
tous les attributs du pouvoir suprême . Le patriarche Arsène,
tuteur de Jean IV, dont il s’efforçait de préserver les droits, était un ancien
moine d’Apollonia qui n’avait même pas encore reçu les ordres ecclésiastiques
lorsqu’en 1255 un caprice de Théodore II Lascaris l’avait imposé aux évêques,
après que Nicéphore Blemmydès eut refusé d’accepter la dignité patriarcale . Michel Paléologue
avait littéralement fait le siège de ce personnage et réussi à le convaincre
que le seul moyen de sauver le trône de Jean IV était de donner au régent le
titre de basileus, dont il exerçait déjà les fonctions.
Le 1er décembre 1258, Michel
Paléologue était élevé sur le pavois à Magnésie : le 1er janvier suivant, il était couronné basileus à Nicée par le patriarche, malgré
quelques opposants, en même temps que Théodora, son épouse, et le jeune Jean
IV ,
au salut duquel il s’était engagé à veiller par un serment solennel, mais qu’il
relégua dans un château du Bosphore. Arsène comprit alors qu’il avait été joué
et, de désespoir, se retira dans un monastère. Michel, considérant cette retraite
comme une démission, fit élire par le synode un nouveau patriarche, Nicéphore,
métropolite d’Éphèse, malgré l’opposition des archevêques de Sardes et de
Thessalonique .
Cependant les événements extérieurs avaient
déjà montré combien il était urgent que l’Empire fût tenu d’une main ferme. Il
n’y avait rien à craindre du côté de Constantinople où Baudouin Il se trouvait
dans le dénuement le plus complet. Après lui avoir fait demander la restitution
de Thessalonique, de la Macédoine et de la Thrace il fut trop heureux de signer
une trêve avec Michel (décembre 1258) . La menace venait de
l’Épire, dont le despote Michel II avait annexé la Macédoine jusqu’au Vardar et
formé une coalition contre l’État de Nicée avec Manfred et Guillaume de
Villehardouin, prince de Morée. Michel Paléologue essaya de négocier, mais le
despote repoussa ses propositions et Manfred emprisonna ses ambassadeurs. Avant
même son couronnement Michel nomma son frère Jean grand-domestique et lui
confia une armée qui pénétra en Macédoine, surprit les Épirotes à Vodéna et les
mit en fuite, puis s’empara d’Ochrida. Le despote d’Épire regroupa ses forces
et reçut les renforts amenés par le prince de Morée ainsi que des chevaliers
siciliens envoyés par Manfred mais les alliés subirent une déroute complète
devant Pelagonia (octobre 1259). Guillaume de Villehardouin y fut fait
prisonnier et Jean Paléologue occupa Arta, la capitale du despote, envahit la
Thessalie et pénétra en Grèce jusqu’à Thèbes . Peu après d’ailleurs,
avec des renforts envoyés par Manfred, Nicéphore, fils du despote, put reprendre
une partie du terrain perdu et faire prisonnier Alexis Stratégopoulos, qui fut
délivré à la suite d’un traité conclu entre Michel Paléologue et le despote
d’Épire (fin 1259-1260) .
A ce moment Michel Paléologue était tout
entier à ses préparatifs contre Constantinople. Tranquille du côté de l’Europe
il signa un traité avec les Mongols en abandonnant son allié le sultan
d’Iconium , et, afin d’associer
toutes les forces helléniques à la reprise de la ville impériale, il fit
alliance avec l’empereur de Trébizonde, Manuel Comnène . Puis au printemps de
1260 il passa l’Hellespont et s’avança jusqu’à Selymbria qu’il occupa, mais
Anseau de Toucy, fait prisonnier à Pelagonia et qu’il avait mis en liberté à
condition qu’il lui ouvrirait une porte de la ville, ne tint pas sa
promesse ; et Paléologue, après avoir conclu une trêve avec Baudouin,
regagna Nicée . Ce fut peu après qu’il
reçut à Nymphée une ambassade de Génois
qui venait lui proposer de l’aider à reprendre Constantinople moyennant
l’octroi de privilèges importants.
Chassés de toutes leurs positions à
Constantinople et dans l’Empire depuis 1204, les Génois s’étaient livrés à une
guerre de pirates contre les établissements vénitiens et n’avaient jamais voulu
reconnaître la légitimité de l’Empire latin . A Saint-Jean-d’Acre
les rixes étaient continuelles entre les quartiers génois et vénitiens et en
juin 1258, après avoir perdu une bataille navale, les Génois durent se réfugier
à Tyr . Cependant après de
laborieuses négociations le pape Alexandre IV avait fini par imposer son
arbitrage aux belligérants (avril 1259), mais son légat, envoyé à
Saint-Jean-d’Acre, ne put obtenir des Vénitiens l’accomplissement des
conditions prévues . Ce fut alors que les
Génois, désireux de prendre leur revanche sur Venise et lui porter un coup
mortel en la chassant de Constantinople, proposèrent leur alliance à Michel
Paléologue.
Le basileus, n’ayant pas une flotte
suffisante pour attaquer Constantinople par mer, accepta toutes les conditions
des Génois. Par le traité signé à Nymphée le 13 mars 1261, Michel VIII et Gênes
contractaient une alliance offensive et défensive contre Venise et Baudouin
II ; Gênes mettait sa flotte à la disposition de l’empereur, qui lui
accordait tous les avantages, privilèges, quartiers dont les Vénitiens
jouissaient à Constantinople, dans l’Archipel et la mer Noire, ainsi que la
liberté de commerce dans tout l’Empire . Les conséquences de ce
traité, qui remplaçait le monopole économique de Venise par celui de Gênes,
devaient peser d’un poids très lourd dans les destinées de Byzance.
Par une véritable ironie du sort, ni ce
traité désastreux, ni les autres dispositions de Michel VIII ne servirent à la
reprise de Constantinople et ce fut l’un des chefs de guerre les plus
médiocres, le César Alexis Stratégopoulos, qui, chargé de faire une
démonstration avec 800 hommes à la frontière bulgare, se détourna de sa route
pour observer la Ville Impériale et, à la suite d’une entente entre une de ses
patrouilles et des habitants, eut la gloire d’y pénétrer le 25 juillet 1261,
tandis que Baudouin II s’enfuyait dans une barque et que la flotte vénitienne,
qui se trouvait à l’entrée de la mer Noire, en revenait une fois l’événement
accompli . Le 15 août suivant,
Michel Paléologue faisait son entrée dans la ville reconquise et était couronné
de nouveau à Sainte-Sophie par Arsène, qu’il avait rappelé au patriarcat après
la mort de Nicéphore II . Après une interruption
de 57 ans, Constantinople redevenait la Nouvelle Rome, le siège de
l’Empire ; la tradition était renouée.
2. L’Œuvre de relèvement de Michel
Paléologue (1261-1282)
Michel Paléologue, maître de
Constantinople, ne pouvait songer à reconstituer l’Empire non seulement dans
son intégrité, mais même dans son étendue territoriale d’avant 1204. Il a du
moins réussi à consolider son pouvoir, à fonder une dynastie et à conserver
Constantinople en dépit des menaces des puissances ennemies, désireuses de
restaurer l’Empire latin à leur profit.
Son premier
soin fut de rétablir la ville impériale dans sa splendeur , d’en faire nettoyer
les rues laissées à l’abandon, d’en rebâtir les quartiers incendiés, de
l’enrichir de fondations nouvelles , d’y ramener la population
émigrée dans la banlieue, de distribuer à ses partisans les propriétés
abandonnées par les Vénitiens, d’installer les Génois dans leur nouveau
quartier et de mettre la ville en état de défense en faisant réparer les
murailles et construire une flotte de guerre .
Mais dans son désir de fortifier son
autorité, sentant très bien qu’il était encore considéré comme un usurpateur,
il n’hésita pas à commettre froidement un crime politique qui faillit
d’ailleurs lui coûter le trône : il fit aveugler et emprisonner le pauvre
enfant impérial, Jean Lascaris, héritier légitime du trône, et il eut la
cruauté de faire mutiler son secrétaire, Manuel Holobolos, pour le punir
d’avoir témoigné de la compassion à cette innocente victime . La sanction ne se fit
pas attendre : à cette nouvelle, le patriarche Arsène, saisi d’horreur et
de remords, prononça l’excommunication du basileus et il s’ensuivit un
conflit religieux des plus néfastes qui aboutit à la déposition d’Arsène, à son
exil à Proconnèse et à l’élection de Germain, archevêque d’Andrinople, au
patriarcat : un nouveau
schisme allait déchirer l’Église de Constantinople. Toute l’affaire avait été
conduite par le confesseur de Michel VIII, le moine Joseph, ignorant et entreprenant :
par ses intrigues il força Germain à abdiquer le patriarcat (14 septembre
1266), se fit élire à son tour et releva solennellement Michel de
l’anathème . Arsène n’en conserva
pas moins des partisans qui le considéraient comme le seul patriarche légitime .
La politique intérieure de Michel VIII fut
toute en faveur de la noblesse, par réaction contre les tendances démocratiques
de Vatatzès et de Théodore II et il s’attacha les grandes familles par des
unions matrimoniales avec les siens.
Comme autrefois les Comnènes et les Anges,
il eut soin de confier les postes importants à ses proches, et son frère Jean,
qu’il mit à la tête de ses armées, contribua par ses victoires à accroître son
prestige . En 1272 il associa au
trône son fils aîné, Andronic, âgé de 16 ans, et le maria à la fille d’Étienne
V, roi de Hongrie .
Parmi les difficultés que rencontra son
gouvernement, il faut noter les embarras d’argent dus aux dépenses énormes
qu’exigeait l’entretien de son armée et de sa diplomatie : il devait
laisser l’Empire complètement ruiné . Les Génois, d’autre
part, grâce aux privilèges qu’ils tenaient du traité de Nymphée, privaient
l’Empire des sources de richesse qui auraient pu rétablir sa prospérité. Ce fut
ainsi que Manuel Zaccaria obtint le monopole fructueux de l’exploitation de l’alun
à Phocée . Les Génois ne se montrèrent
même pas des alliés fidèles et furent convaincus d’avoir comploté en 1264 avec
Manfred pour livrer Constantinople aux Francs : après avoir essayé de se
rapprocher de Venise , qui hésitait à traiter
avec lui, Michel VIII finit par se réconcilier avec les Génois, mais leur enleva
le quartier qu’il leur avait attribué à l’intérieur de la ville, pour les
établir au-delà de la Corne d’Or au faubourg de Galata, préalablement
démantelé , événement qui devait
avoir une portée considérable : une ville étrangère s’installait ainsi aux
portes de Byzance.
Politique extérieure. — Pendant les 21
années de son règne à Constantinople, Michel VIII eut vraiment ce qu’on peut
appeler sans anachronisme une politique extérieure, répondant à deux idées directrices :
compléter la restauration de l’Empire en prenant pied dans toutes les régions
de la péninsule balkanique et en maintenant la paix avec les Mongols en Asie
Mineure ; mettre Constantinople à l’abri d’une croisade destinée à restaurer
l’Empire latin et, pour empêcher les papes de la proclamer, pratiquer une
politique d’union religieuse en obligeant le clergé grec à se départir de son
intransigeance vis-à-vis de Rome.
En fait toutes ces questions étaient
solidaires. Les rois de Sicile, Manfred, puis Charles d’Anjou, qui avaient des
visées sur Constantinople, cherchèrent à gagner l’appui des États balkaniques,
Épire, Serbie, Bulgarie et de la Morée, hostiles à Michel. De son côté, Michel
ne manqua pas d’exploiter les dissentiments entre les papes et la Sicile pour
faire triompher sa cause.
L’un de ses premiers succès fut le traité
qu’il força Guillaume de Villehardouin, son prisonnier depuis la bataille de
Pelagonia (1259), à signer avant sa libération (1262). Le prince de Morée
devenait vassal de l’Empire et lui cédait les trois forteresses importantes de
Mistra, Géraki et Monemvasia . L’Empire reprenait
pied en Grèce et le frère de Michel, le sébastocrator Constantin, chargé
d’administrer cette nouvelle colonie, établit sa résidence à Mistra . La conquête de ces
positions allait permettre d’éliminer la domination franque du Péloponnèse.
Pour Michel VIII, c’était un gage qui lui permettait de poursuivre des négociations
avec autorité.
Au moment de la reprise de Constantinople,
le Saint-Siège était vacant , mais l’un des premiers
actes du nouveau pape, Jacques Pantaléon, de Troyes, élu le 28 août sous le nom
d’Urbain IV, fut de préparer une nouvelle croisade de Romania et de déclarer nul le
traité conclu par Guillaume de Villehardouin avec le basileus . Devant ces menaces
Michel VIII essaya de se rapprocher de Manfred, mais, ses offres d’alliance
ayant été repoussées , il prit le parti de
s’adresser au pape et de lui demander d’établir la paix entre les Grecs et les
Latins . Or Urbain IV venait de
repousser une tentative de Baudouin II pour le réconcilier avec Manfred, dont
la participation à la croisade future semblait indispensable , et il venait d’offrir
le royaume de Sicile à Charles d’Anjou . Abandonnant provisoirement
le projet de croisade en Romania, il accueillit favorablement les ouvertures de
Michel VIII et une correspondance
active en vue de l’union des Églises s’établit entre Rome et Constantinople.
Ce ne fut pas sans quelques heurts. Tout en
protestant de son amour de la paix, Paléologue continuait à attaquer les États
latins, envoyait la flotte génoise dans l’Archipel et faisait assiéger par son
frère Constantin les places fortes du prince de Morée qui, oublieux de ses
serments, violait le traité de Constantinople . De là entre les deux
interlocuteurs des alternatives de ruptures et de rapprochements. Tantôt
l’accord semble fait, Urbain IV abandonne la cause de Baudouin II qui se
compromet avec Manfred, et il est prêt à garantir le trône de Michel s’il se soumet
à Rome (juillet 1263) ;
tantôt, s’il apprend une nouvelle agression des Grecs en Morée, il fait prêcher
la croisade contre Constantinople (mai 1264) . Enfin les troupes de
Michel ayant subi un gros désastre en Morée, il y eut une trêve de fait entre
les belligérants (printemps 1264) ; les pourparlers
reprirent avec Rome et l’union semblait probable quand Urbain IV mourut
le 2 octobre 1264.
Son successeur, Clément IV, ancien évêque
du Puy, élu seulement le 5 février 1265, était tout dévoué à Charles d’Anjou et
commença par l’investir du royaume de Sicile , Un an après, le 26
février 1266, devant Bénévent, Charles était vainqueur de Manfred qui périssait
dans la bataille . Ce fut vraisemblablement
alors que Michel VIII fit sa première démarche auprès de Clément IV, ainsi
qu’il ressort d’une lettre du pape au basileus , La disparition de
Manfred n’avait nullement amélioré la situation de Michel Paléologue. Le
nouveau roi de Sicile reprenait tous les plans du Hohenstaufen contre
Constantinople, avec des moyens beaucoup plus puissants et fort de l’appui du
pape. Il commençait par prendre à sa solde les chefs des troupes de Manfred
stationnées en Épire, s’alliait avec le prince de Morée et, par le traité de
Viterbe (27 mai 1267), il s’engageait à restaurer Baudouin II à Constantinople,
moyennant le tiers des conquêtes qu’il ferait en Romania .
Clément IV, qui semblait approuver les
projets de Charles d’Anjou (il ratifia le traité de Viterbe), en redoutait au
fond l’exécution et continua à correspondre avec Michel, mais, plus
intransigeant que son prédécesseur, et peut-être pour gagner du temps, il
refusait d’accorder la moindre garantie au basileus si celui-ci et tout le
clergé grec ne se soumettaient pas à l’Église romaine sans conditions , La situation était
d’autant plus menaçante que la défaite de Conradin à Tagliacozzo (23 août 1268)
avait achevé de renforcer la situation de Charles d’Anjou en Italie et que,
tout en équipant une grande flotte,il envoyait des troupes et de l’argent au
prince d’Achaïe .
Ce fut sur ces entrefaites que mourut
Clément IV (29 novembre 1268) et, par suite des divisions des cardinaux, la
vacance du Saint-Siège se prolongea pendant deux ans et neuf mois, jusqu’au 1er septembre 1271 . C’était pour Michel
Paléologue le début d’une période critique. Charles d’Anjou, n’étant plus
retenu par l’autorité d’un pape, pouvait donner libre cours à ses desseins et
pousser ses préparatifs. Cependant Venise, qui venait de conclure un traité
avec Michel VIII , refusait de participer
à l’expédition. Malgré cet échec, Charles voulait entrer en campagne au
printemps de 1270 . Dans ces conjonctures,
Michel Paléologue ne trouva rien de mieux que de s’adresser à saint Louis,
comme au véritable chef de la chrétienté en l’absence d’un pape et d’un
empereur : il échangea avec le roi de France deux ambassades (printemps
1269, début 1270) en lui demandant d’arrêter les entreprises de son frère
contre l’Empire byzantin au moment où le basileus, son clergé et son peuple
étaient prêts à rentrer dans la communion de Rome . Saint Louis renvoya la
question religieuse au collège des cardinaux, qui reproduisirent dans leur
réponse à Michel la plupart des conditions exigées par Clément IV, mais il arrêta
l’expédition de Charles d’Anjou contre Constantinople en l’entraînant à la
croisade de Tunisie : ce fut au camp
de Carthage que, quelques heures avant sa mort, saint Louis reçut la deuxième
ambassade de Paléologue, dirigée par le futur patriarche Jean Veccos .
Accomplissement de l’Union (1271-1276). — Après la mort
de saint Louis et son retour de Tunisie, Charles d’Anjou reprit ses plans de
conquête de l’Orient, scella son alliance avec le prince d’Achaïe en mariant un
de ses fils à Isabelle de Villehardouin et en lui envoyant de nouvelles troupes
qui infligèrent des défaites aux Grecs , mais il allait encore
être arrêté sur la route de Byzance, et cette fois ce fut par le pape. Élu à ta
papauté le 1er septembre 1271, alors qu’il se trouvait à
Saint-Jean-d’Acre, Theodebaldo Visconti, qui prit le nom de Grégoire X, était
résolument opposé aux projets de Charles d’Anjou et à la croisade de Romania
qu’il regardait comme des obstacles à la véritable croisade en Terre Sainte,
dont la réussite d’autre part ne pouvait être assurée que par la réconciliation
des Églises .
Cependant Charles d’Anjou accentuait ses
menaces contre Constantinople en étendant son influence dans la péninsule
balkanique, chez les Albanais, qui le proclamaient roi ainsi que son fils, en
Morée où il envoyait Philippe de Toucy avec un corps de chevaliers et de
Sarrasins de Lucera, en Thessalie où il s’alliait avec le prince Jean l’Ange,
bâtard de Michel II d’Épire, qui s’était rendu indépendant, et jusqu’en Serbie
et en Bulgarie (1272-1273) . De son côté Michel
VIII faisait alliance avec Alphonse X, roi de Castille, candidat à l’Empire
d’Occident et ennemi de Charles d’Anjou, contre lequel il soutenait les
Gibelins de Lombardie avec le roi Étienne de
Hongrie, dont la fille épousait l’héritier du trône byzantin , et il se réconciliait avec
les Génois, qui promettaient de s’opposer à toute hostilité contre
l’Empire .
Mais plus efficace que ces alliances fut
l’action du pape Grégoire X. Avant même d’avoir quitté la Palestine, il avait
écrit à Michel VIII pour lui faire part de son désir d’union et, après son retour en
Italie, il envoya à Constantinople quatre franciscains chargés de promettre au
basileus la protection du pape s’il réalisait l’union . Dès lors des rapports
empreints de cordialité s’établirent entre le basileus et le pape . Tous deux avaient la
volonté ferme d’atteindre le but. Au lieu du programme radical de Clément IV,
Grégoire X n’exigeait du clergé grec que la reconnaissance de la primauté du
pape en droit et en fait, la promesse d’union et la commémoration du pape dans
la liturgie. Michel VIII se livra à une propagande active pour démontrer au
clergé que ces concessions étaient peu de chose au prix du salut de Constantinople,
mais dès le début de sa campagne il se heurta à une opposition irréductible,
bien que modérée dans la forme . Cependant il n’hésita
pas à passer outre et fit savoir au pape, par deux des frères mineurs qu’il lui
avait envoyés, que, malgré les difficultés qu’il avait rencontrées, le clergé
était près d’accepter l’union : il lui demandait aussi de garantir la
sécurité des ambassadeurs qu’il enverrait au concile .
C’était du bon vouloir de Charles d’Anjou
et de ses alliés que dépendaient les garanties demandées. Le pape se chargea de
cette délicate négociation et, sur ses objurgations, Charles accorda les
sauf-conduits demandés (7 janvier et 1er mai 1274) .
Rien ne s’opposait plus à l’union. A
Constantinople le basileus continuait sa propagande et remportait une véritable
victoire en gagnant à sa cause le théologien Jean Veccos, jusque-là hostile à
tout rapprochement avec Rome , tandis que le
patriarche Joseph, malgré son attachement au basileus, restait
irréductible . Les Grecs ne devaient
participer au concile œcuménique convoqué à Lyon que par une ambassade qui
avait à sa tête l’ex-patriarche Germain, le grand logothète Georges Acropolites
et Théophane, métropolite de Nicée. Ces envoyés apportaient au pape une lettre
de l’empereur reconnaissant en tout la doctrine romaine et un acte du clergé,
qui se bornait aux concessions exigées par Grégoire X. Après la lecture de ces
lettres, l’union des Églises fut proclamée par le pape à la 4e session du concile, le 6 juillet 1274 .
Le rêve des papes depuis deux
siècles : la fin du schisme et la réunion pacifique de l’Église grecque à
l’Église romaine, était ainsi réalisé, mais cet accord était peu solide, dû aux
préoccupations purement politiques de Michel VIII, qui avait extorqué de force
les adhésions du clergé grec et avait contre lui jusqu’à ses proches parents.
Comme le fait remarquer le père Jugie, il n’y eut au concile que deux évêques
grecs et l’union fut conclue « sans préparation psychologique, sans
discussion théologique sur les points en litige » . On ne devait pas
tarder à s’apercevoir que la force ne sert à rien dans ces matières, mais qu’il
y faut d’abord l’adhésion des âmes.
Les résultats immédiats du concile furent,
d’une part, la signature d’une trêve entre Charles d’Anjou et Michel VIII , d’autre part
l’abdication du patriarche Joseph (11 janvier 1275), cinq jours plus tard la
reconnaissance solennelle de l’union, mais à la chapelle du palais
impérial , enfin l’élection de
Jean Veccos au patriarcat (26 mai) Très influent à la
cour, Veccos se fit le défenseur de l’union, mais se heurta à une opposition
farouche dirigée par des érudits comme Grégoire de Chypre, par la propre sœur
du basileus, Eulogia, et par des princes du sang, que Michel n’hésita pas à
emprisonner . Un concile
anti-unioniste dirigé contre Paléologue et Veccos fut tenu en Thessalie .
Jusqu’à la fin de sa vie Grégoire X
continua à avoir des relations fréquentes avec Michel VIII qu’il entretenait
d’un projet de croisade, aussi avantageux pour l’Empire que pour la Terre
Sainte, puisqu’il prévoyait d’abord l’expulsion des Turcs de l’Asie
Mineure . Le pape avait décidé
de prendre lui-même le commandement de l’expédition lorsqu’il mourut le 6
janvier 1276.
Cette mort porta à la cause de l’Union un
coup sensible, car les premiers successeurs de Grégoire X, dont le règne dura
peu (trois papes en deux ans, janvier 1276 - mai 1277), élus sous l’influence
de Charles d’Anjou, témoignèrent leur hostilité aux Grecs et, mal renseignés
sur leurs aspirations, rendirent impossible par leurs exigences la tâche de
Michel VIII et de Veccos , qui continuèrent cependant
à montrer leur respect pour le Saint-Siège et saisirent toutes les occasions de
manifester leur accord avec lui, tout en cherchant à obtenir de lui le maintien
des rites propres à l’Église grecque, auxquels le clergé et les fidèles
tenaient surtout . Le pape exigeant que
l’empereur, son fils, le patriarche et tous les clercs jurent personnellement
l’union, une nouvelle cérémonie venait d’avoir lieu à cet effet à
Sainte-Sophie , mais le mécontentement
était général et c’était en vain que jean Veccos tenait un synode qui excommuniait
ses adversaires .
Bien qu’opposé aux projets ambitieux de
Charles d’Anjou, à qui il défendit d’attaquer Constantinople, Nicolas III, élu
à la papauté le 25 novembre 1277, était décidé à obtenir la soumission complète
de l’Église grecque et déclara insuffisantes et incomplètes les professions de
foi envoyées à son prédécesseur . Au moment de l’arrivée
de ses envoyés à Constantinople, Veccos, à la suite d’accusations calomnieuses
et brouillé avec l’empereur, avait abdiqué le patriarcat : Michel
embarrassé organisa une vraie comédie pour empêcher les envoyés du pape de
s’apercevoir de cette disgrâce du principal défenseur de l’union et, pour montrer son
bon vouloir, leur fit visiter les prisons où étaient détenus des princes qui
avaient manifesté leur opposition , Dans sa réponse à
Nicolas III le basileus montra que, s’il succombait dans la lutte contre ses
adversaires, c’en était fait de l’union et le pape, touché par
ces arguments, se porta comme médiateur entre Charles d’Anjou, son gendre
Philippe de Tarente, fils de Baudouin II, et Michel VIII . Au même moment le
basileus se mettait en rapport, par l’intermédiaire de Jean de Procida, avec le
roi d’Aragon Pierre III, époux de Constance, fille de Manfred , dont il revendiquait
l’héritage sicilien, et le pape autorisait l’Aragonais à détrôner Charles
d’Anjou .
Mais après la mort de Nicolas III (22 août
1280), Charles d’Anjou lui fit donner comme successeur un de ses plus dévoués
partisans, le cardinal français Simon de Brie (Martin IV, 21 février 1281).
Tous les efforts de Michel VIII pour maintenir l’union devenaient
stériles : pour obéir à Nicolas III, il s’était mis ses sujets à dos et
s’était érigé en tyran cruel, allant jusqu’à faire crever les yeux à de hauts
dignitaires récalcitrants et remplissant la ville d’espions qui épiaient les
conversations . Tous ses plans
s’effondraient en même temps. Les ambassadeurs qu’il avait envoyés à Nicolas
III peu avant sa mort étaient capturés par un capitaine de Charles d’Anjou et
paraissaient en prisonniers devant Martin IV, qui leur reprochait la duplicité
de leurs compatriotes et excommuniait Michel Paléologue .
Fort heureusement pour le basileus, les
récentes entreprises de Charles d’Anjou dans la péninsule balkanique avaient
échoué. En octobre 1278 il avait occupé l’Achaïe, comme baile de sa bru
Isabelle, veuve de son fils Philippe et héritière de son père Guillaume de
Villehardouin, mort le 1er mai précédent. Il y envoya des troupes,
mais cette occupation lui donna plus de soucis que d’avantages par suite des
attaques continuelles de la garnison grecque de Mistra . Plus menaçante avait
été l’expédition confiée par Charles à son capitaine-général en Illyrie, Hugue
de Sully, qui, parti de Durazzo, pénétra en Albanie, assiégea Bérat, mais fut
fait prisonnier le 3 avril 1281 et amené en triomphe à Constantinople .
L’élection de Martin IV semblait permettre
au roi de Sicile de prendre sa revanche et d’exécuter enfin son grand dessein.
Par l’entremise du pape une coalition fut formée contre Michel Paléologue par
Charles d’Anjou, Philippe de Tarente et la république de Venise (traités
d’Orvieto, 3 juillet 1281). L’expédition, dont le départ fut fixe en avril
1283, serait une croisade destinée à restaurer l’Empire latin et à conquérir la
Terre Sainte . Mais Michel Paléologue
et son allié le roi d’Aragon mirent à profit le délai qui leur était laissé par
les coalisés et après la tragédie des Vêpres Siciliennes (21 mars 1282) tous
les espoirs de Charles d’Anjou et de Martin IV s’effondraient : Pierre III
débarquait en Sicile et était proclamé roi à Palerme (août 1282). Loin de
pouvoir attaquer Constantinople, Charles d’Anjou n’aurait pas trop de toutes
ses forces pour défendre l’existence de son royaume .
Lorsque Michel Paléologue mourut quelques mois
plus tard , malgré les obstacles
semés sur sa route il avait atteint son but il laissait à son successeur
Constantinople à l’abri d’une croisade occidentale.
L’action politique dans la péninsule des
Balkans.
— Obligé à une défensive perpétuelle, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur,
Michel VIII n’a pu avoir dans les Balkans une politique territoriale vraiment
cohérente. Après avoir cherché à faire le plus d’annexions possible, il a perdu
l’initiative des opérations pour se livrer uniquement à des contre-attaques et,
pour empêcher les chefs des États balkaniques de se mettre au service de ses
adversaires d’Occident, il eut souvent recours à la politique matrimoniale.
Sans pouvoir recouvrer de vastes
territoires, il s’empara de positions importantes, amorces d’agrandissements
futurs, comme les forteresses de Mistra, Géraki, Monemvasia, arrachées en 1262
à Guillaume de Villehardouin qui ne put jamais les reprendre. De même il
s’établit dans l’île d’Eubée, conquise, sauf Nègrepont, la capitale, par
Licario de Vérone qu’il avait pris à son service , mais ce fut surtout
aux dépens du despotat d’Épire et de l’État vlacho-bulgare qu’il chercha à
agrandir ses domaines.
Le tsar bulgare Constantin Asên, marié à
une fille de Théodore II Lascaris, ne pouvait être favorable à Michel Paléologue
et ce fut justement le corps d’armée chargé de s’opposer à son agression
possible qui entra à Constantinople par surprise en 1261 . Après cette victoire
le basileus n’eut aucun scrupule à élargir ses frontières au nord du Rhodope en
territoire bulgare jusqu’à la plaine de Sofia (1263), mais il se heurta à
l’armée hongroise d’Étienne V, dont l’ambition était d’établir sa suzeraineté
sur les États slaves des Balkans et il dut battre en
retraite. Abandonnant la sphère d’influence hongroise, Michel VIII, après avoir
repris Philippopoli, tourna ses efforts vers l’est et s’empara des ports
d’Anchiale et de Mesembria. Le tsar n’hésita pas à faire appel à son allié,
Nogaï, Khan du Kiptchak . Une horde de Tartares
envahit la Thrace et infligea à Michel Paléologue le plus gros désastre qu’il
ait jamais subi, mais se contenta de piller la région sans attaquer
Constantinople (1265) .
L’empereur sauva la situation par sa
diplomatie cauteleuse. Il offrit la main de sa fille Marie au tsar devenu veuf
d’Irène Lascaris, avec les villes de la mer Noire qu’il avait prises, en dot,
puis, le mariage accompli, refusa de s’en dessaisir en invoquant le désir de
leurs habitants de rester Grecs . Constantin Asên
furieux appela encore les Mongols, mais dans l’intervalle Michel VIII avait
fait alliance avec Nogaï en lui donnant une de ses bâtardes en mariage et cette
fois ce furent les Tartares qui défendirent la Thrace contre les Bulgares .
A la suite d’un accident, Constantin Asên
dut confier la régence à Marie Paléologue, au grand mécontentement des boyards
et des paysans, qui se soulevèrent et proclamèrent tsar le porcher Ivailo
(1277) . Ce fut là le point de
départ d’une série de tragédies et de guerres civiles que Michel VIII essaya
d’exploiter pour placer la Bulgarie sous son influence en opposant à Ivailo un
prétendant au trône bulgare dont il avait fait son gendre et qui se rattachait
par sa mère à la dynastie asênide. Ce Jean Asên III fut reconnu comme tsar à
Tirnovo en 1279, mais ne put s’y maintenir. Ivailo, qui l’en avait chassé avec
l’appui des Mongols, fut lui-même renversé par un Coman, Georges Terter (fin de
1280), dont le premier acte fut de s’allier à Charles d’Anjou contre
Paléologue .
Vis-à-vis de l’État serbe, en train de
prendre dans les Balkans la place prépondérante que perdait la Bulgarie, la
politique de Michel VIII fut encore plus malheureuse. Le roi Étienne Ourosch Ier avait épousé une princesse latine, Hélène d’Anjou : pour
contrebalancer son influence, le basileus chercha à marier une de ses filles au
prince Miloutine, mais les ambassadeurs envoyés en Serbie pour conclure l’union
furent tellement choqués de la simplicité toute patriarcale de la cour serbe
que, sur leur rapport, le projet fut abandonné . Ce fut une faute
grave : Étienne Miloutine, l’un des plus grands rois de Serbie, épousa la
fille du grand ennemi de Paléologue qu’était Jean l’Ange et, du vivant même de
Michel VIII, préluda aux conquêtes qu’il devait faire aux dépens de l’Empire en
s’emparant de Skoplje et en pénétrant jusqu’à Serres (1282) .
La politique orientale. — Tous ses
efforts tendus vers l’Occident empêchèrent Michel Paléologue d’avoir une
politique active dans le monde oriental en voie de transformation profonde. Ses
deux puissances prédominantes étaient celle des Mamlouks d’Égypte, qui avaient
renversé le dernier sultan ayoubide en 1250 , et celle des Mongols
de Perse gouvernés par le frère du grand Khan Mongka, Houlagou, qui s’était
emparé de Bagdad en 1258 et avait supprimé le califat abbasside ; en Asie Mineure
son domaine comprenait la plus grande partie du sultanat de Roum et le roi de
Petite Arménie Héthoum Ier était son vassal. Dès son avènement,
Michel Paléologue s’était empressé de conclure un traité de paix avec ce
puissant souverain en le laissant attaquer librement les Turcs d’Asie
Mineure .
Mais tandis que Houlagou, ennemi de
l’islam, dont il avait détruit la plus vénérable institution, favorisait les
chrétiens , le sultan des
Mamlouks, Bibars l’Arbalétrier (1260-1277) était au contraire le champion du
monde musulman . Or, par leur foi et
par leur origine même (ils se recrutaient en partie chez les peuplades turques
de la Russie méridionale), les Mamlouks étaient en relations constantes avec
l’État mongol du Kiptchak, dont les Khans et leurs sujets s’étaient convertis à
l’islam . Séparés par les États
de Houlagou, l’Égypte et le Kiptchak cherchèrent à obtenir de Michel Paléologue
le libre passage des détroits qui leur permettait de communiquer par mer.
Sollicité à cet effet par Bibars, Michel semble s’être d’abord dérobé , mais, obligé de
ménager le Khan de Kiptchak, qui, ainsi qu’on l’a vu, avait envoyé ses troupes
au secours de Constantin Asên, attachant d’autre part une grande importance à
conserver de bonnes relations avec l’Égypte, menacée comme Constantinople d’une
croisade occidentale, il n’hésita pas à abandonner l’alliance de Houlagou. Ce
fut pour cette raison qu’il se lia avec le Khan Nogaï en lui donnant en mariage
une de ses bâtardes et c’est ce qui explique les échanges de lettres et d’ambassades
entre Bibars et lui .
En 10 ans en effet (1262-1272) on ne compte
pas moins de huit ambassades byzantines en Égypte. Celle de 1262 répondant à
une demande du sultan lui accorde le libre passage des esclaves achetés en
Russie, destinés au recrutement des Mamlouks, et lui demande l’installation
d’un patriarche melchite à Alexandrie . Dès 1263 les envoyés
de Bibars et du Kiptchak traversent Constantinople et Michel VIII fait
intervenir le sultan auprès de son allié tartare pour faire cesser les attaques
du Kiptchak contre l’Empire . En 1268 Bibars venait
de s’emparer d’Antioche et il ne restait plus aux Francs que Tripoli, Acre et
Sidon. Des traités reliaient Constantinople au Kiptchak et à l’Égypte, triple
alliance dirigée contre l’Occident, grossie probablement vers 1275 du concours
de l’Aragon .
Ces relations cessèrent à peu près pendant
le pontificat de Grégoire X, au moment où l’union des Églises était négociée et
où Michel VIII songeait à une croisade byzantine, mais elles reprirent dès l’été
de 1275 , et Kelaoun successeur
de Bibars (1277) renouvela le traité d’alliance avec Constantinople en y
ajoutant une clause d’assistance navale contre les entreprises de Charles
d’Anjou .
Ainsi, jusque dans ses rapports avec les
puissances orientales, c’est le souci de parer à une attaque de l’Occident qui
commande toute la politique de Michel Paléologue.
Et c’est la raison pour laquelle il a
négligé la question d’Asie Mineure, le sultanat de Roum n’étant plus un danger
pour l’Empire et Michel ne disposant pas de forces suffisantes pour le
conquérir. D’ailleurs, depuis près de deux siècles que les Turcs étaient venus
dans la péninsule d’Anatolie, ils en avaient non seulement fait la conquête
politique, mais ils avaient pris possession de son sol : le pâtre turcoman
en avait chassé le paysan grec . Dans les villes les
Seldjoukides avaient abandonné leur grossièreté primitive et créé un art et une
littérature : le persan était la langue officielle des sultans et, dans l’art, la
tradition sassanide se mélangeait d’éléments hellénistiques et arméniens . C’est dire que même si
les empereurs byzantins avaient pu réoccuper l’Anatolie, ils se seraient
trouvés devant une population inassimilable, l’hellénisme ne s’étant maintenu
que dans l’État de Trébizonde, en Bithynie et sur les côtes de l’Archipel
tandis que la Cilicie était devenue une colonie arménienne. Bien plus,
l’invasion mongole, par le déplacement des peuples qui fuyaient éperdument à
son approche, eut pour résultat de renforcer l’élément turc en Asie Mineure.
C’est de cette époque que date la formation d’émirats indépendants comme celui
de Karaman qui s’empara d’Iconium en 1278 . Au même moment une
tribu obscure, les Keï-Kan-Kli, originaire du Khorassan, dont elle avait été
chassée par l’invasion mongole, atteignait le sultanat de Roum et se mettait au
service du sultan Alaeddin, qui l’établit entre Kutayeh et Brousse, à Sougyout,
sous le commandement de leur chef Ertoghroul et ce fut ainsi que les
Ottomans entrèrent dans l’histoire.
Devant ces bouleversements ethniques qui
mettaient en péril non seulement l’État byzantin, mais l’avenir de l’hellénisme
et du christianisme dans ces régions, la politique de Michel Paléologue fut mesquine
et incohérente. Il ne sut même pas préserver du démembrement les territoires
recouvrés par les empereurs de Nicée. Il crut avoir fait un coup de maître en
accueillant à bras ouvert l’un des héritiers du sultanat de Roum, Azz-ed-dîn,
dépossédé de son apanage par les Mongols et en traitant à son
insu avec Houlagou, à qui il promit de le retenir sa vie durant à
Constantinople. Mis au courant de cette trahison, Azz-ed-dîn s’allia au tsar
bulgare Constantin et aux Mongols du Kiptchak en guerre contre Michel, leur
communiqua des renseignements militaires et s’échappa après la défaite de
l’empereur (1265) .
Ne pouvant intervenir efficacement en Asie
Mineure, Michel VIII pouvait au moins organiser la défense des frontières . Il fit tout le
contraire : par mesure fiscale il supprima les privilèges des akritai, colons établis par les
empereurs de Nicée à charge de la défense du territoire , Les conséquences de
cette mesure ne se firent pas attendre. N’étant plus défendues, les provinces
impériales furent envahies périodiquement par des hordes d’irréguliers Turcs et
Mongols qui massacraient les habitants des villages et ravageaient leurs cultures.
La riche vallée du Méandre fut changée en désert et, de Constantinople, on ne
pouvait plus communiquer que par mer avec les ports de la mer Noire .
Entre-temps Michel VIII envoya des
expéditions : en 1264-1265 Jean Paléologue réussit à chasser les
envahisseurs, mais dut acheter leur tranquillité en leur cédant des
territoires . La vallée du Méandre
et la Carie furent encore saccagées en 1281 : Michel VIII envoya en Asie
avec une armée son fils Andronic, qui, après avoir dégagé la frontière, rebâtit
somptueusement la ville de Tralles entièrement ruinée et lui donna son nom,
Andronicopolis , mais il la laissa mal
fortifiée et sans eau potable. Les Turcs vinrent l’assiéger et la prirent
d’assaut, sans que le prince, qui était à Nymphée, soit venu à son secours et
la campagne se termina par un traité désastreux qui reculait de nouveau la
frontière . Tralles, connue
désormais sous le vocable d’Aïdin, devint le siège d’un émir turc indépendant
qui devait être l’un des plus dangereux ennemis de Byzance .
Le seul succès remporté par Michel VIII en
Asie Mineure. fut son alliance avec Jean II Comnène, empereur de Trébizonde,
qui, après des négociations compliquées, entourées de difficultés protocolaires
(1281-1282), vint en personne à Constantinople épouser une fille de
Paléologue . Cette alliance des
deux États byzantins avait son prix, mais était peu de chose à côté de la perte
irrémissible de la plus grande partie de l’Asie Mineure. La péninsule
anatolique, traversée par les voies terrestres qui mènent en Orient et dont les
côtes commandent les voies maritimes, était nécessaire à la grandeur de Byzance :
l’Empire restauré par Michel Paléologue devait toujours souffrir de n’avoir pu
la recouvrer.
3. La crise de l’Empire restauré (1282-1321)
Michel Paléologue avait réussi à maintenir
le siège de l’Empire à Constantinople, mais les difficultés auxquelles il avait
dû faire face l’avaient obligé à pratiquer une politique de grand style, qu’on
a pu comparer à celle d’un Manuel Comnène, embrassant le monde chrétien tout
entier , appuyant les
négociations d’actions militaires, exigeant des armées importantes, des flottes
de guerre et un nombreux personnel de diplomates.
Cette obligation de rester toujours sur la
défensive empêcha Michel VIII de poursuivre l’œuvre de restauration
territoriale commencée au début de son règne. D’autre part sa grande politique
épuisa les ressources des territoires mal reliés entre eux qui composaient
l’Empire. Il légua à son successeur un État complètement ruiné et troublé par
les discussions religieuses.
C’est cette situation qui explique la crise
redoutable que subit l’Empire au lendemain de sa restauration, sous le long
règne d’Andronic II (1282-1328). La tâche de relèvement qu’il entreprit était
trop lourde pour ses épaules et il ne put même pas conserver les résultats
acquis. Au moment où la croisade contre Constantinople semblait écartée, de nouveaux
périls menaçaient l’Empire : des États jeunes et remplis d’ambitions se
constituaient sur ses frontières, en Europe l’État serbe qui cherchait à
atteindre la mer Égée et visait Thessalonique, en Asie de puissants émirats
turcs et bientôt, hors de pair, l’État ottoman.
Alors que des ressources considérables
étaient nécessaires pour conjurer ces dangers, l’Empire se trouva diminué par
la détresse financière, incapable de lever des armées suffisantes ou d’équiper
des flottes, réduit au rang d’État secondaire, d’État passif, que Venise et
Gênes considéraient comme un territoire de colonisation commerciale qu’elles se
disputaient âprement. Comme l’a fait remarquer Ostrogorsky, ce fut à cette
situation et non au caractère personnel des empereurs que fut due la décadence
de l’Empire . Andronic II, dont on a
exagéré l’incapacité, a commis sans doute de grosses fautes, mais a lutté pour
améliorer le régime intérieur et montré souvent de la fermeté. Très cultivé, il
encouragea les lettres et les sciences et fonda une académie qui fait déjà
songer à celles de la Renaissance italienne . Ses réformes
judiciaires et financières furent parfois heureuses et lui survécurent, mais
les maux qu’il fallait guérir dépassaient les moyens dont il disposait :
son père lui avait légué une terre trop petite pour l’œuvre grandiose qu’il eût
fallu accomplir.
Pendant la première partie de son règne
Andronic eut une politique personnelle et systématique qui prit en tout le
contrepied de celle de Michel Paléologue (1282-1302) : répudiation de
l’Union, effort dirigé vers l’Orient, alliance avec les villes italiennes.
Cette politique eût pu réussir avec des ressources plus grandes : en fait
elle aboutit à des troubles religieux et à des revers à l’extérieur ; elle
laissa l’Empire aux abois.
A partir de 1302 au contraire, Andronic n’a
plus une politique définie. Il est réduit aux expédients ; l’Empire est à
la merci des Catalans et des Italiens. C’est à ce moment que du trouble et du
désordre intérieur naît la guerre civile.
L’union religieuse répudiée. — La croisade
occidentale étant écartée, Andronic, poussé d’ailleurs par ses proches, par son
entourage et par la majorité du clergé , sans qu’il soit
nécessaire d’admettre qu’il eût fait aux moines avant son avènement les
promesses précises que lui prête Guillaume d’Adam , inaugura son règne par
des mesures nettement anti-unionistes : l’inhumation nocturne et sans
cérémonie du corps de son père dans un monastère voisin de la petite ville de
Thrace où il était mort (Il décembre 1282) , l’éloignement du patriarche
Veccos (25 décembre) , la restauration
triomphale de Joseph, suivie de représailles contre les unionistes (30
décembre) , se succédèrent en quelques
jours, mais ne suffirent pas à assouvir la haine de leurs ennemis. Contre le
gré du basileus qui estimait Veccos, le patriarche de l’union dut comparaître devant
un concile et signer son abdication, puis fut exilé à Brousse (début de
1283) . Après avoir été cité
devant un nouveau synode où il confondit ses adversaires , il partit pour un nouvel
exil et y mourut en 1293 .
Ces mesures ne ramenèrent même pas le calme
dans l’Église, toujours troublée par le schisme arsénite qui durait depuis la
déposition d’Arsène en 1266. Arsène était mort en 1273, mais ses partisans
continuaient à former une petite Église qui refusait de communier avec ses
successeurs au patriarcat . Joseph étant mort
(mars 1283) et remplacé par un laïc érudit, fougueux adversaire de l’union, Grégoire
de Chypre , il s’ensuivit une
nouvelle agitation des Arsénites qui prétendirent faire condamner la mémoire de
Joseph et que les concessions de l’empereur, qui les ménageait, ne purent faire
renoncer à leur intransigeance . La translation en
grande pompe et en présence d’Andronic du corps d’Arsène à Constantinople ne
contribua pas peu à surexciter les esprits . Lorsqu’après
l’abdication de Grégoire (1289), Andronic fit une nouvelle tentative pour faire
cesser leur schisme, ils émirent des prétentions si extravagantes qu’ils
finirent par lasser la longanimité du basileus .
Ce fut en vain que le moine Athanase,
successeur de Grégoire de Chypre , essaya de rétablir la
discipline dans l’Église : sa sévérité pour les clercs de tout ordre
souleva des tempêtes et malgré son caractère énergique, mal soutenu par le basileus,
il dut abdiquer une première fois en 1293, fut rappelé au patriarcat en 1304 et
se retira définitivement en 1310 . Le désordre qui
continua à régner dans l’Église devait contribuer à affaiblir l’autorité
impériale et à troubler l’ordre dans l’État.
Contre cette
politique antiromaine il n’y eut aucune réaction des papes, préoccupés surtout
de la perte de la Terre Sainte et de leur lutte contre
les puissances temporelles. Cependant les projets de croisade contre Constantinople
n’étaient pas abandonnés. Baudouin II était mort en 1273 ; mais ses droits
étaient reportés sur la tête de sa petite-fille Catherine de Courtenai, qui
résidait à Naples. Andronic demanda sa main pour son fils aîné Michel, pensant
ainsi écarter toute tentative de croisade par cette réconciliation des deux dynasties
rivales sans avoir recours à l’union religieuse, mais les négociations qui
durèrent de 1288 à 1296 échouèrent et ce fut Philippe le
Bel qui obtint la main de Catherine de Courtenai pour son frère Charles de
Valois (1301) . Ce n’était pas de ce
côté qu’était le danger, car la plupart des projets de croisade élaborés à
cette époque déconseillaient le passage par Constantinople . Seul Guillaume d’Adam
préconisait la conquête préalable de l’Empire byzantin avant toute expédition
en Palestine .
Gouvernement intérieur. — Agé de 24 ans
à son avènement, Andronic II avait eu deux fils, Michel et Constantin, de sa
première femme, Anne de Hongrie, et il venait d’épouser en secondes noces
Yolande de Montferrat, descendante des rois latins de Thessalonique, qui prit
le nom d’Irène. Elle devait lui donner trois fils et une fille et, très
ambitieuse, détestant les enfants du premier lit, elle chercha à faire
constituer pour ses fils de vastes apanages. Lassé de ses récriminations
continuelles, le basileus finit pas la délaisser et elle se réfugia à
Thessalonique où elle ne cessa d’intriguer . Andronic ne fut pas
plus heureux avec son frère Constantin dont le train magnifique et l’orgueil
lui déplaisaient et, l’ayant convaincu de complot en 1291, il le condamna à la
confiscation des biens .
Préoccupé de l’avenir de sa dynastie, il
fit reconnaître la légitimité de son pouvoir par le malheureux Jean Lascaris,
fils de Théodore II, toujours enfermé dans une forteresse de Bithynie , et il associa au trône
Michel, son fils aîné, de son premier mariage, couronné à Sainte-Sophie le 21
mai 1295 ; le lendemain il créait despote Jean, l’aîné des fils que lui
avait donnés Irène .
De tempérament robuste, très religieux,
esprit subtil, mais caractère mesquin, rempli d’incertitude, tel nous apparaît
Andronic, incapable de réagir contre les influences qu’il subissait, celle de
son ministre favori, le grand-logothète Théodore Muzalon, qui l’engagea dans
les querelles religieuses , celle de son père
spirituel Andronic, évêque de Sardes, qu’il laissa accabler de mauvais
traitements les évêques unionistes , et, plus tard, celle
de Théodore Métochitès qui le brouilla avec son petit-fils. On s’explique que,
dans un État aussi troublé que celui de Byzance à cette époque, Andronic n’ait
pas eu une autorité suffisante pour ramener l’ordre et la prospérité. Il fut
surtout un velléitaire, n’ignorait pas les maux de l’Empire et s’efforçait d’y
remédier par des réformes parfois bien conçues, comme sa réforme
judiciaire , mais il ne tenait pas
suffisamment la main à leur application et elles n’apportaient aucune
amélioration. Il fut surtout incapable de lutter contre la détresse financière
qui ne fit que s’accroître par suite de dépenses inconsidérées, comme celles de
l’impératrice Irène . Les moyens qu’il
employa pour trouver des ressources furent désastreux : emprunts ruineux,
lourds impôts sur les céréales, altération des monnaies, diminution des gages
des officiers du Palais, droit du dixième sur les pensions, il eut recours à
tous les expédients, qui amassèrent des mécontentements, suscitèrent des
révoltes et ne firent qu’aggraver la pénurie du trésor. Mais de toutes les
mesures qu’il prit, la plus néfaste fut la suppression de la marine de guerre,
le licenciement des équipages et la mise au rebut des galères : l’Empire ne
serait plus défendu que par des corsaires et par la flotte génoise ; ses
destinées étaient désormais à la merci des républiques italiennes.
Or les deux
principales puissances maritimes, Gênes et Venise, éternelles ennemies l’une de
l’autre, se disputaient âprement la prépondérance économique à Constantinople
et dans tout l’Orient . Michel Paléologue
avait su tenir la balance égale entre elles : Andronic favorisa
exclusivement les Génois et, lorsque la guerre éclata entre les deux
républiques, Constantinople se trouva exposée aux représailles des Vénitiens et
fut mal défendue par ses alliés génois .
Cette guerre qui dura près de 6 ans
(1293-1299) eut pour origine les rixes continuelles entre capitaines génois et
vénitiens, mais, comme l’a montré Bratianu, sa véritable cause est la rivalité
des deux puissances dans la mer Noire, où Gênes avait hérité des anciennes
positions de Byzance et fondé la colonie prospère de Caffa et où Venise
cherchait à s’introduire, grâce à son alliance avec le Khan tartare Nogaï . Ce fut pour cette
raison que, par suite des efforts vénitiens pour pénétrer dans la mer Noire,
Constantinople se trouva au centre des hostilités. En juillet 1296 une escadre
vénitienne débarqua des troupes qui brûlèrent Péra et Galata et la flotte
chercha à forcer l’entrée de la Corne d’Or. En représailles les Génois réfugiés
dans la ville massacrèrent tous les Vénitiens qui s’y trouvaient , mais des corsaires
vénitiens purent aller dévaster les établissements génois de la mer Noire .
La grande bataille navale qui se livra le 7
septembre 1298 entre la côte dalmate et l’île de Curzola fut pour Venise un
désastre sans précédent . Les deux adversaires
également affaiblis signèrent la paix à Milan (25 mai 1299) sans se demander de
réparations, mais ce fut l’empereur Andronic qui paya les frais de la guerre.
Sur son refus d’accorder des indemnités aux Vénitiens lésés en 1296, une flotte
vénitienne vint bloquer Constantinople et lancer des flèches à l’intérieur du
Grand Palais. Le basileus dut négocier et signer une paix onéreuse avec Venise
(1302-1303) , tout en concédant un
quartier plus étendu à Gênes, qui l’avait abandonné dans sa détresse , et en laissant Benoît
Zaccaria, concessionnaire de l’exploitation des mines d’alun de Phocée, occuper
l’île de Chio sous prétexte de la défendre contre les Turcs (1304) .
L’expansion serbe. — Conscient de
l’insuffisance de ses forces, Andronic recherchait avant tout la paix avec les
voisins de l’Empire au moment où ceux-ci, profitant de sa faiblesse, ne
songeaient qu’à agrandir leurs territoires à ses dépens. Le plus dangereux
était le Kral serbe Ourosch II Miloutine qui, après avoir pris Skoplje, où il
établit sa résidence, s’était emparé de Serrès et de Kavala, portant ainsi ses
frontières jusqu’à la mer Égée (1282-1283) et, par la vallée du Vardar,
menaçant Thessalonique. Poursuivant ses succès, il occupa l’Albanie septentrionale
(1296). Ce fut seulement alors qu’Andronic II se décida à réagir, mais l’armée
qu’il confia à son meilleur stratège, Michel Glabas, fut battue et, dans son
impuissance, il essaya de traiter avec le Kral en lui faisant épouser une
princesse impériale. Sur le refus de sa nièce Eudokia, veuve de l’empereur de
Trébizonde, il lui donna sa fille, Simonide, une enfant, malgré le blâme du
patriarche et lui reconnut une partie de ses conquêtes . Miloutine, qui fut
l’un des plus grands souverains de la Serbie du Moyen Age, célèbre par ses
nombreuses fondations d’églises et d’hospices, dans ses États, à
Constantinople, à Thessalonique, à Jérusalem , semble avoir eu
l’ambition d’unir la Serbie à l’Empire byzantin sous la même domination et
était encouragé dans ce dessein par sa belle-mère, l’impératrice Irène . Ce fut d’ailleurs sous
son règne que, grâce à Simonide, les modes et les influences byzantines
s’introduisirent en Serbie .
L’Asie Mineure et la naissance du danger
turc.
— Nous avons vu que, sous le règne de son père, Andronic avait déjà manifesté
tout l’intérêt qu’il portait à l’Asie Mineure . Dans son second éloge
de cet empereur, Théodore Métochitès le loue de l’activité qu’il a manifestée
en Asie dès son avènement : il le montre franchissant le Bosphore en plein
hiver, refoulant les Turcs et leur reprenant la Bithynie, la Mysie, la Phrygie,
rebâtissant des villes et mettant la frontière en état de défense . Après avoir parcouru
la Bithynie avec le grand-logothète Muzalon, il fit un long séjour à Nymphée en
1290 .
En même temps il recherchait l’alliance du roi de Petite Arménie, Héthoum II,
dont une sœur épousa l’héritier du trône byzantin, Michel IX (16 janvier
1296) .
La situation dans laquelle se trouvait
l’Anatolie ne justifiait que trop cette activité. C’est à cette époque que la
petite tribu des Osmanlis sous son chef Osman, successeur d’Ertoghroul, paraît
s’être convertie à l’islam et commence à élargir les limites de son domaine aux
dépens de l’Empire byzantin et des Mongols . La révolte militaire de
Philanthropenos, envoyé en Asie sans argent, d’ailleurs vite réprimée (décembre
1296), arrêta les opérations . A partir de 1300 les
incursions d’Osman, jusque-là guerre obscure de village à village, lui valent
des résultats fructueux et pour la première fois en 1301 ses cavaliers bardés
de fer rompent la ligne d’un corps de troupes impériales devant Nicomédie . Les Osmanlis n’étaient
d’ailleurs qu’une puissance minuscule à côté de celle des émirs de Saroukan, de
Kermian, de Karaman, d’Aïdin, qui occupaient une partie des provinces
maritimes et commençaient à
exercer une pression sur les côtes et les villes de l’intérieur .
Grâce à l’enrôlement d’un corps d’Alains du
Caucase, Andronic II put envoyer en Asie Mineure une armée commandée par son
fils Michel IX (1302), mais cette campagne fut désastreuse. Dès le premier
contact avec l’ennemi, le jeune basileus mal conseillé alla s’enfermer dans
Magnésie, mais ne pouvant arriver à calmer une émeute des Alains qui
réclamaient leur congé, il prit le parti de s’enfuir, suivi bientôt de la
garnison et de toute la population. Ce fut une véritable panique : les
Turcs tombèrent sur les fuyards et les massacrèrent et Michel IX alla se mettre
en sûreté à Cyzique .
Tel fut le dernier effort des empereurs
pour sauver l’Asie Mineure par leurs propres forces. Andronic cherchait
désormais des secours extérieurs, d’abord celui du Khan mongol de Perse,
Ghazan, à qui il offrit une de ses bâtardes en mariage, mais Ghazan mourut (31
mai 1302) . En désespoir de cause,
Andronic eut recours à l’une de ces compagnies de routiers, spécialistes de la
guerre, qui louaient leurs services aux princes d’Occident.
L’Empire au pouvoir des Almugavares
(1303-1311). — La paix de Caltabellota, signée par Frédéric III d’Aragon
et Charles II d’Anjou (1302) , laissait sans emploi
la magnifique armée recrutée en Catalogne, en Aragon, en Navarre, que le roi
d’Aragon avait prise à son service et qu’il ne se souciait pas de ramener en
Espagne. Après leur licenciement, les Almugavares se donnèrent comme chef
un aventurier, Roger de Flor , ancien Templier,
chassé de l’ordre pour vol, corsaire redoutable et propriétaire d’une compagnie
de chevaliers. Au courant des affaires de la chrétienté, il fit offrir ses
services à Andronic II et signa avec lui un traité qui lui attribuait le titre
de mégaduc, la main d’une princesse impériale et pour ses troupes une solde
double de celle des mercenaires habituels, payable 4 mois à l’avance .
En septembre 1303 la flotte qui portait les
routiers, leurs femmes et leurs enfants arriva à Constantinople et dès les premiers
jours ces nouveaux alliés se montrèrent sous leur véritable jour en massacrant
les Génois qui réclamaient à Roger de Flor le paiement des sommes qu’il leur
avait empruntées . Andronic II se hâta de
les faire passer en Asie, où les émirs turcs, ne trouvant plus de résistance,
poussaient leurs courses jusqu’au Bosphore en réduisant les populations en esclavage .
Débarqués à Cyzique (janvier 1304), les
Catalans commencèrent par dégager cette ville assiégée par les Turcs, qu’ils
massacrèrent ou capturèrent , et y passèrent
l’hiver, non sans molester les habitants, auxquels Roger de Flor distribua
100 000 onces d’or d’indemnité avant son départ . Leur véritable
campagne commença en avril 1304 : en quelques mois ils délivrèrent l’Asie
Mineure des Turcs que leurs chevaliers et leurs piétons attaquaient à l’arme
blanche et chargeaient avec une telle furie qu’ils n’avaient pas le temps de se
servir de leurs arcs et de leurs flèches. Ils parvinrent ainsi
jusqu’au pied du Taurus cilicien, où ils livrèrent aux Portes de Fer une
bataille sanglante qui acheva de désorganiser les forces des Turcs, réduits à
s’enfuir dans les montagnes en abandonnant de nombreux morts et un immense
butin (août 1305) .
La contrepartie de ces victoires était la
mésintelligence croissante entre les indigènes et les Catalans dont les excès
étaient souvent pires que ceux des Turcs, mais les Grecs n’étaient pas moins
répréhensibles : les habitants de Magnésie pillèrent pendant l’absence des
routiers les magasins où Roger de Flor avait entassé son butin. A leur retour,
les Catalans trouvèrent les portes fermées et ils allaient assiéger la ville
avec des machines de guerre quand le basileus les rappela en Europe pour
marcher contre les Bulgares .
Andronic II était en effet en mauvais
termes avec le tsar Théodore Sviétoslav, fils de Terter, qui avait délivré la
Bulgarie tombée sous le joug des Mongols (1285-1293) , et lui avait opposé
plusieurs prétendants . En cette année 1305 Sviétoslav
avait envahi le territoire impérial et menaçait les ports de la mer Noire.
Michel IX, qui lui fut opposé, se fit d’abord battre près d’Andrinople, puis
ayant levé de nouvelles troupes en faisant fondre sa vaisselle, il infligea une
défaite aux Bulgares . Cependant sa victoire
était loin d’être décisive et ce fut ce qui porta Andronic à appeler les
Catalans à la rescousse, mais, à cette nouvelle, les troupes de Michel IX
éclatèrent en murmures et le jeune basileus écrivit à son père que l’arrivée des
routiers dans son camp serait le signal de la révolte de son armée .
Cependant les Catalans, après avoir passé
l’Hellespont, s’étaient arrêtés dans la péninsule de Gallipoli. Andronic,
renonçant à les faire marcher contre les Bulgares, avait résolu de les renvoyer
en Asie , mais ils étaient
hostiles à ce projet et réclamaient le paiement de la solde promise. Roger de
Flor, qui avait été porter leurs doléances à Constantinople, n’en rapporta que
de faibles sommes et en monnaie de mauvais aloi . Au même moment
débarquait à Madyte un nouveau chef qui amenait des renforts, Bérenger
d’Entença, d’une des premières familles de la noblesse d’Aragon. En réalité il
était l’agent de Jayme II, roi d’Aragon, et de Frédéric III de Sicile, qui,
après avoir reçu des renseignements sur les exploits des Almugavares, voulaient
se servir d’eux pour conquérir des positions en Orient . Roger de Flor paraît
avoir redouté ce personnage et, pour se faire bien voir de lui, il lui céda
avec l’autorisation d’Andronic sa dignité de mégaduc (25 décembre 1306) . Le conflit qui s’était
élevé entre le basileus et les routiers semblait en voie d’apaisement, quand,
Andronic s’étant plaint des immenses sacrifices qu’il avait faits pour les
Catalans, Bérenger le prit de très haut et quitta Constantinople en jetant à la
mer le bonnet de mégaduc, insigne de sa dignité .
Cette rupture avec éclat et probablement
voulue mettait Andronic dans la situation la plus critique : en janvier
1307 il apprenait que Roger fortifiait la péninsule, que les Turcs bloquaient
de nouveau Philadelphie, que le roi de Sicile Frédéric III préparait une
expédition contre Constantinople et avait envoyé des navires à Gallipoli . Dans son désarroi
Andronic ne vit d’autre moyen de salut que de s’appuyer sur Roger de Flor,
auquel il conféra la dignité de César après avoir signé avec lui un nouveau
traité : Roger recevrait en fief les provinces d’Asie avec une forte
rente ; de son armée il ne garderait que 3 000 hommes, avec lesquels
il marcherait de nouveau contre les Turcs .
Tout semblait réglé et Roger faisait déjà
passer ses troupes en Asie, mais avant son départ il voulut par une véritable
bravade aller saluer Michel IX, campé près d’Andrinople, dont il n’ignorait pas
l’hostilité à son égard. Très bien reçu par le jeune basileus qui dissimulait
sa colère, il fut assassiné avec toute sa suite dans un festin (7 avril
1307) . En même temps des
Turcoples et des Alains envoyés à Gallipoli surprenaient les routiers
dispersés, en massacraient un grand nombre et enlevaient leurs chevaux au
pâturage .
Aucun événement ne pouvait être plus
néfaste pour l’Empire. Ce crime déchaîna les fureurs des Catalans dont les
représailles terribles achevèrent la désorganisation de l’État byzantin et
bouleversèrent toute la péninsule des Balkans pendant plusieurs années :
ils frayèrent ainsi la voie aux Osmanlis.
Ils commencèrent par massacrer tous les
habitants de la presqu’île de Gallipoli tombés entre leurs mains, élurent comme
chef Bérenger d’Entença et organisèrent un rudiment d’État avec un sceau à
l’effigie de saint Georges, patron des croisés . Avec une flottille
Bérenger ravagea les côtes de la Propontide en massacrant les habitants, mais à
son retour il fut fait prisonnier par des Génois . D’autre part Michel IX
essayait d’attaquer les Catalans, mais se fit battre à Apros, au sud-ouest de
Rodosto, et perdit la plus grande partie de son année . L’empereur n’ayant
plus de troupes à leur opposer, les Catalans se répandirent librement en
Thrace, pillant, brûlant, ravageant, massacrant avec une cruauté inouïe,
réduisant les survivants en esclavage, plaçant leur quartier général à Rodosto
et allant incendier les chantiers de construction de la marine impériale
au-delà de Constantinople . Leur armée se
renforçait sans cesse d’aventuriers de tous pays, de déserteurs grecs,
d’Italiens et même de Turcs venus d’Asie Mineure sur l’invitation des Catalans,
qui furent ainsi les premiers à les introduire en Europe . En outre de nouveaux
Almugavares furent amenés par Fernand Ximénès de Arenos, qui s’établit à
Madyte, tandis que Bérenger de Rocafort occupait Rodosto et que l’historien de
l’expédition, Ramon Muntaner, était gouverneur de Gallipoli .
Ils vécurent ainsi pendant deux ans et
demi, passant l’hiver en orgies grossières et repartant au printemps pour des
expéditions qui réussissaient toujours, grâce à la rapidité foudroyante de leur
marche et à l’effet de surprise . Une tentative du
Génois Spinola pour attaquer Gallipoli (juillet 1308) échoua complètement . En revanche Bérenger
d’Entença, dont la rançon avait été payée par le roi don Jayme, revint se
mettre à la tête de la Compagnie et fit une démonstration insolente devant
Constantinople épouvantée .
Cependant les ressources de la péninsule de
Gallipoli étaient épuisées et, au dire de Muntaner, le pays étant dévasté à dix
lieues à la ronde, les Almugavares ne pouvaient plus y subsister. Tous les
chefs étaient d’accord pour quitter le pays lorsque dans l’été de 1308 l’infant
Fernand d’Aragon, neveu de Frédéric III de Sicile, débarqua à Gallipoli en
excipant des pouvoirs qu’il avait reçus de son oncle, qui lui conférait le
commandement de la Compagnie et lui interdisait de conclure aucun traité sans
son assentiment. Bérenger d’Entença, Ximénès et Muntaner reconnurent ses
pouvoirs, mais Rocafort lui opposa un refus inébranlable , et lorsque l’exode des
Almugavares commença, l’armée était profondément divisée : après le
passage de la Maritza, malgré les précautions ordonnées par l’infant, les
troupes d’Entença se trouvèrent en contact avec celles de Rocafort : il
s’ensuivit une bataille au cours de laquelle Entença fut tué . Ximénès, menacé à son
tour, abandonna l’armée et se réfugia à Constantinople, où Andronic le maria à
l’une de ses nièces et le créa mégaduc .
Constantinople était libérée de ses
terribles hôtes, séparés désormais en deux armées distinctes à la recherche de
nouvelles aventures. Après avoir menacé inutilement Thessalonique , Rocafort avec la plus
grande partie de l’armée s’établit dans la péninsule de Kassandreia, dont il
pilla les alentours sans épargner même les couvents de l’Athos . L’infant don Fernand
et Muntaner, partis de Thasos sur la flotte, firent escale à Nègrepont où se
trouvait une escadre vénitienne ainsi qu’un agent de Charles de Valois,
prétendant au trône latin de Constantinople, Thibaud de Chépoy. L’infant,
arrêté et enchaîné, fut envoyé au duc d’Athènes, Guy de la Roche, qui, en
représailles du pillage du port thessalien d’Amyros, le fit jeter dans un
cachot . Attaquées par les
Vénitiens, les galères catalanes furent délestées de leur butin, et Thibaud de
Chépoy livra les prisonniers, dont Muntaner, à Rocafort avec lequel il fit
alliance au nom de Charles de
Valois. Il ne tarda pas d’ailleurs à se brouiller avec ce chef autoritaire et
ambitieux ; les capitaines catalans, auxquels Rocafort était devenu
odieux, le livrèrent à Thibaud de Chépoy qui l’expédia à Naples, dont le roi,
Robert d’Anjou, l’emprisonna à Aversa jusqu’à la fin de ses jours .
L’odyssée des Almugavares approchait de son
terme. Les ressources de la presqu’île de Kassandreia étant épuisées et
Thessalonique imprenable , ils gagnent la
Thessalie sous la conduite de Thibaud de Chépoy. Là ils sont l’objet d’enchères
de la part du souverain du pays, le sébastocrator Jean l’Ange, allié d’Andronic
II et du despote d’Épire contre les États français de Grèce , et de la part de
Gautier de Bryenne, duc d’Athènes, désireux justement de recouvrer les places
de Thessalie méridionale enlevées à son État par les Grecs et de placer Jean
l’Ange sous sa suzeraineté . Ils traitent d’abord
avec le sébastocrator et usent de son hospitalité avec si peu de discrétion que
Thibaud de Chépoy, dégoûté de leur indiscipline, les abandonne , puis Gautier de
Bryenne leur fait des propositions si avantageuses qu’ils lui donnent la
préférence . En six mois ils
reprennent 30 places enlevées au duché d’Athènes , mais quand vient
l’heure du règlement des comptes, Bryenne en attache 500 à sa maison et renvoie
les autres . Il ne tarda pas à s’en
repentir. Sentant la vengeance prochaine, il fit appel à toute la chevalerie
franque de l’Achaïe et des îles, mais ces brillants escadrons, attirés dans les
marécages du lac Copals, y furent massacrés presque entièrement par les piétons
catalans et Gautier lui-même y trouva la mort (13 mars 1311) . La poursuite des
fuyards permit aux vainqueurs d’occuper Thèbes et Athènes où ils s’établirent.
A leur demande, le roi Frédéric III leur envoya son fils Manfred qui prit le
titre de duc d’Athènes et fonda en Grèce un État catalan qui devait durer 80
ans .
Le désarroi de l’Empire (1308-1321). — Le passage des
Almugavares à travers l’Empire, plus désastreux que celui de plusieurs croisades,
acheva de lui enlever toute possibilité de redressement. Le chroniqueur catalan
Ramon Muntaner résume ainsi l’œuvre destructive de ses compatriotes :
« Nous épuisâmes toute la Romania, car, sauf les villes de Constantinople,
Andrinople, Christopolis-Cavalla et Salonique, il n’y eut cité qui ne fût mise
par nous à feu et à sang... » . La révolte des
Almugavares, qui nous reporte à celle des milices gothiques du ve siècle, eut pour
conséquences de nouveaux démembrements de l’Empire. Andronic II, comme le
remarque Muntaner , n’eut pas le bénéfice
de la libération de l’Asie Mineure. Les Catalans partis, les Turcs reparurent,
reprirent leurs positions et firent de nouvelles annexions.
Ce fut ainsi que les Osmanlis pénétrèrent
en 1308 dans la péninsule de Nicomédie, investirent Brousse, repoussèrent une
invasion de Mongols suscitée par le basileus et annexèrent à leur milice ceux
qui avaient été faits prisonniers . Une perte encore plus
désastreuse fut celle d’Éphèse, prise par un allié d’Osman, l’émir Saïsan, qui
viola la capitulation et pilla le célèbre trésor de Saint-Jean . Enfin l’île de Rhodes,
devenue un véritable repaire de pirates et qui n’était rattachée à Constantinople
que nominalement, fut conquise par les Hospitaliers, qui avaient dû quitter
l’île de Chypre à la suite de conflits avec le roi Henri II. Ils avaient offert
à Andronic de tenir Rhodes sous sa suzeraineté, mais avaient essuyé un refus et
le basileus envoya même des secours à la cité de Rhodes, qui fut prise après un
long siège le 15 août 1310 .
Une puissance nouvelle allait donc prendre
part à la lutte contre la marine turque, mais, loin d’en rechercher l’alliance,
le gouvernement impérial ne lui manifestait que de l’hostilité.
Les provinces d’Europe n’étaient pas moins
troublées que l’Asie Mineure. Les Almugavares avaient laissé derrière eux des
bandes de Turcs qui continuaient à ravager la Thrace et interceptaient les communications
entre Constantinople et Salonique. Andronic traita avec leur chef, Halil, mais
au passage de l’Hellespont un officier impérial, violant les conventions,
voulut lui reprendre son butin, d’où une bataille dans laquelle Michel IX
perdit ses bagages et fut mis en déroute. Les Turcs continuèrent à occuper la
région, qui resta trois ans sans être cultivée (1311-1314). Il fallut tout ce
temps à Andronic pour équiper et exercer une nouvelle armée qui, commandée par
un excellent chef , et grâce au secours
des Serbes, parvint à encercler les Turcs dans la péninsule de Gallipoli et à
détruire leur troupe qui ne comprenait pas plus de 1 800 guerriers .
Cet épisode en dit long sur la détresse de
l’État byzantin et l’impuissance à laquelle il était réduit. C’est ce qui
explique qu’Andronic ait été incapable de secourir son gendre Miloutine qui,
après avoir enlevé Durazzo aux Angevins, était menacé par une coalition du roi
de Hongrie Charles-Robert et de son oncle
Philippe de Tarente, à qui Charles de Valois, son beau-père, avait cédé ses
droits sur l’Empire latin . Le pape fit prêcher la
croisade en Albanie contre les Serbes schismatiques. Miloutine perdit Belgrade
et un territoire en Bosnie . Après sa mort (1321)
son successeur Étienne Detchanski, ne pouvant plus compter sur Byzance, chercha
des alliances en Occident et négocia avec le pape.
La situation intérieure n’était pas moins
troublée et les querelles religieuses y tenaient toujours une grande place. En
1307, à l’instigation du patriarche Athanase, Andronic II expulsait les Frères
Mineurs établis à Constantinople depuis 1220 . Le schisme arsénite se
perpétuait et ses tenants étaient irréductibles en dépit des tentatives du
basileus et des patriarches pour les réintégrer dans l’Église . A la suite d’un véritable
mouvement de folie mystique, le peuple exigea le rétablissement d’Athanase au
patriarcat et força Jean Cosmas à démissionner (23 août 1304) , mais Athanase ne put
se maintenir au pouvoir et dut se retirer en 1312 . L’Église tomba alors
dans l’anarchie : en onze ans (1312-1323) le patriarcat changea cinq fois
de titulaire et resta vacant deux fois (1315-1316) (1323-1324) .
Plus désastreuses encore allaient être les
conséquences des discordes de la famille impériale.Le jeune Andronic, fils de
Michel IX et de la sœur du roi Héthoum, né vers 1296, avait été longtemps le
favori de son aïeul, puis la vie désordonnée qu’il mena dans sa vingtième année,
sa passion pour la chasse et le jeu, ses emprunts aux Génois et même une
tentative de complot pour se constituer un apanage le firent tomber en
disgrâce. Après de violentes altercations il y eut cependant une réconciliation
entre Andronic II et son petit-fils (1318) , mais elle ne devait
pas durer longtemps. Deux ans plus tard, par une fatale méprise, des bravi,
apostés par le jeune prince pour tuer un rival qui cherchait à lui enlever sa
maîtresse, égorgèrent son propre frère, le despote Manuel. A cette nouvelle,
Michel IX, malade à Thessalonique, mourut de chagrin (1er octobre
1320) .
Andronic II, exaspéré, voulut exclure son
petit-fils du trône et lui substituer un bâtard de son second fils Constantin.
Averti par celui-là même chargé de l’espionner, le jeune Andronic s’entendit
avec le grand-domestique Jean Cantacuzène et d’autres amis : il se forma
bientôt un parti pour soutenir ses droits et il eut l’appui du Kral serbe
Miloutine (1320) . Le basileus prit peur
et résolut de condamner son petit-fils à la prison perpétuelle il le fit
comparaître devant un tribunal de hauts dignitaires (5 avril 1321) ; mais
effrayé par la présence des conjurés, après lui avoir fait de violents
reproches, il lui fit grâce. Le jeune Andronic demanda un sauf-conduit pour ses
amis, mais se vit opposer un refus formel . Alors, ne se sentant
plus en sûreté, il s’enfuit à Andrinople où ses partisans vinrent le
rejoindre . Ce fut le signal de la
guerre civile.
4. La période des guerres civiles (1321-1355)
La guerre civile fut le résultat naturel de
l’anarchie et du désordre dus à la politique somptuaire de Michel Paléologue, à
la faiblesse et aux maladresses d’Andronic II. En 34 ans on compte 21 ans de
guerres civiles, séparées en deux périodes par le règne réparateur, mais trop
court, d’Andronic III : la guerre des deux Andronic (1321-1328) et la
révolte de Jean Cantacuzène (1341-1355). Ces troubles continuels achevèrent la
désorganisation de l’Empire et paralysèrent sa défense, mais leur résultat le
plus néfaste fut l’intervention des étrangers dans ces querelles intestines,
ainsi que les démembrements territoriaux qui en résultèrent. Jamais l’Empire ne
put se relever de cette crise.
La guerre des deux Andronic (1321-1328). — Réfugié à
Andrinople, le jeune Andronic vit bientôt se grouper autour de lui une armée de
mécontents, alors que le vieil empereur, surpris comme toujours par les
événements, ne savait quel parti prendre, exigeait un nouveau serment de
fidélité des dignitaires, faisait excommunier les rebelles , puis se décidait à
transiger, offrant même d’abdiquer et de se faire moine : un traité fut
signé, qui partageait le territoire de l’Empire entre les deux princes (juin 1321). Mais
Andronic II n’était pas sincère et entretenait un espion qui le renseignait sur
tous les faits et gestes de son petit-fils. La découverte de cette intrigue
entraîna la rupture et la guerre commença (août 1321) .
En fait cette lutte se poursuivit en deux
campagnes, séparées par un nouvel accommodement qui dura cinq ans (1322-1327).
L’attaque vint du vieil empereur qui commença à reprendre les villes
abandonnées à son petit-fils. Celui-ci, qui avait assiégé en vain Héraclée et
que ses troupes ne voulaient plus suivre, se trouva dans une position critique,
démuni d’argent et tombé malade à Didymotika . Il fut sauvé par son
fidèle Cantacuzène qui l’aida de ses deniers, et au printemps de 1322 il put
marcher sur Constantinople et s’emparer facilement des villes qui en
défendaient l’accès . Partout il était bien
accueilli en promettant aux villes et aux paysans des remises d’impôts. A
Thessalonique les habitants se déclarèrent pour lui et lui livrèrent son oncle,
Constantin, qu’Andronic Il voulait déclarer héritier du trône . Son petit-fils mit en
fuite un corps de Turcs envoyé à sa rencontre et poursuivit sa marche. Menacé
d’être assiégé dans Constantinople, le vieil empereur demanda la paix,
qu’Andronic le Jeune accepta en montrant une grande modération (juillet 1322).
Cette fois la paix parut sincère :
laissant Constantinople et sa région à son aïeul, Andronic le Jeune se retira à
Didymotika et s’y occupa loyalement de la défense de l’Empire. Profitant de la
guerre civile, le tsar bulgare Georges Terter II, bien que neveu par sa mère du
jeune Andronic, avait envahi la Thrace, occupé Philippopoli et poussé jusqu’à
Andrinople. Le jeune Andronic le força à battre en retraite, fit une incursion
en Bulgarie . Terter II étant mort
sans héritier (1323), le pouvoir fut disputé entre les boyards . Andronic le Jeune
essaya de recouvrer Philippopoli et dut en lever le siège, mais la ville fut
prise peu après par un de ses lieutenants, Georges Bryenne . Un des prétendants au
trône bulgare, Boeslav, battu par son rival Michel Šišman, d’origine
comane, se réfugia à Constantinople. La guerre continua avec Šišman et, les deux empereurs n’ayant pas d’armée à lui opposer, elle menaçait d’être
désastreuse pour eux, lorsque le nouveau tsar, pour légitimer son pouvoir,
épousa la veuve de Sviétoslav, Théodora, fille d’Andronic II, et fit la paix
avec l’Empire .
Jamais une pareille cordialité n’avait
régné entre les deux Andronic. Le vieil empereur faisait couronner
solennellement son petit-fils, l’associait à l’Empire et, sa femme, Irène de
Brunswick, étant morte en 1324, le remariait à la sœur du comte de Savoie,
Jeanne (1326) , mais, malgré la fin de
la guerre civile, la situation de l’Empire ne s’améliorait pas. Les provinces
d’Europe étaient toujours infestées de bandes turques et Andronic III était
obligé de leur livrer bataille pour ramener sa nouvelle épouse de
Constantinople à Didymotika . En Asie Mineure le
petit État osmanli continuait à élargir son territoire et, au moment de la mort
d’Osman, s’emparait de Brousse (6 avril 1326) , qui fut sa première acquisition
importante et dont le successeur d’Osman, Ourkhan, fit la capitale de son État,
encore l’un des plus faibles de l’Anatolie.
La paix entre les deux empereurs semblait
du moins définitive, lorsque Andronic III apprit que son aïeul, excité par le
grand-logothète Théodore Métochitès et le protovestiaire Andronic Paléologue,
préparait une nouvelle guerre contre lui . A la liste de griefs
qui lui fut adressée il répondit en demandant à venir se justifier. Mais
l’accès de Constantinople lui fut interdit et le patriarche qui le soutenait
fut enfermé dans un monastère . Cette fois l’étranger
intervint dans la querelle : Andronic III eut pour lui le tsar Michel Šišman,
tandis que son aïeul avait signé un traité d’alliance avec le nouveau Kral
serbe Étienne Detchansky .
Après avoir épuisé tous les moyens de
conciliation , Andronic III entra en
campagne et attaqua l’armée de son aïeul, qui se trouvait en Macédoine. Il débuta
par un magnifique succès, la prise de Thessalonique, où il fut appelé par les
habitants, et qui entraîna la reddition de la plupart des places macédoniennes
(janvier 1328) . Il marcha alors sur
Constantinople où il pénétra avec la complicité d’un gardien des murailles dans
la nuit du 24 mai . Il témoigna le plus
grand respect à son aïeul, qui conserva tous les dehors de la souveraineté et
vécut dans la retraite jusqu’en 1332 .
Le règne d’Andronic III (1328-1341). — Le règne
d’Andronic III ne fut qu’une période d’accalmie entre deux guerres civiles.
Conscient des fautes de son aïeul, Andronic III travailla avec une véritable ardeur
à relever l’Empire et réussit dans une certaine mesure à l’arrêter sur la pente
du précipice, mais ses ressources étaient insuffisantes et son règne fut trop
court. Il eut pour principal collaborateur Jean Cantacuzène, qui fut pour lui
un ami fidèle et lui inspira ses mesures les plus utiles. Andronic voulait
l’associer à la couronne , mais il refusa, pour
son malheur et celui de l’Empire . D’une famille noble,
alliée aux Paléologues, il mit au service d’Andronic III son expérience de la
guerre, ses talents d’homme d’État et de diplomate. Il était en même temps
grand-domestique, chef de l’armée et grand-logothète, directeur de
l’administration intérieure, mais il se démit de cette charge en faveur
d’Alexis Apocauque, Bithynien d’origine obscure, qui s’était enrichi rapidement
dans l’administration des salines impériales. Sur le point d’être poursuivi
pour malversations, Apocauque s’attacha à la fortune d’Andronic III qui le créa
parakimomène en 1321, mais qui le considérait comme un aventurier. Regardé
comme un habile financier, il dut beaucoup à la protection de Cantacuzène,
qu’il devait trahir dans la suite . Très ambitieux, il
réussit par ses intrigues à se faire créer mégaduc et gouverneur de
Constantinople contre le gré de l’empereur .
Maître du pouvoir, Andronic III rétablit
Isaïe au patriarcat et n’exerça guère de
représailles sur ceux qui l’avaient desservi. Il libéra même le traître
Syrgiannis, condamné par Andronic II à la prison perpétuelle , mais il trouva excessif
que Cantacuzène le mît à la tête des armées d’Occident pendant sa maladie . Il n’exerça pas longtemps
cette charge : accusé d’un complot, Syrgiannis fut jugé par le basileus en
personne, mais parvint à s’enfuir à Nègrepont et fut tué en faisant la guerre à
l’Empire dans les troupes du Kral serbe .
La mesure la plus importante du règne
d’Andronic III fut sa réforme judiciaire, qui devait lui survivre . Il s’efforça aussi de
relever de leurs ruines les nombreuses villes dévastées par la guerre et en fonda
même de nouvelles, mais il mourut avant d’avoir pu assurer la défense de la
Thrace en transformant Arcadiopolis (Lulle Bourgas) en une puissante
forteresse .
Excellent soldat, entraîné à tous les
exercices du corps, commandant lui-même ses troupes, Andronic III passa une
bonne partie de son règne à faire la guerre et parvint à améliorer les
positions de l’Empire dans la péninsule des Balkans.
Cependant sa première tentative ne fut pas
heureuse : cherchant à exploiter le différend serbo-bulgare , il entra dans une
coalition formée par Šišman contre le Kral Étienne et
fut entraîné dans la défaite des Bulgares à Velbùzd (Kustendjil) (juillet
1330) : Michel Šišman fut tué au cours de
l’action . Le Kral vainqueur
s’empara de Nisch et d’une partie de la Macédoine occidentale, renvoya la sœur
d’Andronic III à Constantinople, tira la sienne de la prison où Šišman l’avait reléguée et l’installa à Tirnovo comme régente au nom de son fils
mineur. Les Bulgares, ne voulant pas obéir au petit-fils d’un Serbe, la chassèrent
et élurent tsar un neveu de Michel Šišman, Jean Alexandre (printemps de 1331).
Le nouveau tsar fournit à Andronic
l’occasion de réparer son échec en reprenant des villes frontières cédées à
l’Empire. Andronic attaqua aussitôt la Bulgarie et s’empara du port de
Mesembria, ainsi que de quelques places à la frontière des Balkans, mais ne put
prendre Anchiale. Alexandre offrit de céder cette ville en échange de Diampolis
(Pliska), puis, le traité signé, attaqua les Grecs et les força à battre en retraite ;
il fit savoir en outre qu’il observerait le pacte si le basileus donnait sa
fille en mariage à son héritier. Andronic y consentit, bien qu’à contrecœur (juillet 1332), mais le
mariage ne fut célébré qu’en 1338 .
Andronic III fit en outre des acquisitions
fructueuses dans les régions occidentales de la péninsule des Balkans. En 1336,
il va réprimer les brigandages des Albanais avec un corps de Turcs habitués à
la guerre de montagne et fait une immense razzia de leurs troupeaux . En même temps il
négocie avec les habitants de l’Acarnanie, sujets du despotat d’Épire, et
annexe cette province à l’Empire , mais il doit la
défendre trois ans plus tard contre un soulèvement d’une partie des habitants
en faveur de l’héritier légitime du despotat, le jeune Nicéphore l’Ange, et
arrive à soumettre les villes rebelles . Le danger était
d’autant plus grand que Nicéphore était réfugié auprès de Catherine de Valois,
veuve de Philippe de Tarente et impératrice titulaire de Constantinople, qui débarqua
en Achaïe avec une armée en 1338, mais, mal secondée par ses vassaux, ne put entamer
le territoire grec .
Malheureusement, obligé de s’occuper
exclusivement de la défense des provinces d’Europe, Andronic III ne put
s’opposer aux progrès des Turcs en Asie Mineure et ce fut sous son règne que
l’Empire fut chassé de ses dernières positions à l’intérieur de la péninsule.
Au moment de son avènement, l’émir le plus puissant était celui de Phrygie
(Kermian) qui résidait à Kutayeh et dont l’armée était la plus nombreuse . Il était assez
puissant pour que le gouverneur mongol de Roum, Timour-schah, qui faisait des
incursions jusqu’à la Méditerranée, se fût abstenu de l’attaquer (1327) . Andronic III se rendit
à Cyzique pour signer avec lui un véritable traité de sauvegarde des
territoires byzantins .
Malgré la prise de Brousse, l’État osmanli
était encore l’un des plus petits, mais au moment où Andronic triomphait de son
aïeul, Ourkhan assiégeait Nicée. Arrivé en hâte avec une armée improvisée, le
basileus perdit la bataille de Pelekanon et Nicée fut prise le 2
mars 1331 . Ourkhan attaqua
ensuite Nicomédie : à plusieurs reprises Andronic le força à en lever le
siège, mais la place finit par tomber entre ses mains, en 1337 au plus
tard .
L’étendue des conquêtes d’Ourkhan fut exagérée dans la suite par les
historiens. Cependant vers 1340 il était déjà maître de 100 forteresses et
avait porté sa frontière jusqu’aux environs de Scutari, non loin du
Bosphore . Il commençait même à
s’agrandir aux dépens des autres émirs, et vers 1337 son intervention dans les
affaires de l’émirat de Mysie lui valut la possession de Pergame et de plusieurs autres
villes. Toutes ces annexions s’effectuaient sans qu’il y eût la moindre
intervention de l’État byzantin.
Andronic III faisait en effet porter ses
principaux efforts sur les questions maritimes qui étaient d’un intérêt vital
pour Constantinople. Parmi les maux dont souffrait l’Empire, le plus douloureux
était la piraterie organisée par les émirs turcs des provinces maritimes, celui
de Saroukhan, maître de Magnésie, Omour-beg, émir d’Aïdin établi à Smyrne,
Khidr-beg d’Éphèse . Depuis 1330 leurs
agressions se multipliaient dans l’Archipel aussi bien contre le territoire byzantin
que contre les possessions latines, Nègrepont, Crète vénitienne, duché de
Naxos, tandis que les émirs de Carie, Lycie, Pamphylie étaient contenus par les
Hospitaliers établis à Rhodes, Cos, Nisyros, et par la marine de Chypre . En 1333 l’émir de
Saroukhan dirige une flotte de 75 navires contre les côtes de Thrace ;
après avoir pillé Samothrace, les Turcs débarquent et se trouvent en face des
troupes d’Andronic qui n’ose les attaquer, mais dont l’arrivée les détermine à
se rembarquer. Un peu plus tard des pirates turcs s’en vont occuper Rodosto, à
quelques heures de Constantinople, et il faut une expédition commandée par
l’empereur en personne pour les en déloger . L’année suivante une
flotte turque débarque des troupes dans le golfe Thermaïque et il faut
qu’Andronic et Cantacuzène, qui se trouvaient à Thessalonique, marchent à leur
rencontre et les rejettent à la mer . Enfin dans l’été de
1337 ce sont les environs immédiats de Constantinople qui sont assaillis par
une bande de Turcs levés dans l’État osmanli et c’est Jean Cantacuzène qui les
repousse et, après un combat acharné, les massacre presque entièrement .
Pour mettre un terme à ces pirateries il
eût fallu une marine de guerre, qui faisait défaut à l’Empire depuis les
mesures néfastes d’Andronic II et que son petit-fils ne put rétablir
qu’incomplètement. Les corsaires turcs avaient du moins affaire aux navires des
deux frères Martin et Benoît Zaccaria, co-souverains de l’île de Chio,
qu’Andronic Il avait cédée à bail à leur grand-oncle en 1304. Ils inspiraient
une véritable terreur aux Turcs dont ils capturaient les navires en grand
nombre, mais à la faveur des troubles de l’Empire, Martin Zaccaria était devenu
à peu près indépendant, avait exclu son frère du gouvernement de Chio,
substituait ses armoiries à celles des Paléologues et frappait monnaie à sa
seule effigie . Effrayé des progrès de
cette nouvelle puissance, Andronic III cita Martin à comparaître devant lui et,
sur son refus, après avoir équipé une flotte de 105 navires, il parut devant
Chio : après un essai de résistance, Martin fut fait prisonnier et emmené
à Constantinople. Le basileus établit un gouverneur grec à Chio (1329) . Quelques années plus
tard il rétablissait son autorité dans l’île de Lesbos ainsi qu’à Phocée :
Dominique Cattaneo, seigneur de la Nouvelle Phocée sous la suzeraineté
impériale, allié aux chevaliers de Rhodes, au duc de Naxos, aux Génois de
Galata, s’était emparé de l’île de Lesbos et se déclarait indépendant. Poussé
par Cantacuzène, Andronic fit alliance avec des émirs turcs qui lui fournirent
des navires et alla assiéger en même temps Mytilène et Phocée, mais ce fut
grâce aux négociations de Cantacuzène avec l’amiral génois Spinola que les deux
villes se rendirent .
On voit par cet exemple à quel point la
seule marine impériale était insuffisante et les États chrétiens qui se
partageaient la possession de l’Archipel étaient trop désunis pour agir
efficacement contre les pirates. Ce fut pour cette raison que Venise, dont les
colonies d’Orient communiquaient difficilement entre elles, proposa aux papes
Jean XXII (1316-1334) et Benoît XII (1334-1342) la formation d’une ligue navale
des États chrétiens qui débarrasserait la Méditerranée orientale de la
piraterie c’était seulement à ce prix qu’une croisade était possible, mais il
était essentiel que Byzance fît partie de la ligue, ce qui supposait un retour
à l’union religieuse entre Constantinople et les papes .
Or ce programme correspondait au désir
d’Andronic III, que l’impératrice Anne de Savoie poussait à reconnaître
l’autorité du pape. Michel Paléologue avait conclu l’Union pour éviter une
croisade contre Constantinople désormais l’Union aura au contraire pour objet
de provoquer la croisade qui portera secours à l’Empire. C’est à cette époque
que ce point de vue nouveau apparaît dans la politique impériale.
Déjà Andronic II, malgré son hostilité
contre Rome, en était venu à la fin de son règne à exprimer au roi de France
Charles le Bel son désir de négocier une nouvelle union (1327) . Andronic III alla
encore plus loin. En 1332 il se fit représenter aux conférences tenues à Rhodes
par les envoyés de Venise et conclut une alliance contre les Turcs avec Venise
et le grand maître des Hospitaliers. En 1334 le roi de France et le pape se
joignaient à cette ligue navale ainsi que le roi de Chypre . En même temps Andronic
faisait part à Jean XXII de son désir d’union et le pape renvoyait à
Constantinople les deux dominicains qui lui avaient porté les demandes du
basileus. Mais tous ces projets échouèrent. Nicéphore Grégoras, désigné pour
discuter avec les envoyés du pape, se déroba et les fit renvoyer sans réponse . D’autre part Andronic
III, qui avait rassemblé 20 navires dans l’Archipel, attendit en vain la flotte
alliée toujours à l’ancre dans le port de Marseille. Jean XXII venait de mourir
(décembre 1334) et Benoît XII qui lui succéda se borna à adresser des appels à
la chrétienté en faveur des Arméniens de Cilicie menacés par les Turcs. En fait
ce furent les discordes entre Gênes et Venise, ainsi que la rupture entre
Philippe VI et Édouard III, qui firent échouer cette première ligue navale .
Andronic III n’en chercha pas moins à
renouer des relations avec le pape, mais sachant combien ses sujets étaient
hostiles à l’Union, ce furent deux étrangers, le moine calabrais Barlaam et le
Vénitien Étienne Dandolo, qu’il envoya secrètement à Benoît XII à Avignon.
Barlaam plaida chaleureusement la cause des Grecs. Il chercha à persuader au
pape que le seul moyen de les gagner était de leur envoyer d’abord des secours
et il préconisa la réunion d’un concile œcuménique pour résoudre les
difficultés, mais Benoît XII réfuta tous ses arguments et tout se borna à un
échange de paroles (1339) .
Les circonstances étaient d’autant plus
défavorables à l’Union que tout Byzance, clercs et laïcs, était agité alors par
les controverses entre les hésychastes (quiétistes), qui prétendaient arriver par une méthode appropriée à la vision
de la divinité, et les humanistes imbus de la philosophie aristotélicienne, qui
ne voyaient d’autre terrain apologétique que la démonstration . Grégoire Palamas,
moine de l’Athos, où s’était propagée la doctrine hésychaste, et Barlaam, Grec
de Calabre émigré à Thessalonique, avaient rempli cette ville de leurs polémiques
d’une âpreté singulière (1333-1339) . A son retour
d’Avignon, le Calabrais eut connaissance d’un écrit où Palamas exposait sa
doctrine de la lumière divine incréée et prenait son adversaire à partie.
Barlaam y vit une théologie hétérodoxe, rappelant d’anciennes hérésies. Après
avoir écrit un traité pour le réfuter , il alla à
Constantinople accuser Palamas d’hérésie devant le patriarche Jean Calécas qui,
médiocre théologien, l’accueillit fort mal, mais Barlaam remua si bien
l’opinion qu’il fallut faire venir Palamas . Le 10 juin 1341 un
concile fut tenu à Sainte-Sophie sous la présidence du basileus, mais il refusa
de discuter le bien-fondé des doctrines en présence : il se borna à
déclarer qu’il appartenait aux seuls évêques de statuer sur les dogmes et força
Barlaam à faire des excuses aux moines qu’il avait attaqués .
C’était une défaite pour Barlaam qui
regagna l’Occident, mais loin d’apaiser les esprits, cette solution ne fit que
rendre plus profondes les divisions qui régnaient dans le monde byzantin et qui
allaient engendrer de nouvelles guerres civiles. Cinq jours après le concile de
Sainte-Sophie, Andronic III mourait, âgé de 45 ans, laissant pour lui succéder
un enfant de neuf ans sous la tutelle d’une impératrice que son origine
occidentale et sa foi romaine avaient rendue impopulaire (15 juin 1341) .
La révolte de Jean Cantacuzène (1341-1347). — Andronic III
disparaissait à l’âge où un homme est en pleine vigueur, laissant inachevée la
tâche de relèvement qu’il avait entreprise. Un seul homme, Jean Cantacuzène,
était capable de continuer cette œuvre, mais il avait refusé d’être revêtu de
l’autorité impériale qui lui eût été nécessaire pour réussir. Andronic III
l’avait du moins désigné comme régent et l’impératrice Anne avait accepté cette
décision. Maître du gouvernement, il voulait réorganiser l’armée, rétablir les
finances, résister aux exigences des étrangers, achever la restauration de
l’Empire . Malheureusement il
avait compté sans les jalousies qu’il inspirait à ceux mêmes qui lui devaient
leur fortune, à Alexis Apocauque, qui le comblait de flatteries, mais le
détestait , au patriarche Jean
Calecas, qui lui devait son élection à laquelle le synode était opposé . Ce furent ces deux
personnages qui le desservirent auprès d’Anne de Savoie en lui prêtant les plus
mauvais desseins contre la famille impériale . Se sentant suspect,
Cantacuzène offrit sa démission, qui fut refusée , mais pendant une de
ses absences les deux complices obtinrent de l’impératrice que Jean Cantacuzène
fût destitué de toutes ses charges, sans pouvoir même venir se justifier à
Constantinople . A cette nouvelle,
Cantacuzène se fit proclamer empereur à Didymotika le 26 octobre 1341, jour de
la fête de saint Démétrius, mais en faisant acclamer le nom de l’héritier légitime,
Jean V, avant le sien .
Une nouvelle guerre civile commençait, mais
elle avait des causes plus profondes qu’une simple lutte pour le pouvoir.
Cantacuzène représentait la grande noblesse terrienne, les archontes, contre
lesquels il s’était formé au xive siècle dans la plupart des villes un parti démocratique et populaire composé de
petits artisans, de marchands et même de paysans. Ce furent les rancunes de ces
classes contre les nobles que les ambitieux comme Apocauque, type du parvenu
sans scrupule, surexcitèrent, et c’est ce qui explique que cette deuxième
guerre civile, à la différence de la première, eut les allures d’une guerre sociale.
Elle eut d’ailleurs pour résultat d’achever la désorganisation intérieure et de
livrer l’Empire à l’étranger, auquel chacun des deux partis faisait appel sans
aucun scrupule .
Cette guerre fut longue et décousue, les
deux adversaires étant contraints et forcés par leurs partisans, qui faisaient
échouer leurs tentatives d’accommodement . Dans les deux camps
d’ailleurs les ressources manquaient. Pour s’en procurer, Anne de Savoie fit régner
une fiscalité intolérable, envoya au creuset les pièces du trésor, confisqua
les biens des nobles . Ce fut surtout une
guerre d’intrigues et de combinaisons diplomatiques dans lesquelles les
alliances matrimoniales, la corruption des gouverneurs de places fortes tenaient
une grande place. Dès son début la guerre eut le caractère d’un duel entre
Apocauque, qui avait pour lui les classes populaires, et Cantacuzène, soutenu
par les archontes, les moines et aussi les hésychastes.
Établi dans une forte position, à Didymotika , bâtie en amphithéâtre
sur un des derniers contreforts du Rhodope, arrosée par un affluent méridional
de la Maritza, à l’entrée de la plaine de Thrace, Jean Cantacuzène organisa son
armée et somma les commandants des places de Thrace et de Macédoine de
reconnaître son autorité .
Pendant la première partie de la guerre
(hiver de 1341 - fin 1344) il n’éprouva que des revers. Dès le début sa marche
sur Constantinople est arrêtée par son échec devant Andrinople défendue par des
Bulgares , ainsi que par la défection
de trois de ses principaux partisans . A Constantinople Anne
de Savoie fait couronner solennellement Jean V et confie le pouvoir à
Apocauque, qui jette la mère de Cantacuzène dans une prison où elle meurt . En mars 1342
Cantacuzène marche sur Thessalonique, mais il s’arrête à Drama en apprenant la
nouvelle du mouvement démocratique dit des Zélotes, dirigé contre les
nobles . Entre-temps Cantacuzène
s’en va faire alliance avec le Kral Étienne Douschan et attaque Thessalonique
avec des troupes serbes, mais l’arrivée d’Apocauque avec une flotte et une
armée le force à lever le siège et à se réfugier à Berrhoé (Verria) . L’année suivante une
nouvelle tentative pour s’emparer de la ville avec l’appui de la flotte et de
l’armée de l’émir de Smyrne Omour-beg échoua encore et en novembre 1343
Jean Cantacuzène était de retour à Didymotika .
Sa situation fut alors des plus critiques.
Il ne pouvait plus compter sur l’alliance d’Omour-beg après la prise de Smyrne
par la croisade de l’Archipel (28 octobre 1344) . A l’instigation d’Anne
de Savoie le Kral Étienne Douschan et le tsar Jean Alexandre envahissaient la
Thrace. A la voix du patriarche, une armée de volontaires se forma à
Constantinople et Apocauque, établi à Héraclée, tenta trois fois de faire
assassiner Cantacuzène . Mais à la fin de cette
année la situation était rétablie. Les troupes d’Étienne Douschan étaient repoussées
par les Turcs d’Omour-beg, qui n’avaient pu se rembarquer faute de navires,
Cantacuzène forçait les Bulgares à repasser la Maritza et réoccupait les places
qu’ils avaient prises : Jean Alexandre signait la paix et Anne de Savoie
elle-même aurait volontiers traité si Apocauque ne s’y était opposé .
A partir de ce moment la situation de
Cantacuzène se raffermit, mais les opérations sont lentes, les deux parties
étant également faibles. En janvier 1345 il parvient à occuper
Andrinople ; mais grâce à ses intelligences avec le gouverneur et ne pouvant plus
compter sur l’appui d’Omour-beg, il s’adresse à Ourkhan, lui fiance sa fille
Théodora et introduit 6 000 Osmanlis en Europe, au grand émoi des Génois
de Galata ; avec ces
renforts il serre de près Constantinople. Le meurtre d’Apocauque, assassiné
dans la prison modèle qu’il visitait par les victimes elles-mêmes qu’il y avait
enfermées (li juin 1345) le débarrassait de son
principal adversaire et désorganisait le parti d’Anne de Savoie. Cependant il
se passa encore près de deux ans avant que Cantacuzène pût entreprendre
l’opération décisive qui allait lui livrer Constantinople et l’Empire. Le
vendredi 3 février 1347, à la septième heure de la nuit, ses partisans lui
ouvraient les portes de la ville, le lendemain du jour où la régente, brouillée
avec le patriarche Jean Calecas, l’avait fait déposer par le synode .
Le règne de Jean VI (1347-1355). — Vainqueur de
la guerre civile, maître de Constantinople, mais non de tout l’Empire, Jean Cantacuzène
ne s’en trouvait pas moins dans la situation la plus difficile et pendant les
huit ans que dura son pouvoir il lutta avec une incroyable énergie pour
rétablir l’ordre et finalement succomba à la tâche.
Il avait d’abord à compter avec le
sentiment légitimiste en faveur de Jean V, car pour beaucoup il n’était qu’un
usurpateur. De là le traité qu’il conclut avec Anne de Savoie qui avait eu des
velléités de se défendre au palais des Blachernes, mais finit par
capituler : Cantacuzène était reconnu comme le collègue de Jean
Paléologue, qui lui serait cependant subordonné pendant dix ans . Une amnistie générale
était proclamée et tous les sujets de l’Empire durent prêter un serment de
fidélité aux deux souverains . Par là Jean VI cherchait
à effacer toutes les traces de la guerre civile et à se présenter comme un empereur
légitime, allant jusqu’à affirmer dans ses diplômes sa parenté avec la dynastie
des Paléologues .
Plus difficile était le rétablissement de l’ordre et de la prospérité. Les coffres de l’État étaient vides au point qu’on ne put même pas célébrer dignement les fêtes du couronnement de Jean VI et d’Irène, qui eut lieu dans l’église du Palais le 12 mai. Une tentative du basileus pour déterminer les notables de Constantinople à contribuer de leurs deniers au rétablissement des finances publiques se heurta à une incompréhension totale . De plus, en dépit des efforts de Jean VI, les deux camps de la guerre civile ne désarmaient pas. Les partisans de Cantacuzène étaient jaloux des faveurs accordées à leurs adversaires . L’indiscipline régnait partout et jusque dans la famille impériale. Le fils aîné de Cantacuzène, Mathieu, entreprenait de se constituer un apanage en occupant Didymotika et plusieurs villes de Thrace : il fallut les remontrances de l’impératrice pour le faire renoncer à son dessein . La sécurité ne régnait plus dans les
provinces ; des bandes de Turcs infestaient toujours la Thrace et en 1348
les deux empereurs revenant d’une expédition sur la mer Noire durent livrer
bataille à l’une d’entre elles et coururent un grand danger . Les résultats du règne
d’Andronic III étaient compromis l’île de Chio, qu’il avait si heureusement
annexée, avait été occupée ainsi que l’ancienne et la nouvelle Phocée, à la fin
de la guerre civile, par le Génois Vignoso, au moment où les chefs de la
croisade de l’Archipel allaient s’en emparer .
D’autre part la deuxième ville de l’Empire,
Thessalonique, restée au pouvoir des Zélotes, ne reconnaissait pas l’autorité
de Jean VI et refusait d’admettre l’archevêque qu’il lui avait envoyé, Grégoire
Palamas . Ce fut seulement à la
fin de 1350 que Cantacuzène, après l’expulsion des Zélotes, put y exercer sa
souveraineté, mais après combien de péripéties et de difficultés, et de la
manière la moins glorieuse, grâce au secours d’une flotte de corsaires turcs
qu’il avait embauchés à l’embouchure du Strymon. Il put ainsi arriver à temps pour
empêcher Étienne Douschan de s’emparer de la ville, que les Zélotes allaient
lui livrer .
L’occupation de Thessalonique par les
Serbes eût mis en question l’existence même de ce qui restait de l’Empire.
Étienne Douschan qui, pendant la guerre civile, avait conquis la Macédoine
orientale, pris Serres et Kavalla qui lui permettaient d’atteindre la mer Égée,
rêvait comme autrefois le Bulgare Syméon de s’emparer de Constantinople et
d’unir sous la même domination impériale les Serbes, les Grecs et tous les
peuples balkaniques. Le dimanche de Pâques, 13 avril 1346, une assemblée
d’évêques tenue à Skoplje institua comme patriarche des Serbes le métropolite
de Peč, puis procéda au couronnement d’Étienne comme
tsar ou basileus des Serbes et des Romains.
Tout à fait dans son nouveau rôle, Étienne
se fit représenter sur ses monnaies en costume impérial, organisa une cour sur
le modèle byzantin, confirma dans ses lois les dispositions des basileis ses
prédécesseurs, relatives notamment aux privilèges accordés aux monastères et
publia lui-même des chrysobulles en faveur des couvents de l’Athos passés sous
sa domination avec la péninsule de Chalcidique .
Avec cette jeune puissance qui disposait
d’une solide armée, Cantacuzène ne pouvait lutter à armes égales. Il parvint du
moins à arrêter son élan, mais avec l’aide des Turcs ses alliés habituels.
Douschan s’étant emparé de Phères en Thessalie, Jean VI essaya de négocier avec
lui, mais ses deux ambassades restèrent sans réponse (mars-avril 1348). II
obtint alors d’Ourkhan 10 000 Osmanlis qui repoussèrent les Serbes, mais
mirent la région au pillage . Douschan continua
librement ses conquêtes sur le territoire de l’ancien despotat d’Épire
qu’Andronic III et Cantacuzène avaient réannexé en 1336 : l’Épire, la
Thessalie, l’Acarnanie, 1’Étolie tombèrent entre ses mains et il fut bientôt le
maître de la majeure partie des pays grecs .
Jean Cantacuzène put du moins, comme on l’a
vu, empêcher Douschan d’entrer à Salonique (fin 1348), mais ce fut seulement
lorsqu’il fut maître de cette ville (octobre 1349) qu’il put prendre
l’offensive, pendant que le tsar serbe était en train de conquérir la Bosnie et
d’enlever Belgrade au roi de Hongrie . Jean VI gagna certains
boyards serbes et reprit successivement plusieurs places macédoniennes, Berrhoé
(Verria), Édesse (Vodéna), la capitale serbe elle-même, Skoplje, Gynéco-Castro
(Avret-Hissar) ou il entra avec le jeune empereur , dégageant ainsi les
abords de Salonique. A la nouvelle de cette campagne, Douschan abandonna la
Bosnie et revint en Macédoine (janvier 1350), mais ce fut pour négocier la
paix. Une entrevue eut lieu entre lui et les deux empereurs et, après s’être
fait réciproquement des reproches, les souverains signèrent un traité d’après
lequel l’Acarnanie, la Thessalie et le sud-est de la Macédoine jusqu’à Serrès devaient
faire retour à l’Empire . Ces concessions du
tsar serbe peuvent s’expliquer par les difficultés que lui suscitaient ses
boyards. De plus il était tout à ses projets sur Constantinople et, sachant
qu’il ne pourrait jamais s’en emparer sans l’appui d’une flotte, il recherchait
l’alliance de Venise . D’ailleurs la rupture
entre Cantacuzène et Jean V, que Douschan ne manqua pas de soutenir, rendit
caduc le traité qu’il venait de signer .
Difficultés intérieures. — Tout en
défendant la Romania contre l’ambition de Douschan, Jean VI devait faire face à
de graves difficultés intérieures. La misère publique fut portée au comble par
la propagation de la peste noire, qui semble être venue d’Asie centrale par
l’intermédiaire du Kiptchak et des ports de la mer Noire et s’être propagée
surtout par la navigation ; car, au témoignage de Nicéphore Grégoras et de
Cantacuzène, qui en décrivent les symptômes, elle sévit surtout sur les côtes
et dans les îles. La maladie, que l’on identifie avec la peste bubonique, gagna
Constantinople en 1348 et y fit de nombreuses victimes, parmi lesquelles le
plus jeune fils de Cantacuzène, Andronic . On sait quels furent
les ravages de la peste noire dans tout l’Orient et dans toute l’Europe, en
France et en Angleterre .
La question religieuse causait surtout des
soucis à Jean VI. Le départ de Barlaam et le concile de Sainte-Sophie en 1341
n’avaient nullement apaisé la querelle hésychaste, qui rebondit au contraire à
la fin de la guerre civile, à la suite des attaques du moine Akindynos contre
Palamas, dont il avait été l’ami mais dont il réprouvait certaines affirmations . Palamas fut condamné
par un nouveau concile présidé par le patriarche Jean Calecas et, comme il
était l’ami de Cantacuzène, Anne le fit jeter en prison (1345) . Cependant au moment où
Jean Cantacuzène s’emparait de Constantinople, la régente, brouillée avec le
patriarche, l’avait fait déposer : Palamas libéré recouvrait sa faveur,
ainsi que ses partisans .
Telle fut la situation que Cantacuzène
trouva après son entrée à Constantinople. Très favorable à Palamas, il fit
confirmer par le synode la déposition de Jean Calecas, qui avait été après
Apocauque son principal ennemi, et le remplaça par un hésychaste notoire,
Isidore, archevêque de Monemvasia , puis, pour faire
cesser les polémiques, il convoqua un concile aux Blachernes (27 mai 3353).
Akindynos et Isidore étaient morts ; le nouveau patriarche, Calliste,
était un moine de l’Athos, borné et ignorant . Le principal
adversaire de Palamas était l’érudit Nicéphore Grégoras que Cantacuzène avait
essayé en vain de gagner à ses vues. Dans ces conditions, le concile, qui dura
15 jours, ne pouvait aboutir qu’à la victoire de Palamas dont les
contradicteurs furent injuriés grossièrement et maltraités . Le basileus alla
jusqu’à interner Grégoras au monastère de Chora et à l’empêcher d’écrire . Le triomphe des
hésychastes était complet.
L’hostilité génoise. — A toutes ces
difficultés s’ajouta l’hostilité de la république de Gênes qui continuait ses
efforts pour accaparer le monopole du commerce dans l’Archipel, à
Constantinople, dans la mer Noire surtout, dont il s’agissait d’interdire
l’accès aussi bien aux Vénitiens qu’aux Grecs. De là l’importance prise par la
colonie génoise de Galata que l’imprudence de Michel Paléologue avait établie
en face de Constantinople : elle était
devenue une place forte, dont la vieille tour qui dominait son enceinte atteste
encore aujourd’hui la puissance, et dans son port affluaient les navires qui désertaient
les escales de la ville impériale . Or Cantacuzène,
réagissant contre la politique de laisser-aller d’Andronic II, ne s’avisait-il
pas de créer une nouvelle marine impériale et d’abaisser les droits de douane
afin de ramener l’activité dans le port de Constantinople ! Voyant leur monopole en
péril, les Génois de Galata n’hésitèrent pas à traiter l’Empire en ennemi. Le
15 août 1348, profitant d’une absence de Jean VI, ils envoyèrent un ultimatum
inacceptable à l’impératrice Irène, coulèrent tous les navires grecs en vue,
incendièrent les maisons de la banlieue de Constantinople et en commencèrent le
siège en établissant un blocus rigoureux à l’entrée de la Corne d’Or .
Cette « guerre de Galata » qui se
prolongea jusqu’en mars 1349 fut extrêmement meurtrière et fit régner la famine
dans la ville. Rentré à Constantinople au moment où un assaut
général venait d’échouer, Cantacuzène improvisa une flotte, mais les navires
mal construits furent coulés facilement par les Génois à l’entrée du Bosphore
(5 mars 1349). Le basileus se préparait à construire de nouveaux navires quand
le sénat de Gênes, qui était à la veille d’une rupture avec Venise, ordonna à
la colonie de faire la paix en donnant satisfaction à l’empereur sur tous les
points .
La guerre entre Gênes et Venise. — Cette paix ne
devait pas durer longtemps. Comme Andronic II autrefois, Jean VI se trouva
englobé malgré lui dans les hostilités qui éclatèrent l’année suivante entre Gênes
et Venise, et au moment où Jean V Paléologue, à la tête d’un parti légitimiste,
recommençait la guerre civile. La cause du conflit entre les deux
thalassocraties était une nouvelle tentative de Gênes pour expulser sa rivale
de la mer Noire en barrant le Bosphore à l’endroit le plus resserré.
Cantacuzène refusa de s’allier avec Venise, qui s’adressa au roi d’Aragon .
Mais ce fut en vain que Jean VI chercha à
conserver la neutralité. A la suite de l’attaque d’une flotte vénitienne contre
Galata, les Génois bombardèrent les murs de Constantinople en y lançant
d’énormes blocs de pierre. Le basileus fit rappeler la flotte vénitienne et
signa un traité d’alliance onéreux pour l’Empire (août 1351) .
Constantinople se trouva en effet exposée
aux coups des Génois sans être soutenue par les Vénitiens. Ce fut ce qui arriva
peu après la signature du traité, au moment d’une nouvelle attaque de Galata
par la flotte de Nicolas Pisani qui laissa couler les navires byzantins par les
Génois sans intervenir et battit en retraite devant la flotte de Doria :
cet amiral génois put saccager Héraclée et Sozopolis sans défense (septembre
1351) . Pisani reparut en
février 1352, renforcé de l’escadre de don Pedro IV, roi d’Aragon : un
combat acharné eut lieu entre sa flotte et celle de Doria au milieu du
Bosphore, mais il ne put forcer le passage et se retira en laissant
Constantinople exposée aux représailles des Génois (15 février 1352). Abandonné
ainsi, Jean Cantacuzène dut signer un traité par lequel il cédait aux Génois
les places de Selymbria et d’Héraclée ainsi qu’un élargissement du territoire
de Galata. L’accès de la mer Noire était interdit aux navires de Constantinople
(6 mai 1352) .
La reprise de la guerre civile. — Pendant que
ces événements tragiques se passaient à Constantinople, Jean V Paléologue,
dénonçant le traité conclu avec Cantacuzène, tenait la campagne dans les
provinces. De Thessalonique où l’avait laissé Jean VI, il négociait avec
Étienne Douschan qui s’engageait à le faire reconnaître comme seul empereur
(juin 1351) ; mais, cédant aux prières d’Anne de Savoie que lui avait
dépêchée Cantacuzène, il s’abstint de toute hostilité moyennant la remise de
places de sûreté en Chalcidique . Cependant, comme son beau-père
tardait à tenir sa promesse, le jeune Paléologue occupa Andrinople au moment où
la flotte de Doria menaçait Constantinople (septembre 1351) . Jean VI parvint à l’en
chasser (juin 1352) , mais il continua la
lutte avec une troupe de Bulgares et de Serbes, après avoir conclu une alliance
avec Venise . De son côté Jean VI
n’hésita pas à faire appel aux Osmanlis, à dépouiller les églises de Constantinople
pour pouvoir payer la solde des 20 000 hommes fournis par Ourkhan, et à
lui promettre de lui céder une forteresse en Thrace .
Grâce à cette alliance, Cantacuzène
rétablit son autorité. Soliman, fils d’Ourkhan, mit les Serbes en déroute à
Didymotika et en septembre 1352 toutes les villes de Thrace et de Macédoine
reconnaissaient Jean VI, tandis que Jean Paléologue, qui avait essayé
inutilement de tourner les Osmanlis de son côté, était réduit à se réfugier
dans l’île de Ténédos . La tentative qu’il fit
en mars 1353 pour débarquer à Constantinople échoua grâce à l’énergie de
l’impératrice Irène, mais il put se réfugier à Thessalonique qui tenait
toujours pour lui . Cependant sa cause
semblait perdue. Sollicité par la noblesse, Jean VI désigna pour son héritier
son fils aîné Mathieu et prononça un violent réquisitoire contre Jean
Paléologue . C’était la rupture
définitive. Le patriarche Calliste ayant refusé de couronner Mathieu et s’étant
enfui auprès de Jean V, au bout de quelques mois, Cantacuzène le remplaça par
Philothée, qui se montra plus accommodant .
Une nouvelle dynastie semblait naître et la
fortune de Jean VI était à son comble, lorsque des événements inattendus la
firent sombrer. Cantacuzène avait dû ses succès à son alliance avec
Ourkhan : elle lui manqua tout à coup. Le 2 mars 1354, « la nuit de
la fête de l’Orthodoxie » , un tremblement de
terre renversa les murailles de Gallipoli et des villes voisines. Les Osmanlis
qui se trouvaient déjà dans la péninsule s’en emparèrent . D’après le traité
conclu par Cantacuzène avec Ourkhan en 1352, ils occupaient une ville de la
Chersonèse de Thrace . La possession de
Gallipoli leur assurait le contrôle du détroit et la tête de pont qui leur
permettrait de passer facilement en Europe. Jean VI, effrayé de ce résultat,
offrit à Ourkhan une rançon pour Tzympé et le somma d’évacuer Gallipoli. Le sultan
accepta la rançon, mais déclara qu’il ne pouvait abandonner ce qu’Allah lui
avait donné et refusa d’avoir une entrevue avec le basileus .
C’était la rupture de l’alliance qui
faisait la principale force de Cantacuzène. Les conséquences ne s’en firent pas
attendre. Dès le mois de juin suivant, Soliman passait en Europe, ravageait la
Thrace et empêchait les habitants de faire la moisson . Un peu plus tard Palamas,
se rendant à Constantinople par mer, fut fait prisonnier par des corsaires
turcs et conduit à Lampsaque . Cantacuzène entièrement
découragé et que l’on rendait responsable des malheurs de l’Empire, attribués à
son alliance avec les Turcs , essaya de traiter avec
Jean V, mais ses avances furent repoussées (juin 1355) . Le dénouement était inévitable.
En novembre 1355 un corsaire génois, François Gattilusio, qui possédait deux
galères, ramena Jean V à Constantinople et put aborder à l’une des échelles de
la Propontide . A la nouvelle de
l’arrivée de Paléologue, le peuple se souleva en sa faveur et pilla l’Arsenal
des Manganes. L’émeute fut cruellement réprimée par la garde catalane , mais Jean VI assiégé
au Palais capitula et signa un traité de partage de la dignité impériale . Ce compromis fut éphémère.
A la suite d’une nouvelle émeute, Cantacuzène se dépouilla des insignes
impériaux et, après avoir revêtu la mandya, se retira au monastère des Manganes
sous le nom de Joasaph . Après un séjour au
monastère de Vatopédi au Mont Athos, il s’établit à Mistra, auprès de son fils
Mathieu (1380), et y mourut le 15 juin 1383 sans avoir jamais essayé de recouvrer
l’Empire .
5. Les Ottomans en Europe. L’Agonie de Byzance (1355-1389)
La longue période des guerres civiles
épuisa l’Empire, qui devint incapable de se relever par ses propres
forces ; mais le fait capital de la période suivante, qui dépasse le cadre
de Byzance, c’est la conquête par les Osmanlis de tous les États chrétiens des
Balkans. En fait, l’Asie Mineure étant occupée par les émirs turcs indépendants
et puissants, ce fut en Europe que se forma le premier État ottoman, qui fit
d’abord figure de puissance européenne. Le succès des Turcs est dû à
l’affaiblissement des États chrétiens et aux obstacles de tous genres que rencontra
la croisade.
Ce fut sur un État ruiné et profondément
bouleversé que régna Jean V après sa victoire : un pays mal pacifié où
subsistaient plusieurs centres de guerre civile, déchiré par les querelles
religieuses, démembré par les étrangers, exposé aux avanies de la puissance
croissante des Ottomans. Incapable de réagir, Jean V resta sur le trône le chef
d’un parti et se résigna à toutes les capitulations. Dès son avènement il est dans
la dépendance des Italiens : il cède Lesbos à François Gattilusio qui l’a
aidé à ressaisir le pouvoir (17 juillet 1355) . Il est à la merci
d’Ourkhan, son beau-frère, qui le rend responsable de la capture d’Halil, son
fils, par des pirates phocéens : malgré une démonstration navale devant
Phocée, Jean V ne peut se faire livrer le captif, dont il est obligé de payer
la rançon en signant un traité désastreux par lequel il reconnaît au sultan la
possession des villes de Thrace dont il s’est emparé . Il a enfin à lutter
contre Mathieu Cantacuzène, qui porte toujours le titre d’empereur et conserve
son apanage d’Andrinople et de la région voisine.
Après un an de guerre entremêlée de
négociations, d’intrigues, de complots, Mathieu fut livré à Jean V par un
traître et, grâce à l’intervention de son père, abdiqua solennellement la
dignité impériale (décembre 1357) .
Mathieu Cantacuzène, accompagné de
l’ex-empereur, se retira en Morée, auprès de son frère le despote Manuel que
Jean VI y avait envoyé pour rétablir l’ordre troublé par les pirateries des
Turcs et les discordes entre les indigènes . En face de l’Achaïe
latine, la Morée byzantine devint alors une province autonome qui, même après
la chute de Jean VI, resta l’apanage des Cantacuzènes. Manuel rétablit la paix
entre les archontes et équipa une petite flotte pour lutter contre la
piraterie . A sa mort en 1380, son
frère Mathieu lui succéda sans opposition de la part de Jean V et Mathieu
lui-même, qui mourut en 1383 peu de temps avant son père, transmit la Morée à
son fils Démétrius. Celui-ci essaya de s’affranchir de l’autorité de
Constantinople et Jean V dut envoyer contre lui son fils Théodore Paléologue
avec une armée. Après une lutte qui dura un an, Démétrius étant mort, Théodore
reçut le gouvernement de la Morée, et jusqu’à la chute de l’Empire ce fut
toujours un cadet de la dynastie régnante qui y exerça l’autorité . Sous l’administration
des despotes la Morée devint le véritable foyer de l’hellénisme et Mistra, sa
capitale, attira les lettrés et les artistes du monde byzantin tout entier.
Malgré la prospérité, toute relative
d’ailleurs, de cette lointaine colonie de Constantinople, l’autorité du pouvoir
impérial n’en était pas moins précaire. Jean V ne put même pas apaiser les
querelles religieuses qui atteignaient leur paroxysme au moment de sa
restauration. A son approche, le patriarche Philothée avait pris la fuite et
Calliste fut rétabli sur son siège, tandis que Nicéphore Grégoras était délivré
de sa captivité . Jean V était
défavorable à Palamas, mais il ne voulait pas de persécution et l’impératrice
Hélène, stylée par son père, réussit à empêcher le débat public que Grégoras
voulait avoir avec Palamas . Une controverse n’en
eut pas moins lieu entre les deux adversaires en présence du légat d’Innocent
VI, Paul, archevêque de Smyrne. Palamas eut le dessous , mais Grégoras fut dès
lors en butte à une série d’attaques calomnieuses dans de nombreux pamphlets
que Jean Cantacuzène paraît avoir inspirés et, lorsqu’il mourut
vers 1360, les Palamites s’acharnèrent odieusement sur son cadavre, qu’ils traînèrent
dans les rues de Constantinople .
Telle est la triste situation de l’État
byzantin après la restauration de Jean V. Les Vénitiens la considèrent comme
désespérée et voient déjà en lui l’homme
malade, dont la succession est à la veille de s’ouvrir. L’un d’eux, Marino
Faliero, conseille au doge de s’emparer de Constantinople s’il ne veut pas voir
tomber l’Empire aux mains des Turcs . Et c’est juste à ce
moment que disparaît l’un de ceux qui semblaient avoir le plus de chance de
recueillir cet héritage. Le tsar serbe Étienne Douschan, dont les projets
grandioses de fusion entre le peuple serbe et les Grecs ont été signalés, meurt
prématurément à l’âge de 47 ans, le 20 décembre 1355 . D’après des sources de
date postérieure, que ne confirme aucun témoignage contemporain, il aurait été
à la veille d’entreprendre une grande expédition contre Constantinople . Ce qui est certain,
c’est que sa mort fut le signal de la dissolution de son État, composé de
provinces disparates, dont les voiévodes (gouverneurs) supportaient mal son
autorité et profitèrent de sa disparition pour se rendre indépendants .
La mort de Douschan laissait le champ libre
aux Ottomans, aucun autre État balkanique n’étant capable de revendiquer
l’hégémonie dans la péninsule. La Bulgarie était affaiblie par l’agitation
bogomile et par la crise qui suivit le divorce de Jean-Alexandre d’avec la Roumaine
Théodora et ses secondes noces avec la juive Rébecca. Il dut partager ses États
entre les enfants de ses deux unions, et après sa mort (1365) éclata entre eux
une guerre civile qui permit aux Hongrois d’occuper Vidin et aux Turcs
d’intervenir dans leurs querelles .
Au-delà du Danube apparaît dans la première
moitié du xive siècle un
État nouveau, qui se rattachait par sa langue latine et ses traditions à la
Rome impériale des Antonins, la principauté valaque. Dès la fin du xiiie siècle, des voiévodes
valaques vassaux de la Hongrie avaient essayé sans y réussir de se rendre
indépendants. Cette tentative fut reprise avec succès par le voiévode d’Arges,
Basarab Ier (1310-1352), qui étendit son autorité sur les autres
voiévodes et se rendit indépendant des Hongrois par la victoire qu’il remporta
sur eux à Potada en 1330. Le « grand Basarab » fut donc le véritable
fondateur de l’État valaque et son tombeau a été retrouvé dans l’église
princière d’Arges, qu’un de ses successeurs, Radu Negru, fit orner de fresques
par des peintres qui s’inspirèrent des remarquables mosaïques de Kahrié-Djami à
Constantinople (vers 1375-1387) .
Un peu auparavant, un chef roumain de la
région du Maramures au nord de la Transylvanie avait conquis vers 1360 la
vallée de la Moldava et, après en avoir chassé le gouverneur hongrois, fondé la
principauté de Moldavie . Situés entre la
Hongrie et les pays yougoslaves, les États valaque et moldave devaient
intervenir comme un élément nouveau dans les affaires des peuples balkaniques,
également menacés comme eux par les Hongrois et les Turcs.
Enfin la Hongrie, sous la dynastie angevine
de Naples, est un État féodal bien organisé qui dispose de forces militaires
importantes. Son roi Louis le Grand (1342-1382) a une politique active dans la
péninsule balkanique, mais il a un rôle néfaste en contrariant la formation des
principautés roumaines, en prenant part au démembrement de la Serbie, à
laquelle il enlève Belgrade, et surtout de la Bulgarie qu’il ampute de la
principauté de Vidin. A Venise il ravit la Dalmatie par la paix de Turin
(1381). Il fait servir à des fins politiques la croisade, dont il se proclame
le chef, et ne comprend pas l’intérêt qu’il aurait à défendre les États slaves
contre les Turcs .
Ainsi, au milieu du xive siècle, tous les États chrétiens des Balkans
sont affaiblis par leurs discordes intestines. La Hongrie, qui pourrait les
défendre, poursuit des fins particulières. Ils sont mûrs pour la conquête
ottomane.
L’offensive ottomane. — Pendant que
les chrétiens étaient déchirés ainsi par les guerres civiles, les Osmanlis
passaient du régime de la tribu à celui de l’État régulier. Ourkhan paraît en
avoir été l’organisateur : la tolérance religieuse, le service militaire
obligatoire, mais réservé aux musulmans et remplacé pour les chrétiens par une
lourde capitation, tels en sont les traits essentiels. En fait, les conversions
à l’islam, encouragées, furent très nombreuses et, par suite des unions entre
musulmans et chrétiennes, il se forma, en même temps qu’un État, un peuple
ottoman. Il en résulta que l’armée eut un caractère national qui lui donnait une
grande supériorité sur les troupes mercenaires de cette époque. Elle était déjà
remarquable par la solidité de ses cadres, son dévouement absolu au sultan et
sa rapidité .
L’occupation de Gallipoli permit à Ourkhan
d’envahir la Thrace par une série d’expéditions, sur la chronologie desquelles
on est mal fixé et qui furent conduites par les fils du sultan Soliman, qui
mourut après 1357, et son frère Mourad. Leur objectif était Andrinople :
ils s’emparèrent successivement des places qui en défendaient les abords,
Tchorlou, Didymotika, Kirk Kilissé qui furent prises et reprises plusieurs
fois. Une bataille décisive eut lieu au nord-est de Lulle Bourgas et la
victoire des Turcs entraîna la chute d’Andrinople (1361) . Ourkhan mourut après
la prise de cette ville en mars 1362 . En quelques mois la
Thrace avait été conquise et Constantinople coupée de ses communications
terrestres avec l’intérieur de la péninsule balkanique.
Ce n’était là qu’une première étape, et
l’un des premiers actes du successeur d’Ourkhan, le sultan Mourad, fut de
perfectionner son instrument de guerre par la création des janissaires, jeunes
chrétiens enlevés à leurs familles, convertis à l’islam et organisés en une
milice qui devint l’élément
essentiel de l’infanterie turque et forma la garde favorite du sultan. Jean V,
dépourvu de troupes, dut se résigner à la perte de la Thrace et en reconnut la
possession à Mourad en lui promettant son secours contre les émirs turcs
d’Anatolie (1362-1363) . Jean V essaya trop
tard de s’entendre avec la Serbie : une ambassade du patriarche Calliste,
qui fut reçue par la veuve de Douschan à Serrès (1363-1364) , ne produisit aucun
résultat. En revanche la première consécration de la puissance ottomane dans
les Balkans fut le traité de commerce conclu par Mourad avec la république de Raguse ; et pour bien
montrer que sa conquête de la Thrace était définitive, il transporta de Brousse
à Andrinople le siège de son gouvernement et sa résidence . L’État ottoman est
déjà l’une des principales puissances de la péninsule balkanique.
L’appel à l’Occident. La croisade. — Ne pouvant
compter ni sur les Serbes, ni sur les Bulgares, Jean V reprit le projet d’union
religieuse agité si souvent depuis Andronic III, condition indispensable d’une
croisade contre les Turcs. Les pourparlers entre Anne de Savoie, puis Jean
Cantacuzène et le pape Clément VI (1342-1352) avaient été tout à fait stériles,
le pape subordonnant tout envoi de secours à l’abjuration du schisme et l’alliance de
Cantacuzène avec les Ottomans étant un obstacle insurmontable à une
entente .
Jean V au contraire avait pour l’Union
toute l’ardeur que lui avait inspirée Anne de Savoie. Dans un chrysobulle du 15
décembre 1355 il jure de rester personnellement fidèle au Saint-Siège et
propose d’établir à Constantinople un légat permanent avec autorité sur les
nominations aux dignités ecclésiastiques : un de ses fils sera envoyé en
otage à Avignon, mais le pape organisera une croisade dont le basileus serait
le chef . Telles furent les
propositions que Jean V envoya à Innocent VI. Jamais aucun basileus n’avait
fait de pareilles concessions à Rome et n’avait offert des garanties aussi
sérieuses d’exécution . Mais les défiances du
pape qui fit à ces propositions un accueil réservé, la difficulté avec laquelle
il se procura quelques galères, l’impossibilité où était Jean V d’imposer
l’Union à son clergé sans préparation firent encore échouer ce plan . Tout se borna à une
petite expédition navale du légat Pierre Thomas, qui reprit temporairement
Lampsaque .
Ce fut après son traité désastreux avec
Mourad que Jean V fit un nouvel appel à l’Occident, mais le pape Urbain V
(1352-1362), qui préparait une croisade en Terre Sainte, se montra d’abord peu
favorable aux Grecs . Son revirement fut dû
probablement aux correspondances secrètes qu’il eut avec des Grecs partisans de
l’union comme Démétrius Cydonès et aussi à la déception
causée par la croisade du légat Pierre Thomas et du roi de Chypre Pierre de
Lusignan, qui s’emparèrent d’Alexandrie (10 octobre 1365), mais ne purent s’y
maintenir plus de 6 jours . Le 25 janvier 1365 le
pape proclamait la croisade destinée à délivrer la Romania des Turcs et,
d’après le plan qu’il élaborait, le roi Louis de Hongrie devait attaquer les
possessions ottomanes en Europe, Pierre de Lusignan et Amédée VI, comte de
Savoie, diriger une expédition maritime contre les positions turques Mais le roi de Chypre
fit défaut et, pour s’entendre avec Louis d’Anjou, Jean V fit en personne le
voyage de Bude, premier exemple d’un basileus allant quêter lui-même les
secours des Occidentaux . Pour achever son
humiliation, le prince bulgare de Sofia, Šišman, lui ferma la
route de Constantinople à son retour et il dut attendre à Vidin le libre
passage .
Cet événement fit échouer la croisade générale.
Le comte de Savoie, Amédée VI, cousin germain de Jean VI, partit le premier sur
des galères vénitiennes afin d’aller délivrer
le basileus. Son principal exploit fut la prise d’assaut de Gallipoli (2 août
1366), qui ne pouvait que gêner les Turcs sans menacer en rien leurs possessions
européennes, mais dégageait la route maritime de Constantinople . Après une expédition
contre les ports bulgares de la mer Noire, ce qui décida Šišman à laisser passer
Jean V (fin de 1366), et l’attaque de quelques châteaux turcs de 1’Hellespont
(mai 1367), le comte de Savoie regagna ses États . Mais cette expédition
n’était regardée que comme la préface de la croisade générale, qui devait être
précédée de l’abjuration de Jean V entre les mains du pape et de l’union des
Églises . De son côté le roi de
Hongrie, craignant une alliance gréco-bulgare, ne songea pas un instant à
accomplir son vœu de croisade . De l’immense effort
militaire et diplomatique tenté par le pape il restait l’espoir d’un
rapprochement entre les deux Églises, mais à Constantinople les esprits restaient
divisés sur les moyens de résister aux Turcs. Le basileus et sors entourage ne
voyaient d’autre espoir de salut que la croisade le patriarche Philothée et le
clergé envisageaient au contraire une ligue de tous les États orthodoxes contre
les Turcs.
Le voyage et l’abjuration de Jean V
(1369-1371). — Suivant les engagements qu’il avait pris, mais avec un an
et demi de retard, Jean V quitta Constantinople vers le mois d’avril 1369 et
aborda à Castellamare le 7 août . Urbain V venait
d’abandonner Avignon et se dirigeait vers Rome où il voulait rétablir le Siège
apostolique . Dans le courant du
mois d’août il reçut à Viterbe le patriarche latin Paul de Smyrne et Démétrius
Cydonès, envoyés par Jean V pour lui annoncer son arrivée Le 13 octobre le pape
faisait son entrée à Rome où il trouvait le basileus qui l’attendait . Le 18 octobre Jean V
faisait dresser et signait par-devant notaire la profession de foi dont Urbain
V lui avait envoyé le modèle en 1366 et la remettait aux quatre cardinaux
désignés par le pape . Le dimanche 21 octobre
Urbain V recevait solennellement l’abjuration de Jean V sur les marches de
Saint-Pierre .
Cette abjuration fut totale. Elle porta sur
toutes les questions qui divisaient les deux Églises, dogmes, rites,
disciplines. Jean V alla jusqu’à renier les usages liturgiques de la religion
nationale de ses sujets. Il devint un pur Latin . Mais l’acte du
basileus était strictement personnel et n’engageait en rien l’Église grecque . Surtout il n’eut
aucune portée pratique et ne provoqua pas la croisade qui, d’après les
promesses du pape, devait en être la conséquence.
Sans doute Jean V fit les plus grands
efforts pour intéresser l’Occident à la cause de Constantinople. Urbain V
invitait tous les fidèles à aider « le nouveau Constantin » et autorisait le
basileus à enrôler plusieurs bandes de routiers qui guerroyaient en
Italie , mais le roi de Hongrie
continuait à se désintéresser du sort de Byzance sans que le pape fît rien pour
le décider à intervenir. Restait Venise, dont la politique vis-à-vis des Grecs
s’était complètement modifiée depuis que Constantinople était menacée de tomber
aux mains des Turcs : abandonnant tout projet de restauration de l’Empire
latin, les Vénitiens étaient les partisans les plus actifs d’une croisade
destinée à sauver la Romania byzantine .
Ce fut donc à Venise que s’adressa Jean
V ; mais avant toute conclusion d’une alliance, il fallait d’abord aplanir
les difficultés qu’il avait avec la République : renouvellement des
trêves, modalités à établir pour le paiement des dettes de l’empereur qui
s’élevaient à 35 000 ducats. Tel fut l’objet du traité signé par Jean V à
Rome avec les ambassadeurs de Venise et qui n’était dans sa pensée que l’amorce
d’une alliance qu’il irait conclure en personne avant son retour à Constantinople
(1er février 1370) .
Arrivé à Venise dans l’hiver de 1369-1370,
il devait y séjourner jusqu’au printemps de 1371. Pour décider les Vénitiens à
traiter, il offrait de leur céder l’île de Ténédos, position de premier ordre à
l’entrée des Dardanelles, que Venise convoitait depuis qu’en 1352 Jean V la lui
avait cédée en principe . En échange il exigeait
la restitution des joyaux de la couronne impériale mis en gage, la fourniture
de navires de transport et une avance de 25 000 ducats. Venise accepta ces
conditions et fit même de nouvelles avances à Jean V avant son départ sur la
flottille fournie par la République en avril 1371 . L’annonce d’une
nouvelle offensive de Mourad avait décidé le Sénat à en passer par là .
D’après une légende qui ne se trouve que
dans des chroniqueurs du xve siècle, Phrantzès, Doukas, Chalcokondyle, l’empereur, ne pouvant acquitter ses
dépenses courantes aux termes convenus, aurait été enfermé dans la prison pour
dettes. Son fils aîné Andronic, resté à Constantinople, aurait refusé de le
secourir et ce serait son frère cadet, Manuel, qui aurait trouvé la somme
nécessaire à sa mise en liberté . Cette anecdote
ridicule a été recueillie par la plupart des historiens ; elle est en
contradiction avec tout ce que les documents contemporains nous apprennent des
rapports entre le Sénat vénitien et le basileus . La vérité est que
Manuel se trouvait à Venise avec son père , qui dut l’y laisser
comme garant de ses dépenses, « augmentées par la cupidité des
marchands », et le récompensa en lui donnant en apanage Thessalonique et
la Macédoine, par un chrysobulle dont les termes ont pu donner naissance à
cette légende.
L’échec de la croisade orthodoxe. — A la croisade
occidentale le patriarche Philothée voulut opposer une croisade de toutes les
puissances orthodoxes. Pendant le séjour de Jean V en Italie il ne cessa de
contrecarrer la politique impériale en empêchant le clergé de se rallier à
l’Union. Par ses interventions, dans les patriarcats orientaux, en Russie, où
il exhorta tous les princes à reconnaître le pouvoir du grand prince de Moscou,
en Serbie, où il obtint du despote Uglieša la réunion de l’Église
serbe au patriarcat œcuménique, en Valachie enfin, où il combattit les
tendances romaines, il chercha à réunir dans un même faisceau tous les États
orthodoxes afin de les opposer à la fois à la conquête turque et à l’ingérence
du Saint-Siège .
Cependant les circonstances étaient
défavorables et, loin de s’unir aux États orthodoxes, les princes bulgares
successeurs de Jean-Alexandre continuaient à se quereller et à attirer ainsi
les Turcs dans leurs États. Vers 1369 Mourad occupait Sozopolis, forteresse qui
commandait l’entrée du port de Bourgas et forçait Šišman à se déclarer son
vassal et à envoyer sa sœur dans son harem, puis avec des troupes ottomanes Šišman chassa les Hongrois de Vidin et permit ainsi aux Osmanlis
de faire leur première apparition sur le Danube (1370).
Ce fut seulement alors que les Serbes
s’alarmèrent des progrès turcs. Deux frères d’origine dalmate, Jean Ugliešia et Vukasin, anciens dignitaires de la cour de Douschan, devenus indépendants
après sa mort, dans la province située entre Serres et le Danube, qu’ils
avaient été chargés d’administrer , réunirent une armée
composée de Serbes, de Hongrois, de Valaques et envahirent le territoire turc.
Surpris au moment où ils traversaient la Maritza, ils furent complètement
écrasés le 26 septembre 1371 par une force ottomane inférieure en nombre et périrent
dans le combat . Les Grecs n’avaient
pas songé à soutenir les Serbes et profitèrent même de leur défaite : ils
réoccupèrent Serrès qui fut administrée par le despote Manuel Paléologue
(novembre 1371) . Peu après Šišman,
cherchant à s’opposer à la marche des Turcs vers Sofia, s’allia aux Serbes et
subit à Samakov dans la vallée de l’Isker une défaite totale, qui l’obligea à
s’enfuir avec son allié dans les massifs les plus élevés du Rhodope . La route de Sofia
était ouverte, mais avec un sens stratégique remarquable, Mourad ne voulut pas
s’y engager avant d’avoir soumis les vallées du Strymon et du Vardar.
La conséquence de cette défaite fut
désastreuse pour la Bulgarie, qui cessa d’exister comme État indépendant, et
pour la Serbie, dont Mourad acheva la conquête en quelques mois (1372).
Successivement toutes les villes de la Macédoine serbe, Kavalla, Drama, etc.,
furent occupées et colonisées ; leurs églises furent changées en mosquées
et des timariots (fiefs militaires)
furent établis dans la Macédoine orientale. Les Turcs s’élancèrent ensuite dans
la vallée du Vardar, soumirent la Vieille Serbie, une partie de l’Albanie et de
la Bosnie jusqu’aux montagnes d’où ils aperçurent l’Adriatique. Mourad laissa
comme vassaux les dynastes serbes qui s’étaient partagé l’empire de Douschan.
Le fils de Vukašin, Marko Kralievič, le héros des
légendes serbes, conserva le titre de Kral, mais dut amener ses contingents
pour combattre aux côtés des troupes ottomanes .
Ainsi s’étaient évanouis les espoirs
chimériques du patriarche Philothée : loin de s’unir, les puissances
orthodoxes s’étaient fait battre séparément.
Faillite de la croisade occidentale. — Ces événements
rendaient encore plus précaire la situation de Constantinople, mais Jean V
n’avait pas perdu l’espoir de provoquer le départ d’une croisade. Le successeur
du pape Urbain V, Grégoire XI , à la nouvelle de la bataille
de la Maritza, chercha à déterminer le roi de Hongrie et la république de
Venise à intervenir (mai 1372) et convoqua à Thèbes, occupée par les Catalans,
un congrès de tous les États chrétiens d’Orient. Or ce congrès, qui devait se
tenir en octobre 1373, ne se réunit jamais . De son côté Jean V
envoyait en Occident un des meilleurs auxiliaires de l’Union, Jean Lascaris
Kalopheros , qui se présentait
successivement à Avignon et à Paris, à la cour de Charles V, en Hongrie, à
Louis d’Anjou . Il ne rapporta que de
vagues promesses. Le pape faisait du moins des efforts pour constituer une
nouvelle escadre internationale, mais envoyait des nonces à Constantinople
(octobre 1374), pour déclarer à Jean V que son action serait facilitée si
l’Église grecque se réunissait à Rome. Il était déjà trop tard : lorsque
les nonces pontificaux lui parvinrent, Jean V, abandonné de tous, avait traité
avec Mourad et sa cour venait d’être le théâtre d’une tragédie domestique . Ce fut en vain que
dans les années suivantes (1375-1376) le pape fit prêcher la croisade dans
toute l’Europe en vue de sauver Constantinople . L’indifférence et les
divisions des États chrétiens furent les meilleurs auxiliaires des Turcs.
Jean V, vassal du sultan. — D’après le
traité qu’il avait conclu avec Mourad avant juillet 1374 , Jean V devenait le
vassal du sultan et il informait le pape de sa décision par une ambassade qui arrivait
à Avignon en décembre 1374 . Au même moment Jean V
écartait de sa succession son fils aîné Andronic et associait son cadet, Manuel,
à l’Empire . Qu’il y ait eu un
rapport entre les deux événements, que Manuel ait été préféré par Mourad à
Andronic, c’est ce qui n’est pas invraisemblable , mais on doit constater
que de toute manière Manuel était le fils favori de Jean V.
La réaction ne
se fit pas attendre. Andronic se vengea, semble-t-il, doublement en entraînant
dans la conjuration qu’il forma pour détrôner son père le propre fils de
Mourad, Saoudj. Le complot découvert, le sultan fit aveugler son fils et
ordonna à Jean V de punir le sien de la même peine. Grâce à la manière dont
l’opération fut faite, Andronic ne perdit qu’un œil et son fils, Jean, encore
enfant, condamné au même supplice, aveuglé incomplètement .
Andronic et sa famille furent tenus en
prison à Lemnos jusqu’en 1376, mais une nouvelle querelle entre Gênes et Venise
vint renverser la situation. Sous la menace d’une escadre vénitienne, Jean V
avait dû tenir sa promesse et céder Ténédos à la République. Les Génois,
irrités, aidèrent Andronic à s’évader de sa prison avec l’aide de Mourad. Le 12
août 1376 Andronic entrait à Constantinople, emprisonnait Jean V et
l’impératrice , cédait Ténédos à
Gènes, faisait arrêter tous les Vénitiens de Constantinople et restituait
Gallipoli aux Turcs . Les Vénitiens n’en
occupèrent pas moins Ténédos et une expédition des Génois et d’Andronic IV ne
put les en déloger .
Le règne désastreux d’Andronic dura près de
trois ans (1376-1379). Jean V et Manuel, délivrés de leur prison par les
Vénitiens, rentrèrent à Constantinople le 1er juillet 1379. Andronic
se retira à Galata, puis, abandonné de ses partisans, alla se jeter aux pieds
de son père, qui lui pardonna et lui attribua en apanage Selymbria, où il
mourut en 1385 .
L’hégémonie ottomane dans les Balkans. — Avec une
véritable rouerie Mourad avait attisé les discordes de la famille impériale en
favorisant tour à tour chacun des adversaires. Il était désormais tout-puissant
et la situation de Constantinople paraissait désespérée. « Tous ceux qui
sont hors des murs de la ville sont asservis aux Turcs, écrivait Démétrius
Cydonès à Kalopheros vers 1378, et ceux qui sont à l’intérieur succombent sous
le poids des misères et des révoltes . » Les chrétiens
découragés ne songent plus à la croisade et les républiques italiennes, en
dépit des menaces du pape, concluent des traités avec le sultan .
Cependant les ambitions de Mourad ne sont
pas satisfaites. Jean V possède toujours une partie de la Macédoine, dont la
capitale, Thessalonique, gouvernée par son fils Manuel, associé à la couronne,
et la ville importante de Serrès. Malgré le traité qu’il a conclu avec lui,
Mourad est décidé à les lui enlever et fait occuper Serrès par Khaireddin (19
septembre 1383) , mais Manuel
Paléologue, qui songe à chasser les Turcs de Macédoine, s’associe à un complot
des nobles de Serrès pour massacrer la garnison ottomane de la ville. Mis au
courant, Mourad fit assiéger Thessalonique, mais la ville, restée libre du côté
de la mer, se défendit pendant quatre ans (1383-1387) . La perte de la seconde
ville de l’Empire fut la cause d’une nouvelle discorde entre les Paléologues.
Jean V rendit Manuel responsable de ce désastre, lui enleva tous ses honneurs
et l’exila dans l’île de Lemnos . La réconciliation eut
lieu à la fin de 1388, vraisemblablement par l’intervention de Mourad, dont
Manuel avait sollicité le pardon et qui continuait son jeu de bascule entre les
Paléologues .
Pendant ce temps les Osmanlis continuaient
la conquête de la partie occidentale de la péninsule balkanique, d’abord du
bassin du Vardar, Ištip, Monastir, Prilep (1380),
puis d’Ochrida, par Khaireddin qui fut sollicité par Charles Thopia, seigneur
de Durazzo, de l’aider contre un chef albanais (1385) . Les Ottomans saisirent
cette occasion de pénétrer chez les Skipétars, divisés en clans guerriers dont
les chefs puissants, les Thopia dans l’Albanie du nord, les Ducagin dont le
territoire touchait à l’Adriatique et qui étaient les clients de Venise, les
Balcha qui depuis la mort de Douschan refoulaient vers le nord les voiévodes
serbes, quittaient l’Église orthodoxe, pour se soumettre à Rome, et attaquaient
la Bosnie avec succès (1379) . Ce fut contre les
Balcha que Khaireddin se dirigea à l’appel de Charles Thopia. Les autres chefs
albanais, indignés de cette trahison, avaient fait cause commune avec les
Balcha, mais les forces albanaises ne purent tenir contre les Ottomans, qui
remportèrent une victoire décisive à Sawra près d’El-Bassan (1385) et s’emparèrent
l’année suivante de Croïa et de Scutari. Ce fut à partir de ce moment qu’un
grand nombre d’Albanais convertis à l’islam formèrent un élément important de
l’armée ottomane .
Au même moment Mourad cherchait à s’emparer
des passages qui permettent d’atteindre le Danube. Avec un sens stratégique
remarquable il occupa les deux principaux nœuds des routes de la péninsule, qui
donnent accès à volonté à l’Adriatique, à la mer Égée ou au Danube, le bassin
et la ville de Sofia conquis sur les Bulgares (1386), et la ville de Nisch
enlevée aux Serbes l’année suivante .
L’État ottoman semblait au faîte de sa
puissance et ne rencontrait plus de résistance chez les chrétiens : avec
des méthodes simples et primitives il arrivait à régir un ensemble complexe de
nations . Cependant le prince
Lazare, successeur sur le trône serbe du fils de Douschan, qui avait dû
accepter la suzeraineté ottomane, supportait impatiemment le joug turc et
préparait un soulèvement avec l’appui du roi de Bosnie, Turkto . Mourad ayant envoyé
une expédition contre la Bosnie (1388), une forte armée de Serbes et de Bosniaques
barra la route aux envahisseurs à Plochnik dans la vallée de la Toplitsa. La
plus grande partie de l’armée ottomane fut massacrée et, à la suite d’autres
victoires remportées par les alliés à Rudnik et à Bileče (27 août) , il y eut une révolte
générale dans la péninsule. L’Albanais Georges Castriota , tous les dynastes
serbes, les princes bulgares Šišman et Ivanko, dénonçant
leurs traités avec Mourad, ainsi que le prince de Valachie, se serrèrent autour
de Lazare .
Mourad différa sa vengeance et chercha
d’abord à dissocier les alliés. Une expédition d’Ali-pacha contre la Bulgarie
vint à bout de Šišman, qui fut trop heureux d’avoir la vie sauve et de
conserver une partie de son territoire . Ce fut seulement au
printemps de 1389 que Mourad en personne envahit la Serbie moravienne, accompagné
de plusieurs vassaux serbes. De Kruševac l’armée de Lazare, dans laquelle
se trouvaient les troupes de sept nations chrétiennes, atteignit l’armée
ottomane dans la plaine de Kossovo (Champ des Merles). La lutte fut longue et
acharnée ; l’aile gauche des Turcs fut d’abord rompue par une charge de la
chevalerie alliée, mais Bajazet, fils de Mourad, rallia son armée. Un noble
Serbe, Milos Obilič, parvint jusqu’à la tente
du sultan et le poignarda. La bataille était indécise, quand la défection de
Vuk Brankovič, gendre de Lazare, qui abandonna le champ de
bataille avec 32 000 hommes, assura la victoire des Turcs (15 juin
1389) . C’en était fait de
l’indépendance serbe, mais, de plus, la seule force qui pût encore s’opposer à
la conquête ottomane de la péninsule des Balkans était anéantie. Le sort de
Byzance semblait fixé.
LIVRE TROISIÉME. AGONIE ET MORT DE BYZANCECHAPITRE II. — La lutte suprême
(1389-1453)
|