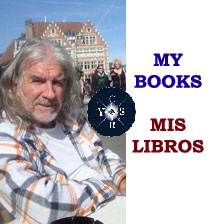 |
BIZANTIUM |
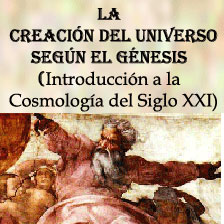 |
Louis Brehier. Le monde byzantin :Vie et mort de ByzanceLIVRE TROISIÈME. Agonie et mort de ByzanceChapitre II .La lutte suprême (1389-1453)
1. L’Héritage de Byzance (1389-1402)
Le sultan Bajazet. — Proclamé
sultan sur le champ de bataille de Kossovo, Bajazet, fils de Mourad, commença
son règne en faisant étrangler son frère Yakoub, dont il redoutait la
popularité dans l’armée, et ce fut là le point de départ d’une tradition
sanglante.
Mourad lui laissait les éléments d’un
empire en formation qui comprenait plus de princes vassaux que de territoires
annexés. Sa force résidait dans l’armée, admirablement organisée, avec une
place nouvelle donnée à l’infanterie, et grossie des contingents des vassaux,
ce qui lui donnait le caractère international des armées byzantines. Cet empire
en formation, Bajazet voulut le constituer définitivement et lui donner la même
étendue que celle de l’ancien Empire byzantin. L’État de Mourad était presque
entièrement européen. Bajazet revendiqua l’héritage de Byzance tout entier et
ses efforts tendirent à s’installer dans son domaine géographique, à joindre la
possession totale de l’Asie Mineure à celle de la péninsule des Balkans. Dès
son avènement, il se proposa donc trois buts : réduire en vasselage ou
détrôner les princes chrétiens encore indépendants ; soumettre les émirs
turcs d’Asie Mineure restés puissants ; couronner cette œuvre par
l’occupation de Constantinople, devenue la capitale d’un grand empire musulman.
Il allait réussir lorsque l’invasion soudaine de Timour vint mettre son État en
pièces.
Politique
ambitieux, impitoyable ou modéré suivant son intérêt, Bajazet n’eut d’autre
tactique vis-à-vis des Paléologues que d’exiger d’eux l’accomplissement strict
de leurs obligations de vassaux, de les humilier en paralysant chez eux toute
initiative, de s’immiscer dans leurs querelles et de favoriser la discorde
entre eux. C’est ainsi qu’avant sa campagne contre les émirs d’Anatolie, il
exige de Jean V le paiement d’un tribut et l’envoi de Manuel avec 100 cavaliers
pour prendre part aux opérations de l’armée ottomane . C’est lui, de même,
qui favorise la révolte du fils d’Andronic IV, Jean, qui, s’étant échappé de
Gênes, où Manuel l’avait fait envoyer en ambassade, entra à Constantinople le
14 avril 1390 et put s’y maintenir jusqu’au 7 septembre suivant. Jean V avait
pu se réfugier dans le fort construit près de la Porte d’Or. Manuel, qui se
trouvait à Lemnos, réunit quelques forces et chassa l’usurpateur. Celui-ci se
réfugia auprès de Bajazet, qui lui donna le district de Selymbria .
La malveillance du sultan vis-à-vis des
Paléologues se manifestait de plus en plus. Ce serait à cette époque que
Philadelphie, la seule ville d’Asie Mineure échappée jusque-là aux Osmanlis,
aurait été assiégée et prise par Bajazet qui aurait forcé Jean V et Manuel à
concourir au siège de leur propre cité . Tout à fait certain
par contre est l’ultimatum envoyé à Jean V qui avait fait construire une forteresse
entre la Porte d’Or et le rivage de la Propontide : Bajazet lui ordonnait
de la détruire en le menaçant de crever les yeux à Manuel, présent à sa
cour ,
mais le 16 février 1391, Jean V mourait à l’âge de 61 ans et, à cette nouvelle,
Manuel s’échappa de Brousse, à la grande colère du sultan. Bajazet fit bloquer
Constantinople pendant sept mois et attaqua la Morée ; gouvernée par
Théodore Paléologue, frère de Manuel, puis, ayant besoin de son armée, il
imposa au nouveau basileus des conditions draconiennes : augmentation du
tribut, colonie musulmane et mosquée avec minaret et muezzin à Constantinople,
garnison turque à Galata : tel fut le don de joyeux avènement que reçut
Manuel Paléologue .
A part la
Bithynie et une petite partie de la Lydie et de la Phrygie, le jeune État
ottoman était presque entièrement européen. Les émirs d’Anatolie, dont
l’indépendance datait du démembrement de l’Empire seldjoukide et qui avaient
joué un rôle important dans les guerres civiles de Byzance, étaient restés
assez puissants pour tenir l’État ottoman en échec et quelques-uns, comme le
Grand Karaman Alaeddin, gendre de Mourad, avaient sur lui l’avantage de
posséder une marine. En 1387 Mourad essaya de lui enlever quelques territoires,
mais, après une bataille indécise près de Konieh, il lui accorda la paix . Bajazet commença une
lutte de plus grande envergure. N’ayant pas de flotte, il attaqua les émirs
maritimes par terre, força ainsi l’émir d’Aïdin à devenir son vassal, puis
l’interna à Brousse . En 1391 il essaya de
s’emparer de Smyrne, toujours occupée par les Hospitaliers depuis la croisade
de 1345 , mais dut se contenter
d’en faire le blocus. Après l’occupation des émirats maritimes de Saroukhan et
Menteshe, la puissance ottomane atteignait l’Archipel et Bajazet faisait
construire une flotte de guerre, dont le premier exploit fut la dévastation de
Chio, de Nègrepont et des rivages attiques. Adalia, enlevée en 1391 à l’émir de
Tekke, fut le premier port ottoman sur la Méditerranée .
Restait l’émir de Karamanie, isolé en face
des Ottomans après la défaite de ses congénères. Bajazet convoqua ses vassaux
européens, dont Manuel Paléologue, à Angora (hiver de 1391) et assiégea
Iconium, capitale d’Alaeddin, qui se réfugia dans le Taurus. Inquiet des
affaires d’Europe, Bajazet consentit à lever le siège moyennant une cession de
quelques territoires, mais à peine était-il parti qu’Alaeddin reprenait les
places cédées et attaquait la frontière ottomane. Avec une extraordinaire
célérité Bajazet, vainqueur des Hongrois, transporta son armée en Anatolie et
sa seule apparition à Brousse détermina Alaeddin à demander la paix. Loin de la
lui accorder, le sultan saisit cette occasion d’en finir avec lui. Battu non
loin de Kutayeh, Alaeddin fut pris et étranglé, et la Karamanie fut occupée
sans résistance (1392) . Vers 1395 l’émir de Cappadoce
Bourhaneddin fut attaqué à son tour et dut céder à Bajazet Césarée et
Siwas ; peu après, pour ne pas devenir le vassal du sultan, l’émir de
Kastamouni s’enfuyait chez les Mongols, et les Ottomans atteignaient la mer
Noire en occupant les ports de Samsoun et de Sinope .
En réalité, bien que, sauf l’État de
Trébizonde, l’Asie Mineure fût presque entièrement musulmane et turque , la conquête asiatique
de Bajazet était beaucoup moins solide que ses conquêtes européennes, comme les
événements allaient le montrer.
Ses campagnes
en Asie n’empêchèrent pas Bajazet de continuer les entreprises de Mourad dans
la péninsule balkanique et d’en achever la conquête. Après Kossovo, il vengea
d’abord le meurtre de son père par le supplice horrible infligé au prince
Lazare et aux chefs serbes prisonniers , mais il traita bien le
fils de Lazare, Étienne Bulcovič, dont il fit son vassal,
et, estimant la valeur militaire des Serbes, il s’attacha à les incorporer dans
son armée . Il respecta d’abord
l’indépendance de la Bosnie sous le roi Turkto, maître de la Croatie,
conquérant de presque toute la Dalmatie (1387-1388) et organisateur d’une
marine qui portait ombrage à Venise, lorsqu’il mourut en 1391, sans avoir
essayé de secourir les Serbes ; mais sous son successeur la Bosnie devait
perdre toutes ses conquêtes et se trouver isolée en face des Ottomans .
Ce fut après sa première campagne en Asie
que Bajazet fit envahir en même temps la Bosnie et la Valachie, dont le prince
Mircea le Grand était l’un des vaincus de Kossovo, où le corps d’armée qu’il
avait envoyé aux Serbes fut détruit. Incapable de résister, Mircea fut battu,
fait prisonnier et interné à Brousse où il signa un traité de vasselage qui
devait servir de modèle à tous les traités postérieurs entre les princes
roumains et la Porte : investiture du sultan, tribut, contingent
militaire, mais engagement du sultan de n’établir aucune colonie musulmane et
de ne construire aucune mosquée au nord du Danube .
La Hongrie devenait le seul centre de
résistance à l’invasion ottomane. Le dernier roi angevin, Louis le Grand, mort
en 1386, avait eu pour successeur son gendre Sigismond de Luxembourg, fils de
l’empereur Charles IV, qui, comme son prédécesseur, rêvait d’établir la
suzeraineté hongroise sur les peuples chrétiens des Balkans Il n’hésita pas à
prendre l’offensive et envoya un ultimatum à Bajazet en le sommant d’évacuer la
Bulgarie. Ne recevant pas de réponse, il envahit lui-même cette région,
infligea une grave défaite à l’armée ottomane et s’empara de Nicopolis après un
long siège, mais battit en retraite à l’approche de Bajazet et subit de grosses
pertes (1392) . Le résultat de cette
intervention fut la destruction totale de l’État bulgare. Après la prise de
Tirnovo, qui résista trois mois, par un fils du sultan, le patriarche bulgare
et les habitants furent déportés en Anatolie, le statut accordé à la Bulgarie
par Mourad fut supprimé, des garnisons turques occupèrent les villes et le nom
même des Bulgares disparut des actes officiels (1393) .
Carte IV. —
L’Empire ottoman avant la bataille d’Angora (1402).
La cour de Serrès, avril-mai 1394. — En 1394 la
puissance de Bajazet est à son apogée. Suzerain des peuples chrétiens des
Balkans, le roi de Hongrie rejeté au-delà du Danube, maître de l’Asie Mineure,
il possède les deux ailes de l’Empire byzantin d’autrefois. C’est à lui plus
qu’aux Paléologues que convient l’aigle bicéphale. Et il manifeste son pouvoir
impérial d’une manière éclatante dans la cour qu’il tient à Serrès au milieu de
tous ses vassaux.
Les affaires de Morée furent l’occasion de
cette assemblée. La péninsule était toujours partagée entre le despotat
byzantin sous le gouvernement énergique de Théodore Paléologue et les restes de la
principauté franque d’Achaïe disputée entre plusieurs prétendants . L’intervention de
Bajazet fut sollicitée de deux côtés, par Pierre de Saint-Exupéry, chef d’une
compagnie de Navarrais, qui, après avoir soutenu les droits de Jacques de
Baux ,
conquérait l’Achaïe pour son propre compte et était menacé par le despote
byzantin et ses alliés florentins les Acciaiuoli , ainsi que par Paul
Mamonas, gouverneur de Monemvasia, qui voulait se rendre indépendant de
Théodore Paléologue .
Au même moment une armée turque venait de
faire la conquête de la Thessalie et de la Phocide et menaçait la Morée. Ce fut dans ces
circonstances que Bajazet convoqua à Serrès tous ses vassaux, les
Paléologues : Manuel II, le despote Théodore de Mistra, l’empereur détrôné
Jean VII, fils d’Andronic IV, les princes serbes survivants, le gouverneur de
Monemvasia. Il apparut ainsi comme l’héritier véritable des Césars. Après avoir
entendu les plaintes de Mamonas et fait comparaître devant lui les Paléologues,
il les condamna à mort, puis sur l’avis de son vizir Ali-pacha, il révoqua la
sentence, mais fit crever les yeux à plusieurs de leurs conseillers et força le
despote Théodore à renoncer à Monemvasia, à lui céder Argos et à laisser
occuper les places de son despotat par des garnisons turques (avril-mai 1394) . Mais avant que les
envoyés du sultan chargés de se faire remettre les forteresses aient pu
parvenir en Morée, Théodore s’échappa de Serrès, arriva à temps pour empêcher
l’exécution du traité et demanda secours à Venise . L’année suivante une
armée ottomane pénétra facilement en Morée, mais ce fut uniquement pour aider
les Navarrais et, après avoir occupé Leontarion et Diakova, retourna en
Thessalie, pendant que la guerre continuait entre le despote et la Compagnie
navarraise , Bajazet remit à plus
tard sa vengeance.
La croisade de Nicopolis. — Devant la
situation précaire de Constantinople, dont le blocus durait depuis 1392 , la chrétienté occidentale
finit par s’émouvoir. Venise elle-même, qui craignait pour ses intérêts une
alliance turco-byzantine, était rassurée par l’hostilité du sultan contre les
Paléologues, mais redoutait d’autant plus sa mainmise sur Constantinople et les
détroits : favorable à une nouvelle croisade, elle allait jusqu’à se
réconcilier avec Gênes et dès juillet 1394 se mettait en rapport avec Manuel
II .
De son côté, le basileus, voyant la difficulté d’une campagne par terre,
demandait secours aux puissances maritimes .
Mais déjà l’initiative de la croisade avait
été prise par le roi de Hongrie Sigismond, et les ambassades envoyées par lui
pour cet objet à la cour du roi Charles VI, au duc de Lancastre, à Bordeaux, à
Venise, avaient été accueillies avec la plus grande faveur . Grâce à la propagande
de Philippe de Mézières la noblesse française
manifesta un véritable enthousiasme : il fallut réduire à mille le nombre
des chevaliers qui voulaient partir. Le comte de Nevers, héritier du duché de
Bourgogne, chef de l’expédition, était accompagné du maréchal Boucicaut, de
Jean de Vienne, d’Enguerrand de Coucy , de la fine fleur de la
chevalerie : Sigismond devait délivrer la Valachie et la Bulgarie, Venise,
rompre le blocus de Constantinople.
Les hésitations et les atermoiements de
Venise, qui songeait encore à traiter avec Bajazet en février 1395 , retardèrent le départ
de la croisade. Ce fut seulement en avril 1396 que la République donna son
adhésion . Son capitaine des
galères, Tommaso Mocenigo, parvint à rompre le blocus de Constantinople et de
Péra (28 octobre 1396) , mais il attendit en
vain l’armée de terre avec laquelle il devait faire sa jonction dans la ville
impériale. Après avoir opéré leur concentration à Bude (juillet), les croisés,
malgré l’avis de Sigismond, refusèrent de rester sur la défensive et
s’élancèrent vers le Danube, qu’ils passèrent en aval des Portes de Fer. Après
avoir pris Turnu-Severin, ils assiégèrent Nicopolis où Bajazet les atteignit le
25 septembre . La bataille de
Nicopolis montra la supériorité de l’infanterie ottomane sur la brillante
chevalerie, aux charges de laquelle elle opposa une résistance inébranlable. Le
désastre des chrétiens fut complet. Sigismond parvint à s’enfuir sur une
barque, mais le comte de Nevers, Boucicaut et un grand nombre de chevaliers
furent faits prisonniers ou périrent dans la bataille . Plus heureux que les
autres chefs, le hospodar valaque Mircea put sauver son armée et infliger aux Turcs
une défaite qui les obligea à repasser le Danube .
Le blocus de Constantinople et l’expédition
française (1396-1402). — Après sa victoire la colère de Bajazet
s’appesantit surtout sur Byzance et sur Venise. Il s’empara de Selymbria, poste
avancé de Constantinople, enleva Argos à Venise et fit envahir la Morée qui fut
ravagée jusqu’à Modon. Le 21 juin 1397 les troupes du despote furent battues
près de Leontarion, mais, après avoir fait des prisonniers, les Turcs se
retirèrent en Thessalie .
L’objectif principal de Bajazet était
désormais la prise de Constantinople, dont il resserra le blocus après le
départ de l’escadre vénitienne de Mocenigo, sur un navire de laquelle Sigismond
fugitif avait pris passage pour être ramené dans ses États . Loin d’être abattu par
sa défaite, Sigismond ne songeait qu’à préparer une nouvelle croisade :
Venise se tenait au contraire sur la réserve et cherchait surtout à empêcher
Manuel Paléologue de traiter avec Bajazet . Cette politique à
courte vue ne pouvait être d’aucun secours à Constantinople. Dans son désarroi,
Manuel envoya en Occident son oncle Théodore Cantacuzène solliciter des secours.
Il n’obtint rien de Venise, ni des autres États italiens : par contre il
fut bien reçu à Paris (octobre 1397) et, après des hésitations, Charles VI
consentit à envoyer à Constantinople une petite expédition sous le commandement
du maréchal Boucicaut .
Partie d’Aigues-Mortes le 26 juin 1399, la
flottille française fit de nombreuses escales pour attendre les secours promis
par les Italiens et arriva à Constantinople au cours de l’automne, après avoir
été rejointe à Ténédos par une escadre vénitienne et des navires de Rhodes et
de Lesbos . Boucicaut, avec ses
quelques galères et ses 2 000 hommes de troupes, ne pouvait faire que des
incursions. Prenant avec lui l’empereur Manuel, il réussit par une série de
coups de main à déloger les Turcs de leurs positions dans la mer de Marmara et
le Bosphore et il termina sa campagne au bout d’un mois en prenant d’assaut et
en détruisant de fond en comble le château de Rive (Riwa Kalessi) qui défendait
l’entrée de la mer Noire .
Le blocus de Constantinople était rompu.
Boucicaut mit alors la ville en état de défense et réconcilia Manuel avec son
neveu Jean VII, protégé de Bajazet, qui, d’après les sources byzantines, avait
forcé Manuel à l’associer au trône . Ce témoignage n’exclut
pas d’ailleurs celui du biographe de Boucicaut, qui alla chercher lui-même Jean
VII à Selymbria . Le maréchal, persuadé
qu’une croisade pouvait seule sauver Constantinople, détermina Manuel à venir
lui-même solliciter les secours de l’Occident et à laisser l’exercice du
pouvoir à Jean VII pendant son absence . Chateaumorand resta à
Constantinople avec une petite garnison de chevaliers et d’arbalétriers, un
crédit chez les marchands et le titre de « capitaine pour le roi de France
en la ville de Constantinople » . Malgré les difficultés
de tout genre, famine, pénurie d’argent, mauvaise volonté des Grecs, il parvint
grâce à son énergie à tenir tête à toute l’armée turque, à la grande admiration
de ses contemporains .
Manuel II en Occident (1399-1403). — Accompagné
d’une nombreuse suite, Manuel partit sur l’escadre de Boucicaut le 10 décembre
1399, fit escale en Morée (février) et débarqua à Venise où il fut reçu magnifiquement
et comblé de promesses et de cadeaux (mai). Après un séjour à Padoue et à Milan
où il fut accueilli par Jean Galeas Visconti , il passa en France et
fit son entrée solennelle à Paris le 3 juin 1400. Pendant son séjour qui se
prolongea jusqu’en octobre, ce fut une succession continuelle de fêtes, de
banquets, de réceptions, de chasses. Les rapports entre Charles VI et son hôte
furent de la plus grande cordialité et Manuel obtint la promesse d’un secours
de 1 200 hommes sous le commandement de Boucicaut et d’une pension annuelle
de 14 000 écus . En octobre il partit
pour l’Angleterre, s’arrêta à Calais et fut reçu à Londres par Henri IV le 21
décembre . Il était de retour en
France en février 1401 et y demeura jusqu’au 22 novembre 1402. De Paris il
entretenait une vaste correspondance avec les puissances occidentales en vue de
la croisade future . A son retour, il traversa
Gênes (22 janvier 1403), dont Boucicaut était gouverneur, et alla s’embarquer à
Venise (avril) pour regagner Constantinople où il arriva le 15 juin 1403 .
Maigre était le résultat de ces longues
pérégrinations, de ce déploiement de magnificences, de ces interminables
discours, de ces actives correspondances. Le pape Boniface IX avait lancé une
encyclique (27 mai 1400) pour exhorter les fidèles à prendre la croix ou à
coopérer de leurs deniers à la défense de Constantinople . Manuel rapportait
surtout des promesses, mais il avait été déjà informé de la catastrophe qui
allait empêcher Bajazet d’accomplir ses desseins contre Byzance .
Au moment où
la jeune puissance ottomane paraissait inébranlable, il suffit d’une simple bataille
malheureuse pour la renverser. La raison est que sa force principale était
surtout en Europe. Les conquêtes toutes récentes de Bajazet en Asie Mineure
étaient restées superficielles. La plupart des émirs vaincus s’étaient réfugiés
auprès de Tamerlan, le nouveau conquérant de l’Asie. La diplomatie de Bajazet,
très au courant des affaires d’Europe, semble avoir négligé la puissance
monstrueuse qui se formait depuis 30 ans au cour de l’Asie. Le sultan turc fut
pris au dépourvu et, loin de chercher à s’accommoder avec son adversaire, il le
provoqua à plaisir et attira sur lui la foudre.
D’origine très modeste, né en 1336, fils
d’un petit seigneur turc de Transoxiane, Timour-Lenk (le Boiteux) (le Tamerlan
des Occidentaux) fit sa fortune lui-même. Ses débuts furent peu glorieux et,
après avoir été au service du Khan Mongol du Djagataï, il mène en Iran une vie
d’aventurier, réunit une horde, s’allie avec le roi de Balkh, Mir Hossein,
contre le Khan, se brouille avec son associé, le détrône et se fait proclamer
roi de Transoxiane à Balkh le 10 avril 1370, mais pour ménager les Mongols, il
conserve comme un roi fainéant un membre de la dynastie du Djagataï D’une famille de
musulmans fanatiques, Tamerlan établit un État théocratique, remplace la
coutume mongole (yassak) par la loi musulmane
(chériat), protège le clergé musulman
et, sous prétexte de mener la guerre sainte (djihad) contre les païens, se donne comme but la conquête ou plutôt
le pillage de l’Asie avec l’armée solide de Turcs qu’il a levée en Transoxiane
et qui forme une puissance militaire incomparable .
A la différence de Gengis-Khan, Tamerlan
n’avait aucun plan d’ensemble, ne cherchait pas à organiser ses conquêtes,
laissant un pays après l’avoir pillé, ne fondant rien de stable, recommençant
plusieurs fois la conquête d’un même pays . II conquit
successivement tous les État mongols issus de l’empire de Gengis-Khan, la
plupart en décadence et en état de guerre civile : le Kharezm (région de
l’Amou-Daria) (1379), le Turkestan oriental (Ili-Kachgarie) 1390-1397, l’Iran
oriental (Hérat 1381, Kandahar 1383), l’Iran occidental (Irak, Bagdad,
Sultanyeh), la Géorgie (prise de Tiflis 1386), la Grande Arménie, la Perse et
le Farsistan (massacres d’Ispahan 1387, campagnes de 1392 à 1396, révolte de
Bagdad cruellement réprimée en 1401) . Il intervient dans les
querelles de succession du Kiptchak et ses campagnes victorieuses (1378-1399)
préparent la désagrégation de la Horde d’Or et l’affranchissement de la
Russie .
Arrivé aux portes de l’Asie occidentale, il
s’en détourna pour aller conquérir dans l’Inde le sultanat turco-afghan de
Delhi, d’où il ramena des éléphants de guerre (fin 1398) , et revint vers
l’Occident, où les sultans mamlouks d’Égypte refusaient de reconnaître sa
suzeraineté. Tamerlan envahit leurs possessions de Syrie, s’empara d’Alep (3
novembre 1400) et de Damas (25 décembre) et quitta la région (mars 1401) après
l’avoir pillée et en emmenant un grand nombre d’ouvriers d’art et de
lettrés .
Il n’avait plus devant lui qu’un seul État
puissant, l’Empire ottoman de Bajazet : un conflit entre eux était
inévitable. La provocation vint de Bajazet qui voulut imposer sa suzeraineté à
des émirs vassaux de Tamerlan et accueillit à sa cour un de ses ennemis, chef
de la horde du Mouton Noir, Kara Yousouf . Une correspondance
aigre-douce s’engagea entre les deux potentats et Bajazet, repoussant toute
offre d’accord, répondit par des lettres insultantes aux messages de Tamerlan . La réplique ne se fit
pas attendre au mois d’août 1400 Tamerlan envahissait le territoire ottoman et
s’emparait de Siwas , mais ce fut seulement
après avoir triomphé des Mamlouks de Syrie qu’il envahit l’Asie Mineure (juin
1402) où se livra la bataille décisive dite d’Angora, au nord-est de cette
ville, à Tchiboukâbâd, le 20 juillet. Elle fut longue et acharnée : les
contingents d’Asie Mineure de l’armée ottomane firent défection, tandis qu’à
l’aile gauche les Serbes de Lazare Vulkovič se firent tuer
héroïquement. Bajazet lutta un jour entier à la tête de ses janissaires accablé
par les Mongols, il s’enfuyait à cheval lorsque sa monture s’abattit. Fait
prisonnier avec un de ses fils, il fut enfermé dans une litière grillée. Il
devait mourir peu après (mars 1403) .
En une seule journée l’Empire ottoman
s’était écroulé. Exploitant sa victoire, Tamerlan s’empara facilement de toutes
les places turques d’Asie Mineure et enleva Smyrne aux chevaliers de Rhodes.
Les émirs turcs dépossédés par Bajazet furent restaurés dans leurs États et le
territoire ottoman fut réduit à la Bithynie et à une partie de la Phrygie . Les États chrétiens
n’avaient pas attendu la victoire d’Angora pour faire leur soumission ;
l’empereur de Trébizonde, Manuel III, dont le beau-frère, l’émir d’Erzindjian,
avait gagné la faveur de Tamerlan, fut sauvé de la conquête par cette
entremise, mais dut fournir des galères et des troupes qui prirent part à la
bataille d’Angora dans les rangs tartares . A Constantinople Jean VII
accepta les mêmes obligations (15 mai 1402) et, après la bataille, transporta à
Tamerlan le tribut qu’il payait à Bajazet ; les Génois de
Galata eux-mêmes arborèrent la bannière du vainqueur .
Avec un sens politique remarquable Tamerlan
se mit en rapport avec les principaux États d’Occident, notamment avec la
France, dont le roi Charles VI était seigneur de Gênes depuis 1396 , et avec le roi de
Castille, dont les ambassadeurs assistaient à la bataille d’Angora ; mais c’était
surtout l’intérêt du commerce entre l’Orient et l’Occident qui était en jeu
dans ces pourparlers . Tamerlan ne fonda rien
de durable, mais, sans l’avoir cherché, il sauva la chrétienté occidentale
d’une offensive ottomane et il assura à Byzance une survie d’un demi-siècle.
2. La crise ottomane et le relèvement
byzantin (1402-1421)
Après Angora, la puissance ottomane était
détruite, la guerre civile éclatait entre les fils de Bajazet, les vassaux
d’Europe se révoltaient, les émirs turcs d’Asie étaient rétablis dans leurs
États, Byzance revendiquait les territoires qui lui avaient été
arrachés.Cependant les jalousies mutuelles des États chrétiens, leur politique
maladroite vis-à-vis des prétendants, permirent à l’État ottoman de se reformer
en moins de 20 ans et de reprendre sa politique de conquête. Jamais les conditions
n’avaient été si favorables à une croisade, mais, le danger passé, on n’y
pensait plus. L’état d’anarchie de l’Occident, guerres anglaises, grand
schisme, guerre des Hussites, luttes entre les États italiens, rendait
impossible toute croisade.
En Orient, Byzance n’était plus qu’un
nom : les territoires qu’elle avait recouvrés étaient dispersés, elle
était tombée au rang de puissance secondaire. Les puissances dominantes en
Orient étaient Venise et la Hongrie, mais elles n’avaient qu’une politique
étroite, sans vues d’ensemble, tantôt hostiles aux Turcs, tantôt engagées dans
leur alliance. L’une et l’autre étaient d’ailleurs absorbées par des entreprises
en Occident, Venise par la conquête des pays de terre ferme , le roi de Hongrie par
sa politique allemande et tchèque.
Après avoir traversé une période de crises
redoutables, les Turcs, exploitant les divisions des chrétiens, reprirent leur
marche en avant et détruisirent ce qui restait encore de l’Empire byzantin. Ce
qu’il est bon de rappeler d’ailleurs, c’est que Byzance lutta jusqu’au bout, soutenue
par les États chrétiens des Balkans et la Hongrie : il fallut un demi-siècle
aux Turcs pour venir à bout de son héroïsme.
A peine rentré
à Constantinople, Manuel supprima le tribunal du cadi, fit fermer ou détruire
les mosquées, révoqua les privilèges commerciaux accordés aux musulmans et
détrôna son neveu Jean VII . Après la mort de
Bajazet, (8 mars 1403), chacun de ses fils s’installa dans un territoire, Isa à
Brousse, Mahomet à Amasée, Soliman en Europe , et les émirs turcs
d’Asie Mineure rentrèrent dans leurs États . Manuel II signa avec
Soliman un traité qui lui restituait Thessalonique, le territoire du Strymon,
la Morée, quelques places voisines de Constantinople, les ports de la mer
Noire, les îles de la côte de Thrace . Par un juste retour
des choses c’était Soliman qui devenait le vassal de l’Empire (1404). A Venise,
qui voulait sa part des dépouilles, Soliman cédait l’accès à toutes les
échelles turques du Levant, la ville d’Athènes et un territoire en face de
Nègrepont .
Les fils de
Bajazet ne purent s’entendre. Mahomet chassa de Brousse son frère Isa
(1404) mais il en fut lui-même
expulsé par Soliman, inquiet des progrès de son frère et de ceux de l’émir Djouneid,
qui, à la faveur des troubles, avait hérité des États de l’ancien émir d’Aïdin,
Omour-beg (fin 1406) . Isa ayant
disparu et Djouneid s’étant
soumis, la lutte se concentra entre Mahomet et Soliman qui enleva à son frère
Angora, tandis que Mahomet échoua devant Brousse (1407-1408) ; mais il ne tarda
pas à rétablir sa situation, grâce à son alliance avec l’émir de Karamanie et à
l’intervention d’un quatrième fils de Bajazet, Mousà, délivré de la prison
qu’il avait partagée avec son père. Prenant parti contre Soliman, Mousà passa
en Europe par Sinope, Caffa et la côte valaque, fit alliance avec le prince
roumain Mircea (juillet 1409), pénétra en Bulgarie en chassant les troupes
fidèles à Soliman et s’empara de la résidence de son frère, Andrinople (13
février 1410) . Soliman revint en
toute hâte dans ses États (juin) et la guerre entre les deux frères se
prolongea avec des alternatives de succès et de revers pendant neuf mois.
Soliman fut battu et tué le 17 février 1411 et Mousà resta maître
d’Andrinople et des provinces européennes. Il y avait désormais deux États
ottomans, l’un en Europe, l’autre en Asie. L’unité impériale était rompue et il
ne tenait qu’aux États chrétiens de perpétuer cette division : ils firent
justement le contraire.
Sans doute Mousà est d’abord l’ennemi de
Manuel Paléologue, qui est entré en campagne contre lui et cherche à reprendre
Gallipoli . Mousà n’en renouvelle
pas moins le traité conclu par Soliman avec Venise (12 août 1411) tout en prenant
l’offensive contre Manuel, mais il fait une vaine démonstration devant Constantinople
qu’il ne peut assiéger faute de machines (août) et échoue successivement devant
Selymbria et Thessalonique (automne) .
Ce fut alors que Manuel attira Mahomet en
Europe en sollicitant son intervention contre Mousà et en lui fournissant des
navires pour transporter ses troupes et l’on vit le spectacle étrange d’un
sultan turc défendant la Ville Impériale contre son propre frère, qui tentait
de l’assiéger de nouveau . Rappelé en Asie par
une révolte de Djouneid, Mahomet revint en juin 1413 et envahit la Thrace,
également bien accueilli par les chefs musulmans et chrétiens qui détestaient
la tyrannie de Mousà. Son armée fut bientôt grossie de nombreux contingents, bulgares
et serbes et, après avoir passé les Balkans, il rencontra Mousà à Tschamurli
près des cluses que traverse l’Isker pour entrer dans le bassin de Sofia. Mousà
fut vaincu et tué (5 juillet) .
Seul survivant des six fils de Bajazet,
Mahomet se trouvait l’unique sultan. Grâce à l’appui de Manuel et des autres
princes chrétiens des Balkans, il avait reconstitué l’unité ottomane. Cependant
la grande amitié qu’il témoigna à Manuel écarta tout danger immédiat pour
Constantinople . Toute son attention
était d’ailleurs portée vers l’Asie Mineure qu’il voulait reconquérir. Avec
l’alliance des Hospitaliers de Rhodes et des Génois de Chio et de Lesbos, il
réprima la révolte de Djouneid et lui enleva la possession de Smyrne et des
places d’Ionie, puis en quatre campagnes il soumit la Karamanie . Il regagnait ainsi le
terrain perdu depuis la bataille d’Angora et son pouvoir en Asie Mineure était même
plus solide que n’avait été celui de Bajazet. Ce fut à ce moment que les États
chrétiens commencèrent à comprendre la faute qu’ils avaient commise en
favorisant la naissance d’un nouvel empire ottoman.
Manuel II en Morée, 1414-1415. — Cependant, grâce
à la cordialité de ses rapports avec Mahomet, Manuel put réorganiser son État
et renforcer son pouvoir en Morée.
Après la mort du despote Théodore Ier sans enfant (1405), sa succession revint à son neveu Théodore Paléologue encore
mineur, fils de Manuel qui prit la régence . Le pays était troublé
par les conflits incessants entre la noblesse remuante des archontes et le
despote et par des violences continuelles , véritable régression
des mœurs, surtout depuis l’immigration des Albanais . Manuel se proposait
d’étendre la domination byzantine à l’ensemble du Péloponnèse et de faire de la
presqu’île le réduit de la défense impériale. Parti de Constantinople en
juillet 1414, il passa l’hiver à Thessalonique et débarqua près de Corinthe où
le prince latin d’Achaïe, Centurione Zaccaria, vint lui faire hommage (13 mars
1415) . Pour assurer la
défense de la Morée, Manuel fit construire la muraille de l’Hexamilion qui
barrait l’isthme entre les golfes Saronique et de Corinthe. Une grande partie
de la population contribua à cette œuvre par ses prestations ou son argent,
mais plusieurs archontes se montrèrent récalcitrants et, malgré les appels de
Manuel, Venise refusa toute contribution .
Après avoir inspecté le pays et rétabli
l’ordre, Manuel quitta la Morée et revint à Constantinople (mars 1416) , mais, poursuivant sa politique
de rattachement de la presqu’île à son gouvernement, il y envoya l’héritier du
trône, le prince Jean, qui y arriva à l’improviste et gouverna la Morée de
concert avec son frère le despote Théodore II . Tous deux attaquèrent
Centurione Zaccaria qui voulait s’affranchir de la suzeraineté de l’Empire (mai
1417), et la principauté d’Achaïe allait être démembrée lorsque Venise,
inquiète des progrès des Paléologues, proposa sa médiation . Jean VIII quitta la
Morée à la fin de 1418 et fut remplacé par son frère le prince Thomas,
accompagné de l’historien Phrantzès . L’action de
Constantinople sur la Morée se manifesta dans les domaines intellectuels et artistiques.
A la même époque Gémiste Pléthon attirait autour de lui de nombreux disciples
et présentait à Manuel II et au despote Théodore un plan de réforme sociale et
politique, tandis que des peintres de premier ordre couvraient les voûtes des
églises de Mistra de leurs fresques délicates . C’est à Mistra que
par-delà Byzance les lettrés ont retrouvé la patrie hellénique.
Devant la
reconstitution de l’unité ottomane, la politique des puissances chrétiennes
d’Orient fut maladroite et incertaine. Déjà, au lendemain de la défaite de Bajazet,
les projets de croisade avaient échoué par la faute des deux principaux
partenaires, Venise et Sigismond, qui poursuivaient chacun leurs buts
particuliers : le roi de Hongrie cherchant à établir sa suprématie en Serbie,
dont le prince Étienne Lazarevič lui transportait
l’hommage qu’il avait fait au sultan (1406), ainsi qu’en Bosnie, où il était en
conflit avec Venise ; quant à la
Sérénissime République, elle faisait des réponses dilatoires aux démarches
d’Étienne Lazarevič (1406), de Manuel II
(janvier 1407), de Sigismond lui-même (octobre 1408, février 1409) en vue de
l’organisation de la croisade , et préférait s’assurer
l’héritage de la Dalmatie que Ladislas d’Anjou, qui l’avait disputée à la
Hongrie, lui vendit pour cent mille ducats (1409, marché infâme) . Il s’ensuivit une
guerre scandaleuse entre Venise et la Hongrie, qui rendit impossible toute
entente contre les Turcs et se prolongea, avec des trêves dans l’intervalle, jusqu’en
1437 .
Telle est la véritable raison pour
laquelle, malgré des circonstances favorables, on ne put organiser de croisade
à cette époque. Cependant après la victoire de Mahomet, Venise comprit le
danger que couraient ses possessions illyriennes et celles du Levant : dès
mars 1415 elle prenait des mesures contre les corsaires turcs qui
recommençaient à sillonner l’Archipel . Mais elle n’allait pas
plus loin, tandis que Manuel II, en dépit de son amitié pour Mahomet, cherchait
de tous côtés des secours pour Constantinople, auprès du roi d’Aragon
Ferdinand et de Venise, qu’il
avait entrepris de réconcilier avec Sigismond .
Pour affaiblir Mahomet les États chrétiens
ne trouvèrent rien de mieux que de lui opposer un prétendant, Mustapha, qui se
disait fils de Bajazet et avait de nombreux partisans en Asie Mineure. Il
s’adressa d’abord à Venise, qui l’éconduisit et l’envoya au prince de Valachie
Mircea . Une ligue composée de
Manuel II, de Mircea, du prince de Karamanie se forma en sa faveur . Venise elle-même montrait
de meilleures dispositions et négociait avec les puissances maritimes du Levant
l’entretien d’une flotte permanente dans les détroits . Elle se vit bientôt
contrainte d’aller plus loin : dans l’automne de 1415 Mahomet Ier équipa une flotte de 112 navires, qui vint croiser dans les eaux de Ténédos, et
cette réapparition d’une flotte ottomane dans la Méditerranée était un
événement considérable Venise jouait
d’ailleurs un double jeu et, tout en se montrant disposée à adhérer à la ligue
contre Mahomet, elle cherchait par tous les moyens à renouveler avec lui le
traité qu’elle avait conclu avec Mousà .
Venise ne désirait pas la guerre, mais
redoutait la domination exclusive de Mahomet dans la Méditerranée. Il suffit
cependant de la rencontre des deux flottes ottomane et vénitienne en face de
Gallipoli pour que le combat s’engageât : le 29 mai 1416 l’amiral vénitien
Lorédan détruisit entièrement la flotte turque après un combat acharné . Cette issus comblait
les désirs de Venise qui n’avait plus à craindre la marine Ottomane et dès
l’année suivante elle négociait avec Mahomet un traité de paix, ratifié
seulement en 1419 : Venise se tirait ainsi d’affaire en laissant les États
chrétiens seuls en face du sultan .
Mustapha, réfugié en Valachie, ne fut
sérieusement soutenu que par Mircea et Manuel II. La destruction de la flotte
turque lui permit d’arriver par mer à Constantinople, d’où il fut conduit à
Thessalonique, afin de gagner à son parti les gouverneurs turcs . La guerre éclatait
ainsi entre Manuel et Mahomet, qui atteignit Mustapha, auquel s’était joint
Djouneid fugitif, en Thessalie, le força à livrer bataille malgré lui et le
battit (fin d’automne 1416). Le gouverneur de Thessalonique où les vaincus
s’étaient réfugiés refusa de les livrer au sultan, mais Mahomet traita avec
Manuel II et il fut convenu que Mustapha serait interné à Lemnos et Djouneid
dans un monastère de Constantinople . Quant à Mircea, il ne
fut pas question de lui dans le traité, et Manuel l’abandonna à la vengeance du
sultan qui lui enleva la Dobroudja, le força à payer un nouveau tribut et à
accepter la construction en territoire roumain de forteresses turques qui
commandaient le passage du Danube (1417) .
Malgré cette brouille passagère, Mahomet
continuait à ménager Manuel et en 1420 les deux souverains eurent une entrevue
des plus cordiales à Scutari . Le sultan mourut
l’année suivante, à la suite d’un accident de chasse, à l’âge de 42 ans . A ce moment la
situation de Manuel était encore intacte il n’avait rien perdu de ce que les
Turcs lui avaient restitué ni, malgré ses erreurs, subi aucune dommage, grâce à
l’amitié réelle de Mahomet pour lui. Avec l’avènement de Mourad II, fils de
Mahomet, Manuel allait avoir affaire à un jeune sultan plein d’ardeur et bien
décidé à relever l’Empire ottoman : tout le bénéfice de l’affaiblissement
turc était déjà perdu et Byzance allait se trouver de nouveau en danger mortel.
3. La renaissance de l’Empire ottoman et la dernière résistance (1423-1448)
Bien que Mourad II fût servi par des hommes
d’État et des chefs de guerre de premier ordre, son État était loin d’être la
puissance dominante en Orient et il chercha encore à prolonger la paix, mais
les fautes et les discordes des États chrétiens ne tardèrent pas à lui
permettre de regagner les positions perdues. En 4 ans (1421-1425) Byzance perdit
tous les avantages qu’elle avait acquis pendant la crise ottomane, retomba sous
le joug des Turcs et se trouva de nouveau menacée dans son existence. L’Empire
ottoman se reforma, plus agressif que jamais et recouvra son ancienne
prépondérance.
Dès les premiers jours du règne du Mourad, Manuel eut à
choisir entre le renouvellement de l’alliance que lui offrait le sultan et les
promesses magnifiques de Mustapha, s’il était rétabli sur le trône. Pour
montrer son désir de conciliation Mourad allait jusqu’à l’offre de céder Gallipoli
à l’Empire . Manuel était partisan
de la paix, mais il avait contre lui Jean VIII et ses autres fils : il
céda et lâcha la proie pour l’ombre. La suite allait le montrer.
Mustapha et Djouneid, mis en liberté,
assiègent Gallipoli. Laissant l’armée grecque devant la place, Mustapha marche
sur Andrinople et bat l’armée envoyée contre lui par Mourad (fin 1421) : à
cette nouvelle, Gallipoli se rend, mais Mustapha en interdit l’entrée aux
troupes impériales, qu’il renvoie à Constantinople (janvier 1422) . Manuel essaye alors de
renouer avec Mourad, mais ses exigences aboutissent à un échec, tandis que le
sultan signe un traité avantageux avec les Génois de la Nouvelle Phocée . Pour prévenir une
attaque de Mourad, Mustapha parvient à passer en Asie, mais au moment où il se
trouve en face de l’ennemi, il est trahi par Djouneid, abandonné par ses
troupes (20 janvier 1422) et s’enfuit éperdument, poursuivi par Mourad, qui le
capture près d’Andrinople et le laisse pendre au haut d’une tour par la
populace .
La défaite de Mustapha laissait Manuel
exposé à la vengeance de Mourad : cette fois le basileus ne pouvait plus
compter sur la longanimité du sultan, qui vint dès le mois de juin 1422
assiéger Constantinople . Manuel retiré au monastère
de la Peribleptos avait laissé le pouvoir à Jean VIII, qui chercha vainement à
traiter avec Mourad : un de ses ambassadeurs, Corax, suspect d’entente
avec le sultan, dont il n’avait pas révélé les préparatifs, fut lynché par la
foule le jour où l’armée ottomane parut brusquement sous les murs de la
ville . La lutte fut
acharnée : Mourad fit construire entre la Corne d’Or et la Propontide une
immense levée de terre chargée de machines de guerre, parmi lesquelles des bombardes
et armes à feu, qui faisaient plus de bruit que de mal, voisinaient avec les
balistes et les tours roulantes d’autrefois Le camp turc était
rempli de marchands d’esclaves et de derviches qui venaient prendre leur part
du butin, sur la foi de la proclamation du sultan livrant la ville et ses
trésors aux vrais croyants. Un illuminé, vénéré de tous, le scheik
Seïd-Bokhari, de la famille du Prophète, avait prédit que la ville tomberait
aux mains des musulmans le lundi 24 août. L’assaut général fut donné ce jour-là
et la bataille avait été longue et acharnée, lorsque les Turcs furent pris
d’une panique inexplicable, brûlèrent leurs machines de guerre et battirent en
retraite , mais non sans laisser
quelques troupes devant la ville .
Cet échec fut dû sans doute à
l’insuffisance des forces dont disposait Mourad, qui ne paraît pas avoir
assiégé la ville par mer, et aussi au courage et à l’ardeur que montrèrent les
défenseurs : le jour du grand assaut, les chroniqueurs montrent tous les
habitants, hommes et femmes, se portant vers les remparts pour contribuer à la
défense, tandis que Jean VIII dirigeait une sortie victorieuse.
Renonçant à cette entreprise qui s’était
avérée comme prématurée, Mourad fit envahir la Morée par les troupes de
Tourakhan-beg cantonnées en Thessalie (mai 1423). Au lieu de s’unir contre les
Turcs, le despote Théodore II et le prince d’Achaïe se faisaient la guerre.
Devant le danger turc ils signaient une trêve à l’instigation de Venise (17
décembre 1422) , mais la République
négociait encore pour former une ligue quand les Turcs apparurent. La muraille
de l’Hexamilion qui devait arrêter les invasions n’était même pas
défendue . Tourakhan s’en empara
facilement et la fit détruise, puis il ravagea les possessions du despote, mais
il rencontra, semble-t-il, une assez grande résistance et n’osa assiéger
Mistra ; dès qu’il eut
quitté la Morée, les luttes entre les États chrétiens recommencèrent
(1423) .
Après une incursion en Albanie, les Turcs
se portèrent sur Thessalonique dont ils organisèrent le blocus. Son gouverneur,
le despote Andronic, fils de Michel, sujet à des attaques d’épilepsie et
irrésolu, poussé aussi par les habitants qui souffraient du blocus, ne vit
d’autre moyen d’empêcher la ville de tomber aux mains des Turcs que de la
vendre à Venise, ainsi que la presqu’île de Kassandreia et la région du Vardar
inférieur. Venise accepta et en juillet 1423 deux provéditeurs avec une flotte
importante prirent possession de la ville , mais la République ne
put obtenir de Mourad la reconnaissance de cette occupation .
Cependant la guerre n’éclata pas de suite
entre Venise et le sultan, occupé par sa lutte contre les émirs d’Asie Mineure
et son intervention dans la succession de Valachie, sans que les puissances
chrétiennes aient fait le moindre effort pour exploiter cette situation. En
Valachie la querelle de succession qui s’éleva entre les fils de Mircea le Grand,
mort en 1418, fournit aux Turcs l’occasion de pénétrer pour la première fois en
Transylvanie (1421) et en Moldavie, dont ils attaquèrent le port de
Cetatea-Alba à l’embouchure du Dniester. Le prétendant qu’ils avaient installé
sur le trône valaque, Radu le Chauve, fut renversé par son frère Dan qui, avec
l’aide des Hongrois, força les Turcs à repasser le Danube et fit la paix avec
Mourad . De futurs conflits
étaient en perspective dans ces régions où la pression ottomane avait commencé
à s’exercer.
En Asie Mineure Mourad mena lui-même la
campagne contre le protecteur de Djouneid, l’émir de Kastamouni, qu’il força à
signer la paix et à lui donner sa fille en mariage (1424-1425) , mais, pendant que le
sultan célébrait ses noces à Andrinople, Djouneid parvenait à rentrer dans
Smyrne et, ne pouvant s’y maintenir, s’enfuyait en Cilicie, et de là auprès du
prince de Karamanie, qui lui fournit quelques troupes avec lesquelles il gagna
la Lydie. Ce fut là que s’acheva sa destinée : assiégé dans le port
d’Hypsela par une armée turque appuyée d’une flotte génoise de la Nouvelle
Phocée, il dut capituler et fut étranglé avec toute sa famille malgré la
promesse de vie sauve qu’il avait obtenue .
Cette disparition affranchissait Mourad
d’un de ses plus gros soucis. Sauf le prince de Karamanie, resté puissant, les
émirs d’Asie Mineure lui étaient soumis et en Europe il n’avait plus affaire
qu’à deux puissances : le roi de Hongrie Sigismond, resté neutre et
absorbé par les affaires de Bohême et du grand schisme d’Occident, Venise, avec
laquelle il avait refusé de traiter.
En face de cet empire reconstitué, les
Paléologues, abandonnés par leurs alliés, toujours brouillés avec Mourad,
étaient impuissants et, de plus, ils étaient divisés entre eux. Manuel, vieilli
et découragé, voulait faire la paix avec le Turc ; Jean VIII, qui assumait
de plus en plus la direction des affaires, était partisan de la résistance.
Laissant le gouvernement à son frère Constantin Dragasès, il entreprit, comme
autrefois Manuel, un voyage diplomatique pour aller chercher des alliances.
Parti de Constantinople le 23 novembre 1423 , il passa par Venise et
Milan dont il décida le duc à faire la paix avec Sigismond, puis il gagna la
Hongrie où il se trouvait encore un an après, mais quand il revint en
traversant la Moldavie (fin octobre 1424), Manuel avait déjà traité avec
Mourad .
Une ambassade composée de trois
dignitaires, dont l’historien Phrantzès, était allée trouver le sultan à
Éphèse, où il tenait sa cour, et concluait des traités d’amitié avec les
représentants des États chrétiens. Le traité rédigé par Phrantzès précipitait
de nouveau Byzance dans la vassalité ottomane : le basileus paierait au
sultan un tribut de 300 000 aspres et lui céderait les ports de la mer
Noire, sauf Mesembria et Derkos, et conserverait Zeïtoun et la région du
Strymon (22 février 1424) . Manuel ne survécut que
17 mois à ce honteux traité et mourut le 21 juillet 1425, à l’âge de 77 ans,
après 52 ans d’un règne fertile en tragédies et en désastres .
Essai de résistance des Paléologues. — Jean VIII,
déjà associé à l’Empire, devint donc seul basileus, mais il eut à compter avec
ses cinq frères entre lesquels étaient répartis sous forme d’apanages les
maigres territoires qui constituaient l’Empire et étaient menacés à la fois par
les Turcs et par Venise. Malgré des conditions défavorables et avec une
véritable vaillance, ces derniers Paléologues n’attendirent pas l’attaque pour
organiser la défensive par leurs propres moyens.
Jean VIII fit porter son principal effort
sur la Morée, véritable réduit de la défense byzantine après Constantinople. Il
vint se mettre lui-même à la tête des troupes de Mistra et attaqua Charles
Tocco, despote d’Épire, qui avait acheté d’un aventurier italien la forteresse
de Clarentza et était en conflit avec le despotat byzantin au sujet des
troupeaux transhumants dans la plaine d’Élide . Une victoire sur la
flottille de Tocco aux îles Echinades, la cession de Clarentza à Byzance et le
mariage de Constantin Dragasès avec une nièce de Tocco, tels furent les résultats
de cette campagne (1427-1428) . De retour à
Constantinople sur la flotte qu’il commandait lui-même, Jean VIII fit restaurer
la Grande Muraille et, l’année suivante,
Constantin Dragasès, qui partageait le gouvernement de la Morée avec son frère
Théodore , s’empara de la ville
importante de Patras, fief d’un archevêché latin, malgré les protestations de
Venise et avec l’acquiescement donné par Mourad, non sans hésitation (5 juin
1429) . Au même moment Thomas
Paléologue attaquait le dernier prince franc d’Achaïe, Centurione, lui prenait
sa forteresse de Chalandritza et l’obligeait à lui donner sa fille en mariage
avec toutes ses possessions, sauf la baronnie d’Arcadie, en dot . L’Ordre Teutonique
lui-même devait céder Mostenitza . A part les possessions
vénitiennes toute la Morée était
aux mains des Grecs, au grand mécontentement de Venise qui se vengea en faisant
une guerre économique au despotat . Aussi Jean VIII
était-il en relations avec les ennemis de la République, en particulier avec le
roi de Hongrie, qui venait de conclure une trêve avec Mourad « afin,
écrivait-il aux despotes, de pouvoir résister à l’insolence de nos ennemis communs » .
L’offensive victorieuse de Mourad. — Pendant que
les Paléologues achevaient de conquérir la Morée, Mourad, respectant le traité
conclu avec Manuel, semblait se désintéresser de Constantinople, mais poussait
ses entreprises dans toutes les directions et s’assurait des positions
stratégiques de premier ordre tant en Asie qu’en Europe.
Le plus grand État continental d’Anatolie
était la Karamanie, le domaine du Grand Karaman qui s’étendait sur la Phrygie
(Iconium) et une partie de la Cappadoce (Karahissar), débordant au sud vers
l’Isaurie et cherchant à s’ouvrir un chemin vers la mer par l’occupation
d’Attalie. Après quatre ans de guerre et de négociations, le dernier prince de
Karamanie, Ibrahim, se reconnaissait le vassal de Mourad (1426-1430) et il ne
restait plus trace en Asie Mineure du régime instauré par Tamerlan .
Mais ce fut surtout vers l’Europe que
Mourad dirigea ses plus grands efforts. Établi à Andrinople depuis 1423, il
intervint dans toutes les régions de la péninsule balkanique, mais au lieu
d’annexer des territoires, comme Bajazet, il laissait aux vaincus leurs princes
nationaux en les soumettant au tribut et au service militaire .
Sa principale action fut d’abord dirigée
contre Venise, devenue puissance balkanique depuis son achat de Thessalonique
et qui soutenait successivement tous ses ennemis : Djouneid, le faux Mustapha,
le Grand Karaman . Après avoir occupé les
abords de Thessalonique (1425-1430), Mourad, vainqueur de la Karamanie, vint
lui-même diriger le siège de Thessalonique qu’il prit d’assaut le 29 mars
1430 .
Les églises furent changées en mosquées et la ville repeuplée par des musulmans.
L’effet produit en Europe fut considérable.
En même temps Mourad intervenait
victorieusement en Serbie, dont le despote Georges Brankovič,
neveu et successeur d’Étienne Lazerevič, devait se reconnaître
son vassal et répudier la suzeraineté hongroise (1428) ; de plus, les
Turcs occupèrent sur le Danube, au débouché des Portes de Fer, une forteresse
qui leur avait été vendue par un boyard . Le sultan profitait
surtout des querelles de succession, fréquentes dans les dynasties balkaniques.
Celle de Charles Tocco, despote d’Épire, lui rapporta la possession de Janina
et la suzeraineté de l’Épire et de I’Acarnanie (1431) . En Valachie la reprise
de la querelle entre Dan et Radu suscite une double intervention, d’une part de
Sigismond, avec, comme auxiliaires, des chevaliers croisés amenés par don
Pedro, fils du roi Jean de Portugal , d’autre part des Turcs
qui envahissent le pays. Bien que rétabli sur le trône valaque par Sigismond,
Dan dut faire hommage de son État (1428) , mais à sa mort en
1431, son fils Bassarab, se vit disputer le pouvoir par deux fils de Mircea,
Vlad le Dracul et Aldea, soutenus, le
premier par Sigismond, le second par le prince Alexandre de Moldavie.
Mourad ne manqua pas cette nouvelle
occasion d’intervenir et, après une guerre de 5 ans (1432-1437), qui provoqua
la rupture de la trêve entre Sigismond et le sultan (1433) et permit à celui-ci
d’envahir les provinces méridionales de la Hongrie, Sigismond étant mort (9
décembre 1437), son protégé, Vlad Dracul, reconnu par les Valaques, n’eut
d’autre ressource que de se déclarer le vassal de Mourad et d’envoyer ses fils
en otages à la Porte .
Ainsi Mourad avait réussi dans toutes ses
entreprises. En 12 ans (1425-1437) il avait reconstitué un empire continental
plus étendu et plus solide que celui de Bajazet et il avait humilié Venise, la
grande puissance maritime de l’Orient. Ses vassaux lui obéissaient et il ne
tolérait pas chez eux le moindre écart, comme s’en aperçut Georges Brankovič,
qui, ayant tardé à envoyer sa fille au harem du sultan, dut lui céder la
forteresse de Kruševac . Maître de la Valachie,
il menaçait la Hongrie dont le roi Sigismond, son principal et son plus sérieux
adversaire, venait de disparaître. Ces succès alarmaient les États chrétiens,
mais n’avaient provoqué de leur part aucune réaction. Des tentatives assez
timides pour provoquer la formation d’une croisade s’étaient heurtées à
l’indifférence la plus complète .
Les victoires
de Mourad rendaient de plus en plus précaire la situation du petit État
byzantin, du sort duquel Mourad, satisfait de l’avoir dans sa vassalité , semblait se
désintéresser momentanément, mais dont les forces ne pesaient pas lourd devant
la formidable puissance du sultan.
Et ce fut au moment où Constantinople était
ainsi en danger qu’on assista au spectacle scandaleux d’une nouvelle guerre
entre Gênes et Venise dans laquelle l’État byzantin fut impliqué. Une flotte
vénitienne venant attaquer Galata (septembre 1433), Jean VIII fut pris comme
arbitre par les belligérants et réussit à sauver la colonie génoise d’un
désastre imminent . En reconnaissance, une
flotte génoise, se rendant en Crimée l’année suivante, s’avisa d’attaquer les
murs maritimes de Constantinople ; mais Jean VIII avait encore des
navires, qui chassèrent la flotte génoise, et des troupes, qui assiégèrent
Galata, dont les habitants durent accepter les conditions de l’empereur .
D’autre part les dissentiments qui
troublaient la famille impériale étaient une autre cause de faiblesse. Jean
VIII n’ayant pas d’enfant, le second fils de Manuel, le despote Théodore, se
considérait comme son héritier légitime, mais le basileus lui préférait son
frère Constantin Dragasès, soutenu par Thomas, avec lequel il avait échangé son
héritage de Morée. Parti déplorable, les deux frères rivaux cherchaient à
s’assurer l’appui de Mourad et, revenus en Morée après un séjour à
Constantinople, fertile en intrigues (septembre 1435-juin 1436), ils se
préparaient à une guerre civile, lorsque Jean VIII parvint à leur imposer sa
médiation : Constantin revint à Constantinople et Théodore resta en
Morée .
Ce fut dans ces circonstances que Jean
VIII, désespérant de sauver Constantinople par ses propres forces, reprit la
question de l’union religieuse, préface nécessaire d’une croisade générale.
L’Union de Florence (1437-1439). — Après sa
restauration en 1402, Manuel oublia entièrement l’Union, machine de guerre à effrayer
les Turcs. Ce fut seulement après le rétablissement de l’unité ottomane par
Mahomet Ier que la question recommença à le préoccuper. Il envoya un
délégué au concile de Constance (1417) et ses ouvertures furent bien
accueillies du pape Martin V. Les pourparlers continuèrent pendant le voyage de
Jean VIII en Occident (1423), mais furent rompus après la signature du traité
entre Manuel et Mourad .
Ce fut après la prise de Thessalonique par
les Turcs que Jean VIII fit de nouvelles ouvertures à Martin V en lui demandant
la réunion d’un concile œcuménique à Constantinople (août 1430) . Mais l’état troublé de
l’Occident, la difficulté de réunir Grecs et Latins dans un même concile, de
faire accepter aux Grecs la double procession du Saint-Esprit et l’autorité du
pape, d’organiser une croisade, étaient autant d’obstacles qui paraissaient
insurmontables : de longues années devaient être nécessaires pour aboutir
à une solution et pendant ce temps les Turcs consolideraient leurs positions.
De plus Jean VIII ne pouvait trouver en Occident le terrain solide qu’avaient
connu ses prédécesseurs. A partir de 1431 l’autorité du pape, déjà amoindrie
par le concile de Constance, allait être mise en question par le concile de
Bâle, qui résolut de prendre en main le gouvernement de l’Église et de mettre
fin aux guerres religieuses de Bohême, comme au schisme gréco-latin. Le
basileus se trouva obligé d’engager des négociations à la fois avec le concile
et avec le pape, qui proposaient des solutions opposées. De là une perte de
temps considérable, un échange continuel d’ambassades, de propositions et de
contre-propositions. La chrétienté livrée à l’anarchie faisait le jeu des Turcs
et, quand l’union fut proclamée, il était déjà trop tard pour sauver
Constantinople.
La première ambassade de Jean VIII au pape joua de malheur En traversant la Morée, elle apprit que Martin V était mort (le 20 février 1431) et revint à Constantinople, à la grande colère du basileus . Une seconde ambassade fut envoyée immédiatement au nouveau pape, Eugène IV, élu le 23 mars 1431, mais les conditions n’étaient plus les mêmes que sous Martin V. Le conclave qui élut Eugène IV ne comprenait que 14 cardinaux, et ce qui diminua surtout son autorité ce fut le concile que Martin V avait convoqué à Bâle 20 jours avant sa mort et que son successeur trouva installé à son avènement sous la présidence du cardinal Julien Cesarini . Le premier accueil d’Eugène IV à
l’ambassade grecque fut plein de réserve, et comme siège du futur concile, il
substitua à Constantinople une ville d’Italie, dans laquelle il voulait
transférer le concile de Bâle .
Mais le concile s’opposa à ce
transfert et, d’abord indifférent
à la question de l’Union, prit lui-même en main l’affaire des Grecs et envoya à
Constantinople une ambassade chargée d’informer le basileus que le concile,
représentant l’Église universelle, était supérieur au pape, que l’empereur
Sigismond et tous les princes de l’Europe lui étaient dévoués et que les Grecs
pourraient tirer de grands avantages en renonçant au schisme (début de
1433) . Ces propositions, qui
tranchaient la question de l’autorité du pape dans un sens favorable aux
doctrines grecques, ne pouvaient qu’être bien accueillies à Constantinople.
Aussi Jean VIII se hâta d’envoyer à Bâle son frère le despote Démétrius,
l’higoumène Isidore et Jean Dishypatos .
Ainsi les négociations traînaient en
longueur et les Grecs s’engageaient dans un véritable imbroglio, négociant à la
fois avec Rome et avec Bâle. La première ambassade de Jean VIII au pape ne
revenait à Constantinople qu’après 2 ans d’absence (fin 1433-début de 1434) au
moment où commençaient les pourparlers avec Bâle et elle était accompagnée d’un
légat du pape, le cardinal Garatoni . Les négociations se
poursuivirent ainsi jusqu’à l’automne de 1437 : il y avait plus de six ans
qu’elles avaient commencé. Plus les trois parties échangeaient
d’ambassades , plus les difficultés
devenaient inextricables. Elles portaient sur le choix de la ville où se
tiendrait le concile d’Union : Eugène IV acceptait Constantinople, mais
les pères de Bâle tenaient à Avignon et Jean VIII exigeait
une ville italienne . Il se produisit aussi
une véritable surenchère entre le pape et le concile au sujet des subventions à
accorder aux Grecs pour les indemniser des frais de voyage qu’ils étaient
incapables de supporter. La deuxième ambassade du concile à Constantinople,
dirigée par le dominicain Jean de Raguse (1435-1436), parut un moment sur le
point de l’emporter , mais au même moment
l’ambassade de Jean VIII, qui se trouvait à Bâle, refusait suivant ses instructions
d’accepter la décision de la majorité du concile qui convoquait les Grecs à
Avignon, et déterminait le pape à se rallier à la minorité qui préconisait une
ville d’Italie .
La cause était entendue. Le pape chargea
trois délégués de cette minorité, auxquels il adjoignit ses légats, d’aller
porter ces conclusions à Constantinople où ils arrivèrent en septembre
1437 ,
Au même moment le pape ordonnait le transfert du concile de Bâle à
Ferrare . De son côté le concile
n’avait pas perdu l’espoir de traiter avec Jean VIII ; il lui envoyait
une dernière ambassade, dont faisait partie Jean Grimaldi seigneur de Monaco.
Arrivée à Constantinople le 3 octobre peu après l’ambassade du pape, elle fut
reçue avec égards , mais elle arrivait
trop tard et, le 24 novembre suivant, Jean VIII et les membres du clergé grec
qui avaient été désignés s’embarquaient pour l’Italie .
Au cours de ces négociations compliquées,
la question religieuse, qui était en somme l’essentiel, avait été laissée à
l’arrière-plan, mais parallèlement au travail des chancelleries de nombreux
théologiens des deux partis avaient étudié les conditions dans lesquelles
l’Union était possible. La question se présentait sous un jour beaucoup plus
favorable que par le passé. Depuis le concile de Lyon beaucoup de Grecs s’étaient
mis à étudier la littérature théologique de l’Occident, que des traductions
comme celles de Démétrius Cydonès avaient rendue
accessible à tous. La compréhension mutuelle des Grecs et des Latins était donc
beaucoup plus grande qu’autrefois et c’est ce qui
explique le développement dans le clergé byzantin d’un parti de l’Union, qui
était représenté jusque dans les monastères de l’Athos, et dont les chefs
étaient Bessarion de Trébizonde, métropolite de Nicée , et Isidore, higoumène
de Saint-Démétrius , nommé archevêque de
Kiev (automne 1436) et qui devait entraîner la Russie. Le monde orthodoxe tout
entier en effet avait été invité par Jean VIII à participer au concile d’Union
les patriarches orientaux, les princes russes, les princes roumains, le despote
de Serbie, l’empereur de Trébizonde devaient s’y faire représenter .
Avant le départ, l’empereur tint un
véritable conseil de conscience dans lequel figuraient de futurs adversaires de
l’Union comme Marc Eugenikos et Georges Scholarios , et, ce qui montre dans
quel état de subordination il était vis-à-vis des Turcs, il ne crut pas pouvoir
s’absenter sans prévenir Mourad « à titre d’ami et de frère ». Le
sultan manifesta sa désapprobation et, après le départ du basileus, il aurait
eu des velléités d’attaquer Constantinople et en aurait été détourné par son
vizir Khalil .
Telles furent les conditions
extraordinaires dans lesquelles se présenta le concile d’Union qui s’ouvrit à
Ferrare le 8 janvier 1438, où Jean VIII, le patriarche et la délégation grecque
firent leur entrée dans les premiers jours de mars , après avoir débarqué
le 8 février à Venise, où eut lieu une magnifique réception en leur
honneur .
On commença par perdre du temps pour
attendre les membres du concile de Bâle, qui rompirent complètement avec le
pape ,
et les princes d’Occident qui ne vinrent pas, à la grande déception de Jean
VIII, espérant que l’organisation de la croisade suivrait de près l’Union . Seul le duc de
Bourgogne Philippe le Bon, qui montrait un vif intérêt pour les choses
d’Orient , envoya une délégation
au concile, mais elle n’arriva à Ferrare que le 4 décembre 1438 et s’abstint
d’aller saluer Jean VIII, qui, très mortifié, exigea une réparation . La première session
solennelle eut lieu le 9 avril, mais on accorda 4 mois de délai aux retardataires
et il n’y eut pas d’autre session avant le 8 octobre !
Des discussions sur les points litigieux
commencèrent du moins dans l’intervalle des deux sessions. Le mode de scrutin à
la majorité des voix fut adopté contrairement aux demandes des Grecs, qui
voulaient qu’en matière de dogme chaque parti eût des pouvoirs égaux . Déjà des adversaires
de l’Union prenaient position : Jean VIII dut arrêter une lettre de Marc
d’Éphèse au pape au sujet de la double procession, dont le ton violent ne
pouvait qu’amener une rupture . Il ne put d’ailleurs
empêcher sa tentative de rendre le débat insoluble à la session du 8 octobre en
posant la question : « Est-il permis d’ajouter au
symbole ? » mais Bessarion proposa de la discuter sous une autre
forme : « Le filioque est-il légitime ? » et prononça un discours sur la nécessité de
l’Union . Marc d’Éphèse reprit
sa question à la troisième session (14 octobre), mais ni les discussions érudites,
ni les joutes oratoires dont elles furent suivies ne donnèrent le moindre résultat .
Le découragement était grand. Malgré les
rapports assez cordiaux qui s’étaient établis entre Grecs et Latins , l’Union ne faisait
aucun progrès. La peste avait fait son apparition à Ferrare au mois de juillet
et sa violence s’accrût à tel point que le pape ordonna le transfert du concile
à Florence (janvier 1439) , L’installation de
l’assemblée dans sa nouvelle résidence dura plus d’un mois et la première
session ne se tint que le 14 février. Dans le clergé grec le parti de l’Union
gagnait de jour en jour et Marc d’Éphèse n’avait plus autour de lui qu’un noyau
d’intransigeants, dont son frère Jean Eugenikos et le despote Démétrius , On n’en continua pas
moins la discussion sur la procession du Saint-Esprit, qui occupa encore 8 sessions
(2-24 mars) et donna lieu à un duel acharné entre Marc d’Éphèse et Jean de
Raguse. Celui-ci ayant avoué que le Père est la cause du Fils et de l’Esprit,
on y vit un terrain de conciliation et, Jean de Raguse devant défendre ses
arguments, le basileus, excédé de cette interminable discussion, défendit à
Marc de lui répondre .
On finit alors par comprendre qu’aucun
résultat ne pouvait sortir d’une procédure aussi longue. Jean VIII et Eugène IV
furent d’accord pour supprimer les discussions publiques et les remplacer par
des colloques entre les commissions des deux partis, composées exclusivement
d’Unionistes, qui après s’être mises d’accord, rédigeraient des cédules que
l’on ferait signer par tous les membres du concile. Le 30 mars cette décision
fut communiquée à l’assemblée du clergé grec. Des discussions violentes
s’engagèrent entre Marc d’Éphèse, Isidore de Russie et Bessarion, mais Jean
VIII imposa silence aux anti-unionistes et tous les efforts furent désormais
concentrés sur les moyens d’aboutir à l’Union , Au lieu de rechercher
les discordances, Bessarion montrait la concordance des Pères grecs et latins
sur le dogme du Saint-Esprit .
La cédule sur la double procession du
Saint-Esprit préparée par Bessarion fut adoptée par les Grecs (4 juin) et par
le pape (8 juin) . Il ne restait plus
qu’à arriver à une entente sur les questions des azymes , du Purgatoire et de
l’autorité du pape, seules divergences reconnues par le concile comme méritant
une discussion . L’Union paraissait tellement
certaine que des négociations s’engageaient entre le pape et l’empereur au
sujet de la croisade et que le despote Démétrius, Gémiste Pléthon et Georges
Scholarios quittaient Florence pour ne pas avoir à donner leur signature , Le patriarche Joseph
était mort le 9 juin en laissant par écrit une confession unioniste. Afin de hâter le
dénouement, le pape remit aux métropolites grecs des cédules indiquant
l’opinion de Rome sur les points controversés (10 juin) , L’accord sur le
Purgatoire, l’emploi des azymes, le moment de la consécration, se fit
facilement (12 juin-5 juillet) . Il n’y eut de
véritable difficulté que sur la question de l’autorité universelle du pape, que
l’empereur ne voulait pas admettre en ce qui concernait les patriarches, et la
tenue des conciles œcuméniques. La tension fut un moment assez vive et Jean
VIII parla de départ (23 juin), mais on finit par accepter la formule un peu
vague présentée par Bessarion, reconnaissant au pape le pouvoir suprême, sauf
les droits et privilèges de l’Église d’Orient (26 juin) .
L’accord était complet, mais la rédaction
de l’acte d’Union n’en fut pas moins laborieuse. Sa signature, fixée par le
pape au 28 juin, jour de la fête des Apôtres, n’eut lieu que le 5 juillet par
suite des objections faites par l’empereur . Le 6 juillet l’Union
fut proclamée solennellement à la cathédrale Sainte-Marie-des-Fleurs, sous le
dôme sublime achevé trois ans plus tôt par Brunelleschi. Bessarion, métropolite
de Nicée, lut le texte grec, le cardinal Julien Cesarini le texte latin, puis
les deux prélats s’embrassèrent .
L’Union à Constantinople. — Après une
dernière réunion solennelle (26 août), jean VIII et les Grecs allèrent
s’embarquer à Venise (11 octobre) . L’empereur était de
retour à Constantinople le 1er février 1440 . Le concile n’en
continua pas moins ses travaux après le départ des Grecs, et successivement
toutes les Églises d’Orient détachées de Constantinople : Arméniens,
Jacobites, Chaldéens, Maronites, Éthiopiens s’unirent à l’Église romaine . Le 15 décembre 1439
Eugène IV comprenait Bessarion et Isidore de Russie dans une promotion de
cardinaux et en septembre 1443 le
pape, après neuf ans d’absence, regagnait Rome, où le concile tenait encore
deux sessions .
Mais comment l’Union allait-elle être
accueillie à Constantinople? Le basileus et les théologiens qui revenaient de
Florence pouvaient croire sincèrement que ce rapprochement prolongé entre les
représentants des deux Églises avait dissipé les préventions mutuelles et annulé
en quelques mois l’œuvre schismatique de quatre siècles. Il n’y avait plus
qu’une Église universelle, au sein de laquelle la chrétienté d’Orient
conservait ses usages et ses privilèges séculaires et qui assurerait à
Constantinople la protection efficace de l’Occident. Mais il restait à
convaincre le clergé et le peuple et, dès leur retour en Romania, les membres
du concile, par l’accueil qui leur fut fait, comprirent les difficultés de
cette entreprise . A peine arrivé à
Constantinople, Jean VIII trouva une telle opposition qu’il renonça provisoirement
à la proclamation solennelle de l’Union à Sainte-Sophie. Les adversaires de
l’Union étaient la grosse majorité et de hauts dignitaires, même bien en cour
comme Phrantzès, y étaient hostiles , Les plus modérés
acceptaient le rétablissement du nom du pape dans les diptyques, mais à
condition qu’on s’abstînt de lire le tomus
unionis .
Jean VIII essaya de réagir.A. défaut de
Bessarion retourné en Italie, il remplaça le patriarche Joseph, mort à
Florence, par Métrophane, évêque de Cyzique, dévoué à la cause de l’Union
(printemps de 1440) . Marc d’Éphèse, aidé
par son frère Jean Eugenikos , était le véritable
chef de l’opposition et attaquait avec la plus grande violence les signataires
de l’Union : Jean VIII
l’obligea à regagner son évêché et, comme il cherchait à se réfugier au Mont
Athos, il fut arrêté et emprisonné par ordre impérial . Il continua d’ailleurs
sa propagande par ses lettres et il gagna à sa cause une recrue de premier
ordre en la personne de Georges Scholarios, secrétaire impérial très influent,
qui, bien que défavorable à l’Union, avait hésité jusque-là à la
condamner .
C’était en vain que le pape essayait de
stimuler le zèle du basileus qui paraissait débordé par l’opposition. En 1440
il lui envoya un légat , ainsi que des théologiens
chargés de défendre la doctrine de l’Union. En 1443 Jean VIII organisa une
dispute publique entre deux évêques latins et Marc d’Éphèse, mais, d’après les
témoignages, les deux partis s’attribuèrent la victoire . Des conférences dogmatiques
auxquelles participa Scholarios eurent lieu en présence du Sénat . Ces manifestations
oratoires ne donnèrent aucun résultat. Le patriarche Métrophane se plaignit
d’être mal soutenu par le basileus et démissionna. Sa succession donna lieu à
de nombreuses difficultés et ce fut seulement en 1445 que Jean VIII put le
remplacer par un adversaire de Marc d’Éphèse, Grégoire Mamma, qui fut aussitôt
attaqué par Scholarios et bafoué ouvertement à Sainte-Sophie .
Fait plus grave encore, le clergé grec des
pays occupés par les Turcs s’habituait à leur domination et en était venu à la
préférer à celle des Francs . Une notice datée de
1436 montre les clercs portant des habits turcs, parlant la langue de leurs
vainqueurs et 12 archevêques qui, bien que consacrés par le patriarche, doivent
être autorisés par les autorités ottomanes L’aventure de
Bertrandon de la Broquière passant à Péra en 1432 est significative : pris
pour un musulman, il est comblé d’égards et quand il se dit chrétien, il est
rançonné et doit dégainer pour se défendre . L’Église commence à se
désintéresser du sort de l’État byzantin.
Enfin les
querelles au sujet de l’Union se greffent sur les discordes des Paléologues, à
peine interrompues par le concile. La question de l’héritage de Jean VIII se
complique de celle du parti que prendra son successeur vis-à-vis de l’Union.
Deux des frères du basileus, Constantin et Théodore, lui sont favorables ; on a vu par
contre que Démétrius avait quitté Florence pour ne pas la signer . Protecteur de Marc
d’Éphèse, il était l’espoir des adversaires de l’Union. Or Jean VIII préférait
comme héritier son frère Constantin, qui avait gouverné Constantinople pendant
son absence et n’en était parti qu’en juillet 1441 pour aller épouser Catherine
Gattilusio à Lesbos . De son côté Démétrius
avait achevé de s’aliéner le basileus en épousant contre son gré la fille d’un
archonte de Morée, Paul Asên, descendant de l’ancienne dynastie bulgare .
Et pendant que les Occidentaux essayaient
d’organiser la croisade qui dégagerait Constantinople, les Byzantins mettaient
la question de l’Union avant toutes les autres et les Paléologues donnaient le
spectacle scandaleux d’une guerre fratricide dans laquelle ils faisaient
intervenir Mourad. Démétrius avait reçu en apanage la côte de la mer Noire, de
Mesembria à Derkos, et Selymbria sur la Propontide . Jean VIII, le trouvant
trop menaçant, lui enleva une partie de son territoire et, pour l’éloigner de
Constantinople, Constantin lui fit demander par Phrantzès d’échanger cet
apanage de la mer Noire contre celui qu’il possédait en Morée (octobre 1441).
Mais Démétrius, appuyé par son beau-frère Asên, et avec des troupes turques,
marcha sur Constantinople, en trouva les portes fermées, ravagea la banlieue et
assiégea la ville pendant plusieurs mois (avril-juillet 1442). Constantin,
s’étant embarqué pour aller secourir le basileus, fut attaqué par une escadre
turque et obligé de débarquer à Lemnos où il fut bloqué jusqu’au mois
d’octobre . Ce fut alors que
Mourad intervint : jugeant dangereuse cette querelle entre Paléologues à
la veille de l’arrivée d’une croisade, il conseilla à Démétrius de céder le
territoire en litige contre une compensation .
Démétrius ne recouvra pas son apanage et
Constantin fut mis en possession de Selymbria (mars 1443), qu’il échangea au
mois de juin suivant contre l’apanage de Théodore en Morée . Il semble que Théodore
ait songé de nouveau à succéder à Jean VIII et même à le détrôner, car peu
après il complote avec Thomas et Démétrius contre le basileus. Dénoncé,
Démétrius fut arrêté et emprisonné avec son beau-frère, mais il parvint à
s’échapper, se réfugia à Galata et négocia avec Jean VIII, qui lui donna
plusieurs îles en apanage .
L’animosité ne fut pas éteinte pour cela
entre ces incorrigibles brouillons. Théodore et Thomas cherchèrent encore à
entraîner Démétrius dans un nouveau complot. Il refusa d’abord, puis accepta de
venir à Selymbria, mais Théodore mourut avant son arrivée (juillet 1448).
Cependant Jean VIII, qui sentait son trône peu solide, aurait été sur le point
de lui restituer son apanage de la mer Noire lorsqu’il mourut lui-même le 31
octobre 1448 . A lire le récit de ces
invraisemblables discordes, on a l’impression que les Paléologues oubliaient
que le sort de Constantinople se jouait au même moment sur les deux rives du
Danube.
La croisade de Constantinople. — La croisade
générale contre le Turc aurait dû suivre de près l’Union, mais l’état de
l’Occident était trop troublé pour qu’il fût possible de l’organiser. De 1439 à
1442 il n’en fut pour ainsi dire pas même question et Mourad put continuer son
offensive contre les États chrétiens, envahir la Transylvanie (1438) , enlever à la Serbie la
tête de pont de Semendria (août 1439) , forcer le despote
Georges Brankovič à s’enfuir à Raguse et à Venise en ne conservant
de son État que quelques villes de l’Adriatique (1439-1440) , attaquer Vladislas
III, roi de Pologne, élu roi de Hongrie après la mort d’Albert d’Autriche .
Mais Mourad ne put s’emparer de Belgrade
après deux sièges successifs (1440-1441) et dans l’hiver de
1441-1442 les Turcs ayant envahi la Transylvanie et pillé Hermanstadt se
préparaient à pénétrer dans la plaine hongroise par la vallée du Maros, quand
ils rencontrèrent la résistance inattendue de Jean Hunyade, « le chevalier
blanc des Valaques », d’une famille roumaine de petite noblesse, créé par
Vladislas voiévode de Transylvanie . A la tête des
contingents roumains des Sept Districts, il infligea aux Turcs une défaite qui les
obligea à repasser les Carpathes en abandonnant de nombreux morts et prisonniers
(23 mars 1442) Après avoir envahi la
Valachie, Hunyade détruisit entièrement une seconde armée turque qui avait
passé le Danube à Silistrie et rapporta un immense butin (septembre) .
La nouvelle de ces victoires répandue en
Occident y excita l’enthousiasme et donna un regain de faveur à la croisade que
l’on y préparait avec la lenteur habituelle. Le pape la fit prêcher en Italie
et Venise elle-même s’y montra favorable. Georges Brankovič, réfugié en
Hongrie, se lia d’amitié avec Jean Hunyade et forma avec lui une ligue,
laquelle adhéra le hospodar de Valachie, Vlad Dracul, pour chasser les Turcs de
Serbie et de Bulgarie . Mais les plans grandioses
qui ne manquaient jamais ne furent pas suivis d’effet. Cesarini ne put décider
l’empereur Frédéric III à se mettre à la tête des croisés. Venise offrait des
navires, mais pour défendre ses colonies contre le Soudan d’Égypte, et ne
faisait aucune réponse à l’envoyé de Jean VIII qui venait implorer le secours
de quelques galères . Seuls parmi les princes
d’Occident Philippe le Bon et Alphonse de Naples s’intéressaient vraiment à la
croisade, mais les navires envoyés en Orient par le duc de Bourgogne
n’apportaient aucune aide efficace à Constantinople . Venise laissait la
Hongrie prendre l’initiative de la croisade sans la soutenir.
Cependant les circonstances étaient
d’autant plus favorables que le prince de Karamanie Ibrahim, en apprenant les
victoires de Jean Hunyade, s’était révolté contre Mourad et l’obligeait à
entrer en campagne en Anatolie dans l’été de 1443 . De son côté Hunyade,
qui avait passé l’année à faire ses préparatifs, ne fut prêt qu’en octobre et
imposa aux Turcs une campagne d’hiver. Après avoir passé le Danube à Belgrade
et traversé la Serbie moravienne sans coup férir, Jean Hunyade suivit « le
long chemin » qui devait aboutir dans sa pensée à Andrinople et à
Constantinople. Successivement Nisch le 3 novembre, Sofia le 4 décembre tombaient
entre ses mains, et Mourad revenu d’Asie fuyait devant lui sur la route
d’Andrinople. Mais la saison était trop avancée : malgré des efforts
surhumains, les alliés ne purent franchir les Portes de Trajan qui donnent
accès du bassin de Sofia dans la plaine de Thrace. Il fallut battre en retraite
devant les avalanches (janvier 1444), mais la Serbie était libérée et le
prestige ottoman fortement entamé .
Ce furent ces victoires qui déterminèrent
enfin l’organisation de la croisade générale. De nombreux préparatifs furent
faits en Hongrie, et Venise, qui espérait reprendre ses anciennes possessions
dans la péninsule balkanique, Thessalonique et Gallipoli surtout, promit une
flotte, envoya une ambassade à Bude et reçut le sieur de Wavrin, qui venait
offrir 4 galères au nom de Philippe le Bon. Le roi de Naples s’engageait à
armer une flottille et le roi de Hongrie, d’accord avec Georges Brankovič et Vlad Dracul, avait juré de recommencer la guerre l’été suivant .
Mais, comme toujours, les préparatifs et
les pourparlers furent interminables et surtout il n’y eut aucune entente entre
les alliés. La flotte vénitienne se trouvait à Modon (juillet 1444) alors que
l’armée hongroise n’était pas prête . Un peu auparavant le
cardinal-légat Julien Cesarini arrivait à Constantinople avec des galères
pontificales , D’autre part, au
moment où l’expédition allait commencer, Georges Brankovič, satisfait
d’avoir recouvré ses États, traitait avec le sultan et, sans avoir reçu aucun
pouvoir de Vladislas, provoquait l’envoi d’une ambassade ottomane à Bude . Que se passa-t-il
alors ? D’après Doukas, dont le texte est rempli de confusions et d’erreurs , Vladislas aurait signé
un traité formel avec Mourad, qui aurait abandonné la Serbie et la Valachie à
la suzeraineté hongroise , mais les Annales
turques, qui mentionnent l’accord entre Mourad et Brankovič, ne disent rien
de ce traité et il semble résulter
du témoignage de Laonikos Chalcokondylès que Brankovič a signé une paix
séparée avec Mourad, qu’il a provoqué l’envoi de l’ambassade du sultan à Bude,
qu’il n’y a pas eu de traité formel entre Vladislas et Mourad, mais un échange
de serments, une sorte de pacte de non-agression, qui détermina le pape à
relever Vladislas de ses serments . De toute manière
c’était un mauvais début pour la croisade.
En revanche une circonstance favorable fut
la deuxième révolte du prince de Karamanie, qui força Mourad à repasser en Asie
après son traité avec Brankovič (printemps de 1444).
Ibrahim s’enfuit à l’approche du sultan et implora la paix, que Mourad lui
accorda (juin 1444) , après quoi le sultan
se retira à Magnésie et, bien qu’étant dans la force de l’âge, abdiqua en
faveur de son fils Mahomet II .
Ce fut seulement le 2 juillet 1444 que
l’armée hongroise s’ébranla sous le commandement de Vladislas qui démentit
solennellement, le bruit en ayant couru, qu’il eût signé un traité avec les
Turcs . Le passage du Danube
eut lieu à Nicopolis (18-22 septembre). L’objectif des croisés était le port de
Varna, où l’armée devait retrouver la flotte chrétienne et s’embarquer pour
Constantinople . Grossie du contingent
valaque de Vlad Dracul qui arriva le 16 octobre, l’armée hongroise atteignit
Varna en novembre , La flotte chrétienne
était en retard et Vladislas apprit que Mourad, sorti de sa retraite, avait pu
passer le Bosphore avec les troupes d’Asie et marchait sur Varna . Le 10 novembre les
deux armées entraient en contact : les Turcs furent enfoncés aux deux ailes
et Jean Hunyade, victorieux des troupes d’Asie, attaqua le centre, mais malgré
son avis, Vladislas voulut diriger une charge et jeta la confusion dans
l’armée. Lui-même fut tué et l’on porta sa tête au sultan, qui s’apprêtait à
fuir. Les Hongrois s’enfuirent en désordre et le légat Cesarini périt au cours
de la déroute .
Cette défaite écrasante était due à une
manœuvre inconsidérée, qu’expliquent le manque de discipline et le partage du
commandement entre Jean Hunyade et le roi Vladislas, mais la responsabilité de
l’échec de la croisade, dont le plan était bien combiné, incombe à l’amiral
vénitien Lorédan qui s’attarda dans la Méditerranée et ne put ni empêcher
l’armée de Mourad de traverser le Bosphore, ni arriver à temps à Varna pour
permettre aux croisés de s’embarquer pour Constantinople .
L’occasion perdue ne devait pas se
retrouver et les derniers efforts qui furent faits pour sauver Constantinople
s’avérèrent inutiles. La nouvelle du désastre fut connue tardivement en
Occident. De Nègrepont, Lorédan l’annonçait à Venise (21 mars 1445) et il
recevait l’ordre de contraindre le sultan à faire la paix .
Le pape au contraire enjoignait à la flotte
chrétienne de continuer la croisade et de se mettre à la recherche du roi de
Hongrie et du légat que l’on croyait vivants. Les navires pontificaux et
bourguignons remis en état à Constantinople allèrent croiser dans la mer Noire
et remontèrent le Danube en attaquant les places turques . Un légat traita avec
Jean Hunyade qui avait été nommé régent de Hongrie au nom du fils mineur
d’Albert d’Autriche Ladislas V (juillet 1445) . L’hiver venu, la
flotte rentra à Constantinople et peu après, Venise, abandonnant la croisade,
signait la paix avec Mourad (25 février 1446) .
Cependant les partisans de la résistance
aux Turcs ne désarmaient pas. Il est peu vraisemblable, comme l’affirme
Chalcokondylès, que Jean VIII résigné ait conclu un nouveau traité de sujétion
avec Mourad . On voit au contraire
ses ambassadeurs parcourir l’Europe en 1445 et obtenir des promesses de
secours . Jean Hunyade préparait
sa revanche et allait exécuter le prince valaque Vlad Dracul, qui l’avait trahi
à la fin de la bataille de Varna . Enfin sous le gouvernement
de Constantin Dragasès et de Thomas Paléologue, la Morée était devenue le
principal centre de la résistance byzantine (1444-1446). La muraille de
l’Hexamilion avait été reconstruite, des hommes de confiance avaient été mis à
la tête des villes et Constantin, croyant au succès de la croisade, avait forcé
le duc d’Athènes, Nerio Acciaiuoli, vassal des Turcs, à lui payer tribut, et
occupé la Grèce jusqu’au Pinde . Les linéaments d’un
nouvel État byzantin se dessinaient dans le cadre de la Grèce antique, mais
après la défaite de Varna, il fallut renoncer à cet espoir. Venise rappela sa
flotte, et son traité avec Mourad laissa le despote sans allié, exposé aux
représailles. En novembre 1446 Mourad envahit la Morée, fit bombarder
l’Hexamilion à coups de canon et s’en empara (10 décembre). Le pays ouvert aux
Turcs fut cruellement ravagé et Mourad se retira avec des troupeaux de
prisonniers. Nerio fut rétabli à Athènes et, pour conserver leurs possessions,
les despotes durent payer au sultan un tribut élevé .
Une dernière croisade fut tentée en 1448,
mais cette tentative suprême eut un caractère restreint : Jean Hunyade et
l’Albanais Georges Castriota en furent les seuls participants, Alphonse
d’Aragon le seul protecteur. Si elle ne put sauver Constantinople, elle eut du
moins pour effet d’arrêter l’avance des Turcs vers l’Occident.
Georges Castriota, dit Iskander-beg , avait pour père le
chef d’un clan albanais qui dut livrer ses fils en otages au sultan après
l’insurrection de 1423. Élevé à Andrinople et converti à l’islam, il figura
dans l’armée turque, pendant le Long Chemin de Jean Hunyade en 1443, mais
s’échappa après la défaite des Turcs et, grâce à un firman obtenu de force,
s’empara de la ville forte de Croïa, redevint chrétien et commença contre les
Turcs une lutte qui dura jusqu’à sa mort (1468) , Acclamé par les clans
comme capitaine général de la ligue albanaise , il dispose d’une armée
solide et bat les Turcs à sa première rencontre avec eux (29 juin 1444),
victoire qui lui vaut les félicitations d’Eugène IV, de Vladislas et de Philippe
le Bon , mais il ne peut
prendre part à la croisade de Varna et se laisse engager dans l’alliance
d’Alphonse d’Aragon, devenu roi de Naples en 1442. Résolu à reprendre les
projets de ses prédécesseurs normands et angevins dans la péninsule des
Balkans, mais trouvant partout Venise sur son chemin, Alphonse traita avec
Scanderbeg et lui promit le concours de sa flotte (décembre 1447) .
De son côté Jean Hunyade préparait la
croisade, envoyait une ambassade à Venise (mai 1447), se mettait en rapport
avec Scanderbeg et s’assurait l’appui de la république de Raguse (mars
1448) . Mais cette ardeur pour
la croisade s’éteignit brusquement. Scanderbeg en fut détourné par son allié le
roi de Naples et par Georges Brankovič : ils l’engagèrent
dans une guerre contre Venise qui dura de la fin de 1447 à octobre 1448 . En juillet de cette
année Mourad, excité par Venise, envahit l’Albanie, mais échoua devant Croïa et
se retira, non sans dommage pour son armée . Lorsque après avoir
signé la paix avec Venise (4 octobre) , Scanderbeg voulut
aller au secours de Jean Hunyade , il était déjà trop
tard. Les croisés avaient passé le Danube au château de Severin (28 septembre)
et s’étaient avancés jusqu’à Nisch. Là, Hunyade chercha à se rapprocher de Scanderbeg
et, remontant la Morava bulgare, arriva dans la plaine de Kossovo : il se heurta à
l’armée de Mourad qui, craignant l’arrivée des Albanais, le força à lui livrer
une bataille qui dura trois jours (17-20 octobre) : le troisième jour la
trahison du contingent roumain démoralisa les Hongrois qui s’enfuirent dans la
direction de Belgrade ; Jean Hunyade lui-même tomba au pouvoir de Georges
Brankovič, dont l’attitude n’avait cessé d’être équivoque,
et fut un moment son prisonnier .
Malgré ce désastre, dont la nouvelle aurait
hâté la mort de Jean VIII , Jean Hunyade conserva
intact son royaume de Hongrie, qui resta pour les Turcs une barrière infranchissable
du côté de l’Europe centrale, tandis qu’en Albanie Scanderberg leur barrait le
chemin de l’Adriatique. En les forçant à montrer plus de vigilance de ce côté,
cette double résistance retarda de quelques années la chute de Constantinople.
Ce fut en effet vers l’Albanie qu’an
lendemain de sa victoire de Kossovo Mourad porta son principal effort, mais
Scanderbeg, en butte à l’hostilité de Venise et sans autre allié que la
république de Raguse, tint tête au sultan, lui infligea des pertes énormes devant
Croïa et le força à lever le siège de cette place après cinq mois d’attaques
répétées (juillet-novembre 1450) .
L’effet produit par cette victoire dans
toute la chrétienté fut immense : Alphonse de Naples envoya des subsides
au vainqueur qui, devant le mauvais vouloir de Venise, fit alliance avec
lui .
Alphonse, qui songeait toujours à la conquête de l’Empire byzantin, fut reconnu
roi d’Albanie et se fit livrer la citadelle de Croïa (avril 1452) . Mais ces combinaisons
à courte vue n’allaient pas tarder à être déjouées par les événements. Le sort
de Constantinople n’était déjà plus en question.
4. La mort de Byzance (1448-1453)
Jean VIII
était mort le 32 octobre 1448, à l’âge de 65 ans, après 23 ans et 3 mois de
règne pendant lesquels il avait lutté avec courage pour sauver Byzance, mais il
avait été débordé par les événements, avait vu échouer tous ses plans et
laissait à son successeur une situation tragique . Les discordes entre
ses frères, auxquelles sa succession avait donné lieu de son vivant, faisaient
prévoir qu’une nouvelle guerre civile allait éclater après sa mort : en
fait elle fut évitée de justesse. Jean VIII avait désigné le plus âgé de ses frères,
Constantin Dragasès, né en 1404 , pour lui succéder,
mais une grande partie du peuple opposée à l’Union s’attendait à ce que Démétrius
prît le pouvoir . Effectivement,
Constantin se trouvant alors dans son apanage de Morée, Démétrius s’empara de la
direction du gouvernement et mit Constantinople en état de défense :
d’après Scholarios, son apologiste, il agit ainsi d’une manière désintéressée,
se considérant comme le mandataire de son frère , mais Phrantzès et
Chalcokondylès témoignent au contraire que sa mère, l’impératrice Irène, veuve
de Manuel, et les archontes, redoutant une guerre civile, s’opposèrent à ce
qu’il prît la couronne. De plus Thomas Paléologue, débarqué à Constantinople
(13 novembre), prit parti contre lui et ce fut ainsi que la succession de Jean
VIII fut assurée à Constantin Dragasès .
Mais il fallut obtenir l’assentiment de
Mourad, suzerain de Byzance, et Phrantzès fut chargé de cette démarche
humiliante . Le 6 janvier 1449
Constantin fut couronné basileus dans la Métropole de Mistra et le 12 mars il
fit son entrée à Constantinople . A peine arrivé, il
envoya une ambassade à Mourad avec des présents, et le sultan signa un nouveau
traité avec les Paléologues .
Une autre difficulté fut de délimiter les
apanages des deux despotes. Déçu dans ses ambitions, Démétrius, qui ne
possédait que quelques îles, voulait une compensation. Au conseil impérial il
demanda à recouvrer son apanage de la mer Noire en soutenant qu’il serait ainsi
plus utile à la patrie, mais le conseil en jugea autrement et partagea la Morée
entre lui et Thomas . Après avoir prêté un
serment solennel de n’élever aucune autre revendication et de ne se faire aucun
tort mutuel, les deux frères partirent pour la Morée (août-septembre
1449) . Mais à peine
étaient-ils dans leurs domaines qu’ils commencèrent à se quereller. Thomas
occupa les villes de Démétrius avec le secours des Turcs ; Démétrius
s’adressa à Mourad et un corps de Turcs vint obliger Thomas à abandonner ses
prises. Un arbitrage de Constantin XI rétablit la paix entre les deux
frères (fin 1450) ; mais
la guerre recommença entre eux quelques mois plus tard (printemps de
1451) : grâce à l’intervention de Tourakhan-beg envoyé par Mahomet Il, Démétrius
fit reculer son frère et, après un échange de territoires, ils se réconcilièrent
(mai 1451) .
Ces deux étranges despotes semblaient se
désintéresser du sort de Constantinople et ne cessaient par leurs incursions
d’irriter Venise, déjà en mauvais termes avec Constantin XI . L’alliance des
Paléologues avec Raguse était loin d’avoir pour
eux la même utilité et, Démétrius ayant conclu avec cette ville un traité
d’amitié dirigé contre les Turcs, Thomas inquiet le dénonça aussitôt au sénat
de Venise . Les deux Paléologues
ne perdaient donc aucune occasion de se nuire au moment où leur accord eût été
plus que jamais nécessaire.
Cependant, à
l’avènement de Constantin Dragasès, la situation de Constantinople était
vraiment désespérée. La croisade avait été mise en déroute : seul Scanderbeg
luttait encore, mais si son courage servait à retarder la catastrophe, il ne
pouvait fournir aucun appui direct. Sauf en Albanie, Mourad avait repris toutes
ses positions dans la péninsule balkanique : il tenait dans une dépendance
étroite Constantinople et la Morée. Les discordes des Paléologues et les
querelles religieuses travaillaient pour lui et il n’avait qu’à laisser mûrir
le fruit. Les appréhensions des Grecs étaient grandes, comme le montrent les
exhortations que Georges Scholarios adressait à Démétrius après sa guerre
contre Thomas : « Tu ne combats pas seulement pour tes droits, mais
pour les restes des Hellènes qui périront au milieu de nos discordes.
Puisses-tu prendre de meilleures résolutions dans l’intérêt de ce qui reste de
notre race infortunée, exposée à s’évanouir au moindre souffle ou à être
dévorée par nos ennemis . »
L’effervescence religieuse, qui n’avait cessé de régner à Constantinople, était
pour l’autorité du basileus la principale cause d’affaiblissement. Après la
mort de Marc d’Éphèse , son frère Jean
Eugenikos, diacre de Sainte-Sophie, adressa à Constantin XI à son arrivée un
véritable ultimatum dans lequel il le sommait de défendre la vraie foi, compromise
par Jean VIII, que le clergé refusait de commémorer dans la liturgie. Marc y
était proclamé « le plus récent des saints et des docteurs qui environnent
le trône de Dieu » . Georges Scholarios,
qui avait attaqué le choix de Constantin comme basileus, se fit moine et, sous
le nom de Gennadios, devint le chef des adversaires de l’Union , en même temps que le
mégaduc Lucas Notaras, l’un des hommes les plus influents et les plus riches de
Byzance, assez fortuné pour faire des avances au trésor public, que Jean
Eugenikos appelait dans une lettre « le père de la patrie », qui
regardait les secours de l’Occident comme des sornettes, φλυαρίαι,
et qui aurait dit, d’après Doukas, qu’il préférait voir le turban du sultan
dans la ville plutôt que le chapeau d’un cardinal .
Devenus chaque jour plus audacieux, les
anti-unionistes purent tenir à Sainte-Sophie un concile où les trois
patriarches d’Orient étaient présents : Gémiste Pléthon y prononça un
discours contre la double procession du Saint-Esprit, des évêques unionistes se
rétractèrent, le patriarche Grégoire fut déposé, et une liste des erreurs des
Latins fut dressée en 25 articles . Le basileus était si
impuissant à réprimer cette agitation que le patriarche s’enfuit à Rome . Cependant Constantin
XI entreprit de mettre fin à ces provocations par une proclamation solennelle
de l’Union.
En avril 1451 il envoyait une ambassade au
pape Nicolas V, qui avait succédé à Eugène IV , en lui demandant
d’envoyer des secours à Constantinople, qui n’avait plus ni troupes ni
vaisseaux, et des légats pour proclamer l’Union. Dans sa réponse au basileus
(11 octobre 1351), le pape formulait le même programme, annonçait l’envoi du
cardinal Isidore de Russie comme légat, promettait d’envoyer des galères
fournies par Venise et exigeait la réintégration du patriarche Grégoire . Informé de ces
démarches, Gennadios envoya au basileus un « Discours apologétique »
dans lequel il déplorait le résultat de l’ambassade à Rome, « qui avait
brouillé nos affaires ecclésiastiques » et provoqué un ultimatum du pape,
offrait ses services pour disputer avec les légats des choses de la foi et
ajoutait qu’il était prêt à indiquer au basileus ce qu’il faudrait faire pour
sauver la ville, « mais je sais bien que cela ne sera pas »,
disait-il avec amertume . En même temps il se
livrait à une propagande active pour faire échouer la mission des légats, comme
le montre sa correspondance et, parlant devant Constantin au monastère du
Pantocrator (15 octobre 1452), il déconseillait l’appel aux forces de
l’Occident, soutenant que les orthodoxes devaient sauver la ville par leurs
propres moyens .
Seule la passion antiromaine explique une
pareille inconscience, car, sans les secours de l’Occident, il n’y avait
d’autre solution que la capitulation ; mais la mission des légats du pape
était d’avance vouée à l’insuccès.
Quelques jours après l’assemblée du
Pantocrator, une galère génoise amenait le cardinal Isidore de Russie et
Léonard, archevêque de Chio, avec 200 arbalétriers . Persistant dans son
opposition, Gennadios afficha à la porte de son monastère une profession de foi
(1er novembre). Le 15, convoqué au Palais, il remettait au clergé un
exposé écrit (Ekthesis) des mesures qui, suivant lui, convenaient à la ville et
à l’Église et le 27 novembre,
alors que les forces ottomanes bloquaient déjà Constantinople, il adressait
« à tous les citoyens nobles de la ville, à tous les hiéromoines et
séculiers » une Encyclique dans laquelle il se plaignait des calomnies
répandues contre lui et justifiait toute sa conduite .
Ce fut dans ces circonstances tragiques que
l’Union de Florence fut proclamée à Sainte-Sophie, le 12 décembre 1452, en
présence de Constantin XI, ainsi que du légat Isidore et du patriarche Grégoire
qui officièrent en commun, assistés de 300 prêtres . La rage des adversaires
de l’Union ne connut plus de bornes : la Grande Église fut désertée comme
si elle était devenue un repaire de démons, et des clercs fanatiques
infligeaient les plus dures pénitences à ceux qui avaient reçu l’eucharistie
des mains d’un prêtre unioniste ou les privaient même de la communion .
Les destins de Byzance
s’accomplissaient : Varna avait été la faillite de la croisade ; la
cérémonie de Sainte-Sophie fut celle de l’Union des Églises.
Mahomet II le Conquérant. — Pendant que
les Grecs se disputaient ainsi aveuglément, l’orage s’amassait sur
Constantinople. Le sultan Mourad II était mort près d’Andrinople le 2 février
1451 .
Le premier acte de son héritier, Mahomet II, fut de faire étrangler un enfant
encore à la mamelle, que son père avait eu d’une princesse de Sinope . Agé de 21 ans et ayant
déjà l’expérience de la guerre et des affaires de l’État, le nouveau sultan
était bien décidé à en finir avec Constantinople et, suivant Doukas, il était
hanté nuit et jour par cette unique préoccupation . Cependant les
circonstances l’obligèrent à différer l’accomplissement de ses desseins. Après
avoir tenu sa cour à Andrinople, renouvelé ses traités avec ses vassaux chrétiens
et signé une trêve de trois ans avec Jean Hunyade , il dut partir pour
l’Asie Mineure, où le prince de Karamanie, Ibrahim, jamais résigné à sa défaite,
avait profité de la mort de Mourad pour reprendre les armes et organiser une
révolte avec les descendants des émirs de Kermian. L’expédition fut
courte : à l’approche du sultan, Ibrahim se soumit et restitua les places
qu’il avait prises : au mois de mai 1451 Mahomet avait regagné Andrinople
et travaillait à son grand dessein . En passant à Brousse,
il avait eu à réprimer l’indiscipline des janissaires et il en profita pour
réformer leur organisation et en élargir les cadres, de manière à en faire une
infanterie de premier ordre .
Il s’agissait
d’abord pour le sultan d’isoler Constantinople et de lui enlever toute chance
de secours, d’où une première offensive purement diplomatique et des traités
avec les seuls auxiliaires possibles de Byzance : le 10 septembre 1451,
traité avec Venise, mal disposée, on l’a vu, pour le basileus et qui ne
songeait qu’à une guerre contre Gênes avec l’aide d’Alphonse de Naples ; le 20 novembre
suivant, traité plus important encore avec Jean Hunyade : le sultan
promettait de n’élever aucune fortification nouvelle sur le Danube et de
n’empêcher en rien les relations du prince de Valachie Vladislas avec la
Hongrie . De là aussi, avant le
commencement du siège, deux diversions militaires, l’une en Morée pour empêcher
les despotes de secourir Constantinople (octobre 1452) , l’autre en Albanie
occupée par les troupes d’Alphonse de Naples, dont les projets de croisade étaient
menaçants (été de 1452-avril 1453). A vrai dire, cette expédition fut
malheureuse et Scanderbeg remporta de nouvelles victoires sur les Turcs ;
mais malgré la défaite de ses armées, Mahomet II avait atteint son but, qui
était d’occuper Scanderbeg et d’empêcher toute diversion de sa part en faveur
de Constantinople .
Il ne restait plus au sultan qu’à établir
le blocus de la ville et s’assurer la maîtrise du Bosphore. A l’endroit le plus
resserré du détroit , Mahomet il fit construire
sur la rive européenne le château de Rouméli-Hissar, pourvu d’une artillerie
puissante qui permettait de barrer entièrement la navigation : l’ouvrage
fut achevé en quelques mois (mars-août 1452) au milieu de l’enthousiasme des
Turcs . Le 28 août le sultan
parut devant la ville avec une forte armée et examina sans être inquiété les
fortifications terrestres . Quelques jours après,
des janissaires massacrèrent des paysans de la banlieue qui voulaient les
empêcher de détruire leurs moissons . C’était la
rupture : Constantin fit fermer les portes de la ville et envoya une note
pleine de dignité au sultan, qui répondit par une déclaration de guerre . Le 10 novembre des
navires vénitiens chargés de blé, revenant de la mer Noire, furent coulés en
face de Rouméli-Hissar . Le blocus de la ville
était complet et lorsque, à la suite de cet incident, Venise rompit avec Mahomet
et voulut envoyer des secours à Constantinople, il était déjà trop tard.
Le siège de Constantinople . — Abandonnée par tous
les États d’Occident et par tous ses alliés, Constantinople se trouva en face
de la plus forte organisation militaire de l’Europe du xve siècle. Les Turcs avaient sur les défenseurs
de la ville la supériorité des effectifs, de la cohésion, de la discipline, de
l’armement, de la tactique : leur méthode de guerre est déjà celle des
temps modernes. Pourtant, en dépit de l’accumulation des circonstances
défavorables à leurs défenseurs, discordes intestines, agitation religieuse,
manque de ressources, de troupes et d’armes, les antiques murailles de
l’enceinte de Théodose II résistèrent à l’ouragan qui s’abattit sur elles
pendant plus de deux mois. Byzance se savait perdue, mais du moins elle sut
bien mourir.
Jusqu’au dernier moment Constantin XI
essaya d’obtenir des secours occidentaux, et le siège avait déjà commencé que
ses ambassadeurs parcouraient encore l’Europe, mais ne recueillaient que de bonnes
paroles, du roi de France , de l’empereur Frédéric
III, qui écrivit à Mahomet II pour protester contre le barrage du
Bosphore , du roi de Naples, qui
essaya du moins de ravitailler Constantinople . Jean Hunyade avait
demandé les deux ports de Selymbria et Mesembria pour prix de son
alliance , mais il se borna à
envoyer une ambassade au camp de Mahomet II pour le menacer d’une croisade, s’il
continuait à assiéger Constantinople ! Après la
destruction des navires vénitiens dans le Bosphore (13 décembre) Constantin
avait aussitôt envoyé des messagers à Venise, dont le Sénat décida de faire
partir des navires et des troupes pour Constantinople, mais qui en délibérait
encore le 15 mai 1453, quelques jours avant la prise de la ville ! Le pape Nicolas
V lui-même avait résolu d’envoyer une flotte à Constantinople, mais il s’arrêta
à l’intention . Il est suffisamment
démontré que les puissances d’Occident laissèrent les Turcs s’établir sur le Bosphore.
Constantinople fut donc réduite à ses
propres moyens et aux quelques auxiliaires particuliers qu’elle put déterminer
à la défendre, tels que les 200 soldats amenés par Léonard de Chio et le cardinal
Isidore (novembre 1452). Après la proclamation de l’Union, le légat et le baile
de Venise exhortèrent les capitaines de l’escadre vénitienne qui avait escorté
les envoyés du pape à rester à Constantinople (33 décembre) ; mais on eut
beaucoup de mal à vaincre les résistances de leur amiral, Gabriel Trevisano, et
bien qu’on eût mis l’embargo sur tous les navires présents dans le port (26
janvier 1453) , plusieurs galères
vénitiennes parvinrent à s’échapper (février-mars) . Le 28 janvier arriva
un auxiliaire de marque, le Génois Jean Giustiniani, ancien podestat de Caffa,
avec deux navires et 700 hommes : l’empereur lui fit le plus chaleureux
accueil et le chargea de diriger la défense de la ville . Les habitants de Péra,
officiellement en paix avec le sultan, ne voulurent pas rompre leur traité,
sous le fallacieux prétexte qu’ils pourraient secrètement faire passer des
secours à Constantinople : tel n’était pas l’avis de leur compatriote
Léonard de Chio .
Ainsi, au lieu de l’armée et de la flotte
de guerre qu’il eût fallu pour défendre une enceinte aussi étendue que celle de
Constantinople, le basileus ne disposait que d’effectifs misérables et
disparates dont la bravoure ne rachetait pas l’infériorité numérique.
Phrantzès, chargé par Constantin de dresser l’état des troupes, évalue les
combattants à 4 973 hommes, y compris les moines et les volontaires,
auxquels s’ajoutaient 2 000 à 3 000 étrangers . L’armement de ces troupes
était insuffisant : la plupart des Grecs combattaient à l’arme blanche et
l’artillerie était médiocre ; elle consistait en petits canons de fer dont
le tir ébranlait les remparts . La défense navale
disposait de 7 à 8 navires de guerre, rangés contre la chaîne qui barrait
l’entrée de la Corne d’Or et que l’empereur fit tendre le 2 avril . Les munitions étaient
de mauvaise qualité et distribuées avec parcimonie . Les ressources financières
enfin manquaient cruellement : les demandes d’argent se heurtaient au
mauvais vouloir des habitants et l’empereur dut faire monnayer des trésors
d’églises pour payer les troupes .
Entre cette poignée de braves et la masse
des assiégeants la disproportion était effrayante. Le sultan avait mobilisé
tous les contingents dus par ses vassaux, musulmans ou chrétiens, dont un corps
de cavaliers serbes envoyés par Brankovič . L’estimation de ces forces
varie suivant les chroniqueurs et paraît exagérée. Sur les 160 000 à 200 000 hommes
qui remplissaient le camp turc, il pouvait y avoir environ 60 000
combattants, dont beaucoup de bachibouzoucks ou irréguliers : le reste
était composé d’imans, de derviches qui soutenaient le moral de l’armée, et de
mercantis attirés par l’espoir du butin . Les corps d’élite
étaient formés des contingents d’Anatolie et surtout des 10 000
janissaires, infanterie incomparable, récemment réorganisée par Mahomet II,
remarquable par son enthousiasme religieux, son esprit de corps, sa discipline,
son ordre impeccable, sa mobilité et ses qualités manœuvrières. Les étrangers
étaient impressionnés par ces belles troupes, qui gardaient le silence dans les
rangs, et disaient que 10 000 Turcs faisaient moins de bruit que 100 chrétiens .
Dans cette armée l’artillerie tenait une
place importante et les Turcs lui durent leur victoire. Jamais encore elle
n’avait été employée en si grande masse. Ce qui était nouveau, c’était la
puissance des pièces de siège destinées à démolir les murailles. A cause de
leur poids, on était obligé de fabriquer à la place même qu’elles devaient
occuper les énormes bombardes calées au moyen de grosses pierres. L’effet
matériel et moral de leurs gigantesques boulets de pierre, que l’on pouvait
lancer pardessus les murs, était irrésistible. Phrantzès compte 14 batteries
comprenant chacune 4 gros canons . Trois de ces pièces
étaient remarquables par leurs dimensions insolites, mais la plus célèbre était
le canon géant fabriqué à Andrinople par l’ingénieur hongrois Orban, transfuge
de Constantinople passé au service des Turcs. Le diamètre de cette pièce
colossale mesurait 99 centimètres et elle lançait des boulets d’une
circonférence de 1,86 m. Il fallut deux mois pour la transporter à
Constantinople avec un attelage de 60 bœufs .
Enfin Mahomet II disposait de la flotte la
plus importante que la marine ottomane eût possédée jusque-là. Concentrée à
Gallipoli et commandée par le renégat bulgare Baltoglou, elle vint mouiller
sans difficulté à l’entrée du Bosphore, au pied de la colline de Péra, sur laquelle
fut établi un poste d’observation. A côté de ses 15 galères armées, suffisantes
pour écraser la flottille chrétienne, elle avait des navires disparates et de
valeur inégale .
Telles furent les conditions dans
lesquelles se déroula le trentième et dernier siège de Constantinople, qui
succomba après trois assauts, précédés de bombardements intenses.
Dès le mois de février 1453 les quelques
places encore occupées par les Grecs, qui défendaient les approches de la
ville, furent prises par les Turcs qui ravagèrent cruellement la banlieue et
emmenèrent de nombreux habitants en captivité . L’investissement de la
ville eut lieu entre le 2 et le 6 avril, et les forces ottomanes prirent
position en face des murs terrestres depuis le quartier des Blachernes jusqu’à
la Propontide . Constantin XI de son
côté répartit les troupes dont il disposait en 14 secteurs autour des
remparts : Jean Giustiniani avec 400 chevaliers occupait la porte
Saint-Romain, la plus exposée aux attaques des Turcs . Une tentative de
sortie pour gêner les préparatifs des Turcs eut un insuccès complet et ne fut
pas renouvelée .
Les lignes turques s’étant rapprochées,
successivement, à 2 kilomètres, puis à 1200 mètres de la ville , un premier
bombardement commença le 11 avril et dura 8 jours. Le canon géant, d’abord
placé à la porte Caligaria en face des Blachernes, fut transporté devant la
porte Saint-Romain dont un de ses boulets détruisit une tour, mais après
quelques jours il fit explosion et tua son constructeur . En même temps, les
Turcs cherchaient à combler le fossé avec des fascines, les défenseurs
s’efforçaient de réparer les brèches des avant-murs ; et pour hâter
l’écroulement des tours le sultan faisait creuser des mines, auxquelles répondaient
les contre-mines des assiégés qui repoussaient leurs ennemis en les inondant de
feu grégeois . Le 18 avril Mahomet
II, jugeant les brèches suffisantes, ordonna un assaut nocturne, mais les
fantassins turcs qui tentaient de traverser le fossé durent reculer devant le
feu grégeois que leur lançaient les défenseurs du haut des remparts, tandis que
la brèche de la porte Saint-Romain était défendue victorieusement par
Giustiniani et ses chevaliers .
Malgré la continuation du bombardement, dont les défenseurs réparaient aussitôt les dommages, la lutte se transporta sur mer. Avant le 20 avril les Turcs s’étaient emparés des postes avancés de Constantinople sur le Bosphore et dans les îles des Princes . Ces opérations terminées, ils se proposèrent de forcer l’entrée de la Corne d’Or et la flotte ottomane, renforcée par l’arrivée de nombreuses unités , attaqua la chaîne le 19 avril, mais après un vif combat d’artillerie elle fut victorieu mégaduc Lukas Notaras . Le lendemain on vit
arriver de la Propontide trois galères génoises et un transport grec chargés de
soldats et de vivres ; Mahomet II ordonna à Baltoglou de s’en emparer ou
de les couler, et lui-même assista au combat acharné qui se livra entre la
Pointe du Sérail et la Corne d’Or : grâce à la supériorité de leur tir,
les navires génois traversèrent la flotte ottomane sans dommage et pénétrèrent
dans le port à la grande colère du sultan qui roua de coups de sa masse d’armes
son amiral .
Cette nouvelle victoire surexcita le courage des défenseurs, mais Mahomet, tenace dans ses desseins et jamais résigné sement
défendue par le à l’insuccès, imagina de transporter par terre ses navires dans la
Corne d’Or en les faisant traîner jusqu’au faîte de la colline de Péra, pour
les lancer ensuite dans le port et prendre à revers la flotte chrétienne qui
gardait la chaîne . Cette opération
difficile fut exécutée avec une promptitude extraordinaire dans la nuit du 22
au 23 avril : 70 vaisseaux, qui ne mesuraient pas plus de 17 à 20 mètres
de long, furent halés par des attelages de buffles et un nombre considérable de
travailleurs, de la rive actuelle de Top-Hané jusqu’à Péra, sur une longueur
d’un kilomètre 333 environ, à 41 mètres d’altitude, puis lancés dans la Corne
d’Or .
La réussite de cette manœuvre inattendue
produisit certainement un effet moral sur la population, qui fut
consternée , et obligea une partie
des combattants à s’immobiliser le long des murs maritimes de la Corne d’Or.
Par contre elle n’eut pas le résultat décisif qu’escomptait le sultan :
une fois dans le port, les navires turcs y furent littéralement prisonniers
sans pouvoir forcer la chaîne et exposés aux attaques des navires chrétiens,
auxquels ils ne pouvaient résister à cause de leur faible tonnage . Dans la nuit du 28
avril le commandant d’une galère vénitienne de Trébizonde, Jacopo Cocco, fit
une tentative pour incendier la flotte turque, et il aurait pu réussir sans la
trahison des Génois de Galata qui, mis au courant du projet, le révélèrent à
Mahomet II : les navires incendiaires furent coulés par les canons mis en
batterie sur le rivage . En représailles le
sultan imagina un canon à tir plongeant qui, des hauteurs de Péra, commença à
bombarder les navires qui gardaient la chaîne et en coula plusieurs .
Pendant cette guerre navale le bombardement
des murailles terrestres se poursuivait et la résistance des assiégés
s’affaiblissait ; des querelles accompagnées de rixes partageaient les
Génois et les Vénitiens . Le 23 avril Constantin
XI, sentant la défense à bout de force, avait offert la paix au sultan
moyennant le paiement d’un tribut, mais Mahomet avait répondu : « Je
prendrai la ville, ou elle me prendra mort ou vif . »
Résolu à brusquer le dénouement, qui lui
paraissait proche, Mahomet Il ne laissa plus aucun répit aux assiégés. Sans
engager à fond toutes ses forces, il essaya de pénétrer dans la ville par les
brèches ouvertes par ses canons dans les murs terrestres, mais les deux assauts
qui se succédèrent le 7 et le 12 mai, entre la porte de Caligaria et celle
d’Andrinople, furent repoussés par les assiégés, l’empereur en tête, avec un
magnifique héroïsme .
A partir du 14 mai le bombardement reprit
avec plus d’intensité et, grâce au pont qu’il avait établi au fond de la Corne
d’Or ,
le sultan put faire transporter les canons de la colline de Péra devant les
murs terrestres , et tout l’effort de
l’attaque fut concentré sur la porte Saint-Romain regardée comme le point le
plus faible de la défense . Simultanément le 16
mai une attaque de la flotte turque fut dirigée contre la chaîne et repoussée
par Trevisano, tandis qu’une tentative, déjouée par le mégaduc Notaras, était
faite pour miner la porte Caligaria . Le 18 le sultan
faisait tenter l’escalade des murs au moyen d’une gigantesque tour roulante,
une hélépole des anciens temps, qui dominait les fortifications et à laquelle
les Turcs essayèrent de faire franchir le fossé, mais après un combat acharné
qui dura 24 heures ce monstrueux ouvrage fut incendié Le 21 une nouvelle tentative
fut faite pour forcer la chaîne, mais elle demeura inébranlable jusqu’au
bout .
En même temps du côté des murs terrestres commençait une nouvelle guerre de mines,
qui visait surtout le palais des Blachernes : 14 tentatives furent
repoussées, dont 4 entre le 21 et le 25 mai .
A cette date, après 40 jours de
bombardement, trois grandes brèches avaient été ouvertes dans les murs
terrestres, trois chemins pour pénétrer dans la ville, disait le sultan : entre
Tekfour-Seraï et la porte d’Andrinople, à la porte Caligaria ; dans le val
du Lykos, à la porte Saint-Romain ; à la troisième porte militaire, au
nord-est de la porte de Selymbria les assiégés passaient leur temps à réparer
ces brèches par des moyens de fortune, en entassant des matériaux et en élevant
des palissades garnies de sacs de terre ou de coton . Le moment était venu
de donner l’assaut général, mais le découragement gagnait l’armée turque, qui
ne s’attendait pas à un siège si long et si pénible, et le bruit courait qu’une
formidable croisade s’organisait en Occident . C’est ce qui explique
qu’avant de donner l’assaut, Mahomet ait essayé de se faire livrer la ville par
une capitulation en offrant à Constantin XI, s’il en sortait, la souveraineté
de la Morée sous la suzeraineté ottomane, et menaçant en cas de refus de
massacrer les habitants ou de les réduire en esclavage. A cet ultimatum
l’empereur répondit que lui et les habitants étaient prêts à sacrifier leur vie
plutôt que de rendre la ville .
Cette réponse est d’autant plus belle que
la situation des assiégés était loin d’être rassurante. A mesure que les Turcs
recevaient de nouvelles forces d’Asie, celles des Grecs s’affaiblissaient
chaque jour. Le basileus et les chefs courageux qui l’assistaient avaient peine
à maintenir la discipline parmi les troupes et il fallait organiser des rondes
de nuit pour empêcher les désertions. L’état moral de la population empirait ;
l’empereur et les chefs étaient injuriés ouvertement et les émeutes n’étaient
pas rares. La disette qui se fit sentir dès le 2 mai augmentait le
mécontentement. La discorde régnait entre les chefs, particulièrement entre
Grecs et Latins : Constantin XI eut du mal à apaiser une altercation entre
Giustiniani et Notaras et dut les forcer à se réconcilier . Le 3 mai on avait
réussi à envoyer un navire dans l’Archipel au-devant de la flotte de secours
que Venise avait promise : ce navire revint sans nouvelles le 23 mai, le
jour même où Mahomet II envoyait son ultimatum. Comme des naufragés qui voient
s’évanouir leur dernier espoir, les chefs de la défense comprirent que tout
était perdu et qu’il ne restait plus qu’à mourir .
L’assaut final. — Ce fut le 26 mai
qu’après avoir tenu un conseil de guerre, dont les délibérations furent longues
et où chacun des chefs de corps dut émettre son opinion, que Mahomet II décida
l’assaut général . Le 27 il inspecta ses
troupes, assigna à chacun son poste, promit à ses soldats que tous les trésors
de Constantinople leur appartiendraient et qu’il ne s’en réservait que les
murailles. Il prit ensuite ses dispositions d’attaque et ordonna que l’assaut
des murs aurait lieu par vagues successives, de manière à être ininterrompu et
mené par des troupes toujours fraîches . La nuit venue, de
grands feux de bivouac furent allumés, tandis que tous les navires qui
bloquaient Constantinople étaient illuminés et que les Turcs, sonnant de la trompette
et s’accompagnant des instruments les plus bruyants, poussaient d’immenses
clameurs, au grand effroi des assiégés .
A Constantinople, Giustiniani faisait
réparer tant bien que mal les énormes brèches. La journée du 28 mai fut
particulièrement émouvante. Constantin XI ordonna de grandes processions avec
litanies solennelles les icônes les plus vénérées furent portées sur les
remparts et jusqu’au milieu des brèches, et Phrantzès prête au basileus un discours
qui nous semble aujourd’hui verbeux et sent l’école de rhétorique, mais que le
goût qui régnait alors ne rend pas invraisemblable . Puis Constantin XI
gagna Sainte-Sophie, désertée depuis la proclamation de l’Union, et, après le
basileus, tous les grands dignitaires, tous les chefs, quelle que fût leur
nationalité, reçurent l’eucharistie après s’être embrassés et s’être pardonné
leurs péchés ; tous ensuite retournèrent aux remparts , et derrière eux on verrouillait
les portes des tours qui ouvraient sur la ville afin d’empêcher toute
possibilité de fuite .
L’assaut commença dans la nuit du 28 au 29
mai à une heure trente du matin environ et porta à la fois sur
les trois côtés du triangle que forme la ville, mais ne fut vraiment intense
qu’en face des murs terrestres entre Tekfour-Séraï et la porte Saint-Romain. La
première vague, composée d’irréguliers, de bachibouzoucks, la plupart
chrétiens, s’avança lentement, portant des échelles, et essaya de franchir le
fossé : accablée de projectiles, elle recula après deux heures de combat . La deuxième vague lui
succéda ; elle consistait
en contingents d’Anatolie, disciplinés et bien armés ; ils attaquèrent la
brèche et commencèrent l’escalade, mais furent repoussés à leur tour. Ce fut en
vain qu’on les ramena au combat après que le gros canon eut tiré contre la
brèche . Alors Mahomet II
exaspéré fit donner sa réserve. Le jour se levait . Les défenseurs étaient
épuisés quand les janissaires, en poussant des cris terribles, s’élancèrent
contre la brèche, tandis que les cloches et les simandres retentissaient dans
toute la ville et que l’attaque se concentrait autour de la porte
Saint-Romain .
Ce fut à ce moment que Giustiniani reçut
une blessure au sternum et se retira du combat, qui continua, toujours plus
furieux, après son départ . Les assiégés tenaient
toujours, lorsque tout à coup ils virent l’étendard du sultan flotter dans la
ville. Les Turcs avaient pu y pénétrer par la Cercoporta, une poterne située
non loin de la porte d’Andrinople, à l’endroit où le mur théodosien se soude à
l’enceinte d’Héraclius . Les défenseurs de la
porte Saint-Romain, l’empereur en tête, continuèrent à se battre, mais,
attaqués par-derrière, ils furent littéralement submergés par le flot des
Turcs, et la brèche fut forcée au moment précis où le soleil se levait . Ce fut alors que Constantin
XI, suivi de deux ou trois fidèles, s’élança dans la mêlée, en frappant d’estoc
et de taille, et y trouva la mort glorieuse qui convenait au dernier empereur
de Byzance .
Le sacrifice était consommé : les
Turcs entraient de tous côtés à Constantinople, en massacrant sans distinction
de sexe ni d’âge tous les habitants qu’ils rencontraient ; puis, cette
première fureur calmée, ils organisèrent le pillage méthodique des maisons, des
palais, des monastères . Le peuple affolé se
précipita à Sainte-Sophie où, d’après les récits et les prédictions qui avaient
couru pendant le siège, devait se produire un miracle, mais les Turcs, brisant
les portes à coups de hache, y pénétrèrent à leur tour, mirent l’église à sac
et réduisirent en esclavage tous ceux qui leur tombaient sous la main . Lorsque toute
résistance eut cessé, Mahomet Il fit son entrée dans la ville et se dirigea
droit vers la Grande Église : là, montant à l’ambon, accompagné d’un imam,
il récita la prière, puis, pénétrant dans le sanctuaire, il monta sur l’autel
et le foula aux pieds . Ces deux gestes
symboliques clôturaient une histoire plus que millénaire et devenaient le point
de départ d’une ère nouvelle.
La fin de l’indépendance hellénique. — Avec la
reddition de Galata s’acheva la conquête de Constantinople. Mahomet II
renouvela les privilèges accordés aux Génois par les empereurs, mais il fit détruire
les fortifications et combler les fossés de leur ville .
L’État byzantin n’existait plus, mais deux
centres helléniques jouissaient encore, l’un, le despotat de Morée, de
l’autonomie, l’autre, l’État de Trébizonde, de l’indépendance complète ;
ils survécurent encore quelques années à la chute de Byzance, mais il était
évident que le sultan ne pouvait tolérer dans son empire ces enclaves susceptibles
de devenir le refuge de la nation hellénique, et par leurs maladresses et leurs
discordes leurs chefs ne firent que hâter le dénouement inévitable.
Les deux despotes de Morée, Thomas et
Démétrius, tout entiers à leurs querelles, ne firent pas le moindre effort pour
secourir Constantinople et, après la catastrophe, leur premier souci fut de
préparer leur fuite pour l’Italie ; puis, Mahomet Il leur ayant offert de
traiter avec eux, ils acceptèrent de devenir ses vassaux . Le sultan était au
courant de l’anarchie qui régnait en Morée et qui allait lui fournir des
raisons d’y intervenir. En octobre 1454 il y envoya l’armée de Tourakhan, sous
prétexte de défendre les despotes contre une insurrection des immigrés albanais,
appuyée sous main par Venise . Après la victoire de
Tourakhan, il accueillit la pétition des archontes révoltés contre les
despotes, demandant à relever directement du sultan . En 1456 le tribut
annuel que devaient lui payer les despotes était en retard de trois ans par
suite des difficultés que rencontrait la levée des impôts. Mahomet Il en
profita pour envahir la Morée et attaquer ses forteresses dont plusieurs
résistèrent héroïquement (mai 1458). La prise de Corinthe, après 4 mois de
siège, obligea les despotes à se mettre à la discrétion du sultan, qui les
força à lui abandonner le tiers de leurs possessions, dont Corinthe et Patras
qui furent occupées par des garnisons ottomanes, et à envoyer dans son harem Hélène,
fille de Démétrius (septembre-octobre 1458) .
Cette solution ne devait être que
provisoire. Enthousiasmé par les nouvelles victoires de Scanderbeg et les préparatifs de
la croisade organisée par Pie II , Thomas se révolta
contre le sultan (début de 1459), mais au lieu de chercher à entraîner
Démétrius dans sa révolte, il commit la faute d’attaquer ses possessions. Cette
guerre fratricide ne pouvait que favoriser les plans du sultan , que Démétrius appela à
son secours. Résolu à en finir et craignant de voir ce pays tomber aux mains
d’un prince franc, Mahomet Il reparut en Morée à la tête d’une forte armée et
mit les plaideurs d’accord en leur prenant tout ce qu’ils possédaient. Le 30
mai 1460 Démétrius dut livrer au sultan la forteresse et la ville de Mistra, métropole
de la Morée byzantine, ainsi que toutes les places qu’il tenait encore, et fut
envoyé lui-même à Constantinople. Quant à Thomas, il résista encore quelque
temps en Messénie, puis alla s’embarquer pour Corfou où il arriva le 28 juillet
et alla finir ses jours en Italie. Se considérant comme souverain de la Morée,
Mahomet II traita en rebelles les gouverneurs des places qui résistaient encore
et leur fit subir les supplices les plus cruels .
En 1461 la Morée entière était soumise et
transformée en un pachalik turc. Une seule ville, la république autonome de
Monemvasia, parvint à conserver son indépendance, grâce à la puissance de ses fortifications
et de sa marine, ainsi qu’à la bravoure de son gouverneur, Manuel Paléologue.
Sommés de se rendre en 1460, les habitants opposèrent un refus formel et
Mahomet Il s’abstint de les attaquer. Après la fuite de Thomas, Monemvasia se
plaça sous la protection du pape Pie II, puis, après l’échec de la croisade,
elle se donna à Venise qui la conserva jusqu’en 1540 .
Un an après la Morée byzantine, l’État de
Trébizonde disparaissait à son tour. Enclavé entre le monde hellénique, les
pays du Caucase et les États musulmans d’Anatolie, il avait joui pendant les
deux siècles de son histoire d’une remarquable prospérité économique, grâce à
la situation de Trébizonde, marché d’échanges entre les routes de caravanes
d’Asie centrale et les voies maritimes qui avaient fait de cette cité la
métropole d’une thalassocratie, siège d’une culture originale faite
d’hellénisme et d’apports asiatiques. Cet État eût pu devenir le centre d’un
puissant empire, mais, comme Byzance, il avait été troublé par les querelles de
succession, par les luttes entre le pouvoir central et les archontes, divisés
eux-mêmes en une caste indigène et une noblesse immigrée de
Constantinople ; pas plus que Byzance il n’avait échappé à la mainmise des
colonies italiennes sur son commerce. Les Génois y occupaient depuis le xiiie siècle une situation
prépondérante, mais à plusieurs reprises Trébizonde avait été, à son grand
dommage, le théâtre de leurs luttes avec les Vénitiens.
Après avoir échappé à la domination
mongole, l’État de Trébizonde fut menacé par la puissance ottomane. Les
premiers contacts remontent au règne de Jean IV (Kalojoannès) (1429-1458) qui
défendit victorieusement sa capitale contre une armée ottomane envoyée par
Mourad II (1430) . Après la prise de
Constantinople, Trébizonde accueillit de nombreux réfugiés grecs, au grand
mécontentement de Mahomet qui dirigea contre elle une expédition. En 1454
Khitir-beg, gouverneur d’Amasée, pénétra facilement dans la ville, ravagée par
la peste, et fit des milliers de captifs. Kalojoannès dut signer un traité par
lequel il se reconnaissait le vassal du sultan et lui payait un tribut de
3 000 livres d’or .
Déconsidéré parmi ses sujets à la suite de
ce traité honteux, Kalojoannès, désireux de prendre sa revanche, s’allia au
sultan turcoman du Mouton-Blanc, Ouzoun-Hassan, qui résidait à Tauris et dont
les possessions s’étendaient jusqu’à Diarbékir, et lui donna sa fille Théodora
en mariage . D’autres dynastes
turcs, dont le sultan de Karamanie, adhérèrent à cette ligue, mais chacun se
reposa sur les autres du soin de prendre l’initiative de l’attaque . Kalojoannès mourut
sans avoir rien fait (1458), laissant un fils âgé de 4 ans, Alexis V, mais avec
l’assentiment de tous, le frère du défunt, David, s’empara du trône . Il renouvela le traité
d’alliance avec Ouzoun-Hassan et envoya des messages en Occident, au pape Pie
II, à Philippe le Bon pour solliciter la formation d’une croisade , mais il n’y eut aucune
entente suffisante entre David et ses alliés.
Cette imprévoyance devait lui être fatale.
Poussé par Théodora Comnène, Ouzoun-Hassan prit le premier l’offensive en
envoyant un ultimatum à Mahomet II, le sommant de renoncer au tribut payé par
Trébizonde et, se considérant comme successeur de Tamerlan, lui réclamant celui
que Bajazet s’était engagé à payer aux Tartares . Mahomet II, qui venait
de soumettre la Morée, rassembla aussitôt une armée et une flotte (1461)
s’empara de Sinope, dont l’émir Ismaël était l’allié de David (printemps) , et, franchissant le
Taurus, arriva en 17 jours devant Diarbékir, capitale d’Ouzoun-Hassan.
Celui-ci, pris au dépourvu et, malgré ses rodomontades, incapable de soutenir
l’assaut des Turcs, n’eut d’autre ressource que d’implorer la paix et de
s’engager à ne porter aucun secours à Trébizonde .
Abandonné ainsi de tous ses alliés, David
se trouva réduit à ses propres forces devant l’attaque de Trébizonde par terre
et par mer qui suivit la défection d’Ouzoun-Hassan. Cependant la ville n’était
pas sans défense : ses murailles, restaurées par Kalojoannès, étaient garnies
d’une forte artillerie ; les habitants essayèrent d’empêcher le débarquement
des équipages de la flotte turque, mais furent repoussés et, abandonnant les
faubourgs, s’enfermèrent dans leur enceinte et soutinrent un siège qui dura 28
jours ; mais l’arrivée
de l’avant-garde de l’armée de Mahomet II, commandée par Mahmoud, suivie
bientôt de celle du sultan, rendit leur situation désespérée. Mahomet envoya à
David un ultimatum et son secrétaire Thomas Katabolkios, Grec rallié aux Turcs,
dont les discours persuasifs décidèrent « le dernier basileus » à
capituler. Le 15 août 1461 David remit au sultan les clefs de la ville et,
pendant que les janissaires occupaient l’Acropole, se laissa embarquer pour
Constantinople avec sa famille .
Cependant il n’était pas encore au bout de son destin. L’épouse d’Ouzoun-Hassan, Théodora Comnène, ne rêvait que revanche. En 1467 Mahomet II eut communication par un traître d’une lettre de cette princesse qui demandait à David, interné près de Serrès, d’envoyer à Diarbékir un de ses fils ou le jeune Alexis V, qui serait rétabli par la force sur le trône de Trébizonde. Dans sa fureur, le sultan fit amener à Constantinople David et ses fils, au nombre de sept, et leur donna à choisir entre l’islam ou la mort ; puis, comme ils refusaient d’abjurer le christianisme, il leur fit trancher la tête l’un après l’autre . Par l’héroïsme avec lequel il accepta son martyre, le dernier basileus de Trébizonde se montra digne du dernier basileus de Constantinople.
FINIS
Louis Brehier. Le monde byzantin :Vie et mort de Byzance |