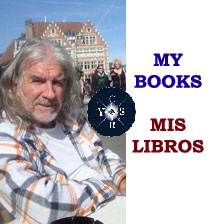 |
BIZANTIUM |
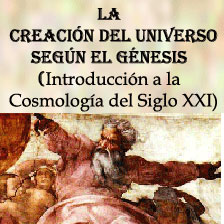 |
Louis Brehier. Le monde byzantin :Vie et mort de ByzanceLIVRE DEUXIÈME. L’EMPIRE ROMAIN HELLÉNIQUEChapitre premierLa période d’organisation (717-944)
Réduit par les démembrements territoriaux
qui accompagnèrent la chute de la dynastie des Héraclides au domaine
géographique de Constantinople, l’Empire d’Orient n’en conserva pas moins ses
traditions et demeura en droit l’Empire romain universel, destiné à régir tous
les peuples, mais cette conception magnifique, qui est encore celle de
Constantin Porphyrogénète, est démentie par les faits. A l’avènement de Léon
l’Isaurien, le seul lien qui rattache encore Constantinople à l’Occident,
l’Italie, est à la veille de se dénouer et surtout l’Orient lui a échappé pour
toujours. A la place de l’État féodal des Perses, se dresse devant Byzance un
empire jeune et vigoureux qui, avec plus de succès qu’elle, tire ses moyens
d’action de la propagande religieuse. L’Empire arabe concentre en lui toutes
les forces de l’antique Orient, hostile à l’hellénisme, au christianisme, à la
culture européenne. La civilisation musulmane ne fut que l’épanouissement de
cette renaissance de l’orientalisme, dont on saisit les premières traces au iiie siècle et qui finit par
détruire l’œuvre d’Alexandre, continuée par ses successeurs et par les Césars
romains.
Mais, si le domaine territorial de l’Empire
d’Orient est désormais restreint, il est devenu plus compact et il a acquis ce
qui manquait à l’Empire romain, l’unité de territoire, de langue, de religion.
Constantinople en est le centre organique, le véritable foyer. Au point de vue
militaire, sa position rend la défense plus facile en permettant les manœuvres
dans les lignes intérieures. Dans le domaine économique, elle demeure longtemps
la ville la plus importante de la chrétienté. Enfin elle fait figure de
capitale intellectuelle, artistique, religieuse et sa civilisation, éveillant à
la vie spirituelle des peuples nouveaux, rayonne sur l’Europe entière. L’Empire
tend à se transformer en une nation, la Romania,
et c’est pendant cette période que le terme d’empire byzantin est le plus
justifié, mais, dans les cinq siècles sur lesquels elle s’étend, on aperçoit
trois stades : du début du viiie au milieu du xe siècle, résistance aux agents de dissolution et crise iconoclaste, période
d’organisation ; expansion de la puissance byzantine sous la dynastie
macédonienne jusqu’au milieu du xie siècle ; déclin de cette puissance, dû à l’essor de peuples nouveaux, mais
longtemps retardée par les Comnènes, dont les successeurs (dynastie des Anges)
sont impuissants à empêcher un nouvel effondrement de l’Empire.
1. L’Œuvre des Isauriens. Léon III (717-741)
L’œuvre des empereurs isauriens et, après
eux, des dynasties arménienne et amorienne, a consisté à arrêter le
démembrement de l’Empire et à le défendre contre les invasions, mais cette
œuvre a été rendue difficile et incomplète par l’agitation intérieure due au mouvement
iconoclaste qui entraîna le détachement de l’Italie et de l’Occident.
Les initiateurs de la politique nouvelle
furent les deux premiers isauriens, Léon III et Constantin V, dont les règnes
ont une importance capitale, mais qu’il y a intérêt à étudier séparément à
cause de la différence de leurs tempéraments, qui se reflète dans leur
politique.
Léon III, d’origine isaurienne d’après
Théophane, syrienne d’après les autres sources , mais certainement d’une
famille orientale émigrée en Thrace, avait commencé sa carrière militaire sous
Justinien II et, après s’être bien
acquitté d’une mission importante dans le Caucase, avait reçu d’Anastase II la
charge de stratège des Anatoliques . Ce fut à son alliance
avec le stratège des Arméniaques, Artavasde, auquel il donna sa fille en mariage,
qu’il dut la couronne. Son pouvoir a donc une origine purement militaire et sa
politique, comme celle de ses successeurs, s’en ressent : l’armée sera
leur principal point d’appui.
A son avènement, Léon III a deux
préoccupations essentielles : sauver Constantinople de l’étreinte des
Arabes, rétablir l’ordre dans l’État.
Cinq mois après le couronnement de Léon,
l’armée de Moslemah, partant de Galatie, rejoignait la flotte arabe de
1 800 navires concentrés à Abydos et faisait passer ses troupes sur la
rive d’Europe. Le siège dura un an (15 août 717 - 15 août 718). Malgré leur
nombre et l’arrivée de flottes de renfort, les Arabes ne purent ni forcer la
chaîne qui barrait le port, ni entamer la Grande Muraille. A plusieurs reprises
leurs flottes subirent les effets du feu grégeois ; de plus Léon III
parvint à leur couper leurs moyens de ravitaillement. La famine et la peste se mirent
dans leur camp. Leur retraite fut désastreuse ; une partie de leur flotte
fut détruite par la tempête et l’armée de Moslemah, repassée en Asie, fut
attaquée près de Tyane et décimée . A la suite de cet échec
une trêve fut vraisemblablement conclue entre Léon III et le calife Omar . En fait, il n’y eut pas
d’attaque arabe contre l’Asie Mineure entre 718 et 726. La défense victorieuse
de Constantinople marquait, comme la bataille de Poitiers qui eut lieu quatorze
ans plus tard, la limite infranchissable atteinte par l’invasion arabe.
Les attaques contre l’Asie Mineure qui
reprirent en 726 ne furent plus que des incursions et des razzias, pénibles
pour les populations , mais simples raids sans
établissements permanents. Contre les Arabes Léon III fit alliance avec les Khazars
et en 733 son fils Constantin, associé à la couronne, épousa la fille de leur
Khagan .
Ce fut probablement grâce à sa diplomatie que les Khazars envahirent
l’Azerbaïdjan en 731 et forcèrent le calife à leur abandonner la principale
route du Caucase, la passe de Derbend . Enfin en 740 Soliman
ayant pris l’offensive en Asie Mineure, Léon III et Constantin infligèrent une
grande défaite à ses troupes sur le plateau d’Akroinon en Phrygie
(Afium-Kara-Hissar) qui obligea les Arabes à évacuer la partie occidentale de
l’Asie Mineure .
Non seulement Léon III a arrêté la conquête
arabe, mais il a fait cesser l’anarchie qui régnait dans l’Empire, en réprimant
les tentatives de révolte qui suivirent son avènement, celle d’un stratège de
Sicile et celle de l’ex-empereur Anastase II , et en cherchant à
fonder une dynastie par l’association de son fils à la couronne dès sa
naissance . Il s’efforça de
rétablir la prospérité dans les provinces dépeuplées par les invasions et les
épidémies, ainsi qu’à Constantinople dont la population avait été décimée par
la peste de 718 et qu’il repeupla en y transportant de gré ou de force des
Orientaux . Il constitua une bonne
armée et augmenta le nombre des thèmes , mais, pour accomplir
cette œuvre de relèvement, il du créer de nouveaux impôts et fit ainsi beaucoup
de mécontents .Enfin, si, comme on l’a
déjà dit, il n’est pas l’auteur de la Loi Agricole, il n’en n’a pas moins
publié une œuvre législative importante, le « Choix des lois » tirées
du Corpus juris de Justinien, rendues
plus claires adaptées à l’état social du temps et mises à la portée de tous par
l’emploi exclusif du grec .
Léon III est surtout célèbre par sa
politique religieuse. On sait peu de chose de l’édit par lequel il obligeait le
Juifs et les Montanistes à se faire baptiser (722) , mais, par contre, son
nom est inséparable du mouvement iconoclaste, dont il fut l’initiateur, et qui,
les querelles dogmatiques étant terminées et la paix religieuse semblant
assurée, devait cependant troubler l’Église et l’Empire pendant plus d’un siècle.
Par suite de la rareté des témoignages
contemporains et de la destruction de la plupart des écrits iconoclastes, les
origines du mouvement sont obscures et encombrées de faits apocryphes et
contradictoires. Les partis pris des historiens qui ont vu en Léon III une
sorte de despote éclairé à la manière d’un Joseph II n’ont fait qu’obscurcir la
question .
Il faut d’abord distinguer les
représentations sacrées, peintures murales, mosaïques qui avaient une valeur
d’enseignement et les icônes proprement dites du Christ, de la Vierge et des
saints, tableaux et objets portatifs, auxquels on attribuait un caractère
miraculeux, dont plusieurs passaient pour acheiropoiètes (non faits de la main d’un homme) et qui étaient l’objet d’un culte
fervent .
A plusieurs reprises, depuis le ve siècle, les formes idolâtriques que revêtait ce culte avaient choqué certains
esprits et incité plusieurs évêques à le proscrire, mais il s’agissait de faits
isolés et les sectes hérétiques elles-mêmes, Manichéens, Ariens, Jacobites,
admettaient l’iconographie sacrée.
La première mesure iconoclaste est venue
des Arabes, bien que le Coran ne défende pas les représentations figurées, mais
seulement les idoles : ce fut l’édit du calife Yézid ordonnant en 723 la
destruction des images dans les églises chrétiennes et dans les maisons . Au même moment
plusieurs évêques d’Asie Mineure proscrivirent les images dans leurs diocèses
et deux d’entre eux, Constantin de Nacolia et Thomas de Ciaudiopolis, vinrent à
Constantinople pour essayer de gagner à leurs doctrines le patriarche Germain
qui les repoussa avec indignation . Léon III partageait-il
déjà ces doctrines ou y fut-il gagné à cette époque ? La question demeure
obscure .
Toujours est-il qu’on lui a attribué à tort la publication d’un édit proscrivant
le culte des images en 726 . Loin de heurter ainsi
de front les sentiments intimes de ses sujets, il commença à faire lui-même
dans des assemblées populaires une propagande insidieuse contre les images et, d’après la chronique
de Nicéphore, cette campagne commença après la terrible éruption sous-marine
qui fit surgir une île nouvelle entre Théra (Santorin) et Thérasia, dans l’été
de 726, et dans laquelle il vit un effet de la colère divine contre le culte
idolâtrique .
Ce fut seulement l’année suivante que les
mesures iconoclastes commencèrent et qu’il en résulta les premiers
troubles : destruction violente de l’icône du Christ qui surmontait les
portes de bronze du Grand Palais au milieu des protestations du peuple ; propagande dans
les armées qui excita la révolte du thème des Helladiques et la proclamation d’un
empereur, dont la flotte fut détruite devant Constantinople (18 avril
727) ;
tentatives pour forcer le patriarche Germain et le pape Grégoire II à condamner
le culte des images . L’ultimatum adressé au
pape provoqua la révolte des milices italiennes . Léon III accomplit
alors un acte décisif : dans un silention tenu au Tribunal des 19 lits le
17 janvier 730, il déposa le patriarche Germain et le remplaça par son
syncelle, Anastase, qui s’empressa de rédiger un édit synodal conforme aux
désirs du basileus . Désormais la doctrine
iconoclaste s’appuyait sur un acte canonique et la proscription des images
commença, provoquant l’émigration de beaucoup d’habitants de Constantinople et
une émotion qui franchit les frontières de l’Empire et incita Mansour (Jean
Damascène), fonctionnaire arabe, mais chrétien, à écrire ses traités
apologétiques en faveur du culte des images .
La principale protestation vint du pape
Grégoire III (consacré en mars 731), dont les lettres à l’empereur furent
interceptées et qui tint à Rome un concile où les doctrines iconoclastes
étaient condamnées . Par représailles Léon
III doubla les impôts en Calabre et en Sicile et confisqua les propriétés
(patrimoines de Saint Pierre) qui se trouvaient dans ces régions . Il aurait en même temps,
bien que les sources contemporaines n’en parlent pas, démembré la juridiction
du pape en rattachant les églises de l’Illyricum, de la Sicile et de la Crète
au patriarcat de Constantinople .
2. Constantin V (741-775) et Léon IV (775-780)
Constantin V continua avec succès à
l’extérieur l’œuvre défensive de Léon III et à l’intérieur il accentua sa
politique iconoclaste en y apportant une passion violente qui contraste avec la
sagesse diplomatique de son père. Cependant son règne de 34 ans est loin de présenter
un aspect uniforme et les circonstances l’obligèrent d’abord à une certaine
modération. Pour ses débuts, il dut conquérir son trône et réprimer la révolte
redoutable de son beau-frère Artavasde, qui semble avoir été l’espoir des
partisans des images. Pendant que Constantin organisait en Asie une expédition
contre les Arabes, Artavasde, proclamé empereur par les troupes de l’Opsikion,
dont il était comte, dispersa l’armée impériale commandée par Beser et marcha
sur Constantinople où il avait des intelligences et, après y être entré sans
résistance, reçut la couronne des mains du patriarche Anastase (juillet
743) .
Son premier soin fut d’autoriser le culte des images et d’associer son fils
aîné au trône.
Artavasde exerça le pouvoir un an, mais sa
tentative pour venir à bout de Constantin, appuyé par les thèmes orientaux,
échoua complètement. Battu près de Sardes, il se réfugia à Constantinople, que
Constantin prit d’assaut (2 novembre 742) . Artavasde et ses fils
aveuglés parurent au triomphe que le vainqueur célébra à l’Hippodrome, tandis
que le patriarche Anastase, battu de verges, conservait ses fonctions .
Le résultat de cette victoire fut une
nouvelle proscription du culte des images et la destruction de toutes les
peintures d’histoire sacrée qui ornaient les églises et de tous les objets du
culte ornés de sujets iconographiques . Il semble cependant que
Constantin V, sentant le terrain peu solide, ait montré une certaine modération.
Les régions éloignées de Constantinople n’étaient pas encore touchées par le
mouvement iconoclaste et les moines, devenus les principaux défenseurs des
images, s’y réfugiaient en grand nombre . Bien plus, à la
différence de Léon III, Constantin avait d’excellents rapports avec le pape
Zacharie, qui servait toujours d’intermédiaire entre l’Empire et les
Lombards .
Ce fut seulement douze ans après la chute
d’Artavasde que Constantin crut le moment venu de se faire donner par l’Église
l’arme qui lui permettrait de traiter les iconodules comme des hérétiques et
des rebelles. Appuyé sur un véritable parti iconoclaste dont l’armée des thèmes
d’Asie, originaire de régions où le culte des images était inconnu , et le haut clergé
formaient la force principale, après avoir mené, comme jadis Léon III, une
propagande active contre le culte des images dans des assemblées populaires ou
des silentia , Constantin convoqua un
concile auquel participèrent 338 évêques assemblés au palais impérial de Hieria
(10 février 754) . Prenant lui-même parti
dans le débat théologique, l’empereur avait composé un livre dans lequel, afin
de montrer le caractère hérétique des images du Christ, il employait des termes
condamnés par les conciles, allant même jusqu’à rejeter le dogme de
l’intercession de la Vierge et des saints, aussi bien que le culte des
reliques . On ne connaît du
concile, qui se déclara œcuménique et dont les délibérations durèrent sept
mois, que sa conclusion (ὄρος),
qui condamnait sous les peines les plus sévères la fabrication, la possession
et la vénération des icônes, mais le soin avec lequel le concile affirma le pouvoir
d’intercession de la Vierge et des saints montre qu’il repoussa les doctrines
hérétiques de l’empereur .
Celui-ci possédait ainsi les armes
redoutables qui lui permettraient de supprimer complètement les images et de
châtier leurs défenseurs. Cependant la terreur iconoclaste ne commença pas
immédiatement après le concile. Constantin essaya d’abord de gagner les
champions les plus éminents du culte proscrit, comme le montrent ses démarches
auprès d’Étienne le Nouveau, moine au mont Saint-Auxence près de Chalcédoine,
dont il connaissait l’influence sur le monde monastique . Il attachait tant
d’importance à l’adhésion d’Étienne au concile iconoclaste qu’il fit traîner
l’affaire pendant dix ans, essayant tour à tour la violence et la douceur sans
ébranler la fermeté d’Étienne, qui, après avoir été jugé par une commission
d’évêques, fut exilé à Proconnèse et subit le martyre le 20 novembre 764 . Cependant les décrets
du concile concernant la destruction des icônes et de la décoration religieuse
avaient reçu un commencement d’application, des épisodes de chasses
remplaçaient dans les églises les thèmes sacrés et Constantin poursuivait
d’une haine particulière les moines, dont un grand nombre fut exilé, emprisonné,
mutilé .
Mais ce fut après le supplice de saint
Étienne que s’ouvrit réellement l’ère des martyrs. Exaspéré par les
résistances, l’empereur força tous ses sujets à prêter serment qu’ils ne
vénéraient pas les images et le patriarche Constantin dut jurer le premier à
l’ambon de Sainte-Sophie (765) . Puis ce furent des
expositions ignominieuses de dignitaires iconodules, des défilés de moines à
l’Hippodrome sous les insultes de la foule (766). Accusé de
complot, le patriarche Constantin fut déposé, exposé à l’Hippodrome, torturé et
enfin décapité le 15 août 768 . Dans les provinces, des
gouverneurs renchérissaient encore sur les rigueurs du maître. Michel
Lacanodracon, stratège des Thracésiens, faisait piller les monastères par ses
soldats, et rassemblant un jour des moines et des religieuses sur une place
d’Éphèse, leur donnait le choix entre le mariage ou la perte des yeux .
La conséquence de cette politique fut la
ruine de l’autorité impériale en Italie, dont les liens avec l’Empire étaient
de plus en plus lâches et qui, depuis le début du mouvement iconoclaste, était
devenue le refuge de tous les proscrits . Cependant, malgré leur
animosité réciproque sur le terrain religieux, les papes et les empereurs s’en
tenaient à un régime de compromis résultant de leur solidarité devant le danger
lombard. Constantin V, ne pouvant envoyer d’armée en Italie, utilisait, comme
on l’a vu, le prestige du pape sur les Lombards et les négociations entre
Zacharie et Luitprand en 741-742 avaient obtenu un plein succès (742-743) .
Il en fut autrement lorsqu’en 751 le roi
lombard Astolphe, ayant pris Ravenne et annoncé l’intention de marcher sur Rome,
se montra rebelle à toute tentative de négociation . Soit de sa propre
initiative, soit, ce qui est plus probable, par ordre de Constantin V, qui lui
avait envoyé le silentiaire Jean, le pape Étienne II alla solliciter en Gaule
le secours du roi franc Pépin, tout dévoué au Saint-Siège, qui avait favorisé
son avènement à la couronne . Le 6 janvier 754 au
palais de Ponthion, Pépin promet au pape de prendre en main « la cause du
bienheureux Pierre et de la république des Romains » et de restituer au
pape « par tous les moyens l’exarchat de Ravenne, les droits et les
possessions de la république » . Sans doute le terme de république est dans la langue de
l’époque l’équivalent d’empire romain. Mais Pépin se lie envers saint Pierre et
non envers l’empereur, qui n’est pas nommé, et les événements qui suivent,
l’octroi à Pépin par le pape du titre insolite de « patrice des
Romains » , le refus opposé par
Pépin, engagé dans sa première expédition, de promettre aux ambassadeurs de
Constantin V la restitution de l’Exarchat à l’Empire , enfin, après la
victoire finale, la tradition à saint Pierre de toutes les cités reconquises
(756) montrent avec évidence qu’un nouveau droit est né à l’entrevue de Ponthion,
celui de la souveraineté du Saint-Siège, indépendante en droit et en fait de
celle de l’empereur.
On ne voit pas que Constantin ait fait une tentative militaire pour recouvrer l’Exarchat ou même élevé une protestation, mais, loin de se résigner à ce nouveau démembrement territorial, il chercha à agir par sa diplomatie De 756 à 769 eut lieu une lutte très serrée
entre les diplomaties impériale et pontificale qui cherchèrent à agir à la fois
sur les Francs et sur les Lombards. Pépin reçut trois ambassades successives et
l’empereur entreprit de lui faire condamner le culte des images : un
concile à tendances iconoclastes fut tenu à Gentilly en 767 . Tous ces efforts
échouèrent et l’avènement d’Étienne III, qui tint en 769 un concile où la
légitimité du culte des images fut proclamée, marqua la fin de la subordination
dans laquelle le pape se trouvait placé vis-à-vis de l’empereur . Désormais l’empereur ne
ratifie plus les élections pontificales et c’est au roi des Francs que le
nouvel élu fait part de son avènement . L’Empire conserve
encore en Italie quelques territoires la Calabre, la terre d’Otrante, le littoral
napolitain , mais son prestige a été
atteint gravement.
Continuant du moins l’œuvre militaire de Léon III, Constantin V assura la sécurité des frontières de l’Empire et c’est le souci de consacrer toutes les forces disponibles à la défense de Constantinople qui explique sa politique d’expectative en Occident. Il a mis à profit les guerres civiles du
califat, qui ont abouti à la chute de la dynastie des Ommiades et à l’avènement
des Abbassides en 750 , pour prendre
l’offensive, donner à l’Empire des frontières solides et rétablir son prestige
chez les Arméniens, révoltés contre les Arabes (749-750).
Ce résultat fut atteint par la prise de
Germanicia (Marasch) en 745, de Théodosiopolis et Mélitène en 751 , par la destruction de
leurs murailles et le transport de leurs habitants dans l’Empire. Cette
politique de colonisation à l’intérieur, qui fit suite à celle de Léon III, se
rattachait à son plan défensif en facilitant le recrutement de l’armée et à sa
lutte contre les images, dont un grand nombre de ces Orientaux condamnait la
vénération . Le rétablissement du
prestige impérial en Asie se manifeste par le fait qu’il suffit de la seule
approche de Constantin pour faire reculer les Arabes entrés en Cappadoce en
756 et que désormais les armées des thèmes suffisent à contenir leurs incursions.
Ces résultats permirent à Constantin de
consacrer la majeure partie de ses forces au front bulgare contre lequel il eut
à lutter pendant tout son règne, mais qu’il parvint à contenir. Le Khan Tervel
avait aidé Léon III à repousser les Arabes de Constantinople et était resté
fidèle au traité qu’il avait conclu en 716 avec Théodose III , mais en 755 le
peuplement des forteresses de Thrace par des Orientaux servit de prétexte au
nouveau Khan pour réclamer un tribut. Constantin ayant repoussé cette
prétention, les Bulgares franchirent les Balkans et ravagèrent le pays jusqu’au
Long Mur et, après 39 ans de tranquillité,
commença la série des incursions périodiques qui mettaient chaque fois le sort
de Constantinople en danger sans aucun égard pour les trêves conclues dans
l’intervalle des expéditions .
Constantin V ne se borna pas à repousser
les invasions , mais, à plusieurs reprises,
il mena des offensives vigoureuses et infligea aux Bulgares de sévères leçons.
Il avait d’ailleurs sur ses ennemis deux avantages : d’une part, la
possibilité de faire pénétrer la flotte impériale dans le Danube pour prendre à
revers les Bulgares, qu’une armée attaquait de front; d’autre part, les guerres
civiles entre les boliades qui se disputaient le pouvoir permirent à l’empereur
de se porter arbitre entre les prétendants et d’entretenir en Bulgarie des
espions qui le renseignaient sur les projets de ses adversaires . Ce fut ce qui lui
permit d’infliger au Khan Teletzes, qui avait envahi la Thrace, l’une des
défaites les plus graves que les Bulgares aient jamais subies, dans la plaine
d’Anchialos (Sizebolou actuelle) sur le golfe de Bourgas. Des troupeaux de
prisonniers figurèrent au triomphe de Constantin à l’Hippodrome et furent
cruellement mis à mort (10 juin 762) . Dix ans plus tard,
informé par ses espions de la rupture prochaine de la paix signée en 765,
Constantin réussit à tromper les envoyés du Khan, venus pour négocier, en
feignant des préparatifs contre les Arabes et, gagnant les Balkans à marches forcées
avec des troupes d’élite, tomba sur l’armée bulgare à Lithosoria et, après
l’avoir détruite presque entièrement, revint triompher à Constantinople avec un
imposant convoi de prisonniers et un immense butin, si satisfait de cette expédition
qu’il l’appela « la noble guerre » Une nouvelle chevauchée
en 773 força les Bulgares à demander la paix, garantie par les garnisons
réparties dans les forts de la frontière ; Constantin V
n’avait pu songer à conquérir la Bulgarie, mais il l’avait suffisamment
affaiblie pour assurer à sa ville impériale une sécurité qui dura vingt
ans .
Léon IV, que Constantin V avait eu de sa
première femme, fille du Khan Khazar, a continué en tout pendant son règne très
court (775-780) la politique de son père, dont il était loin d’avoir l’énergie
farouche, mais il en a maintenu tous les résultats. Au point de vue dynastique,
marié à une obscure provinciale attachée au culte des images, l’Athénienne
Irène ,
il a écarté du trône les deux fils aînés de la troisième femme de Constantin V,
qui avaient reçu le titre de César et, avant de couronner Auguste son fils
Constantin âgé de cinq ans, il lui fit prêter un serment solennel à
l’Hippodrome par toutes les classes de la population .
A l’extérieur la paix avec la Bulgarie ne
fut pas troublée et les Arabes, ayant repris l’offensive contre l’Asie Mineure,
subirent deux grandes défaites, l’une en Cilicie près de Germanicia en
778 ,
l’autre dans le thème des Arméniaques en 780 . De son expédition
contre Germanicia, le trop fameux Michel Lacanodracon ramena des Syriens
jacobites qui allèrent grossir les colonies établies en Thrace sous le règne
précédent.
En matière de religion, Léon professait des
opinions assez différentes de celles de son père. Théophane vante sa piété, son
culte pour la Panaghia, son amitié pour les moines qu’il nomma à des
évêchés ,
mais, s’il y eut quelque détente dans les persécutions, Léon ne songea
nullement à abolir les lois iconoclastes. Le patriarche Nicétas étant mort en
780, son successeur Paul dut, bien qu’à contrecœur, prêter le serment de
détestation des images et, peu après,
l’empereur condamna au fouet cinq dignitaires du palais, accusés d’avoir
introduit secrètement des icônes dans la chambre de l’impératrice . La situation était donc
de nouveau tendue lorsque Léon IV mourut subitement de la maladie du charbon, à
l’âge de trente ans . Cet accident
imprévisible allait provoquer un revirement complet de la politique impériale.
3. L’Orthodoxie restaurée (784-813)
L’héritier du trône, Constantin VI, était
âgé de 10 ans, mais sa mère, avec un esprit de décision inattendu, s’empara du
pouvoir ,
déjoua une conspiration militaire destinée à faire couronner empereur l’un des
deux Césars, fils de Constantin V, Nicéphore, qui dut, ainsi que ses frères,
recevoir les ordres ecclésiastiques et distribuer la communion au peuple à
Sainte-Sophie le jour de Noël 780 .
Ainsi s’évanouissait l’espoir du parti
iconoclaste qui comptait, grâce à Nicéphore, conserver le gouvernement de
l’Empire, mais la situation d’Irène, que tous savaient favorable aux
iconophiles, n’en était pas moins périlleuse : tous les emplois de la
cour, tous les gouvernements des thèmes étaient tenus par des iconoclastes
notoires et tous les évêques avaient prêté le serment contre les images. Après
le complot de ses beaux-frères, Irène eut à réprimer la révolte d’Helpidius,
stratège de Sicile, contre lequel il fallut envoyer une expédition . Tout en encourageant
les iconophiles et en laissant rentrer les exilés, elle dut montrer beaucoup de
prudence, d’autant plus nécessaire qu’elle se trouva subitement en face d’une
nouvelle agression arabe au moment où la plus grande partie de l’année était en
Sicile. En 782 les coureurs arabes, commandés par le futur calife Haroun, atteignirent
Chrysopolis : Irène signa avec lui une trêve de trois ans moyennant le
paiement d’un lourd tribut, abandonnant ainsi tous les avantages dus aux
victoires des règnes précédents .
Ce ne fut qu’en 784, après avoir négocié
avec tous les évêques, qu’Irène écrivit au pape Hadrien pour lui demander la
convocation d’un concile œcuménique qui rétablirait le culte des images . La lettre ne devait
parvenir au pape qu’en octobre 785 et dans l’intervalle le patriarche Paul,
pris de remords à cause du serment iconoclaste qu’il avait prêté, abdiqua et
fut remplacé par un laïcs, l’asecretis Tarasius . Le pape, auquel il
envoya sa synodique , fit de fortes réserves
sur la légitimité de son élection. Il y eut donc un malentendu initial entre
Rome et Constantinople.
Cependant lorsque le concile œcuménique
s’ouvrit à l’église des Saints-Apôtres le ler août 786, deux corps
de la garde, les scholaires et les excubiteurs, envahirent l’église et
dispersèrent les évêques . C’était là le résultat
d’un complot entre les chefs de l’armée et certains évêques. Irène fit passer
des mutins en Asie et occuper Constantinople par des troupes de Thrace, qui
désarmèrent les corps de la garde , Un nouveau concile fut
convoqué à Nicée (mai 787), mais ne s’ouvrit que le 24 septembre. Il comprit de
330 à 367 évêques, deux légats du pape, un grand nombre d’higoumènes et de
moines. Ses travaux, terminés le 23 octobre suivant, eurent pour objet la
condamnation des décrets du concile iconoclaste et la constitution d’une
apologétique des images et de leur culte, fondée sur les autorités bibliques et
patristiques, ainsi que sur la réforme de l’Église, dont l’ordre avait été
troublé par la querelle iconoclaste . L’influence des moines,
qui avaient blâmé la réception par le concile des évêques iconoclastes
repentis, apparaît dans les canons disciplinaires qui interdisent
l’intervention des princes temporels dans les élections épiscopales , C’est au concile de
Nicée qu’il faut chercher le point de départ de la réforme de l’Église et de la
société, qui fut tentée par les Studites . Par contre, les décrets
du concile furent reçus avec peu d’empressement hors de l’Empire et
rencontrèrent même dans l’Église franque une vive opposition qui se manifeste
dans le Capitulare de imaginibus et
dans les canons du concile de Francfort (794) .
Le concile de Nicée, qui aboutit à la
suppression des lois iconoclastes, n’en fut pas moins un triomphe pour Irène,
mais la tranquillité intérieure ne tarda pas à être troublée par
l’intransigeance des moines qui déniaient au patriarche Tarasius le droit
d’admettre à la pénitence et de réconcilier les évêques iconoclastes ou
simoniaques , et surtout par les
dissentiments qui s’élevèrent entre Irène et son fils et provoquèrent une série
de révolutions de palais et d’intrigues qui compromirent le prestige de
l’Empire.
La véritable cause du conflit entre le
jeune empereur et sa mère fut la tutelle étroite dans laquelle, avec l’appui de
son principal ministre, l’eunuque Staurakios, elle le maintint quand il fut
parvenu à l’âge d’homme . Sans le consulter et
pour des raisons politiques, elle rompit ses fiançailles, qui dataient du début
de son règne, avec une fille de Charlemagne et lui fit épouser
malgré lui une obscure provinciale, Marie l’Arménienne, choisie par Staurakios
à la suite d’un de ces étranges concours de beauté qui servaient à recruter les
impératrices . Exaspéré, Constantin
entreprit de renverser Staurakios et d’exiler Irène, mais le ministre eut vent
du complot, fit arrêter et fouetter les conjurés et l’empereur lui-même reçut
les verges (septembre 790). Irène exigea des troupes le serment de ne pas reconnaître
son fils comme empereur tant qu’elle vivrait. Aussitôt le thème des Arméniaques
se révolta et entraîna les autres thèmes qui proclamèrent Constantin seul
empereur. Staurakios fut fouetté et emprisonné, Irène reléguée au palais
d’Éleutheria .
Devenu ainsi maître du pouvoir, Constantin
VI ne sut pas le conserver et commit faute sur faute. La première fut de
rappeler Irène au palais, sans avoir désarmé sa vengeance, de lui rendre le
titre d’Augusta (15janvier 792) et de consentir au retour de Staurakios ;
les Arméniaques manifestèrent leur mécontentement : ils furent envoyés
dans le Pont et leur stratège Alexis Mosèle fut emprisonné . La sanglante déroute
infligée par les Bulgares à Constantin, qui les avait attaqués sur la foi d’un
astrologue (juillet), le déconsidéra aux yeux de son armée, et un complot
organisé pour proclamer empereur son oncle, l’ex-César Nicéphore, ayant été
découvert, Constantin fit couper la langue à quatre de ses frères utérins et
aveugler l’aîné, Nicéphore, ainsi qu’Alexis Mosèle . Aussitôt les Arméniaques
se soulevèrent et une guerre civile de six mois (novembre 792- mai 793) ravagea
l’Asie Mineure. Le basileus dut conduire lui-même une expédition contre les
rebelles, qui furent vaincus par trahison et cruellement châtiés .
Mais ce qui mit le comble à son
impopularité, ce fut son divorce avec Marie l’Arménienne, accusée sans preuve
de complot, et son second mariage, qu’il trouva un prêtre de Sainte-Sophie pour
célébrer, avec une suivante de sa mère, laquelle aurait, pour le mieux perdre,
favorisé leurs rapports . Cette union souleva
d’unanimes protestations et les chefs de la réforme, Platon, higoumène de Saccoudion,
et son neveu Théodore se séparèrent de la communion du patriarche, accusé
d’être complice de l’adultère. Platon fut emprisonné et les autres moines
exilés ,
mais presque tous les monastères de l’Empire manifestèrent la même
indignation . Irène tenait sa
vengeance, mais elle mit deux ans à en assurer le succès, profitant d’un voyage
aux eaux de Brousse pour gagner la garde impériale (octobre 796) et allant
jusqu’à faire trahir son fils par ses troupes pendant une expédition contre les
Arabes (mars 797) . Une première tentative
pour s’emparer de sa personne (juin) échoua et il put gagner les thèmes
d’Orient mais, trahi par son entourage et capturé, il fut ramené à Constantinople
et aveuglé dans la Porphyra où il avait vu le jour . Irène devenait l’unique
basileus des Romains et occupait seule le trône pendant cinq ans.
Cette situation était sans précédent.
Plusieurs princesses héritières du trône, comme Pulchérie ou Ariadne, avaient
apporté le pouvoir à leur époux : aucune ne l’avait encore exercé seule,
aucune ne s’était intitulée dans les protocoles
πιςτος
βασιλεύσ, empereur fidèle . Irène se fit
représenter sur les diptyques consulaires en costume de basileus et, afin de rendre
sensible aux yeux de tous la nature de son pouvoir, parut dans une procession
triomphale sur un char traîné par quatre chevaux blancs, dont quatre patrices
du rang le plus élevé tenaient les brides .
En même temps Irène cherchait à se rendre
populaire, comme si elle voulait faire oublier son abominable crime. Elle
rappela les moines exilés par Constantin et ce fut à ce moment que Théodore et
ses compagnons s’installèrent au monastère de Stoudios . Le prêtre Joseph, qui
avait béni le second mariage de Constantin, fut excommunié et déposé par le
synode patriarcal . Avec une véritable insouciance
elle appauvrit le trésor en supprimant les impôts urbains et en diminuant les
droits perçus à la douane d’Abydos , ce qui lui valut une
lettre de félicitation de Théodore le Studite . Elle montra la même
légèreté dans ses rapports avec les Arabes dont les incursions en Asie Mineure
étaient périodiques; elle laissa le calife Haroun-al-Raschid constituer autour
de Tarse, entre la Syrie et la Cilicie, une Marche militaire, peuplée avec des
habitants du Khorassan, qui devint une menace perpétuelle pour l’Empire, dont
les frontières n’étaient plus défendues , et pour acheter sa
tranquillité, elle signa avec le calife un traité par lequel elle s’engageait à
payer de nouveau le lourd tribut consenti en 781 .
Ces actes inconsidérés soulevèrent contre
elle une forte opposition. Au début de son gouvernement elle dut exiler à
Athènes les fils de Constantin V, que les iconoclastes voulaient proclamer
empereurs et ayant appris que les chefs slaves de l’Hellade s’agitaient en leur
faveur, elle les fit aveugler, eux et leurs complices . Sa cour était devenue
le théâtre d’une lutte acharnée entre ses deux principaux ministres, Aétius et
Staurakios, tous deux eunuques, qui cherchaient à assurer sa succession à l’un
de leurs parents. Accusé par son rival de vouloir usurper l’Empire, Staurakios
parvint à se justifier, puis, quelque temps après, il essaya de gagner les
corps de la garde et fomenta pour détrôner Irène un véritable complot qui fut découvert
et facilement déjoué. Staurakios en serait mort de colère (801) .
Maître de la situation, Aétius travailla à
assurer l’Empire à son frère , mais, au même moment,
arrivait à Constantinople une ambassade de Charlemagne, désireux de faire
reconnaître par Byzance son titre impérial et, d’après un bruit enregistré par
le seul Théophane, proposant à Irène de l’épouser afin d’unir en un seul État
l’Orient et l’Occident . Mais si ce projet
chimérique a jamais eu un fondement réel, il était trop tard pour l’accomplir.
Excédés par l’arbitraire du gouvernement d’Aétius, humiliés de voir l’Empire
tombé aux mains d’une femme, dont le crime faisait horreur et dont la politique
insensée conduisait l’État à sa perte, un certain nombre de hauts dignitaires
se concertèrent et le 31 octobre 802 mirent fin à la fois au pouvoir d’Aétius
et à celui d’Irène . Proclamé empereur, le
Iogothète du trésor, Nicéphore, exila Irène aux îles des Princes, puis à
Lesbos .
Irène laissait l’Empire troublé et appauvri
à l’intérieur, diminué et sans prestige à l’extérieur. Sacrifiant tout au
rétablissement des images, elle a désorganisé les thèmes d’Asie et, pour se
venger des Arméniaques, elle a détruit l’une des principales forces qui
défendaient les frontières contre les Arabes. Les résultats de cette politique
ne se sont pas fait attendre : l’Asie Mineure a été ouverte aux
entreprises de l’ennemi dont les incursions ont atteint le Bosphore en 781,
Éphèse en 795, Amorium en 796, de nouveau le Bosphore en 798, raid qui permit
aux Arabes d’enlever les chevaux des écuries impériales de Malagina . Les initiatives
personnelles de Constantin VI ne furent pas plus heureuses. L’expédition qu’il
entreprit en 791 à travers l’Asie Mineure et qui le mena jusqu’à Tarse, sans
qu’il ait rencontré l’ennemi, ne produisit aucun résultat .
Le seul succès militaire de ce règne fut
l’expédition de Staurakios contre les Slaves de Grèce en 783 . Les Bulgares, assagis
par les leçons que leur avait infligées Constantin V, se tenaient tranquilles :
Constantin II, désireux d’acquérir un prestige militaire, les attaqua mal à
propos en 791 et se fit battre honteusement, et la nouvelle tentative qu’il fit
en 796 pour envahir la Bulgarie ne fut pas plus heureuse .
En Occident la politique d’Irène fut
inconsistante et ne fit que compromettre le prestige de l’Empire. Désireuse de
recouvrer l’Italie, elle ne pouvait s’entendre avec le pape Hadrien et elle
oscilla entre l’alliance franque (fiançailles de Rothrude avec Constantin VI en
781) et l’alliance avec le duc lombard de Bénévent, Arichis (787), puis de son
fils Grimoald, mais celui-ci dut se soumettre aux Francs et l’expédition
envoyée en 788 pour replacer sur le trône lombard Adalgise, fils de Didier,
échoua complètement . Mais le plus gros échec
que Byzance subit en Occident fut le couronnement de Charlemagne comme
« empereur Auguste » le 25 décembre 800, véritable usurpation au
regard du droit impérial, regardé plus tard à bon droit comme l’origine du
schisme, mais qui donnait au souverain de l’Occident un prestige égal à celui
du basileus byzantin et dont les relations de Charlemagne avec le calife
Haroun-al-Raschid montrent toute la portée .
Mais des maux dont souffrait l’Empire, les
plus menaçants étaient l’indiscipline des armées et les divisions religieuses
irréductibles. Trois partis, également forts, se disputaient le pouvoir :
les iconoclastes, encore très nombreux, appuyés par les thèmes d’Orient, par certains
évêques et répandus même dans quelques monastères ; à l’opposé, le
parti de la réforme morale de l’Église et de l’État, dont les principaux
champions étaient les Studites, défenseurs intransigeants du culte des icônes
et de l’observation rigoureuse des canons ecclésiastiques par tous, clercs ou
laïcs, et surtout par le basileus ; enfin un tiers parti, le parti de
l’ordre dans l’Église et dans l’État, attaché à l’orthodoxie et aux images,
mais soucieux avant tout de la paix religieuse et de la répression des troubles
et de tous les écarts, même des moines, recruté surtout dans le haut clergé et
les hauts fonctionnaires : les patriarches Tarasius et Nicéphore,
l’empereur Nicéphore lui-même en sont les représentants les plus qualifiés.
De 802 à 842, chacun de ces partis exerça successivement le pouvoir, et tout d’abord le tiers parti avec Nicéphore (802-811), l’un des nombreux Orientaux hellénisés immigrés à Constantinople , fonctionnaire zélé, parvenu au rang de logothète « του γενικου », comme tel, chef de la trésorerie impériale et décidé certainement, en acceptant le pouvoir, à rétablir les ressources de l’État dissipées par les prodigalités d’Irène, à faire régner la paix à l’intérieur et à restaurer le prestige de l’Empire à l’extérieur. Mais les compressions indispensables qu’il
fallut substituer au régime de facilités qui perdait l’État expliquent les
rancunes qu’il amassa contre lui et dont le chroniqueur Théophane, à peu près
son seul témoin, s’est fait l’écho en énumérant ses onze prétendues
« vexations » qui ne sont autre chose
que des mesures rendues nécessaires par l’appauvrissement du trésor, pour
supprimer les exemptions d’impôts consenties par Irène à des collectivités et à
des possesseurs de biens de mainmorte, pour augmenter les revenus de l’État par
la révision du cadastre et le recensement des fortunes, pour assurer le
recrutement indigène de l’armée en mettant au compte des riches l’équipement et
les impôts des pauvres (allelengyon) .
De plus le fonctionnaire civil qu’avait été
Nicéphore ne parvint jamais à acquérir un prestige suffisant auprès des
stratèges des thèmes et il eut à combattre des révoltes militaires, parfois en
pleine guerre ou en face de l’ennemi, comme celle de Bardanios Tourkos, auquel il
avait confié le commandement des cinq thèmes d’Asie pour prendre l’offensive
contre les Arabes et qui, après s’être avancé jusqu’à Chrysopolis, fut livré à
Nicéphore par ses lieutenants (juillet 803) . Et lorsqu’il lui fallut
défendre Constantinople contre les Bulgares, des complots et des émeutes
continuelles paralysèrent ses opérations et contribuèrent à sa fin
tragique .
Une autre opposition redoutable fut celle
des Studites, qui éclata après la mort du patriarche Tarasius (25 février 806)
et son remplacement par Nicéphore, promu directement, comme son prédécesseur,
des fonctions d’asecretis à
l’épiscopat . Nicéphore, qui avait
composé des livres d’apologétique contre les iconoclastes, manifesté ses goûts
pour l’ascétisme par la fondation d’un monastère et pris l’habit monastique
avant sa consécration, présentait donc des garanties suffisantes pour gouverner
l’Église, mais, aux yeux des réformistes, en cela d’accord avec les papes, il
n’était qu’un néophyte, un intrus,
élu contrairement aux canons . Ce fut en vain que le
nouveau patriarche fit des avances aux Studites : ils demeurèrent dans
leur opposition , qu’un nouvel incident
vint exaspérer. Avec le dessein de pacifier l’Église, l’empereur obligea le
patriarche à relever de son excommunication le prêtre Joseph . Aussitôt Théodore et
les Studites se séparèrent de la communion patriarcale et un conflit
irréductible divisa le parti iconophile. L’empereur réunit un synode qui
condamna à l’exil Théodore, son frère Joseph, archevêque de Thessalonique, et
l’higoumène Platon, tandis que plusieurs moines étaient emprisonnés . En vain ils en
appelèrent au pape Léon III, avec lequel l’empereur, à cause de son conflit
avec Charlemagne, n’avait plus aucun rapport.
A l’extérieur en effet, comme dans sa politique
intérieure, Nicéphore était bien décidé à rompre avec les errements du règne
précédent et à dénoncer les pactes humiliants et onéreux au prix desquels Irène
avait acheté sa tranquillité. Son tort fut de sous-estimer les forces de ses
adversaires et d’agir vis-à-vis d’eux avec la même désinvolture orgueilleuse
que s’il avait eu à leur opposer des armées fortes et disciplinées. De là les
échecs qui le conduisirent à sa perte.
Ce fut ainsi qu’il refusa de traiter avec
les ambassadeurs francs qui se trouvaient à Byzance au moment de son avènement
et qu’il les renvoya en France avec trois de ses envoyés. Charlemagne, qu’ils
rencontrèrent en Saxe, leur fit des propositions auxquelles Nicéphore ne daigna
même pas répondre . Le conflit portait sur
le titre impérial que Nicéphore refusa absolument de reconnaître et sur la
possession de Venise, qui fait son apparition dans l’histoire et où un parti
franc et un parti byzantin se disputent l’élection du doge, l’ancien duc
byzantin, devenu maître des îles du Rialto. En 807 Nicéphore envoie dans
l’Adriatique une expédition qui replace Venise et la Dalmatie sous la
dépendance de Constantinople , mais en 809-810, Pépin,
fils de Charlemagne, créé par son père roi des Lombards , conquiert toute la
Vénétie .
Nicéphore finit par s’émouvoir et envoie une ambassade qui, Pépin étant mort,
se transporte à Aix-la-Chapelle. Il semble que, pour obtenir la reconnaissance
de son titre d’empereur, Charlemagne ait abandonné Venise, car au printemps de
811 a lieu l’élection du doge Angelus Partecipatus, favorable à Byzance , mais quand l’ambassade
byzantine, accompagnée d’envoyés francs, revient à Constantinople, elle trouve
Michel Ier sur le trône .
La politique de résistance aux Arabes
n’aboutit qu’à de nouveaux revers. Après avoir refusé le tribut consenti sous
Irène par une lettre injurieuse qui, si elle est authentique, est une pure
rodomontade , Nicéphore ne put éviter
les représailles du calife Haroun-al-Raschid, qui organisa, sans rencontrer de
résistance, de fréquentes et fructueuses incursions en Asie Mineure. Son
établissement à Tyane (806) située sur la route de Césarée, et où il bâtit une
mosquée, constitua une nouvelle base d’invasion . Deux fois Nicéphore dut
se soumettre au tribut (803 et 806) ; deux fois il viola
ses promesses et attira sur l’Asie Mineure de nouveaux ravages .
Enfin l’offensive qu’il prit contre les
Bulgares, après le traité désastreux signé avec le calife en 806, et sans qu’on
puisse en discerner les motifs, eut des résultats encore plus funestes. Alors
que la paix régnait de ce côté depuis 797, Nicéphore choisit, pour l’attaquer,
le moment où l’État bulgare double sa puissance par l’union, sous un chef
ambitieux et entreprenant, Kroumn , des Bulgares de Pannonie,
qui avaient aidé Charlemagne en 796 à détruire le Ring des Avars, et des
Bulgares de Mésic chez lesquels prédominait une aristocratie slave. Une première
tentative d’expédition en 807 fut arrêtée par un complot qui éclata à Andrinople ; en 809 Kroumn
attaqua l’Empire à son tour, s’empara d’une caisse militaire et atteignit Sofia
que Nicéphore ne put délivrer par suite d’une révolte des chefs de son
armée .
Enfin en 811 l’empereur fit d’immenses préparatifs, augmenta les impôts pour
avoir des ressources et envahit la Bulgarie à la tête d’une armée composée des
thèmes d’Europe et d’Asie. Kroumn, effrayé, demanda à traiter et n’obtint qu’un
refus. Traversant la Mésie, Nicéphore atteignit la résidence du Khan bulgare,
incendia son palais, pilla ses richesses, mais, s’étant engagé avec son armée
dans une plaine marécageuse, se laissa encercler par les Bulgares qui
interceptèrent toutes les issues en y entassant des abattis d’arbres
surplombant un fossé profond. Cernée ainsi, l’armée impériale offrit une proie
facile à l’ennemi qui en massacra la plus grande partie : Nicéphore fut
tué dans la mêlée et son fils Staurakios, blessé, s’enfuit à
Constantinople .
C’était à lui que revenait de droit la
succession de Nicéphore qui, désireux de fonder une dynastie, l’avait associé à
la couronne (décembre 803) et marié à une parente
d’Irène l’Athénienne, Théophano . Mais Staurakios était
regardé comme un incapable : de plus, grièvement blessé, il se sentait
près de sa fin et il cherchait à assurer le pouvoir à son épouse, au détriment
de son beau-frère, Michel Rhangabé, marié à Procopia, fille de Nicéphore; mais
les sénateurs le mirent devant le fait accompli en proclamant Michel, et
Staurakios abdiqua sans résistance (2 octobre 811) .
Avec Michel Rhangabé, issu d’une famille de
hauts dignitaires , c’était le parti
réformiste qui arrivait au pouvoir. Non seulement il rappela les Studites
exilés, mais il les réconcilia avec le patriarche Nicéphore, ce qui valut au
prêtre Joseph une nouvelle excommunication , et il les appela à
siéger dans ses conseils en même temps que des évêques. Pendant son règne
éphémère de 22 mois (2 octobre 811 - 10 juillet 813) il bouleversa entièrement
la politique de son prédécesseur et commença par gaspiller en largesses de
toutes sortes le trésor qu’il avait amassé . Conformément aux
doctrines des réformistes, il renoua des rapports avec l’Occident, fit le
meilleur accueil aux ambassadeurs que Charlemagne avait envoyés à Nicéphore,
dépêcha lui-même une ambassade à Aix-la-Chapelle afin de demander la main d’une
princesse franque pour son fils aîné Théophylacte, associé au trône , en accordant au roi
franc le titre envié de basileus, ce qui équivalait à légitimer l’existence
d’un Empire d’Occident et à rétablir l’unité politique du monde chrétien . En revanche Charlemagne
laissait à Byzance Venise et les villes de la côte dalmate, mais moyennant le
paiement d’un fort tribut (812) . En même temps le patriarche
se mettait en rapport avec Léon III et lui faisait parvenir la synodique dont
le précédent empereur avait interdit l’envoi . Le rêve des Studites
d’établir l’autorité universelle de la morale chrétienne semblait près d’être réalisé.
Cependant les iconoclastes n’avaient pas
désarmé. Ils en étaient encore à comploter pour mettre sur le trône les fils
infortunés de Constantin V, qu’il fallut changer de résidence , ou cherchaient à
ameuter la foule par des manifestations accompagnées de prétendus miracles au
tombeau de leur souverain favori . Les immigrés orientaux
de Thrace et de Macédoine, sectateurs d’hérésies anciennes, Pauliciens,
Athingans, Manichéens, qui n’avaient pas été inquiétés jusque-là dans leurs
croyances, furent l’objet de mesures draconiennes demandées par le patriarche
Nicéphore, alors que les Studites avaient conseillé l’emploi de la douceur pour
les convertir . La paix religieuse
était donc loin d’être complète lorsque Michel Rhangabé dut faire face à la
menace bulgare.
Au lieu de marcher sur Constantinople après
sa victoire sur Nicéphore, Kroumn attaqua les ports de la mer Noire, s’empara
de Develt au fond du golfe de Bourgas, ruina la ville et en transporta ailleurs
les habitants. Lorsque Michel voulut marcher contre les Bulgares,
l’indiscipline se mit parmi ses troupes, et l’ennemi en profita pour envahir la
Thrace. Pris de panique, les habitants des villes désertaient leurs demeures et
les immigrés orientaux cherchaient à retourner dans leur patrie (juin-août
812) .
Ne pouvant combattre, Michel accepta les propositions de paix du Khan, mais
celui-ci exigeait la livraison réciproque des transfuges qui se trouvaient dans
les deux armées. Bien que ce fût là une pratique courante, un véritable conseil
de conscience assemblé par le basileus rejeta les propositions de Kroumn sous
l’influence des Studites et contre l’avis du patriarche et des métropolites,
étendant pour la première fois l’observation de la morale chrétienne aux
relations internationales . Kroumn se vengea en
s’emparant de Mesembria, grâce à la science d’un ingénieur transfuge . Un nouveau conseil de
conscience (novembre) s’en tint aux conclusions précédentes et Michel passa
l’hiver à constituer une grande armée, composée des thèmes d’Asie et d’Europe,
avec laquelle il partit en campagne (mai 813), ayant fort à faire pour lutter
contre l’indiscipline de ses troupes. La bataille qui se livra près
d’Andrinople (22 juin) fut pour l’armée impériale une déroute encore plus honteuse
que celle de 811. Trahi par les stratèges des thèmes d’Asie, Michel Rhangabé
s’enfuit éperdument vers Constantinople pendant que son armée proclamait
empereur le stratège d’Anatolie, Léon l’Arménien, qui entra sans résistance
dans la ville (10 juillet), où il fut reçu par le Sénat . Michel, après avoir
abdiqué, se laissa interner dans l’île de Plati où il se fit moine .
4. La seconde période iconoclaste (813-842)
Avec Léon l’Arménien ce furent les armées
des thèmes d’Asie, attachées aux doctrines iconoclastes, qui arrivèrent au
pouvoir. Le nouvel empereur était un soldat de fortune : appartenant à une
famille d’origine mésopotamienne réfugiée en Asie Mineure, simple doryphore de
la garde de Bardanios Tourkos, qu’il trahit pendant sa révolte contre
Nicéphore, créé en récompense stratège des Arméniaques, puis disgracié en 811
pour avoir laissé prendre sa caisse militaire par les Arabes, rappelé d’exil
par Michel Rhangabé qui le nomma stratège d’Anatolie, il aurait été responsable
du désastre d’Andrinople en se retirant du champ de bataille au moment où les
Bulgares commençaient à fuir .
Le règne de Léon V (813-820) marque le
début d’une période pendant laquelle l’ordre fut rétabli dans l’Empire, non
sans difficulté, par la répression des dernières révoltes militaires ; et,
au prix de gros sacrifices, comme l’abandon de l’Occident, les dangers qui
menaçaient Constantinople furent écartés.
La première tache de Léon fut de mettre en
état de défense les remparts de Constantinople contre lesquels l’élan des
Bulgares victorieux vint se briser. Kroumn essaya en vain de terrifier la
population en faisant des sacrifices humains sous les murs de la ville ;
il finit par se retirer en ravageant la riche banlieue de Constantinople et en
emmenant un troupeau de captifs . Il préparait une
nouvelle attaque quand il mourut subitement (14 avril 814) et les difficultés que
rencontra son fils, Omortag, pour lui succéder le portèrent à conclure avec
Léon une trêve de trente ans . Constantinople ne
devait plus subir d’attaque bulgare avant 894.
Ce succès donna à l’empereur assez de
prestige pour lui permettre de prohiber de nouveau le culte des images. Dès son
avènement il avait fait couronner son fils en lui donnant le nom significatif
de Constantin et répandait l’opinion
que les malheurs de l’Empire étaient dus au retour à la vénération des
images ,
mais il n’osa heurter l’opinion populaire en brusquant les choses. Ce fut
seulement en octobre 814 qu’après avoir fait réunir les actes du concile iconoclaste
de 754 il mit le patriarche Nicéphore en demeure d’interdire le culte qui scandalisait
le peuple ou de prouver sa légitimité (560). Après des
simulacres de discussions pendant lesquelles des soldats détruisirent le
crucifix qu’Irène avait fait replacer sur la porte de Chalcé , le patriarche fut jeté
dans une barque, emmené à Chrysopolis et remplacé par le laïc Théodote . Un concile tenu à
Sainte-Sophie en avril 815 confirma le synode iconoclaste de 754, réprouva
celui de Nicée et interdit le culte des images, mais avec plus de modération
que le concile de Constantin V .
Ce mouvement iconoclaste fut d’ailleurs moins
violent que celui du viiie siècle et la résistance fut plus efficace parce qu’elle trouva son point
d’appui chez les Studites, qui bravèrent ouvertement la volonté impériale . Théodore le Studite fut
exilé en Bithynie et mis au secret dans une forteresse . Loin de proscrire les
moines, Léon parvint à en gagner quelques-uns à ses idées, mais, de sa prison
(il avait été transporté à Smyrne en 819), Théodore encourageait les
résistances et écrivait au pape et aux trois patriarches d’Orient . Un grand nombre
d’opposants, évêques et moines, — dont le chroniqueur Théophane et Michel,
syncelle de Jérusalem, envoyé à Léon l’Arménien par le patriarche Thomas, —
furent emprisonnés et maltraités .
En faisant couronner son fils basileus,
Léon songeait bien à fonder une dynastie, mais les compagnons d’armes qui
l’avaient aidé à saisir le pouvoir, Michelle Bègue, Thomas le Slavonien,
étaient travaillés d’ambitions secrètes et, dans leur conduite comme dans leur
langage, ne témoignaient aucun égard à l’ancien camarade parvenu au trône. Une
nouvelle révolte militaire était toujours menaçante. Michel, convaincu d’avoir
fomenté un complot pour renverser Léon l’Arménien, fut condamné à mort, mais,
son supplice ayant été différé à cause de la fête de Noël, ses amis envahirent
le grand Palais et assassinèrent le basileus, en train de chanter matines avec
les clercs de sa chapelle .
Michel, encore chargé de chaînes, fut porté
sur le trône et acclamé empereur, puis couronné par le patriarche sans aucune
opposition . Originaire d’Amorium en
Phrygie, il avait fait toute sa carrière dans l’armée. Dénué d’instruction,
rude d’abord, il avait les manières d’un soudard. Sa famille professait les
doctrines d’une secte hérétique qui avait conservé des pratiques juives . Il était prudent,
retors, superstitieux et avait foi dans son étoile . Son règne assez court
(820-829) n’en eut pas moins une extrême importance. Il mit fin à l’ère des révoltes
et fonda une dynastie qui releva la situation de l’Empire. A peine sur le
trône, il fit couronner empereur son fils Théophile, qui épousa le même jour la
jeune fille choisie à la suite d’un concours de beauté et publia un décret
interdisant toute discussion sur le culte des images ; mais, avant que
son pouvoir fût assuré, il eut à surmonter une terrible révolte, qui dura deux
ans et dépassa par son ampleur la portée d’un simple mouvement militaire.
Thomas le Slavonien, dont l’origine et les
aventures sont assez obscures , avait été comme Léon
l’Arménien et Michel le Bègue au service de Bardanios Tourkos . Réfugié chez les Arabes
pour éviter le châtiment que lui avait valu son inconduite, il prétendit
arriver lui aussi au trône en supplantant ses anciens compagnons d’armes . Soutenu par le calife
Al’Mamoun, il leva une armée hétérogène composée d’Arabes, d’Arméniens,
d’Iraniens, d’Ibères, de Slaves établis en Asie Mineure, se déclara le
défenseur du culte des images, se donna même comme étant le malheureux
Constantin VI, fils d’Irène, parvint à gagner à sa cause tous les thèmes
d’Asie, sauf ceux des Arméniaques et de l’Opsikion, et souleva les populations
d’Anatolie accablées d’impôts : il eut pour lui tous les mécontents .
La révolte éclata aussitôt après
l’avènement de Michel. La défection des thèmes maritimes donna à Thomas une
flotte qui parvint à pénétrer dans la Corne d’Or, tandis que lui-même passait
l’Hellespont, soulevait les villes de Thrace et assiégeait Constantinople à
deux reprises (décembre 821, printemps de 822). Mais l’intervention des
Bulgares le força à battre en retraite jusqu’à Arcadiopolis, où il fut assiégé,
livré à Michel par les habitants et exécuté (printemps de 823) . Les plus riches
provinces de l’Empire avaient été ruinées et les Arabes d’Occident avaient
profité de cette guerre civile pour s’installer en Crète et en Sicile et intercepter
les routes de la Méditerranée.
La défaite de Thomas, qui s’était donné
comme le défenseur des images, eût pu provoquer une nouvelle guerre religieuse,
mais dans ces matières la politique de Michel le Bègue fut très circonspecte.
Au début de la révolte, il avait rappelé à Constantinople Théodore le Studite
et les iconodules exilés en Anatolie et, loin de les inquiéter,
il chercha un terrain de conciliation entre les deux doctrines . Mais Théodore le
Studite refusa d’avoir une conférence avec le patriarche Antoine et déclara en
appeler au pape . Michel finit par entrer
dans ses vues, pensant qu’une décision du pape ferait cesser l’opposition des
iconodules. De là ses lettres à Louis le Débonnaire et à Pascal Ier,
dans lesquelles il montrait les abus auxquels donnait lieu le culte des images
et invoquait à la fois l’arbitrage de l’Église franque et celui du pape . Un concile tenu à Paris
en 825 lui donna satisfaction, mais se heurta à l’opposition de Rome ; Michel mourut avant
que la question fût tranchée, premier basileus mort dans son lit depuis Léon IV
(1er octobre 829).
Cette particularité et la facilité avec
laquelle Théophile, déjà couronné, recueillit la succession de son père
montrent le changement qui s’était opéré dans les esprits depuis la défaite de
Thomas. La personne du souverain est redevenue inviolable et l’un des premiers
actes de Théophile, illogique sans, doute, mais qui devait avoir une grande
porté; fut de faire mettre à mort les meurtriers de Léon l’Arménien pour avoir
porté la main sur l’oint du Seigneur, χριστον
Κυρίου . Le châtiment du
régicide fortifiait la doctrine de la légitimité du pouvoir impérial.
Très différent de son père, Théophile avait
reçu une éducation raffinée et avait eu pour maître Jean le Grammairien
(Hylilas), dont il fit un patriarche en 832 et qui lui avait donné
le goût de la théologie et un attachement très grand aux dogmes iconoclastes.
Les chroniqueurs qui écrivaient au temps de la dynastie macédonienne l’ont sans
doute calomnié en le représentant comme un caractère fantasque et en lui
prêtant les outrances d’un maniaque . Il a laissé le souvenir
d’un justicier impitoyable, voulant connaître les affaires par lui-même, permettant
à toutes les victimes d’une injustice de s’adresser directement à lui, lorsque
chaque semaine il se rendait à cheval aux Blachernes, et les punitions
sommaires qu’il infligeait aux délinquants atteignaient les plus haut
placés .
Sa réputation de justicier était encore vivante à l’époque où le roman de
Timarion l’adjoignait aux Juges des Enfers .
Le règne de Théophile fut en réalité très
brillant et peut être regardé comme le début de la renaissance de l’Empire.
Homme de guerre, commandant lui-même ses armées, excellent financier (il laissa
à sa mort une somme de 970 Kentenaria dans son trésor) , et, ce qu’on n’avait
pas vu depuis longtemps, grand bâtisseur, doué de goûts artistiques et
intellectuels, il embellit le Grand Palais de constructions luxueuses qui
constituèrent une nouvelle résidence, digne de rivaliser par la profusion des
marbres précieux, des mosaïques, des chefs-d’œuvre d’orfèvrerie avec le palais
des califes de Bagdad, que son architecte, Patrikios, avait pris pour
modèle .
Autre nouveauté, ce fut Théophile qui releva les écoles publiques et confia
l’enseignement destiné à former des administrateurs et des évêques à Léon le
Mathématicien, regardé comme le plus illustre savant de son époque ; il
l’installa au palais de la Magnaure et sut le disputer au calife qui cherchait
à l’attirer à Bagdad .
Malheureusement le même homme, si libéral
pour tout ce qui concernait les lettres et les arts, se montra d’une grande
étroitesse dans le domaine religieux et, poussé, dit-on, par le patriarche
Jean ,
entreprit de faire revivre le régime iconoclaste que son père avait rendu moins
rigoureux.
Il semble qu’il ait cherché d’abord à
gagner les partisans des images à sa doctrine par les conversations fréquentes
qu’il aimait à avoir avec les moines. Le chef de la résistance, Théodore le
Studite, était mort en 826 et le moment paraissait
favorable. Un concile tenu aux Blachernes en 832 renouvela les décrets iconoclastes , mais, loin de céder,
les iconophiles essayèrent au contraire de démontrer à l’empereur la légitimité
du culte des images, comme l’atteste la lettre, véritable traité apologétique,
adressée par les patriarches d’Orient à Théophile . Cette résistance finit
par l’irriter. Comme autrefois Constantin V, il fit substituer aux peintures
religieuses des églises des tableaux profanes et fit détruire ou brûler un
grand nombre d’icônes, tandis qu’il remplissait les prisons d’évêques, de moines
récalcitrants, de peintres d’icônes . L’impératrice Théodora
elle-même, qui vénérait secrètement les images, ne fut pas à l’abri de cette
persécution , dont les victimes les
plus célèbres furent les deux moines de Jérusalem Théodore et Théophane, venus
à Constantinople sous Léon l’Arménien avec Michel le Syncelle, surnommés les Grapti, parce qu’après une discussion
dans laquelle Théophane convainquit l’empereur de se servir d’un texte adultéré
des Écritures, Théophile eut la barbarie de leur faire graver au fer rouge des
vers injurieux sur le front . En fait la persécution
fut limitée à Constantinople et à ses environs et se montra tout à fait
inefficace. Seule la volonté de l’empereur soutenait l’iconoclasme expirant.
Situation extérieure. — Au point de
vue extérieur, cette période fut marquée par la résistance de l’Empire à un
dernier assaut du califat, résistance facilitée par le maintien de la paix
conclue avec les Bulgares en 825, mais achetée au prix de l’abandon de la
plupart des possessions qui restaient à l’Empire en Occident . La première moitié du ixe siècle fut en effet
désastreuse pour la chrétienté, assaillie par les pirateries des Scandinaves au
nord, des Sarrasins dans la Méditerranée, des Narentans de l’archipel illyrien
dans l’Adriatique. Non seulement la navigation et le commerce maritime furent
interrompus, mais les pirates fondèrent des établissements permanents sur tous
les rivages .
Les troubles incessants du califat ommiade
de Cordoue , l’anarchie qui régna
dans le Maghreb à la suite de la diffusion de l’hérésie des Kharedjites
expliquent l’essor de la piraterie, due à l’expulsion ou à l’émigration
volontaire des mécontents, Arabes d’Espagne ou Berbères confondus sous le nom
de Sarrasins. En quelques années ils parvinrent à se rendre maîtres de la
Méditerranée et les possessions byzantines mal défendues furent victimes de
leurs déprédations.
En 816 des Arabes d’Andalousie, révoltés
contre le calife Al Hakam, ayant été vaincus, s’embarquèrent avec leurs
familles et, en écumant les côtes sur leur passage, parvinrent en Égypte, où, à
la faveur de troubles, ils s’emparèrent d’Alexandrie par surprise, mais ne
purent s’y maintenir. Chassés d’Égypte à la suite d’une expédition envoyée de
Bagdad (827), ils abordèrent en Crète et firent la conquête de l’île sans
rencontrer de résistance . On était au lendemain
de la guerre civile fomentée par Thomas le Slavonien et les tentatives que fit
Michel le Bègue pour reconquérir la Crète échouèrent, faute de forces
suffisantes . Pendant 133 ans
(828-961) cette île allait être un repaire inaccessible de pirates dont les
expéditions périodiques désolèrent les côtes de la Méditerranée orientale .
Dans cette même année 827 les Arabes
d’Afrique commençaient la conquête de la Sicile, où le commandant de la flotte
impériale, Euphemios, se révolta et demanda secours à l’émir Aglabite d’Afrique
devenu indépendant du calife abbasside . Les Arabes saisirent
cette occasion pour attaquer la Sicile, mais échouèrent devant Syracuse qu’ils
assiégèrent longuement (828) . Puis en 830 l’île fut
envahie à la fois par deux armées venues, l’une d’Espagne et l’autre d’Afrique.
L’événement important de cette campagne fut la prise de Palerme par les Africains
(septembre 831). Les Arabes eurent ainsi en Sicile un établissement permanent
qui fut le noyau de leur colonisation . Théophile ne réagit
qu’en 835, mais la flotte qu’il envoya contre Syracuse fut détruite et les Arabes commencèrent
la conquête de l’intérieur. En 841 ils possédaient presque entièrement la
partie occidentale de l’île .
La Sicile était déjà devenue comme la Crète
un centre important de corsaires, qui commencèrent à ravager les côtes d’Italie
en s’alliant parfois avec les princes lombards en discorde et en prenant pied
définitivement sur les rives de la mer Ionienne et de l’Adriatique, en 838 à
Brindisi, en 839-840 à Tarente, en 841 à Bari . La même année ils
allaient couler des navires vénitiens au fond de l’Adriatique en représailles
des secours prêtés par Venise à Théophile pour essayer de
reprendre Tarente, débarquaient à l’embouchure du Pô, incendiaient une ville
dalmate et pillaient Ancône .
A la même époque la domination byzantine
disparut en Dalmatie et en Illyrie . Par le traité
d’Aix-la-Chapelle (812) ces régions avaient été partagées entre l’Empire franc
et Byzance, qui avait reçu pour sa part Venise, les cités et les îles de la
côte dalmate . Les Francs ne purent
conserver la Croatie qui se révolta (810-823) et passa sous l’influence bulgare.
Byzance, privée de ses forces navales, fut tout aussi impuissante à régir les
tribus slaves de l’Adriatique constituées en États indépendants, comme la
république de corsaires des Narentans qui occupèrent l’archipel dalmate . La conversion des Croates
au christianisme par des missionnaires francs envoyés par le patriarche
d’Aquilée (805-811) fut aussi un grave échec
pour le prestige byzantin. Enfin c’est le moment où la Vénétie, regardée
jusque-là comme partie intégrante de l’Empire d’Orient, commence à affirmer son
indépendance. Non seulement Venise soutient avec ses seules forces la guerre
contre les pirates slaves et sarrasins de l’Adriatique, mais en 840 elle signe
un traité d’alliance avec l’empereur franc Lothaire Ier qui lui
garantit toutes ses possessions . C’était là un premier
relâchement dans les liens qui rattachaient la République de Saint-Marc à
Byzance, dont toutes les possessions occidentales s’étaient détachées
successivement en moins d’un demi-siècle.
Dans l’impossibilité où il se trouvait de
disposer de forces suffisantes pour mettre un terme à l’expansion de plus en
plus audacieuse de la piraterie, Théophile eut recours au moyen, classique dans
les traditions byzantines, de la diplomatie. Par deux fois il envoya des
ambassadeurs aux empereurs francs, en 839 à Louis le Débonnaire à
Ingelheim , en 842 à Lothaire qui
reçut ses envoyés à Trêves , pour leur demander de
chasser les Arabes de Sicile et d’Italie; il reçut de bonnes paroles, mais,
s’il avait été mieux renseigné sur la situation intérieure de l’Empire
carolingien, il se fût sans doute abstenu de ces démarches. L’ambassade envoyée
à Cordoue (839-840), au moment le plus critique de la guerre avec le califat de
Bagdad, eut un caractère encore plus chimérique. Théophile engageait
Abd-er-Rahman II à revendiquer les pays d’Orient dont les Abbassides avaient
dépouillé ses ancêtres et à chasser de Crète les Sarrasins d’Espagne. Le calife
répondit par un refus catégorique. Cet échange fastueux d’ambassades eut des
résultats intéressants, mais dans le seul domaine intellectuel .
Cependant, trop affaibli pour défendre ses
possessions d’Occident, l’Empire a pu faire face au dernier grand effort
militaire que le califat abbasside ait dirigé contre Constantinople. Le calife
Al-Mamoun, qui avait soutenu la révolte de Thomas, entendait bien profiter des
embarras de l’Empire pour entreprendre une offensive décisive ; aussi refusat-il
toute proposition de paix, aussi bien celle que lui fit Michel II en 825 , que les avances de
Théophile, qui, sous prétexte de lui notifier son avènement, envoya à Bagdad
une brillante ambassade dirigée par son précepteur Jean le Grammairien .
Loin de répondre à ces intentions
pacifiques, Al-Mamoun organisa des incursions périodiques dans les thèmes
d’Asie Mineure, mal remis encore de la situation troublée qu’avait laissée la
révolte de Thomas ; il dirigea
lui-même les plus importantes, auxquelles répondaient les contre-attaques de
Théophile, qui, après avoir traversé le Taurus en 831, ramena du territoire de
Tarse du butin et des prisonniers, et célébra un éclatant triomphe à son
retour .
La guerre ne fut qu’une série de coups de main, jusqu’à la mort d’Al-Mamoun en
833 .
Il y eut ensuite une période de paix (833-837), pendant laquelle Théophile donna
asile aux réfugiés perses de la secte communiste des Khourranites, dont la
révolte avait été écrasée par le nouveau calife Moutassim, et en forma une
légion perse, sous les ordres d’un certain Théophobe, regardé comme le
descendant des anciens rois .
La guerre recommença en 837 sur un théâtre
plus vaste. Théophile pénétra en Haute Mésopotamie, qui n’avait pas vu d’armée
impériale depuis longtemps, et s’empara des forteresses de Zapetra et Mélitène,
mais n’exploita pas son succès et revint célébrer un nouveau triomphe à
Constantinople . En revanche en 838
Moutassim mit sur pied deux armées dont l’une envahit au nord le thème des Arméniaques,
tandis que la seconde, commandée par lui-même, partait de Tarse et marchait sur
Amorium, d’où la dynastie était originaire. En essayant de s’opposer à
l’invasion du thème arméniaque, Théophile subit une grosse défaite au-delà de
l’Halys et battit en retraite vers Constantinople. Après avoir fait leur
jonction à Ancyre, les deux armées arabes allèrent assiéger Amorium qui fut
prise par trahison au bout de 12 jours (12 août 838) . Le calife vainqueur
repoussa les demandes de paix de Théophile et il songeait même à marcher sur
Constantinople quand il fut rappelé en Syrie par une révolte . De fait, peu après la
mort de Théophile, une flotte arabe cinglait vers la Ville impériale,
lorsqu’elle fut détruite par une tempête au cap Chélidonia du thème des
Cibyrrhéotes .
Ces guerres continuelles ne produisirent au
point de vue territorial que des résultats insignifiants et n’aboutirent qu’à
affaiblir les belligérants, mais en dépit de victoires plus retentissantes que
fructueuses, les véritables vaincus de la lutte étaient les Arabes qui avaient
refusé les propositions d’accord réitérées de Théophile et n’avaient pu entamer
le territoire impérial .
5. Le raffermissement de l’Empire (842-886)
L’œuvre de restauration due à Théophile se
poursuivit sous ses deux premiers successeurs, l’un, dernier représentant de la
famille amorienne, Michel III, l’autre, Basile, fondateur de la dynastie macédonienne.
En dépit d’une agitation intérieure et d’événements tragiques qui eurent
surtout pour théâtre Constantinople et le palais impérial, la période
correspondant à ces deux règnes doit son unité au raffermissement de la
puissance impériale, qui lui permit de reprendre quelques-unes des positions
perdues et de préparer l’avenir en redevenant la principale puissance militaire
de la chrétienté, le centre le plus brillant de la civilisation chrétienne.
A sa mort, le 20 janvier 842 , Théophile laissait cinq
filles, dont une mariée à Alexis Mousel , et un fils, Michel, âgé
de six ans , qu’il désigna pour son
successeur en confiant sa garde à l’impératrice Théodora, chargée du
gouvernement de l’Empire avec l’assistance d’un conseil, dont le membre le plus
influent était le logothète du drome Théoctistos .
Le premier acte du nouveau gouvernement
devait être logiquement le rétablissement de l’Orthodoxie, Théodora et ses
conseillers étant profondément attachés au culte des icônes ; mais ce fut
seulement au bout d’un an que l’impératrice, soucieuse de ménager la mémoire de
Théophile et d’obtenir son absolution des évêques orthodoxes, convoqua un
concile à cet effet . Le patriarche Jean
refusa d’y assister, fut déposé et remplacé par le moine Méthodius, dont
Théophile, qui goûtait fort sa conversation, avait toléré l’iconophilie (4 mars
843) .
Après l’absolution formelle de Théophile et la tenue du concile qui remit en
vigueur les canons de Nicée , le premier dimanche du
Carême (11 mars 843), la restauration de l’Orthodoxie fut solennellement
proclamée à Sainte-Sophie par la lecture de l’édit synodal (synodikon) qui
condamnait non seulement les iconoclastes mais tous les hérétiques qui les
avaient précédés ; puis un banquet,
auquel prirent part ceux qui avaient souffert pour la cause des images, fut
célébré au palais impérial . L’année suivante il fut
décidé qu’on relirait le synodikon tous les ans, à l’anniversaire de la
restitution de l’Orthodoxie .
Le pouvoir de Théodora et de Théoktistos
dura 14 ans (842-856). Celui-ci, qui devait sa prépondérance au rôle important
qu’il avait joué lors de l’avènement de Michel II , fut bientôt en butte à
l’hostilité des parents de l’impératrice qui étaient entrés au Conseil de
régence et en particulier de son frère, l’ambitieux Bardas . Le jeune empereur, dont
les instincts pervers inquiétaient sa mère et qui avait été marié en 855, à la
suite d’un concours de beauté, à une femme insignifiante , entra dans les vues de
Bardas et fut à la tête du complot qui renversa Théoktistos, arrêté
traîtreusement au palais et tué dans sa prison (début de 856) . Théodora abandonna
volontairement le pouvoir et, au bout de deux ans, fut reléguée dans un
monastère avec ses filles .
Libre ainsi de toute contrainte, Michel III
s’adonna tout entier à ses plaisirs et à ses turpitudes : il se peut que
les chroniqueurs de la dynastie macédonienne aient pris plaisir à noircir sa
figure, afin de justifier le meurtre qui donna le pouvoir à Basile , mais les hontes de la
conduite de Michel et ses gaspillages insensés du trésor public n’en furent pas
moins réels : ce qui est
certain, c’est que, s’il prit part à des expéditions, il abandonna complètement
le gouvernement de l’Empire à Bardas qui, après s’être élevé graduellement dans
la hiérarchie, fut créé César le 26 avril 862, ce qui faisait de lui l’héritier
de son neveu .
Maître du pouvoir, Bardas se consacra au
gouvernement de l’Empire . De mœurs assez légères
et dénué de scrupules, il se montra un véritable homme d’État et ses ennemis
eux-mêmes, tel Nicétas David, ont rendu justice à ses qualités . Nous verrons comment il
a relevé le prestige de l’Empire à l’extérieur. Continuateur de la politique de
Théophile, il acheva la restauration des murs maritimes de Constantinople et donna tous ses soins
à l’administration de la justice , mais son œuvre la plus
importante fut la réorganisation de l’Université impériale commencée par
Théophile : en 863 il l’installa au palais de la Magnaure sous la
direction de Léon le Mathématicien, devenu archevêque de Thessalonique, avec
des maîtres de grammaire, de géométrie, d’astronomie . Il était d’ailleurs lié
d’amitié avec l’asecretis Photius, véritable encyclopédie vivante, qui connaissait
à fond l’antiquité classique , mais ce fut justement
cette amitié qui lui suscita la principale difficulté de son gouvernement.
Nouvelle agitation religieuse. — Le rétablissement
des icônes ne procura pas la paix à l’Église. Sans doute l’orthodoxie ne fut
plus remise en question : les iconoclastes se rallièrent ou se
cachèrent , mais des dissentiments
profonds divisaient les orthodoxes ; vers 842 comme en 787 on retrouvait
les deux partis opposés : d’un côté les réformistes, les rigoristes dont
les Studites étaient les champions, de l’autre les modérés, les moines de
l’Olympe, le haut clergé respectueux des droits de l’État. La lutte acharnée de
ces partis troubla l’Église byzantine pendant 70 ans (842-912) et on les
retrouve avec toute leur ardeur dans le conflit entre Méthodius et les
Studites, dans le schisme entre Ignace et Photius, dans l’affaire de la
tétragamie. Il n’existait pas entre eux de divergence dogmatique, mais une manière
différente de concevoir les rapports entre l’Église et l’État .
Ancien moine de l’Olympe , le patriarche Méthodius
avait montré son désir de conciliation en faisant transférer les reliques de
saint Théodore au monastère de Stoudios , mais les moines, déjà
mortifiés d’avoir vu leur candidat écarté du patriarcat , se mirent à critiquer
les promotions à l’épiscopat faites par Méthodius, qui choisissait de
préférence les victimes des persécutions iconoclastes sans avoir égard à leur
instruction et à leur expérience . A ces reproches Méthodius
répondit par une contre-attaque déplorable, il voulut obliger les moines à désavouer
les écrits de Théodore contre Tarasius et Nicéphore . Ceux-ci n’en firent
rien et furent frappés d’anathème , mais dans son testament
il recommanda de les réadmettre à la communion .
Les troubles qui éclatèrent pendant le
patriarcat d’Ignace eurent des conséquences autrement graves. Second fils de
Michel Rhangabé, tonsuré à l’âge de 14 ans (813), il avait passé sa vie dans un
monastère sans recevoir l’instruction profane, dont il avait horreur. Par la
ridigité de ses principes il se rapprochait des Studites, mais il n’avait
jamais manifesté d’opposition à Méthodius, et ce fut peut-être pour cette
raison qu’il fut choisi pour lui succéder en 847 par la volonté de Théodora,
comme pouvant réconcilier les deux partis ecclésiastiques . Mais une fois
patriarche, Ignace accumula les maladresses , condamnant et déposant
des évêques qui avaient désapprouvé son élection, en particulier Grégoire Asvestas,
archevêque de Syracuse, réfugié à Constantinople, qui en appela au pape . Après le meurtre de
Théoktistos et la retraite de Théodora, Ignace, sans la moindre enquête, refusa
la communion à Bardas, accusé par l’opinion de relations incestueuses avec sa
bru, le jour de l’Épiphanie 858 . Quelques mois après il
refusait, d’ailleurs avec courage, de tonsurer Théodora, et Bardas l’exilait
dans l’île de Térébinthe (23 novembre 858) .
Bien décidé à remplacer Ignace au
patriarcat, Bardas finit par obtenir de lui un acte d’abdication volontaire,
mais avec la réserve que son successeur ne serait pas un évêque excommunié,
allusion claire à Grégoire Asvestas . Or, si celui-ci ne fut
pas élu patriarche, ce fut du moins l’un de ses amis, le protoasecretis Photius
(25 décembre 858), simple laïc, qui s’engagea vis-à-vis du synode à respecter
Ignace comme un père, mais se fit sacrer par Grégoire Asvestas . Ce fut le signal du
schisme qui devait désoler si longtemps l’Église grecque. D’un côté, les évêques
du parti d’Ignace, réunis à Sainte-Irène, déclarèrent nulle l’élection de Photius ; de l’autre, dans
un synode de 170 évêques, tenu par Photius aux Saints-Apôtres (mars 859), la
déposition d’Ignace fut prononcée et suivie de celle de deux
évêques ignatiens .
Il restait à Photius à faire reconnaître
ses pouvoirs par l’Église universelle. Il envoya donc sa synodique aux
patriarches d’Orient et elle fut portée à
Rome par une ambassade chargée de remettre au pape Nicolas Ier des
lettres de l’empereur et du patriarche . Contrairement à ce
qu’on attendait à Constantinople, le pape blâma la déposition d’Ignace faite
sans sa participation, se réserva le jugement en dernier ressort, protesta
contre la nomination d’un laïc à l’épiscopat et envoya des légats, chargés en
outre de réclamer la restitution au Saint-Siège de la juridiction sur
l’Illyricum .
Ces instructions, apportées à
Constantinople par les évêques d’Anagni et de Porto, consternèrent et
irritèrent Photius et ses partisans, mais, soit par intimidation, soit par
d’autres moyens, on décida ces légats à accepter toutes les conclusions du
second concile qui se tint aux Saints-Apôtres en avril 861 : comparution
d’Ignace forcé de reconnaître qu’il est devenu patriarche sans élection, ἀψηφίστως,
sa déposition, sa dégradation injurieuse et, pour calmer le pape, la défense
d’élever à l’avenir des laïcs à l’épiscopat .
L’affaire, qui n’était jusque-là qu’une
crise intérieure de l’Église grecque, prit alors l’allure d’un conflit entre
Rome et Constantinople. Non seulement Nicolas Ier désavoua
entièrement à leur retour les deux légats coupables de n’avoir pas tenu compte
de leurs instructions , mais il accueillit un
appel rédigé au nom d’Ignace et tint au Latran un
concile qui déposa Photius et rétablit Ignace et les évêques déposés dans leurs
fonctions (avril 863) .
C’était le signal de la guerre, qui eut
d’abord l’aspect d’un échange de lettres acrimonieuses entre Michel III,
Nicolas Ier et Photius , avec des tentatives de
rapprochement, toujours repoussées , et qui se compliqua
d’une lutte d’influence entre les deux sièges chez les Bulgares nouvellement
convertis au christianisme par des missionnaires byzantins ; mais Boris, qui
avait reçu le baptême en 864 et dont Michel III avait été le parrain, entendait
avoir un archevêque muni des pouvoirs nécessaires pour le couronner . Ayant essuyé un refus
de la part de Photius , il s’adressa au pape
qui, sans lui donner satisfaction sur ce point, lui envoya deux évêques,
chargés d’organiser l’Église bulgare, ainsi qu’un mémoire sur la discipline
ecclésiastique en réponse à ses questions (866-867), ce qui
entraîna l’expulsion de tous les prêtres byzantins.
Mais Photius était décidé à la rupture et,
par des négociations avec l’empereur Louis II, entreprenait de faire déposer
Nicolas Ier et, dans un concile
présidé par Michel III, il l’excommunia, puis dans une Encyclique adressée aux
patriarches d’Orient, il accusa avec amertume les prêtres latins « d’avoir
déchiré cette vigne tendre » qu’était la jeune Église bulgare en lui
communiquant leurs usages, réprouvés par les orthodoxes, comme le jeûne du
samedi, le célibat des prêtres et surtout leur dogme impie de la double
procession de l’Esprit-Saint. Il demandait aux patriarches d’envoyer des
représentants pour réprimer ces écarts .
Le schisme était désormais complet, mais au
moment où des courriers envoyés dans toutes les directions allaient répandre
partout le texte de l’Encyclique, un coup de théâtre se produisit : le 24
septembre 867 Michel III était assassiné, Basile lui succédait sur le trône et
commençait son règne en exilant Photius et en rétablissant Ignace au
patriarcat .
Basile le Macédonien. — L’histoire de
l’ascension et de l’avènement de Basile ressemble à un véritable roman
d’aventures, même lorsqu’elle est dépouillée des traits légendaires, des
prédictions, des prétentions généalogiques insérées dans sa biographie
officielle . Né vers 827 de pauvres artisans des
environs d’Andrinople, peut-être d’origine arménienne , il est successivement
au service d’un stratège de Macédoine, puis d’un cousin de Michel III,
Théophilytzès, qui en fit son écuyer et l’emmena dans le Péloponnèse où, étant
tombé malade, il fut recueilli par une riche veuve, Danielis, qui
l’enrichit . Doué d’une force herculéenne,
il attire l’attention sur lui en terrassant un géant bulgare dans un festin
donné par le fils de Bardas et en domptant un cheval
rétif appartenant à Michel III, qui l’enlève à Théophylitzès, lui donne une
charge d’écuyer, se lie d’amitié avec lui et l’élève au rang de
protostrator . Sa faveur croît de jour
en jour et en 865 Michel lui confie un des postes les plus importants du
palais, celui de parakimomène , contre le gré de Bardas
qui voit dans cette promotion une menace pour l’avenir. Une guerre implacable
commence alors entre eux et se termine le 21 avril 866 par le meurtre de Bardas
au cours d’une expédition et à la suite d’un complot favorisé par
l’empereur .
Avec Bardas s’écroulait un régime qui
n’avait pas été sans gloire : l’autorité était entre les mains d’un fou et
d’un aventurier qui n’avait pas eu honte de répudier sa femme légitime, pour
épouser une maîtresse de l’empereur, Eudokia Ingerina, dont il dut reconnaître
deux fils comme les siens . En récompense Michel adopta
Basile comme son héritier et le fit couronner empereur le 26 mai 866 Cette élévation causa
des jalousies et Basile dut réprimer un complot dirigé par le gendre de Bardas,
Symbatios, qui avait participé à l’assassinat de son beau-père et réclamait le
prix de sa trahison . Puis il arriva que
Michel III, qui ne jurait que par son favori, se mit à le détester et essaya de
le faire périr. Basile sentit le danger et le prévint en faisant lui-même tuer
l’empereur à la suite d’une scène d’ivresse au palais de Saint-Mamas, le 23
septembre 867 .
Par ce meurtre, le fils de paysans
macédoniens, qui avait passé la plus grande partie de sa carrière dans les
écuries, se trouva seul maître du pouvoir suprême, sans qu’aucun vengeur de
Michel III ait essayé de lui disputer la couronne et, ce qui semble encore
plus étonnant, fut de prime abord à la hauteur de la tâche écrasante qui allait
lui incomber. Il s’agissait pour lui de reconstituer les ressources de l’État
follement gaspillées par son prédécesseur , de rétablir l’ordre à
l’intérieur, d’assurer la défense de l’Empire et de donner à son autorité un
prestige suffisant qui lui permît de transmettre son pouvoir à son fils et de
fonder une dynastie.
Pendant les 19 ans qu’il exerça le pouvoir
(867-886), Basile s’acquitta à merveille de ces diverses tâches et fut l’un des
meilleurs hommes d’État qui aient gouverné Byzance. L’étude des institutions
montrera la place importante qu’il a tenue comme organisateur et réformateur
dans les domaines financier, judiciaire, législatif. Préoccupé d’abolir la
législation des empereurs iconoclastes, il travailla à la révision des
anciennes lois en les adaptant aux nécessités de son temps et jeta ainsi les
bases de la réforme législative qui fut achevée par son fils. Bon soldat, il
commanda lui-même ses armées, à l’exemple de ses prédécesseurs, et l’on verra
avec quel succès il a sauvegardé les frontières de l’Empire et préparé la
reprise des territoires perdus. Les principales difficultés qu’il rencontra
furent celles que lui suscitèrent ses affaires de famille et la question
religieuse soulevée sous son prédécesseur.
A son avènement, Basile avait deux fils
dont l’aîné, Constantin, auquel allaient toutes ses préférences, qu’il associa
à l’Empire en 870, qu’il emmenait dans ses expéditions, était vraisemblablement
né de sa première femme . Lorsqu’il mourut en
879, Basile fut inconsolable. Le cadet au contraire, Léon, était le fils
d’Eudokia Ingerina et de Michel III, comme l’affirment toutes les chroniques à
l’exception de la Vie de Basile . Celui-ci, obligé de le
reconnaître comme son fils, semble avoir cherché à le priver de sa succession
en associant à la couronne son troisième fils, Alexandre, né après son
avènement . Pour sauver les apparences,
il conféra le même honneur à Léon, mais ne lui témoigna jamais la moindre
tendresse et le maria sans le consulter et contre son gré à une jeune fille de
la noblesse sénatoriale, Théophano . Il se forma d’ailleurs
à la cour une faction qui essaya d’écarter Léon du trône et que Photius passait
pour inspirer. Une sorte de nécromant qui jouissait de la faveur de
Basile ,
Théodore Santabaren, accusa Léon de vouloir tuer l’empereur, qui, sans la
moindre enquête, l’emprisonna avec sa femme et voulut lui faire crever les
yeux : il en fut empêché par Photius et son confident Stylianos, qui
obtinrent sa libération , mais après la mort de
Basile, le premier acte de Léon VI fut de retirer le corps de Michel III de
Chrysopolis et de le faire ensevelir aux Saints-Apôtres , aveu éclatant du drame
secret.
Dans l’héritage que Basile avait reçu de
son prédécesseur se trouvait le double schisme qui scindait l’Église byzantine
en deux partis irréconciliables et, d’autre part, la séparait de Rome. Basile,
nous l’avons vu, régla la question en exilant Photius et en rétablissant Ignace
au patriarcat . Celui-ci, s’empressa
d’interdire la célébration du culte à Photius, à tous les clercs qu’il avait
ordonnés ou qui avaient communié avec lui, ce qui était le plus sûr moyen de
prolonger les divisions de l’Église byzantine . Basile cherchait au
contraire la conciliation, mais ne voyait que l’autorité de Rome et d’un
concile comme capables de l’imposer. Dès le 11 décembre 867 il envoya une
ambassade au pape, en lui demandant son arbitrage, tandis qu’Ignace adjoignait
deux évêques à l’ambassade pour défendre sa cause . Nicolas Ier était mort le 13 novembre 867 ; Hadrien II, qui lui succéda, s’engagea à
suivre sa ligne de conduite , réunit un synode qui
condamna Photius sans l’avoir entendu et envoya trois légats à Constantinople .
Dès l’ouverture du concile œcuménique, le
27 septembre 869, il se produisit un véritable malentendu entre l’empereur et
le Saint-Siège. Les légats avaient pour instructions de faire entériner les
décrets du concile romain et de n’admettre à la réconciliation que les évêques
ordonnés avant 858, qui se rétracteraient en signant un libellus satisfactionis . Basile au contraire,
choqué que le pape eût condamné Photius sans l’entendre, voulait recommencer
toute la procédure contre lui, afin d’obtenir un jugement régulier qui mît fin
à toute polémique. Les deux opinions s’affrontèrent dès les premières sessions,
où le point de vue impérial fut défendu par le Patrice Baanès . Basile finit pas
obtenir la comparution de Photius devant le concile, mais il ne répondit à
aucune question et les légats protestèrent que, son cas étant jugé, il n’avait
qu’à se soumettre ; comme il n’en fit rien, l’anathème fut prononcé contre
lui dans la huitième session (5 octobre 869) . Quand le concile se
sépara le 26 février 870 en proclamant l’union des deux Églises, il n’y en
avait pas moins entre l’empereur et les trois légats un désaccord irréductible :
Basile ne prit même aucune mesure pour faciliter leur voyage de retour qui dura
neuf mois .
Particulièrement grave était le nouveau
conflit entre les deux Églises au sujet de la Bulgarie. Mécontent de n’avoir pu
obtenir des papes Nicolas et Hadrien II l’archevêque dont la création lui avait
été promise, Boris avait envoyé une ambassade au concile pour obtenir satisfaction
et savoir de quelle juridiction relèverait l’Église bulgare. Dans une réunion
extra-conciliaire la lutte fut chaude entre Ignace et les légats, mais les
délégués des patriarches orientaux pris comme arbitres se prononcèrent pour la
juridiction de Constantinople . Après le départ des
légats, Ignace sacra un archevêque et dix évêques qui allèrent prendre possession
de l’Église bulgare , Jean VIII, successeur
d’Hadrien II (décembre 872), essaya en vain de décider Boris à se rallier à la
juridiction romaine , il somma inutilement
Ignace de venir à Rome , Enfin en 878 il envoya
deux légats à Constantinople avec mission de réduire Ignace à l’obéissance en
le menaçant de déposition, mais ils apprirent à leur arrivée qu’Ignace était
mort (23 octobre 877) et que Photius occupait de nouveau le trône
patriarcal .
D’après la Vie d’Ignace, Photius aurait
regagné les bonnes grâces de Basile en lui forgeant une généalogie qui le
faisait descendre des rois d’Arménie . Que cette histoire soit
authentique ou non, il est plus vraisemblable qu’en rappelant Photius, Basile
espérait mettre un terme aux dissensions de l’Église byzantine. Ce qui le
prouverait, c’est qu’une fois rétabli, Photius s’abstint d’exercer des
représailles contre ses ennemis de la veille et qu’il écrivit à Jean
VIII une lettre conciliante après l’arrivée des deux légats envoyés à
Ignace .
Jean VIII, qui à ce moment avait besoin du secours de la flotte impériale
contre les Sarrasins, accueillit les ouvertures de Photius en mettant à sa réconciliation
certaines conditions . Dans l’hiver de
879-880, devant le diacre Pierre, porteur de la lettre pontificale, et les deux
autres légats, un concile de 383 évêques, regardé par les Grecs comme œcuménique,
réhabilita solennellement Photius .
On avait admis jusqu’à ces derniers temps
que, Photius n’ayant pas rempli les conditions exigées par Jean VIII, celui-ci
l’avait de nouveau excommunié ainsi que ses légats et qu’il s’en était suivi un
second schisme . Grâce aux travaux de F.
Dvornik et du R. P. Grumel , on sait aujourd’hui que
ces affirmations reposent sur de faux documents, forgés par des clercs du parti
d’Ignace sous le pape Formose (891-896) , démentis par tout ce
qu’on sait des rapports entre Jean VIII et Photius, qui ne cessèrent d’être
cordiaux . On ne voit pas davantage
que les successeurs de Jean VIII aient rompu avec Photius avant sa deuxième
déposition par Léon VI , mais les Ignatiens
n’avaient pas désarmé et Basile mourut sans avoir pu rétablir la paix à
l’intérieur de l’Église byzantine.
Affaires extérieures. — Au point de
vue extérieur, Byzance a continué à organiser la défensive sur ses frontières,
mais elle a commencé à recouvrer quelques-unes des positions qu’elle avait
perdues et à étendre son influence en Europe, grâce aux missions chrétiennes de
l’Église grecque et à la conversion au christianisme des peuples slaves :
tels sont les résultats importants de cette période.
Sauf une expédition du stratège du
Péloponnèse, Théoktistos Bryenne, qui alla réprimer vers 847-848 une révolte
des tribus slaves d’Achaïe et d’Élide , et une menace du jeune
Khan bulgare Boris, encore païen, que la diplomatie de Théodora sut
apaiser ,
les principaux fronts de guerre se trouvaient dans la Méditerranée, où sévissaient
les Sarrasins de Crète, d’Afrique et d’Espagne, et sur les frontières d’Asie
Mineure, menacées par les Pauliciens et les Arabes, où la défense avait été
fortement organisée sous Théophile .
Devant l’impuissance du gouvernement
impérial, les Sarrasins continuèrent la conquête de la Sicile, s’emparèrent de
Messine (fin 842) et prirent pied en
Italie, où ils allèrent piller la basilique Saint-Pierre de Rome (846) , Pour prévenir un nouvel
assaut, le pape Léon IV fit entourer la rive droite du Tibre de fortifications et la défense de
l’Italie fut dirigée, médiocrement d’ailleurs, par Louis II, fils de Lothaire,
couronné empereur à Rome en 850 : les Sarrasins occupaient
l’Apulie, où un émir indépendant avait fait de Bari une forteresse inexpugnable,
d’où il allait piller la Campanie , En Sicile les Sarrasins
soumettaient l’intérieur de l’île et capturaient la puissante forteresse
centrale de Castrogiovanni , et les flottes que le
gouvernement byzantin envoyait de temps à autre étaient presque régulièrement
détruites .
Sur le front d’Orient les frontières de
l’Empire étaient menacées par un nouvel ennemi, les Pauliciens, secte
manichéenne répandue au viiie siècle dans toute
l’Asie Mineure , puis, à cause des
persécutions dont elle fut l’objet depuis le règne de Michel Ier jusqu’à celui de Théophile, réfugiée en territoire arabe, où l’émir de Mélitène
la prit sous sa protection . Sous leur chef,
Karbeas, les Pauliciens devinrent un petit État et fondèrent des villes, dont
la principale, Tephrik, était située sur la frontière du thème de
Koloneia . Alliés aux Arabes, ils
les aidaient dans leurs incursions en territoire impérial, et se trouvaient probablement
dans les troupes de l’émir de Mélitène, qui attaqua l’Empire en 844 et infligea
une défaite sanglante au ministre de Théodora, Théoktistos .
Jusqu’en 859 les hostilités entre l’Empire
et le califat consistèrent en expéditions de la flotte byzantine contre
Damiette, qui fut pillée et incendiée en 853-854 (756), afin de couper
l’Égypte de la Crête, dont elle était l’arsenal, et en incursions périodiques
des Arabes en Asie Mineure suivies de représailles
byzantines et entrecoupées de
courtes trêves pendant lesquelles les deux partis procédaient à l’échange de
leurs prisonniers de guerre dans la région de Tarse . En 859 au contraire
Michel III et Bardas prirent l’offensive et dirigèrent une expédition contre
Samosate, qui fut victorieuse d’après les historiens arabes, alors que les
sources grecques de l’époque macédonienne transforment leur succès en
échec : les inscriptions de la citadelle d’Ancyre au nom de Michel III et
datées de cette même année, montrent que les fortifications de cette ville
avaient été renforcées, en vue d’assurer une base solide à l’expédition . Après la signature
d’une trêve et un échange de prisonniers, Michel III repartit pour l’Asie
Mineure au printemps de 860, mais il fut soudain rappelé à Constantinople,
qu’une flotte russe de 200 navires était sur le point d’attaquer .
Les Russes, dont il est question pour la
première fois dans les chroniques byzantines sous Théophile, avaient fondé leur
plus ancien État à Novgorod et cherchaient à se rapprocher de la mer Noire où
les attiraient en même temps des buts commerciaux et l’amour du pillage .
Deux compagnons de Rural, Askold et Dir,
s’étaient emparés de Kiev vers 842. Ce fut de là qu’ils partirent en 860 et,
descendant le Dniéper sur leurs monoxyles, ils pénétrèrent dans le Bosphore en
pillant les maisons de plaisance et les monastères et le 18 juin donnèrent
l’assaut à Constantinople, pendant que l’empereur, revenu en toute hâte, et le
patriarche Photius déployaient sur les remparts le maphorion de la Vierge
conservé à l’Église des Blachernes . Ayant échoué dans leur
tentative, les Russes battirent en retraite et Photius prononça un sermon
d’actions de grâces . Quelques années plus
tard, les Russes, instruits par l’exemple des Bulgares, demandaient à se
convertir au christianisme et Photius leur envoyait un évêque .
Ce fut en effet à ce moment que Boris, qui
songeait aussi à se convertir, fit alliance avec Louis le Germanique, tout prêt
à envoyer en Bulgarie des missionnaires latins. Ce danger ayant été dénoncé à
Constantinople par le prince de Moravie Rastislav, Michel III envahit la
Bulgarie et cette démonstration suffit à obtenir la soumission de Boris, qui
renonça à son alliance et accepta l’envoi en Bulgarie de missionnaires
byzantins (863) .
Peu après, Omar, émir de Mélitène, ayant
envahi le thème des Arméniaques et pris le port d’Amisos (Samsoun), une armée
commandée par Petronas, frère de Bardas, infligea une grande défaite aux Arabes
à Poson, sur la frontière des thèmes de Paphlagonie et des Arméniaques (3
septembre 863). L’émir fut tué dans cette bataille décisive dont le souvenir
s’est conservé dans la légende populaire et dans l’épopée .
Au printemps de 866 une armée commandée par
Bardas et Michel III était dirigée contre les Sarrasins de Crète, dont les
déprédations venaient de désoler l’Archipel, mais la flotte fit escale à
l’embouchure du Méandre et ce fut là que Bardas fut assassiné au moment où il
allait relever l’Empire : l’expédition revint à Constantinople .
Basile, devenu le seul maître du trône, sut
au moins développer les avantages acquis sous son prédécesseur et ce fut
pendant son règne que l’Empire commença à reprendre l’offensive contre ses
adversaires.
Malheureusement Basile ne disposait pas de
forces suffisantes pour soutenir la lutte à la fois contre le califat, contre
les Arabes de Crète, contre ceux du bassin occidental de la Méditerranée. Or
c’était à l’époque de son avènement que l’offensive sarrasine contre l’Italie
atteignait son point culminant, se portait même dans l’Adriatique et menaçait
les villes de la côte dalmate. Incapable d’intervenir efficacement, Basile ne
laissa pourtant pas périmer les droits de Byzance.
Ce fut ainsi que vers 868 il accueillit la
demande de secours des habitants de Raguse assiégés par les Sarrasins depuis 15
mois et leur envoya une flotte qui força l’ennemi à lever le siège , qu’il affirma la
subordination de Venise à l’Empire en conférant au doge Ursus Partecipatus le
titre aulique de protospathaire et que, ne pouvant se
charger de la défense de l’Italie, il fit alliance avec Louis II et lui envoya
une flotte qui l’aida à reprendre Bari en 871 . Mais cet accord entre les
deux moitiés de la chrétienté ne devait être qu’éphémère : les deux alliés
se firent réciproquement des reproches et des blessures d’amour-propre. Basile
dénia à Louis le droit de porter le titre impérial et celui-ci se plaignit du
peu de secours que lui avait apporté la flotte byzantine . L’alliance fut rompue
et les efforts de Louis II pour délivrer l’Italie furent contrariés par le duc
lombard de Bénévent, qui tint quelque temps le roi prisonnier et répudia sa
suzeraineté pour se placer sous celle de Byzance (873) . Louis II, obligé de
battre en retraite, mourut à Brescia en 875 . L’année suivante les
habitants de Bari, menacés d’un nouveau siège par les Sarrasins, firent appel
au gouverneur byzantin d’Otrante, qui prit possession de la ville le jour de
Noël au nom du basileus et y fixa sa résidence .
C’était là un événement d’une portée
considérable : Byzance reprenait pied en Italie et apparaissait comme la
puissance protectrice. Le pape Jean VIII, qui avait organisé la défense de
l’État de Saint-Pierre, désespérant de recevoir des secours efficaces de
Charles le Chauve, successeur de Louis II à l’Empire, conclut une alliance politique
ave Basile .
Mais ces succès étaient amoindris par la
perte des quelques positions que l’Empire possédait encore en Sicile. Vers
869-870 les Sarrasins d’Afrique s’étaient emparés de l’île d Malte , et la perte la plus
cruelle fut celle de Syracuse prise d’assaut après 10 mois de siège le 21 mai
878 par une action combinée des Arabes de Sicile et d’Afrique , L’Empire ne possédait
plus en Sicile que Taormina et quelques places secondaires.
Du moins, pendant les huit dernières années
de son règne, Basile parvint à consolider et à élargir considérablement la
domination byzantine dans l’Italie méridionale. Après la prise de Syracuse, une
flotte de 140 navires, sous le commandement du Syrien Nasr, chassa les
Sarrasins d’Afrique des îles Ioniennes, vint attaquer la côte nord de la Sicile
où elle s’empara de Termini et Cefalù, détruisit une flotte sarrasine à la
hauteur des îles Lipari et revint à Constantinople avec un immense butin
(879-880) . Dans la campagne
suivante (880) pour la première fois une forte armée byzantine, composée des
thèmes d’Europe, débarqua en Italie et combina ses opérations avec celles de la
flotte de Naples pour s’emparer de Tarente . Mais l’action décisive
fut celle d’un des hommes de guerre les plus éminents de cette époque,
Nicéphore Phocas, chargé de réparer l’échec subi en 883 en Calabre par le
stratège Étienne Maxentios . A la tête de troupes
que Basile avait pu tirer des thèmes d’Orient, Nicéphore Phocas s’empara de
toutes les places de Calabre occupées par les Sarrasins et, grâce à une
diplomatie savante et aux ménagements avec lesquels il traita la population
indigène, il obtint la soumission des gastalds ou gouverneurs lombards, et sa popularité fut telle que plus tard une église
fut érigée en son honneur : il parvint à relier les villes de Calabre aux
possessions byzantines d’Apulie et fit œuvre de colonisateur autant que de
stratège . Le résultat de cette
politique fut l’extension de l’influence byzantine sur les dynastes de l’Italie
méridionale et centrale dont plusieurs, comme le prince de Salerne, l’évêque de
Naples, le duc de Bénévent, devinrent les vassaux de l’Empire .
De même qu’en Italie la disparition des
empereurs carolingiens laissait le champ libre à Byzance, de même en Orient la
politique de Basile bénéficia de la décomposition du califat abbasside, dominé
par la garde turque et impuissant à maintenir son autorité sur les émirs
provinciaux . A la défensive
victorieuse des Amoriens il substitua une offensive méthodique, destinée à
occuper les routes d’invasion qui traversaient le Taurus et l’Antitaurus et à
refouler les Arabes vers l’Orient . En même temps ses
escadres croisaient dans l’Archipel et, sans pouvoir s’engager à fond, tenaient
en respect les Arabes de Crète, qui infestaient les côtes de la Grèce et de
l’Adriatique , en leur infligeant
parfois de sévères leçons, notamment en 872, lorsque Nicétas Oryphas, ayant
fait traîner ses navires à travers l’isthme de Corinthe, tomba subitement au
milieu de la flotte sarrasine en train de piller les villes de la côte et la
détruisit entièrement . Pendant quelques années
Basile parvint même à occuper l’île de Chypre (vers 874-881), et il l’avait
déjà érigée en thème, quand il se heurta à la résistance de la population qui
favorisa le retour des Arabes .
Mais le principal effort de Basile porta
sur le dégagement des frontières terrestres d’Asie Mineure, où s’était réfugié
un ramassis d’aventuriers, Slaves de Cilicie, Arméniens du Taurus et surtout
Pauliciens de Tephrik, ennemis irréconciliables de Byzance et excellents
auxiliaires des Arabes , mais souvent en révolte
contre eux.
Basile essaya d’abord de gagner les Pauliciens
et de s’en faire des alliés, mais son ambassadeur, Pierre le Sicilien, se
heurta aux prétentions exorbitantes de leur chef, Chrysocheir, qui réclamait
toute l’Asie Mineure (869-870) . Alors en deux
campagnes, dont la première échoua (871), Basile, profitant des troubles du califat,
confia une armée à son gendre, Christophore, domestique des scholes, qui
s’empara de Tephrik, détruisit l’État Paulicien et envoya à l’empereur la tête
de Chrysocheir : Basile célébra ce succès par un triomphe solennel (872) .
Les débris de l’armée paulicienne s’étaient
réfugiés à Mélitène, place très forte située dans la boucle de l’Euphrate,
menace perpétuelle pour la frontière byzantine. S’emparer de cette position,
tel fut désormais l’objectif de Basile, mais, avant de l’attaquer de front, il
voulut d’abord l’isoler en occupant les petites places arabes situées le long
de la frontière, de Sébaste à l’Euphrate septentrional, à Tephrik et à
Mélitène , mais il ne put assiéger
Mélitène et, à la suite d’une défaite, revint à Constantinople (873) .
Après une période d’accalmie de trois ans,
pendant laquelle il occupa l’île de Chypre (874-877) , sans s’obstiner à
attaquer Mélitène, Basile continua à occuper les passages montagneux qui
commandaient les routes d’invasion. Un succès important fut la reprise de la
forteresse de Loulouas sur la route de Tarse à Constantinople, avec la
connivence des Slaves qui l’occupaient (877) . Les émirs arabes
essayèrent bien de réagir, mais une fois entrés sur le territoire impérial, il
leur était difficile d’en sortir, comme le montra le désastre subi en 878 par
Abdallah-ibn-Rachid, qui, après avoir ravagé le sud de la Cappadoce, fut
surpris près des Portes Ciliciennes par l’armée des thèmes de la région :
son armée fut détruite et lui-même fait prisonnier . Enhardis par ce succès,
cinq stratèges attaquèrent le territoire d’Adana et Basile vint les rejoindre
avec son fils Constantin : la frontière de Syrie fut franchie et quelques
places furent prises ou détruites (879) .
Nous savons qu’à la suite de la mort de son
fils préféré Constantin en cette même année, Basile subit une dépression qui
influa sur son activité politique. Ce fut seulement en 882 qu’il reprit ses
projets contre Mélitène, qu’il alla assiéger inutilement grâce aux secours que
la ville reçut de Marasch et de Khada. Une seconde campagne, partie la même
année de Césarée pour prendre ces deux villes, n’eut pas plus de succès . L’année suivante une
attaque contre Tarse, dirigée par Kesta Stypiotès, aboutit à un gros désastre
de l’armée byzantine qui fut entièrement détruite le 14 septembre 883 .
Dès lors Basile ne fit plus aucune
tentative sur la frontière d’Orient, que, malgré ces dernières défaites, il
laissa fortement organisée, après avoir retourné contre les Arabes les forteresses
placées aux points stratégiques qui favorisaient leurs offensives . La victoire de Basile
eût été plus complète si son action militaire eût été appuyée par une révolte
des Arméniens contre les Arabes. Le roi de la Grande Arménie, Aschod le Pagratide,
garda du moins la neutralité, mais Basile, ayant appris qu’il avait reçu du
calife une couronne et le titre royal, s’empressa de lui faire porter une
couronne d’or et de signer avec lui un traité d’alliance en le qualifiant de
fils bien-aimé , rappelant ainsi la
fiction qui faisait de l’empereur romain le suzerain de l’Arménie et ménageant
l’avenir.
Les missions chrétiennes. — Nous avons vu
par l’exemple de Justinien que la protection accordée aux missionnaires était
l’un des moyens les plus efficaces de la politique extérieure de Byzance. Or le
prosélytisme de l’Église grecque, qui avait subi une éclipse depuis l’époque
iconoclaste, reprit avec éclat après la restauration de l’Orthodoxie dans la
seconde moitié du ixe siècle et ne contribua pas peu à faire pénétrer dans des pays restés barbares
le prestige de Byzance et de la civilisation chrétienne. Toute mission
religieuse était accompagnée d’une action diplomatique qui tendait à faire des
peuples convertis des alliés ou même des vassaux de l’Empire, tandis que le
patriarcat de Constantinople agrandissait son domaine en s’efforçant de placer
les chrétientés nouvelles sous sa juridiction . Les moyens de
propagande variaient suivant qu’on avait affaire à des Musulmans, à des Juifs,
à des Pauliciens ou à des païens , mais la propagande
commençait toujours par des controverses qui supposaient chez les missionnaires
la connaissance de la langue du pays .
Avec une véritable souplesse les
missionnaires s’adaptaient à toutes les habitudes des pays qu’il s’agissait de
convertir, traduisaient les Évangiles et les livres liturgiques dans leur
langue nationale et formaient un clergé indigène. Dès la fin du ive siècle Ulfilas avait
créé une liturgie en langue gothique qui s’était conservée chez les Goths de
Crimée et cet exemple avait été suivi par la plupart des missionnaires . Au ixe siècle, malgré quelques
préventions, comme le montre la curieuse aventure de saint Hilarion le Géorgien
dans un couvent de l’Olympe , l’Église grecque
admettait la diversité des langues liturgiques . C’est ainsi que les
descendants de la tribu turque établie par Théophile sur le Vardar célébraient
encore la liturgie en dialecte turc au début du xixe siècle .
Ce fut grâce à ces méthodes que se
produisit au ixe siècle l’un des plus grands événements de l’histoire de l’Europe : la
conversion des peuples slaves par des missionnaires byzantins, dont les deux
principaux, Cyrille et Méthode, ont reçu justement le titre d’apôtres des
Slaves .
Constantin (il ne prit que plus tard le nom
de Cyrille) et Méthode étaient fils d’un drongaire du thème de Thessalonique.
Méthode fut gouverneur d’une colonie slave de Macédoine . Constantin alla achever
ses études à Constantinople, où il fut l’élève de Léon le Mathématicien et le
protégé du ministre Théoktistos , puis il devint lui-même
professeur , reçut les ordres
ecclésiastiques, fut chargé d’une mission diplomatique chez les Arabes , mais, épris de la vie
monastique, il se retira à l’Olympe de Bithynie où il retrouva Méthode . Puis, après l’assaut
russe de 860, le gouvernement impérial lui confia une mission à la fois
politique et religieuse chez les Khazars, où, accompagné de Méthode, il eut des
discussions avec les rabbins juifs, apprit l’hébreu et pendant un séjour à Kherson
découvrit les reliques du pape saint Clément .
Ce fut après le retour des deux frères à
Constantinople que Rastislav, prince de la Grande Moravie, désireux d’échapper
aux entreprises de Louis le Germanique, envoya une ambassade à Byzance, avec
laquelle la Moravie avait déjà des rapports commerciaux, pour demander au
basileus d’envoyer des missionnaires, « capables, disait son message, de
nous enseigner la vraie foi en notre langue » , La Grande Moravie, qui
s’étendait au sud dans une partie de la Slovaquie actuelle jusqu’au Hron,
affluent du Danube, était considérée comme un État vassal par les margraves de
l’Est, et les évêques de Passau la regardaient comme soumise à leur
juridiction. Les Moraves étaient restés païens en grande partie et les clercs
germaniques qui parcouraient leur pays faisaient peu de prosélytes.
L’expédition que Louis le Germanique avait dirigée contre la Moravie en 855
avait échoué piteusement et Rastislav, allié de Carloman, révolté contre son
père, avait étendu sa domination jusqu’à la Tisza, c’est-à-dire jusqu’à la
frontière bulgare. Avec un véritable sens politique il avait compris que le
seul moyen d’échapper à la poussée germanique était de se placer sous la
protection de Byzance, et d’avoir recours à ses missionnaires .
La mission confiée à Constantin et Méthode,
probablement d’après l’avis de Photius, avait donc, malgré son caractère
religieux, un intérêt politique et en fait, comme on l’a vu déjà, une
intervention de Michel III contre les Bulgares, alliés de Louis le Germanique,
les empêcha d’attaquer la Moravie .
Ce fut au printemps de 863 que les deux
frères, porteurs d’une lettre impériale, arrivèrent en Moravie . Comblés d’honneurs par
Rastislav, ils se mirent tout de suite à l’œuvre. Le prince morave avait
demandé que son peuple fût instruit dans sa langue. D’après leurs biographes,
les apôtres apportaient avec eux un alphabet nouveau adapté aux consonances
slaves, qu’ils enseignèrent à leurs premiers disciples, ainsi qu’une traduction
en slave d’un choix de lectures évangéliques .
La création de cet alphabet était le seul
moyen pour les missionnaires de gagner le monde slave au christianisme et, bien
que sa légende en attribue naïvement l’invention à Constantin aussitôt après
l’ambassade de Rastislav, on peut croire qu’il avait été créé depuis
longtemps . Ce fut grâce à cet
instrument parfait que les deux frères purent doter la nouvelle Église de
traductions en slavon des livres liturgiques de l’Église grecque et de
l’Écriture sainte. Ils élevèrent ainsi les dialectes slaves à la dignité d’une
langue littéraire qui leur doit ses premiers monuments . Ce ne fut pas
d’ailleurs sans essuyer les critiques des clercs germaniques qu’ils célébrèrent
les offices religieux dans la langue nationale des Moraves .
Puis, après être restés 40 mois en Moravie,
afin de constituer un clergé indigène, ils se rendirent à Venise en 807,
peut-être avec l’intention de s’y embarquer pour Constantinople avec les
disciples qu’ils avaient amenés pour les faire ordonner prêtres par un
évêque .
A Venise ils eurent des discussions avec le clergé latin an sujet de la
liturgie en langue slave et ils reçurent une
lettre du pape Nicolas Ier qui les mandait à Rome . Quand ils y arrivèrent
au début de 868, Nicolas Ier était mort (23 novembre 867). Son successeur,
Hadrien II, les accueillit avec les plus grands honneurs , reçut d’eux les
reliques de saint Clément et fit ordonner prêtres leurs disciples. Au sujet de
la liturgie slave, le pape se montra très conciliant malgré l’opposition du
clergé romain et désigna trois basiliques dans lesquelles Constantin pourrait
la célébrer . Ce fut alors qu’épuisé
par ses travaux Constantin mourut le 14 février 869, âgé de 42 ans, et fut
enseveli dans la basilique Saint-Clément : avant sa mort il avait pris le
nom de Cyrille, symbole d’orthodoxie et d’unité religieuse .
Peu après, à la demande du chef morave
Kocel, converti au christianisme par des missionnaires allemands, mais qui
s’était rallié à l’Église morave an passage des deux frères dans ses
États ,
Hadrien II créa Méthode archevêque de Sirmium et légat du Saint-Siège auprès
des nations slaves . Mais au moment où
Méthode revenait en Moravie, Svastislav, trahi par son neveu Svatopulk, avait
été livré à Carloman, qui lui avait fait crever les yeux, et la Moravie était
retombée au pouvoir des Germains . A son arrivée, Méthode,
accusé devant un tribunal d’évêques d’avoir usurpé les fonctions épiscopales,
fut emprisonné en Bavière (870) ; mais, malgré la révolte des Moraves qui
chassèrent les Germains de leur pays, il ne fut délivré qu’en 873, grâce à
l’intervention de Jean VIII qui venait de succéder à Hadrien II ; le
nouveau pape avait d’ailleurs ordonné à son légat d’interdire à Méthode la
célébration de la liturgie en langue slave, qu’il admettait seulement pour la
prédication .
Méthode reprit donc son œuvre apostolique
dans des conditions difficiles : Svatopulk, devenu prince de Moravie,
favorisait le clergé allemand, et, en 879, Méthode, accusé devant le pape de
chanter le Credo sans l’addition du Filioque et de continuer à célébrer la liturgie en slave, dut retourner à Rome, où il
n’eut pas de peine à prouver son orthodoxie . Bien plus, Méthode
obtint enfin de Jean VIII l’autorisation de célébrer la liturgie en slave et
l’approbation de sa traduction des Écritures. Le pape écrivit à Svatopulk une
lettre dans laquelle il proclamait l’orthodoxie de Méthode, qu’il nommait
archevêque de Moravie, avec Wiching, évêque de Nitra, comme suffragant . Mais les ennemis de
l’apôtre veillaient. Devançant Méthode, Wiching, agent secret d’Arnulf, fils de
Carloman, alla présenter à Svatopulk une fausse bulle qui condamnait Méthode
comme hérétique . Celui-ci en appela au
pape, qui protesta qu’il n’avait rien écrit à Wiching et confirma les pouvoirs
de l’apôtre . Enfin, dernier
triomphe, l’empereur Basile invita Méthode à venir à Constantinople, où il fut
reçu avec honneur par le souverain et le patriarche Photius qui, comme on le
sait aujourd’hui , avait fait la paix avec
le Saint-Siège.
On s’est demandé pour quels motifs Basile
avait appelé Méthode auprès de lui. On peut voir d’abord dans cette démarche
une preuve de l’intérêt politique que le gouvernement impérial attachait aux missions,
en pays slave en particulier. La biographie de Méthode, seule source qui
mentionne ce voyage , donne ce renseignement
important, que l’empereur « fit l’éloge de sa doctrine et garda auprès de
lui un prêtre et un diacre, disciples de Méthode, munis de leurs livres ».
Il est clair que, mis au courant des succès de la mission en Moravie, Basile
songeait à organiser sur le même modèle d’autres missions chez les Slaves, soit
en Russie, où nous avons vu que Photius avait envoyé un évêque , soit surtout en
Bulgarie dont l’Église était en voie d’organisation et où les disciples de
Méthode pouvaient rendre d’immenses services, soit en Croatie où l’on venait
d’envoyer des missionnaires .
Ce n’est pas d’ailleurs une simple
conjecture. Après la mort de Méthode (6 avril 885), il se produisit une
violente réaction germanique en Moravie. Le pape Étienne V, circonvenu par
Wiching, le nomma archevêque de Moravie et condamna l’œuvre de Méthode . Gorazd, que Méthode
avait désigné comme son successeur, et ses disciples se réfugièrent en
Bulgarie, où ils reçurent le meilleur accueil de Boris qui envoya l’un d’eux,
Clément, en Macédoine où il fonda un monastère à Ochrida. A son avènement,
Siméon le nomma évêque de Velika et il aurait été le premier évêque slave en
Bulgarie .
Ainsi ce fut la Bulgarie qui recueillit
l’héritage de Méthode et sauva son œuvre apostolique.
Grâce à ses disciples, la Bulgarie devint
un pays complètement slave au point de vue religieux, tout en recevant de
Byzance sous la forme de traductions les éléments de sa plus ancienne
littérature . Bien que rattachée
définitivement à Rome, la Croatie adopta la liturgie slave, que lui avaient
transmise des disciples de Méthode et qui se maintint aussi
en Moravie et en Bohême où les papes finirent par la tolérer . Ces résultats montrent
ce que les nations slaves doivent à Byzance, dont les missionnaires les ont
fait entrer dans le cercle des pays de civilisation chrétienne.
6. La résistance de l’Empire (886-919)
La période qui succède à celle du
raffermissement de l’Empire est marquée par de nouvelles difficultés à
l’intérieur, par de nouvelles offensives de ses ennemis et par une crise
redoutable de succession. Non seulement l’État byzantin a résisté à ces agents
de dissolution et à ces causes de destruction, mais sur bien des points il a
continué la politique d’expansion de la période précédente.
La succession de Basile. — Blessé
grièvement au cours d’une grande chasse, Basile le Macédonien mourut le 29 août
886, après avoir désigné pour lui succéder ses deux fils Léon et Alexandre, le
troisième, Étienne, étant patriarche . Il avait ainsi assuré
l’avenir de sa dynastie. Léon et Alexandre, qui devaient régner conjointement,
avaient été déjà associés au trône du vivant de leur père , mais Léon, à qui
Basile, par un reste d’éloignement, avait imposé son frère comme corégent,
l’annihila complètement et arriva même à ne plus le nommer dans ses
constitutions.
Alexandre, qui, d’après les chroniques,
avait un caractère frivole, ne chercha nullement à réclamer sa part du
pouvoir .
L’empereur Léon VI. — La personne du
nouveau basileus formait un contraste saisissant avec celle de Basile. D’une
santé médiocre, d’humeur sédentaire, il n’avait aucun goût pour la vie des
camps, qu’il se contentait d’envisager en théoricien , et vivait au palais, préoccupé
des questions d’étiquette et de cérémonial. Très lettré, élève de Photius, il
avait reçu une éducation encyclopédique et se piquait d’être logicien,
moraliste, métaphysicien, théologien, juriste, tacticien, poète , et avait même une
prédilection pour les sciences occultes et les prophéties . Son savoir universel
lui valut le titre de philosophe, qui
était le grade le plus élevé de l’Université impériale . Très religieux, il
prononçait des homélies aux grandes fêtes , admettait les moines dans
son intimité, notamment son directeur de conscience, Euthyme , et affectait dans ses
novelles une rigidité de mœurs qui ne correspondait pas toujours à sa conduite
privée .
Pendant le règne de Léon VI le palais fut
le théâtre d’intrigues et de conspirations continuelles, dues à des favoris
auxquels le basileus abandonnait la direction des affaires. Le premier fut
Stylianos Tzaoutzès , d’origine arménienne,
déjà bien en cour sous Basile, et qui devait la faveur de Léon à ce qu’il avait
pris son parti dans sa querelle avec son père et parce qu’il avait pour fille
Zoé dont le basileus était épris avant son mariage forcé avec Théophano . Créé logothète du
drome ,
Stylianos eut le pouvoir d’un premier ministre et son autorité ressort du grand
nombre de novelles qui lui sont adressées . Son influence était
contrebalancée par celle du moine Euthyme, qui chercha en vain à détacher Léon
VI de lui, mais en habile courtisan, après avoir manifesté son hostilité au
moine, Stylianos fit mine de se réconcilier avec lui .
Mais Stylianos mourut en 896 après avoir
été disgracié, et sa faveur passa à un jeune eunuque, Arabe converti, Samonas,
qui gagna les bonnes grâces de Léon en lui révélant un complot auquel il avait
feint de participer . Comblé de titres et de
richesses, patrice, parakimomène, Samonas fut pendant quinze ans (896-911) le
maître absolu de l’Empire et Léon VI lui était tellement attaché que le favori
ayant tenté de s’enfuir en pays arabe avec ses richesses et ayant été arrêté,
n’eut à subir que quelques mois de disgrâce (904) et redevint plus puissant que
jamais .
Vindicatif, il calomnia l’un des meilleurs généraux de l’Empire, Andronic
Doukas, qu’il réduisit à s’enfuir chez les Arabes . Mais il finit par
connaître lui aussi l’infortune : convaincu d’avoir écrit un libelle
diffamatoire contre Léon VI, il fut enfermé dans un monastère et privé de ses
biens. Pour comble d’humiliation, il se vit remplacé dans la faveur du maître
par un eunuque paphlagonien de sa maison, Constantin .
Il ne faut pas d’ailleurs juger
exclusivement Léon VI sur ces misères. Juriste de premier ordre, possédant le
sens des réalités et s’efforçant d’y adapter les lois, il fut le plus grand
législateur que Byzance ait connu depuis Justinien, dont il a réédité toute
l’œuvre traduite en grec dans les 60 livres des Basiliques, mais dont ses 113 novelles
ont transformé la législation en supprimant les constitutions périmées et en
corrigeant les autres suivant les besoins de son temps .
Affaires religieuses. — A la mort de
Basile, Photius était toujours patriarche et la paix régnait entre Rome et
Constantinople, mais le nouveau basileus, emporté par sa passion de vengeance
contre Photius et Santabarem, fit déposer le patriarche ignominieusement et
crever les yeux à l’évêque de Néocésarée. Photius, relégué dans un monastère,
où il mourut en 891, fut remplacé au patriarcat par le plus jeune frère de
Léon, Étienne, destiné au clergé dès sa naissance . Ce coup de force
accentua les divisions de l’Église grecque, toujours partagée entre photianistes
et ignatiens. Photius fut regardé comme un saint par ses partisans et Euthyme protesta
vivement contre les représailles exercées sur sa famille par Stylianos .
Mais il y eut bientôt entre ces deux
personnages une cause de conflit autrement grave. Marié malgré lui à Théophano
qui menait au palais la vie d’une religieuse et ne lui avait donne
qu’une fille morte en bas âge, Léon VI voulait la répudier pour épouser la
fille de Stylianos, en mettant en avant l’avenir de la dynastie. Or l’impératrice,
dont la vie était une souffrance continuelle, était disposée à se retirer dans
un monastère quand Euthyme l’en empêcha et alla faire de sévères remontrances
au basileus . Mais Léon VI n’en tint
aucun compte, et peu après, Théophano se retirait au monastère de la Vierge des
Blachernes où elle mourut le 10 novembre 893, considérée comme une sainte au
lendemain même de sa mort . Quelques semaines plus
tard le mari de Zoé mourait aussi : le basileus ne voyait plus aucun
obstacle à ses desseins mais lorsqu’il voulut obtenir l’approbation d’Euthyme,
il se heurta à un refus formel et, poussé par Stylianos, il alla jusqu’à exiler
son père spirituel . Le patriarche Étienne
était mort depuis le 17 mai 893 et par ses manœuvres
Stylianos avait empêché Euthyme d’être choisi pour lui succéder . Sans oser s’adresser au
nouveau patriarche, Léon VI fit bénir son mariage avec Zoé par un prêtre du
palais, qui fut plus tard déposé par le Synode pour cette raison , et Léon créa pour
Stylianos la dignité de basileopator qui le plaçait au sommet de la hiérarchie . Mais Zoé ne fut pas
impératrice plus d’un an et huit mois et sa mort suivit de
près celle de Stylianos en disgrâce.
Au patriarche Étienne avait succédé en 893
un moine de l’Olympe, Antoine Cauléas, qui avait le vif désir de faire cesser
le schisme entre les deux partis ecclésiastiques . Après la déposition de
Photius les Ignatiens rappelés d’exil essayèrent de faire revenir le
Saint-Siège sur la réhabilitation de ce patriarche. Un mémoire de Stylianos,
évêque de Néocésarée, écrit dans ce sens, fut reçu par le pape Formose (891),
dont une ambassade envoyée à Constantinople ne put décider les Ignatiens à
communier avec le patriarche et avec les clercs ordonnés par Photius . Pour venir à bout de
cette intransigeance, il fallut une seconde ambassade romaine envoyée vers 898
par le pape Jean IX . Une amnistie générale
fut proclamée. Les Ignatiens se réconcilièrent d’une part avec le patriarche
Antoine, d’autre part avec Rome, dont ils étaient séparés depuis la
réhabilitation de Photius .
Antoine Cauléas mourut peu après la
proclamation de l’Union en 903 et eut pour successeur
un parent de Photius, Nicolas, qui avait été élevé en même temps que Léon VI,
dont il était devenu le secrétaire intime (mystikos) . Cependant, au moment où
la paix semblait rétablie dans l’Église, la conduite du basileus allait
engendrer de nouveaux troubles. Zoé ne lui avait donné qu’une fille, fiancée à
un prince carolingien. Or Léon désirait un héritier et les cérémonies de la
cour exigeaient la présence d’une impératrice . En dépit de sa novelle
90 ,
le basileus contracta un troisième mariage avec Eudokia, originaire de
Bithynie, qui mourut au bout d’un an, le dimanche de Pâques, 20 avril 900, en
donnant le jour à un fils, qui ne vécut pas .
Cette union avait fait scandale dans
l’Église qui condamnait les troisièmes noces, comme le montrent l’attitude
sévère d’Euthyme vis-à-vis de son impérial pénitent et le refus d’un higoumène
de recevoir le corps de la défunte dans son monastère , A plus forte raison un
quatrième mariage paraissait impossible, mais Léon désirait toujours avoir un
fils et il prit le parti d’installer au palais une favorite, Zoé Carbonopsina
(aux yeux noirs), avec l’intention secrète de l’épouser si elle lui donnait un
fils ,
Si le basileus avait compté sur la complaisance de son ancien condisciple le
patriarche Nicolas pour favoriser son dessein, il fut détrompé aux premières
ouvertures qu’il lui fit à ce sujet et il s’ensuivit dans leurs rapports une
tension qui se manifesta lors de l’attentat contre l’empereur à l’église
Saint-Mocius le 11 mai 903 : Léon accusa Nicolas et son clergé de n’avoir
rien fait pour le défendre .
Mais une circonstance inattendue fit cesser
la résistance du patriarche. Très ambitieux, à la fois autoritaire et souple à
l’occasion, entré dans l’Église malgré lui, impatient de jouer un rôle dans
l’État et se sentant à la veille d’une disgrâce , Nicolas encouragea la
révolte d’Andronic Doukas qui, trompé par une lettre calomnieuse du favori
Samonas, avait fait défection, au moment d’une expédition contre les Arabes et
avait fini par se réfugier chez eux, avec l’intention d’obtenir d’eux des
secours pour renverser Léon VI. Or une lettre compromettante du patriarche au
rebelle, apportée par un déserteur de l’armée d’Andronic, tomba entre les mains
de l’empereur (avant décembre 905) .
Sans rien dire à Nicolas, Léon montra cette
lettre à ses familiers, mais, par des indiscrétions, le patriarche en fut
instruit et son attitude vis-à-vis de l’empereur changea entièrement , Non seulement il vint
au palais plus souvent et bénit le ventre de Zoé qui allait être mère, mais il
négocia avec les métropolites du synode pour obtenir d’eux que le fils qu’elle
mit au monde fût légitimé et baptisé comme un prince porphyrogénète . Ceux-ci finirent par y
consentir à condition que Léon n’épouserait pas Zoé, mais trois jours après le
baptême de Constantin, qui eut lieu le 6 janvier 906, le basileus, violant sa
promesse, fit célébrer son mariage avec Zoé par un prêtre du palais , Aussitôt le synode
prononça l’interdit contre lui, mais Léon, pour sortir de cette situation, fit
demander une consultation au pape et aux patriarches d’Orient sur la légitimité
de son mariage .
Le patriarche n’avait consenti qu’à
contrecœur à cette solution qui blessait son amour-propre et, pour montrer sa
bonne volonté, il reçut Léon VI à l’église malgré l’interdit . Mais le basileus, dont
la rancune contre Nicolas n’avait pas désarmé, annonça à ses familiers son
intention de se présenter à l’église le jour de Noël et d’en chasser le
patriarche, après lui avoir reproché sa trahison. « Ce fut, dit le
biographe d’Euthyme, le commencement de l’incendie qui dévasta l’Église . » Le patriarche,
averti, réunit le synode qui lui donna son approbation et quand le basileus
escorté du Sénat, se présenta aux portes de Sainte-Sophie, il lui en refusa
l’entrée . Alors les événements se
précipitèrent. Une seconde tentative de Léon pour entrer à l’église le jour de
l’Épiphanie eut le même insuccès . Dès lors commença entre
les deux adversaires une guerre de tous les instants et qui dura un mois.
Apostrophe violente de Léon à Nicolas en présence de tous les évêques au festin
impérial de l’Épiphanie, pacte signé entre le patriarche et les métropolites de
résister au basileus jusqu’à la mort annoncèrent le dénouement.
Léon VI, ayant reçu de ses ambassadeurs la nouvelle que sa requête avait obtenu
un accueil favorable tant à Rome qu’en Orient, somma le patriarche et les métropolites
de l’admettre à l’église au moins comme pénitent et, sur leur refus, les envoya
en exil ,
puis le 6 février, ayant convoqué les métropolites qui avaient manifesté le
désir d’une transaction, il leur donna les preuves formelles devant témoins de
la collusion de Nicolas avec Andronic et conclut à son expulsion du
patriarcat .
Il restait à obtenir l’abdication du
patriarche et à le remplacer. Après quelques atermoiements et sur la menace
d’un procès de haute trahison, Nicolas finit par envoyer sa renonciation au patriarcat,
mais en conservant sa dignité d’évêque , Puis, sur l’invitation
du basileus, le synode désigna Euthyme, retiré au monastère de Psamathia, comme
successeur de Nicolas, mais le sévère ascète opposa d’abord la plus vive
résistance à toutes les sollicitations . Il fallut, pour le décider
à accepter, l’arrivée à Constantinople des légats romains et des apocrisiaires
des patriarches orientaux apportant des lettres de dispense pour les quatrièmes
noces, en admettant le basileus à la pénitence , Ces mesures furent loin
de ramener la paix religieuse : le clergé et les fidèles se partagèrent
entre Euthyme, qui fut pris à partie dans de violents pamphlets , et Nicolas, qui fut
regardé comme un martyr. Un nouveau schisme commençait.
Cependant, loin d’avoir des complaisances
pour Léon, Euthyme agissait à son endroit avec la plus grande rigueur. Il
déposa le prêtre Thomas qui avait béni les quatrièmes noces du basileus , Il s’opposa de toutes
ses forces, soutenu par le synode, à un projet de loi de Léon VI rendant les
quatrièmes noces légitimes , Il se montra
particulièrement sévère pour Zoé, qu’il refusa de recevoir à l’église, en
menaçant d’abandonner le patriarcat devant son insistance , Sa seule concession fut
de couronner le jeune Constantin basileus le 9 juin 911 , Léon VI à son lit de
mort aurait rappelé Nicolas le Mystique, et son rétablissement au patriarcat
fut en tout cas le premier acte de son successeur , mais le schisme entre
les partisans des deux patriarches n’en continua pas moins.
La défense de l’Empire. — A l’extérieur,
le règne de Léon VI fut assombri par des événements désastreux, dont le plus
grave pour l’avenir fut la reprise de l’offensive bulgare. Le basileus parvint
cependant à maintenir et même à améliorer les résultats obtenus sous Michel III
et Basile. La défensive byzantine devint même plus active et un fait important
fut la part plus grande faite aux opérations maritimes. Léon disposa d’ailleurs
d’hommes de guerre éminent comme Himérios, Nicéphore Phocas, et d’un excellent
diplomate, Léon Choirosphaktès . Les résultats eussent
été plus remarquables sans les méfaits de la politique intérieure et la
toute-puissance des favoris, comme Samonas, qui provoqua la disgrâce des
meilleurs serviteurs de l’Empire.
Depuis le traité signé par Léon l’Arménien
en 815, la paix entre l’Empire et les Bulgares n’avait guère été troublée et
Byzance pouvait disposer de toutes ses forces contre les Arabes. Mais pendant
cette longue période de paix, des événements considérables avaient transformé
la situation de la région danubienne. La conversion des Bulgares au
christianisme avait accru la puissance royale et la cohésion de l’État bulgare.
Boris avait annexé à la Bulgarie de vastes territoires dans la région
occidentale des grands lacs . Après le règne éphémère
de Vladimir, Boris, devenu moine, avait placé sur le trône bulgare son plus
jeune fils Syméon, qui avait été élevé à Constantinople et manifestait une
telle prédilection pour la civilisation byzantine et l’hellénisme qu’on l’avait
surnommé le demi-Grec . Mais, d’une ambition
sans bornes, ébloui par les splendeurs du Palais Sacré, il ne rêvait rien moins
que de placer la couronne des basileis sur sa tête.
La provocation vint pourtant de Byzance et
fut le résultat du pouvoir exorbitant abandonné à Stylianos Tzaoutzès. La
Bulgarie était devenue un véritable entrepôt commercial entre Byzance et le
continent européen : les navires partis des ports bulgares de la mer Noire
venaient débarquer les produits de l’Europe centrale et de la plaine russe sur
les quais de Constantinople . Or deux marchands grecs
liés avec un esclave de Stylianos se firent attribuer le monopole du commerce
avec les Bulgares et, pour éviter la concurrence, firent transporter les
entrepôts bulgares à Thessalonique, où leurs représentants furent en butte à
toute sorte de tracasseries et d’avanies douanières . Léon VI n’ayant tenu
aucun compte des réclamations de Syméon, celui-ci envahit la Thrace et la
Macédoine, battit l’armée impériale envoyée contre lui et menaça Constantinople
(894) .
A ce moment les forces de l’Empire étaient engagées contre les Arabes , mais un événement qui
devait avoir une portée considérable avait modifié l’échiquier stratégique des
régions danubiennes. Un peuple finno-ougrien, les Magyars (Hongrois), désigné
cependant sous le nom de Turcs par les chroniqueurs grecs et arabes, chassé des
steppes russes par d’autres touraniens, les Petchenègues, et tombé dans la
vassalité des Khazars, apparut aux bouches du Danube vers 880 sous le commandement
d’Arpad .
Léon VI n’hésita pas à faire alliance
contre les Bulgares avec ces nouveaux venus, qui passèrent le Danube sur les
navires de la flotte impériale commandée par Eustathe et ravagèrent la
Bulgarie, pendant que Nicéphore Phocas ramenait les troupes d’Asie. Syméon
regagna rapidement le Danube, mais son armée ne put tenir devant les masses
hongroises et fut mise en déroute. Il ne tarda pas à prendre sa revanche.
Apprenant que Léon VI avait rappelé son armée et sa flotte et disgracié
Nicéphore Phocas, calomnié par Stylianos, il feignit de demander la paix, enferma
dans une forteresse Léon Choirosphaktès venu pour négocier, attaqua les
Hongrois et, après un combat acharné, les força à repasser le Danube, puis se
fit rendre par le gouvernement impérial tous les prisonniers bulgares que les
Hongrois avaient vendus aux Grecs et, après avoir obtenu satisfaction, marcha
subitement sur Constantinople et infligea une défaite complète à l’armée
impériale envoyée contre lui, à Bulgarophygon (Eski-Baba) (895-896) .
Syméon était maître de la situation, mais,
inquiet de l’avance des Magyars, il entendait imposer la paix à l’Empire. Léon
Choirosphaktès et l’asecretis Syméon réussirent cependant à obtenir des
conditions assez modérées , mais, si la paix avec
le prince bulgare ne fut pas troublée du vivant de Léon VI, Syméon lui garda
une profonde rancune de la dévastation du territoire bulgare par les Hongrois
et ne perdit aucune occasion de lui nuire .
Malgré ses conséquences importantes, la
guerre bulgare ne fut qu’un épisode du long règne de Léon VI, qui, au
contraire, de son avènement jusqu’à sa mort, dut faire face à l’offensive musulmane :
attaques du califat en Asie Mineure, des corsaires de Crète dans l’Archipel,
des Sarrasins d’Afrique en Italie et en Sicile.
Du côté du califat, de 886 à 900, la guerre
se poursuit sans aucun plan d’ensemble et ne consiste qu’en incursions et
razzias dans les régions frontières, les attaques venant toujours des
gouverneurs arabes , suspendues en 896 par
un échange de prisonniers , mais reprenant l’année
suivante . Le fait nouveau est la
liaison entre ces expéditions terrestres et les attaques de la marine musulmane
contre les côtes d’Asie Mineure, par exemple en 891 (attaque du port de
Salinda, ancienne Sélinonte) et en 898 (défaite de la flotte byzantine qui
défendait les bases navales d’Asie) . Ce fut seulement en 900
que les opérations devinrent plus importantes. Une armée arabe de Cilicie ayant
envahi le thème d’Anatolie, Nicéphore Phocas, franchissant le Taurus, alla
attaquer Adana et revint avec des prisonniers et un butin considérable qu’il
put ramener à Constantinople après une retraite savante, citée en exemple dans
la Tactique de Léon . Les discordes du
califat permirent aux armées byzantines quelques attaques fructueuses dans les années
qui suivirent (901-904) , mais ces essais
d’offensive furent arrêtés par les coups terribles que les corsaires portèrent
aux forces byzantines.
Depuis l’avènement de Léon VI, les îles de
l’Archipel et les côtes de la Grèce subissaient les attaques continuelles des
corsaires de Crète et des ports de Syrie, sans que la flotte impériale pût
défendre les malheureuses populations, qui n’étaient même pas en sécurité dans
les villes fortifiées . En juillet 904 une offensive
importante fut organisée contre les villes maritimes de l’Empire par un renégat
grec, Léon de Tripoli , qui s’empara par
surprise de la place importante d’Attalie (Adalia), dont il était
originaire . Enhardi par ce succès,
il annonça l’intention de prendre Constantinople et parvint à passer
l’Hellespont et à pénétrer dans la Propontide jusqu’à Parion, mais battit en
retraite devant l’escadre impériale commandée par Himerios, qui le poursuivit,
sans pouvoir l’atteindre, et ne put l’empêcher de se diriger sur Thessalonique
qu’il savait mal défendue .
La deuxième ville de l’Empire n’était
protégée du côté de la mer que par des murs trop bas et son port où
s’entassaient des navires de tous les pays était trop largement ouvert . En dépit d’une défense
improvisée à la hâte par les envoyés de Léon VI, Thessalonique fut prise
d’assaut après un siège de deux jours (29-31 juillet 904) et, après l’avoir
pillée pendant dix jours, les Arabes s’éloignèrent en emmenant un immense butin
et des troupeaux de prisonniers, qui furent rachetés à grands frais .
Cet événement tragique fit une impression
profonde sur les contemporains, comme le montre le discours prononcé par le
patriarche Nicolas le Mystique à Sainte-Sophie , et ne contribua pas peu
à diminuer le prestige de l’Empire, en particulier dans la péninsule des
Balkans, où Syméon, qui avait profité de la paix avec l’Empire pour organiser
son État, songea un moment à repeupler Thessalonique dévastée avec des Bulgares
et n’y renonça qu’après avoir obtenu en Macédoine un territoire qui mettait la
frontière bulgare à 21 kilomètres de cette ville .
Et trois ans seulement après le désastre de
Thessalonique, au moment où Léon VI préparait sa revanche contre les Arabes,
une nouvelle attaque des Russes dirigée par Oleg, frère et successeur de
Rourik, vint menacer Constantinople. Après avoir dévasté les environs de la
ville, Oleg força Léon VI à lui accorder une entrevue et à conclure un traité
qui fut renouvelé en 911 et contenait des clauses commerciales avantageuses
pour la colonie de marchands russes établis au faubourgs Saint-Mamas . En signe de paix, Oleg
avait fixé son bouclier sur la Porte d’Or .
La réalité de cette expédition, que les
chroniqueurs byzantins passent sous silence et qui n’est connue que par la
chronique russe dite de Nestor, a été mise en doute et Grégoire la considère
comme un mythe, dû à une confusion entre Oleg et un vizir bulgare, Olgoutra
Kanou, dont le nom figure sur une borne frontière ; mais, comme on
l’a fait remarquer, les dates des traités données par la chronique russe sont
d’une précision qui dénote une connaissance des sources grecques, et le fait
qu’un corps de 700 Russes participa à l’expédition d’Himerios en 910 indique
bien qu’un accord avait été conclu récemment entre les Russes et l’Empire .
Cependant Léon VI, instruit par ses récents
désastres, prit les mesures nécessaires à l’organisation d’une défensive
efficace contre les Arabes, mais tout son effort se porta sur l’accroissement
de la flotte , si bien que la lutte à
la frontière terrestre conserva le caractère d’opérations décousues, de coups
de main, d’échanges de prisonniers sans résultats appréciables . La réfection de la
flotte étant achevée en 905, une expédition dirigée par Himerios dans
l’Archipel remporta une grande victoire sur les Arabes , mais, comme on l’a vu,
ce fut à ce moment que le commandant de la frontière d’Asie Mineure, Andronic
Doukas, qui avait reçu l’ordre de rejoindre la flotte, trompé par une lettre
mensongère du favori Samonas, fit défection et passa chez les Arabes . A la fin de 906 une
tentative de paix, dont l’initiative fut prise par le calife, nécessita l’envoi
à Bagdad de Léon Choirosphaktès et aboutit à un échange de prisonniers .
Ce fut Léon VI qui rompit cette trêve,
vraisemblablement à la fin de son règne et certainement après l’expédition
d’Oleg ,
en organisant une véritable armada placée sous le commandement d’Himerios et
destinée à débarquer des troupes dans les ports de Syrie, principaux repaires
de la piraterie après la Crète . L’expédition fut précédée
de négociations destinées à détacher les émirs d’Afrique et de Crète de leur
alliance avec Bagdad : une ambassade impériale envoyée à Kairouan obtint
la neutralité du gouverneur de l’Afrique , tandis que l’émir de
Crète se montra irréductible et resta hostile à l’Empire . Dans l’été de 910
Himenios débarqua dans l’île de Chypre après un dur combat et y établit les
bases navales qui lui permirent d’attaquer la côte de Syrie et d’y occuper
quelques forteresses, dont Laodicée (Latakieh) . Mais pendant ce temps
les Arabes, sous le commandement du renégat Damien, reprenaient possession de
Chypre et châtiaient les villages chrétiens qui s’étaient soumis à
Himenios . Celui-ci battit en
retraite vers le nord, poursuivi par une escadre musulmane qui l’atteignit à la
hauteur de Samos et lui infligea un immense désastre (octobre 911) . Quand Himenios, qui
avait échappé à peine à la captivité, revint à Constantinople, Léon VI était
mort et Alexandre le fit interner dans un monastère où il mourut de chagrin . Malgré son insuccès,
l’expédition d’Himerios avait détourné l’attention des Arabes de l’Asie
Mineure, dont la frontière, où l’occupation byzantine avait été renforcée, se
trouvait intacte et mieux défendue que jamais .
Les difficultés rencontrées par Léon VI
dans sa lutte contre les Bulgares et les Arabes d’Orient furent dues sans doute
en grande partie aux fautes qu’il commit dans sa politique intérieure, mais
aussi à la dispersion des forces de l’Empire sur un théâtre trop étendu pour
les ressources dont il disposait. Obligé d’assurer la défense de Constantinople
contre les Bulgares et les Arabes, Léon VI continuait en même temps la
politique de pénétration en Arménie et en Italie que lui avait léguée Basile.
Du côté de l’Arménie et des dynastes du Caucase
son action fut surtout diplomatique. Aschod le Pagratide, roi de Grande
Arménie, qui, comme on l’a dit, avait vu son titre royal reconnu à la fois par
Basile et par le calife, vint à Constantinople en 888 et conclut un traité
commercial et politique avec Léon VI . Ce traité fut renouvelé
par son fils et successeur, Sempad, reconnu roi par le basileus et le calife
(893) .
Léon VI, dont la politique arménienne fut très active, reçut l’hommage de
plusieurs feudataires arméniens, notamment de Grégoire, prince de Taron , et ayant appris que les
Arabes transformaient les églises de la région du Phase en forteresses, il
n’hésita pas à intervenir militairement et à faire détruire les forteresses
arabes et même à faire occuper Théodosiopolis . Malheureusement les
gouverneurs arabes de l’Azerbaïdjan, Afschin (896-898) et après lui son frère,
Yousouf, s’inquiétèrent des bons rapports de Sempad avec Byzance et ravagèrent
son État à plusieurs reprises. En 909, trahi par son neveu Kakigh que les
Arabes reconnurent comme roi, Sempad, battu par Youssouf à l’est du lac Sévan,
s’enfuit dans une forteresse, où il fut assiégé et fait prisonnier. Sommé
d’abjurer le christianisme, il subit le martyre avec courage (914) .
A la veille de sa mort, Léon VI avait
rassemblé des troupes pour le secourir, mais son successeur abandonna cette
entreprise . C’était là un gros
échec pour le prestige impérial. Par contre l’influence byzantine se développa
dans la région du Caucase, où le baptême du chef des Alains vers 902, grâce au zèle
de Bagrat, prince d’Abasgie, fut un véritable succès pour la politique de Léon
VI et provoqua une correspondance suivie entre le patriarche Nicolas, le prince
Bagrat et le nouvel archevêque d’Alanie .
En Italie la domination byzantine organisée
par Nicéphore Phocas fut remise en question par la révolte des vassaux lombards
et par les menaces des Sarrasins. En 887 le prince de Bénévent, Aïon, chassait
la garnison byzantine de Bari, mais assiégé l’année suivante par une armée
formée des thèmes d’Occident, il dut restituer la ville . Par représailles et
pour soumettre plus étroitement les Lombards, le stratège Symbatikios s’empara
de Bénévent après la mort d’Aïon en 891 et y fixa sa résidence. Les princes de
Capoue et de Salerne furent menacés du même sort, mais les Lombards
supportaient mal la domination byzantine et en 895, Guy, duc de Spolète, étant
venu à leur secours, entra à Bénévent grâce à la complicité de l’évêque et des
habitants . Ainsi que le pape
Formose, Léon VI combattit la tentative de la maison de Spolète pour
reconstituer le royaume d’Italie, en recherchant l’alliance du roi germanique
Arnulf (894-896) , puis celle de Louis de
Provence couronné empereur à Rome en 901, à qui il songea à marier sa fille
Anne .
Mais le principal danger pour les
possessions byzantines venait des Sarrasins établis en Sicile, en Calabre, en
Campanie. Les escadres byzantines parvinrent à enlever aux Arabes de Sicile la
maîtrise du détroit de Messine et à les chasser de la Calabre (898-899) , mais l’émir de Kairouan,
Ibrahim-ibn-Ahmed, voulant réprimer la révolte de ses vassaux de Sicile, envoya
une expédition dirigée par son fils Abdallah. Après avoir soumis les rebelles
(août 900), Abdallah attaqua le territoire byzantin, pilla Reggio et détruisit
une escadre impériale (901) . L’année suivante
Ibrahim vint lui-même diriger la guerre sainte, s’empara de Taormina, dernière
place tenue par Byzance en Sicile (3 septembre 902), envahit la Calabre, semant
la terreur sur son passage, mais sa mort (octobre 902) entraîna la retraite de
son armée .
Délivrées du péril africain, les
possessions byzantines étaient encore exposées aux attaques de la colonie
sarrasine de Campanie, établie dans une position formidable sur les hauteurs
qui dominent le Garigliano . De ce repaire les Sarrasins
rayonnaient dans les régions voisines, poussant leurs attaques jusqu’à la Campagne
romaine, s’établissant sur les ruines de l’abbaye de Farfa, abandonnée en
898 .
Élu pape en mars 914, Jean X réussit à organiser une alliance de toutes les
puissances chrétiennes, princes lombards, comme le marquis Albéric de Spolète,
milices de Naples et de Gaète détachées de l’alliance sarrasine, contingents de
Toscane. Le pape lui-même commandait en personne une petite armée et la stratège
byzantin de Bari adhéra à la ligue. En 915, pendant qu’une flotte byzantine
remontait le Garigliano, les alliés établissaient le blocus du camp ennemi.
Après trois mois de siège les Sarrasins tentèrent une sortie, incendièrent leur
camp et se dispersèrent dans les montagnes où ils furent massacrés . Cette victoire, qui mettait
fin à l’insécurité dans laquelle se trouvait l’Italie byzantine, eut son
retentissement à Constantinople, comme le montre la lettre de félicitations du
patriarche Nicolas, qui exerçait alors le pouvoir, au stratège Nicolas
Picingli .
C’est à cette époque que l’établissement de
l’Empire en Italie méridionale est définitivement consolidé et organisé.
Jusqu’en 892 l’autorité y était exercée par des chefs de guerre chargés de
missions temporaires et pris parmi les stratèges des thèmes d’Occident. A
partir de cette date les territoires byzantins forment le thème de Longobardie,
mais il n’est encore qu’une dépendance du thème de Céphalonie, avec un seul
stratège pour les deux thèmes, qui ne furent séparés définitivement que sous
Léon VI .
La succession de Léon VI. — Léon VI mourut
le 11 mai 912. Depuis le 9 juin 911 Byzance avait trois empereurs : Léon,
son frère Alexandre et Constantin Porphyrogénète, âgé de 6 ans . Alexandre, qui n’avait
pas d’enfant, se trouva seul maître du pouvoir, son neveu devant lui succéder.
Agé de 42 ans, Alexandre n’avait guère fait parler de lui pendant le règne de
son frère. D’après les chroniqueurs, malintentionnés à son égard, il aurait été
libertin, ivrogne, ignorant et surtout superstitieux . Toujours est-il que son
avènement fut le signal d’une réaction violente contre les actes de Léon VI. Il
commença par chasser Zoé du palais et par rappeler Nicolas
le Mystique au patriarcat. Euthyme fut déposé solennellement, accablé de coups
et d’injures, puis exilé dans un monastère où il subit les plus mauvais traitements ; les métropolites
qui avaient abandonné Nicolas dans l’affaire de la tétragamie furent
déposés et, par ordre d’Alexandre, le patriarche envoya au pape un plaidoyer pour justifier
sa conduite, mais ne reçut aucune réponse . Les divisions du clergé
grec furent plus profondes que jamais et Nicolas dut compter avec une sérieuse
opposition de la part de certains métropolites qui, comme Aréthas, archevêque de
Césarée, refusèrent de le reconnaître comme patriarche légitime .
Si bref que fut le règne d’Alexandre, il
trouva moyen de brouiller l’Empire avec les Bulgares en refusant de renouveler
le traité par lequel Léon VI s’était engagé à payer un léger tribut à
Syméon .
Ce refus devait avoir des conséquences funestes pour Byzance. L’incapable
basileus mourut le 6 juin 933 en laissant le trône à son neveu, après avoir
institué un conseil de régence présidé par le patriarche Nicolas .
La crise terrible qui suivit la mort
d’Alexandre et dura six ans (913-919) se déroula en trois actes comme une
tragédie classique. Maître du pouvoir, Nicolas le Mystique chassa de nouveau
Zoé qui était rentrée au palais . Inquiet de la situation
intérieure et de la menace bulgare, il avait écrit, avant qu’Alexandre fût
mort, à Constantin Doukas, fils d’Andronic, commandant des troupes réunies pour
faire face aux Bulgares, de venir défendre le trône de l’enfant impérial, auquel
il serait associé ; mais lorsque le
pouvoir lui eut été confié, il changea d’avis et l’entreprise de Doukas, tué au
cours de l’émeute qui accompagna son entrée à Constantinople, échoua complètement
(juin 913) . Au mois d’août suivant,
Syméon paraissait devant la ville, mais à la vue de ses fortes murailles, il
accepta un accommodement (990). Il fut convenu
que le patriarche lui enverrait les arrérages en retard du tribut et il exigea
en outre une promesse de mariage d’une de ses filles avec le jeune
basileus , clause significative
qui dévoilait son ambition d’intervenir dans les affaires de la dynastie macédonienne.
Bien plus, dans l’entrevue que Nicolas eut avec lui, Syméon se fit couronner
par le patriarche qui, en guise de diadème, lui mit sa propre coiffure, son épirriptarion sur la tête, ce qui revenait
à faire de lui un basileus .
Cependant le patriarche et les régents
manquaient d’autorité et Nicolas reprochait aux chefs de l’armée de prendre des
initiatives sans même le tenir au courant de leurs projets . Sur ces entrefaites,
l’impérial enfant se mit à réclamer sa mère et il fallut lui donner satisfaction.
Zoé rentra au palais et, avec une décision remarquable, s’empara du pouvoir en
rappelant les anciens conseillers de Léon VI et en chassant ceux d’Alexandre, à
commencer par les régents . Elle voulait déposer
Nicolas et rappeler Euthyme, mais celui-ci, avec qui son adversaire s’était
hâté de se réconcilier, lui opposa un refus formel et elle se contenta
d’exiger du patriarche la promesse de s’occuper exclusivement des affaires de
l’Église (février 914) .
Mais dans l’ardeur de sa réaction Zoé
attira un nouvel orage sur l’Empire en déchirant le traité conclu entre Syméon
et Nicolas, tandis que le prince bulgare se considérait comme dégagé de ses
promesses . Il en résulta une
guerre de trois ans qui débuta par le ravage de la Thrace (septembre 914) . Pour tenir les Bulgares
en respect, Zoé avait fait alliance avec un peuple touranien nouvellement arrivé
sur le Dniéper, les Petchenègues . Ce fut seulement en 917
qu’une expédition commandée par Léon Phocas envahit la Bulgarie, tandis que
Romain Lécapène remontait le Danube avec la flotte et que Jean Bogas amenait
les Petchenègues sur le fleuve. Mais il y eut une contestation entre ces deux
chefs et les barbares retournèrent dans leur pays. De plus, le 20 août 917
Syméon surprit l’armée impériale en retraite sur Mesembria et la détruisit
entièrement devant Anchiale . La route de
Constantinople était libre et les débris de l’armée vaincue subirent d’une
nouvelle défaite à Katasyrtae, dans la banlieue de la ville : cette fois encore
Syméon n’osa l’assiéger et battit en retraite, mais ce fut pour aller ravager
la Grèce qu’il parcourut impunément jusqu’au golfe de Corinthe .
Le dernier acte de la tragédie
approchait ; Zoé, sentant le trône en péril, et Nicolas, désireux de
reconquérir la régence, n’attendaient plus le salut que d’un chef de guerre,
soit de Léon Phocas, domestique des scholes, fort de ses alliances
aristocratiques, soit de Romain Lécapène, grand-drongaire de la flotte , revenus tous deux à
Constantinople et impatients de saisir le pouvoir. La situation fut dénouée par
l’initiative d’un comparse, le précepteur du jeune basileus, Théodore ; il
fit des ouvertures à Romain Lécapène, qui ne consentit à s’engager qu’après
avoir reçu un ordre autographe du Porphyrogénète. Nicolas le Mystique, rappelé
au palais, destitua Léon Phocas de sa charge et le 25 mars 919 toute la flotte
vint jeter l’ancre sous les murs du palais, où Romain pénétra après avoir juré
de ne rien entreprendre contre l’empereur. Il commença par destituer tous ceux
qui lui étaient suspects, les remplaça par ses affidés, fiança sa fille Hélène
au jeune Constantin et prit le titre, créé par Léon VI pour Stylianos, de basileopator . A cette nouvelle Léon
Phocas, retourné en Asie, souleva les thèmes d’Orient et arriva jusqu’à
Chrysopolis, mais Romain le fit déclarer apostat et un chrysobulle, qu’un
secrétaire eut la hardiesse de porter à ses troupes, leur défendit de lui
obéir. Abandonné de ses soldats et fait prisonnier, il eut les yeux crevés et
fut promené ignominieusement dans les rues de Constantinople . Romain Lécapène était
désormais le maître. Zoé, qu’il négligeait, ayant essayé de l’empoisonner, fut
reléguée dans un monastère et le précepteur Théodore lui-même invité à
retourner dans ses terres. Le 24 septembre 919, Romain prenait le titre de
César et le 17 décembre suivant il était couronné basileus par le patriarche
Nicolas en présence de Constantin Porphyrogénète .
7. L’Œuvre de Romain Lécapène (919-944)
Bien qu’en fait le pouvoir du nouveau
basileus fût le résultat d’une usurpation, son association à l’Empire n’en
manifeste pas moins un progrès des idées légitimistes et de la doctrine
dynastique. Non seulement il s’était engagé par les serments les plus solennels
à respecter la personne et le pouvoir de Constantin VII, mais en droit c’était
de cet enfant qu’il tenait la couronne : un siècle plus tôt, l’héritier du
trône eût été pour le moins relégué dans un monastère, sinon mutilé ou
aveuglé . Romain Lécapène
inaugurait ainsi la série des chefs de guerre proclamés empereurs pour
préserver les droits des héritiers légitimes et ce fut grâce à cette fiction
que la dynastie macédonienne se perpétua encore un siècle et demi. En réalité
d’ailleurs il régna toujours une opposition sourde entre le Porphyrogénète et
son protecteur, qui chercha par tous les moyens à faire de sa famille une
dynastie impériale.
D’origine obscure, fils d’un soldat du
thème des Arméniaques qui avait sauvé la vie à Basile dans une bataille, Romain
Lécapène fut d’abord simple soldat de marine. Comme Basile naguère il aurait dû
son avancement à un exploit accompli sous les yeux de l’empereur, en tuant un
lion qui allait dévorer un soldat. Léon VI lui donna de
l’avancement. En 911 il était stratège du thème de Samos et avant la mort du
même prince il devint drongaire de la flotte, mais, rendu responsable du
désastre d’Anchiale, il échappa de justesse à la destitution . Constantin Porphyrogénète
le représente comme dénué de toute instruction, mais son témoignage est loin
d’être impartial .
Parvenu au pouvoir suprême, Romain le
voulut sans aucun partage et ne laissa pas la moindre autorité au jeune
Constantin, allant jusqu’à punir les familiers qui lui montraient trop
d’attachement ; il ne lui suffit
pas d’en avoir fait son gendre sans violer ouvertement son serment, il
entreprit de l’annihiler progressivement en élevant au-dessus de lui les
membres de sa famille. A son avènement il confia le poste important de
grand-hétériarque (chef de la garde étrangère du palais) à son fils aîné
Christophe déjà marié, et le 20 mai 920 il le fit couronner basileus par le
patriarche et par l’infortuné Constantin VII . Ses deux autres fils,
Constantin et Étienne, reçurent la même dignité le 20 décembre 924 et le même
jour leur plus jeune frère Théophylacte, destiné au patriarcat, fut ordonné
clerc et créé syncelle par le patriarche Nicolas . Enfin avec une grande
habileté Romain sut faire de ce redoutable prélat un allié : la haine
commune de Zoé les rapprocha. Euthyme mourut en 917 et Nicolas consentit à
mettre sa grande autorité au service du gouvernement de Romain .
La guerre bulgare. — La première
tâche qui s’imposa au nouveau basileus fut de se préparer à défendre
Constantinople contre Syméon, désireux de profiter des discordes civiles de
Byzance pour s’emparer du trône impérial. Mais avec l’avènement de Romain
Lécapène s’évanouissait l’espoir du mariage de sa fille avec le Porphyrogénète.
Syméon en fut profondément ulcéré. Aussi lorsque Romain, s’efforçant d’éviter
la rupture, lui fit des offres de conciliation par l’intermédiaire du
patriarche, proposant de lui payer tribut et même de faire épouser sa fille par
l’un de ses fils , Syméon repoussa tout
avec hauteur. C’était en vain que Nicolas le Mystique multipliait ses lettres
dans lesquelles les exhortations se mêlaient aux considérations
politiques . Syméon, avant toute
négociation, exigeait que Romain Lécapène lui cédât le trône .
Ces pourparlers se prolongeaient encore, la
guerre une fois commencée. Elle devait continuer pendant cinq ans (été de 919 à
septembre 924) . Syméon, qui ne pouvait
plus compter sur un effet de surprise, avait affaire cette fois au chef de
guerre expérimenté qui occupait le trône byzantin et au diplomate averti
qu’était le patriarche Nicolas. Un raid bulgare sur lès Dardanelles (été de
919), qui ouvrit les opérations, semble avoir eu pour objet d’intimider
l’adversaire . Une révolte de la
Serbie contre les Bulgares, suscitée par Romain Lécapène, occupa l’attention de
Syméon pendant l’année 920, mais Zacharie, le chef de la révolte, fut fait
prisonnier et le pays fut dépeuplé .
Ce fut seulement en 921 que Syméon, après
avoir envoyé son ultimatum à Nicolas , put marcher sur
Constantinople, mais sa première tentative échoua par suite de la défaite que
lui infligea l’armée impériale à Katasyrtae . Laissant ses troupes à
Héraclée et à Selymbria, il alla passer l’hiver en Bulgarie et les lettres de
Nicolas se firent inutilement plus pressantes . Une seconde attaque
(été de 922) aboutit au pillage du palais de la Source, mais vers l’automne,
les Bulgares s’étant de nouveau approchés de la Grande Muraille, Romain organisa
une sortie, au cours de laquelle le camp bulgare fut détruit : Syméon dut
battre en retraite . Ces échecs le
rendirent plus accommodant et il demanda qu’un envoyé fût accrédité auprès de
lui .
Tout en négociant il envahissait la Thrace en 923 et s’emparait d’Andrinople,
mais sans aller plus loin, il regagna la Bulgarie, et la garnison qu’il laissa
dans la ville se retira à la première approche d’une armée byzantine .
Ainsi la constance de Lécapène lassait
l’ambitieux Bulgare : son recul était dû sans doute à la révolte du prince
Paul de Serbie, soudoyé par l’empereur, dont elle rétablissait les affaires, au
moment où le bourreau de Thessalonique, Léon de Tripoli, subissait une défaite
navale, et qui négociait de nouvelles alliances contre les Bulgares avec les
Hongrois et les peuples de la steppe . Rendu plus accommodant
par ses déboires, Syméon esquissa une tentative de négociation , mais après avoir
vaincu les Serbes (début de 924) il recommença ses menaces et comprenant qu’il ne
prendrait jamais Constantinople sans le concours d’une flotte, il s’allia aux
Fatimites d’Afrique et signa avec eux un traité qui prévoyait une double
attaque de la ville impériale par terre et par mer ; mais la capture des
deux ambassades bulgare et arabe par un drongaire byzantin fit échouer le
projet : les Arabes, comblés d’égards par Romain, abandonnèrent leur
allié .
Mais Syméon avait un tel désir de trôner au
Palais Sacré que cet échec ne l’arrêta pas et qu’après avoir ravagé la Thrace
et la Macédoine (été de 924), il parut sous les murs de Constantinople, puis,
au moment où les habitants s’attendaient à être attaqués, il ouvrit des
négociations. Se flattait-il d’être reçu pacifiquement dans la ville ? On
l’ignore. Toujours est-il qu’avec un véritable courage Romain Lécapène se
rendit à l’entrevue que Syméon avait exigée et qu’il le détermina à signer une
trêve par laquelle il restituait à l’Empire plusieurs places de la mer Noire en
échange d’un léger tribut et de quelques présents (9 septembre 924) .
Le maigre résultat d’un si grand effort
libérait Constantinople, mais, vaincu sans avoir combattu, de retour dans son
pays, Syméon recouvra son insolence et refusa de livrer, les forteresses
promises sous prétexte que l’Empire était incapable de les défendre contre les
Arabes et il s’intitula de sa
propre autorité basileus et autocrator
des Bulgares et des Grecs , Romain ayant protesté,
il obtint du pape en 926 la confirmation de son titre impérial et l’élévation
de l’archevêque de Bulgarie à la dignité de patriarche .
Gouvernement intérieur. — Si Romain Lécapène
avait pu écarter ainsi un des plus grands dangers que l’Empire ait courus, il
le devait en grande partie à la fermeté et à la sagesse de sa politique
intérieure. Avec lui prit fin le gouvernement des favoris qui était la honte
des règnes précédents. Il s’entoura d’hommes probes et compétents. Jusqu’à sa
mort en 925 le patriarche Nicolas fut réellement son premier ministre. On vient
de voir la place importante qu’il tenait dans les relations extérieures, mais
sa correspondance montre l’autorité qu’il exerçait aussi dans l’administration
intérieure . Après lui ce fut aussi
un secrétaire intime du basileus, Jean le Mystique, qui reçut la direction des
affaires, mais il excita la jalousie, fut accusé faussement de complot et dut
entrer dans un monastère . Théophane le protovestiaire,
qui lui succéda dans ses attributions, très compétent en matière diplomatique
et navale, fut pendant 39 ans le premier personnage de l’État après
l’empereur . Parmi les chefs de
guerre que Romain sut choisir avec discernement le plus remarquable fut
l’Arménien Jean Courcouas (Gourguen), qui avait aidé le basileus à arriver au
pouvoir et qui lui resta fidèle .
Aidé par ses conseillers, Romain Lécapène
s’efforça d’agir toujours en vue du bien commun. Il est le premier empereur qui
ait pris des mesures législatives pour enrayer l’extension inquiétante des
grands domaines aux dépens de la petite propriété et pour préserver l’intégrité
des biens militaires, fondement du régime des thèmes et du recrutement d’une
armée indigène .
En 928, à la suite d’une famine due à une
mauvaise récolte, conséquence d’un hiver rigoureux, beaucoup de paysans durent
mettre leurs terres en gage aux mains des puissants et il leur fallait au moins
dix ans pour les dégager, d’où la novelle de 934 qui flétrit l’égoïsme des
puissants et qui, sans ordonner une éviction générale de tous les propriétaires
qui détiennent les biens des pauvres, annule toutes les transactions, dons,
héritages, postérieurs à 922, et décide que tout domaine acheté à un prix
inférieur à la moitié du prix raisonnable sera restitué sans indemnité ;
par contre, si l’achat a été régulier, le domaine pourra être restitué dans les
trois ans moyennant le remboursement de la somme versée . « La petite
propriété, écrivait Romain, a une grande utilité pour le paiement des impôts et
l’accomplissement du service militaire. Tout sera en péril si elle disparaît . » Fils lui-même
d’un possesseur d’un bien militaire, Romain voyait le danger que courait la
démocratie rurale, qui était le meilleur appui de l’État.
Cette politique courageuse, mais
impitoyable, lui faisait des ennemis dans l’aristocratie et même parmi ses
propres fonctionnaires, mais surtout on ne pardonnait pas à ce parvenu ses
empiètements continuels sur l’autorité de l’héritier légitime et ses efforts
pour implanter sa famille sur le trône de Byzance. Aussi pendant tout son règne
Romain eut à réprimer les complots des fidèles de Constantin VII, qui furent
punis surtout de châtiments corporels et d’exil .
Politique religieuse. — L’un des
bienfaits du gouvernement de Romain Lécapène fut le rétablissement de la paix
dans l’Église. La mort d’Euthyme le 5 août 917 n’avait pas fait cesser le
schisme entre ses partisans et ceux de Nicolas . Bien qu’il n’eût plus
à craindre de compétiteur et possédât toute la confiance de Lécapène, le
patriarche ne s’était pas départi de son intransigeance et ne voulait
réconcilier les Euthymiens que s’ils signaient une rétractation écrite de leur
conduite, avec serment solennel de ne pas retomber dans la même faute en excusant
les quatrièmes noces . Vraisemblablement sur
le désir du basileus, qui voulait avant tout la paix, Nicolas accepta un compromis
dont la mémoire de Léon VI fit les frais. Après la tenue d’un concile, le
patriarche promulgua le Τόμος Ἑνώσεως
(tomus unionis), souscrit sans
difficulté par les deux partis (9 juillet 920) . Le quatrième mariage
de Léon était flétri et Constantin Porphyrogénète reconnu légitime par simple
tolérance. Le fils de Léon le Philosophe dut assister à la lecture solennelle
de l’acte qui condamnait son père et il en fut de même à chaque anniversaire de
cette journée .
Il restait à renouer les relations avec
Rome, rompues depuis la dispense accordée à Léon VI par le pape Sergius III en
906. Nicolas n’avait reçu aucune réponse à la lettre qu’il avait écrite à Rome
au moment de son rétablissement en 912 . Sur l’ordre de Romain
Lécapène, il se mit en relation avec le pape Jean X. Dans une première lettre
il semblait rendre les prédécesseurs de ce pape responsables des troubles qui
avaient agité l’Église grecque . Ses lettres suivantes,
beaucoup plus conciliantes, accompagnées d’une missive écrite au nom de
Constantin Porphyrogénète, demandaient au pape d’envoyer des légats qui
rétabliraient les relations entre Rome et Constantinople : le nom du pape
serait établi dans les diptyques, mais, en tenant compte de la dispense
accordée à Léon VI, le pape s’associerait à la condamnation des quatrièmes
noces . En 923 Jean X envoya
en effet deux évêques à Constantinople, mais on n’est renseigné sur leurs actes
que par une lettre de Nicolas le Mystique à Syméon d’après laquelle les légats
jetèrent l’anathème sur les quatrièmes noces et rétablirent la concorde des
Églises. Ils devaient aussi intervenir auprès de Syméon, mais le patriarche,
craignant sans doute l’influence qu’ils pourraient prendre sur le prince
bulgare, ne les envoya pas à Preslav sous prétexte que les routes n’étaient pas
sûres .
Après ce dernier triomphe Nicolas le
Mystique mourut le 15 mai 925 et la question du
patriarcat devint l’un des soucis de Romain Lécapène qui entendait bien le
réserver à son fils Théophylacte, encore trop jeune pour y accéder. Ce fut
seulement au mois d’août suivant qu’il se décida à y installer un homme d’âge,
Étienne, métropolite d’Amasée, qui mourut au bout de deux ans et onze mois (décembre
928). II fut remplacé par un moine austère, Tryphon, qui se montra sans doute
peu docile, car il fut déposé en août 930 : on lui aurait fait signer par
surprise son abdication , Théophylacte n’avait
encore que 13 ans et le patriarcat resta vacant plus d’un an, mais il fallut
une véritable campagne diplomatique pour venir à bout de l’opposition du synode
lorsque le jeune prince eut ses quinze ans révolus. Romain Lécapène fit
pression sur les évêques en leur rappelant qu’ils avaient déjà élu
Théophylacte, dont l’ordination avait été seulement différée, et il alla
jusqu’à demander l’adhésion du pape Jean XI, dont les légats vinrent introniser
le nouveau patriarche et lui conférer le pallium (2 février 993) .
Détail intéressant : probablement sur
le désir de son père, Théophylacte envoya sa synodique aux trois patriarches
d’Orient en leur demandant de rappeler son nom dans la liturgie, usage suspendu
depuis les Ommiades et dont la portée politique est certaine .
L’œuvre extérieure. — Les résultats
de la politique extérieure de Romain Lécapène tiennent une place importante
dans l’histoire de Byzance et marquent un tournant décisif. Non seulement il a
résisté victorieusement à toutes les attaques, mais il a préparé l’Empire à reprendre
l’offensive contre ses ennemis et, depuis Justinien, il est l’un des premiers
empereurs qui aient laissé la Romania plus grande qu’il ne l’avait trouvée.
Il a dû ces succès a une diplomatie aussi
habile que développée et une armée bien commandée. Ancien drongaire de la
flotte, il a donné tous ses soins à la marine et son règne est une des périodes
les plus prospères de l’histoire navale de Byzance. Sa tâche fut facilitée par
la situation des pays voisins de l’Empire. Il trouva en face de lui un État
bulgare maîtrisé, un califat troublé par les guerres civiles et démembré, un
Occident en pleine anarchie.
On peut dire que le pivot de sa politique
fut son alliance avec la Bulgarie.
Syméon était mort le 27 mai 927 après avoir réprimé un
soulèvement des Serbes et subi un gros
désastre en voulant attaquer la Croatie . Déshéritant son fils
aîné, Michel, devenu moine, Syméon avait choisi pour successeur le plus jeune
de ses fils, Pierre, encore mineur, sous la régence de son oncle, Soursouboul.
Celui-ci, devant les dangers de toutes sortes qui menaçaient la Bulgarie,
n’hésita pas à se rapprocher de Byzance, mais appuya les négociations par une
action militaire en menaçant d’investir Thessalonique si la main d’une
princesse porphyrogénète n’était pas accordée au tsar Pierre . Romain Lécapène, qui
avait besoin de toutes ses forces contre les Arabes, accepta la proposition. En
octobre 927, Pierre vint à Constantinople épouser Marie, fille de Christophe Lécapène,
qui prit le nom symbolique d’Irène (La Paix) et Soursouboul signa
avec Romain un traité d’alliance qui restituait à l’Empire les villes du golfe
de Bourgas en échange d’une rectification de frontière du côté de
Thessalonique. En véritable réaliste, Romain concédait à Pierre ce titre de
basileus que Syméon n’avait pu obtenir et s’engageait à donner le pas dans les
cérémonies aux ambassadeurs bulgares sur toutes les autres légations .
Cette alliance était profitable aux deux
États, également menacés par les peuples des steppes, en particulier par les
Hongrois, qui, comme autrefois les Avars, étaient des éléments de trouble pour
toute l’Europe, dirigeant leurs courses indifféremment vers l’Occident ou
l’Orient, redoutables surtout au monde slave qu’ils séparèrent en deux
tronçons, expulsant les Bulgares de la rive gauche du Danube, détruisant la
Grande Moravie et battant les Russes d’Oleg devant Kiev. Contre eux la Bulgarie
couvrait Constantinople, mais d’une manière insuffisante, comme le montra
l’invasion hongroise qui ravagea la Thrace en 934, et, d’après Maçoudi, aurait
poussé jusqu’à la Ville Impériale et se termina par un traité de paix dû à
l’habileté du protovestiaire Théophane .
L’offensive de l’islam arrêtée. — La lutte
contre les Arabes domine toujours la politique extérieure de Byzance. Mais
l’alliance bulgare permet à Romain Lécapène d’employer à cette guerre
perpétuelle ses principales forces. D’autre part c’est le moment où le califat
abbasside perd son autorité sur le monde musulman, tandis que le chef de sa
garde turque, avec le titre d’émir-al-oumarâ (émir en chef), l’avait réduit au rôle de roi fainéant , que les sectes
hérétiques des Kharedjites et des Alides chiites suscitent des troubles qui
dégénèrent en guerres civiles , et que les schismes
religieux provoquent le séparatisme politique et le démembrement territorial du
califat. Depuis le fin du ixe siècle les provinces éloignées échappent à l’autorité du calife l’une après
l’autre : c’est l’Asie centrale, la Transoxiane, pénétrée de civilisation
iranienne, où se succèdent trois dynasties, dont la dernière, les Sâmnides,
lutte de magnificence avec les califes ; ce sont l’Égypte
et la Syrie, où le fils d’un esclave turc fonde la dynastie des Toulounides
(879) ; retombées au
pouvoir du calife en 905, ces deux provinces ne tardent pas à se séparer encore
sous le gouvernement des Ikhchides (935) . Mais l’événement qui
devait briser l’unité politique et religieuse de l’islam fut la création de
l’État des Fatimites par le Mahdi Obeid-Allah, fils de l’imam caché descendant
d’Ali et de Fâtima, la fille du Prophète. En 910 Obeid-Allah renversa la
dynastie des Aglabites, s’établit à Kairouan, prit le titre de calife, en proclamant
la guerre sainte contre les Abbassides . En 929 l’émir ommiade
de Cordoue se fit aussi proclamer calife , de sorte qu’il y eut
désormais trois commandeurs des croyants.
Ainsi Romain Lécapène ne trouvait plus
devant lui un front arabe unique, mais des dominations indépendantes, ennemies
les unes des autres et prêtes à s’allier aux chrétiens, ce qui ouvrait un vaste
champ aux manœuvres de la diplomatie byzantine. Les émirs mêmes, soumis encore
nominalement au califat, celui d’Azerbaïdjan, de qui dépendait l’Arménie, les
Hamdanides de Mossoul et d’Alep, les émirs de Tarse, de Mélitène et d’Édesse
avaient chacun leur politique indépendante.
Depuis la mort de Léon VI jusqu’à la
conclusion de l’alliance avec les Bulgares (912-927) l’Empire dut rester sur la
défensive en cherchant à protéger ses frontières et à arrêter les incursions annuelles
des émirs voisins, qui y voyaient un procédé fructueux pour lever un tribut sur
les populations chrétiennes, mais ne songeaient plus à une guerre de
conquête . Les gouverneurs des
thèmes byzantins s’étaient adaptés à ce régime et rendaient coup pour coup,
grâce à un excellent service de renseignements et à une tactique appropriée. Ce
fut ainsi qu’en 915, pendant que les Arabes de Tarse attaquaient la frontière,
les Grecs faisaient une expédition fructueuse en Mésopotamie et s’emparaient de
Marasch . Au moment de l’attaque
bulgare en 916, Zoé ouvrit des négociations qui furent dirigées par le
patriarche Nicolas : après une ambassade de deux patrices à Bagdad, il y
eut un échange de prisonniers en 917 .
Cette trêve, bien qu’interrompue par des
coups de main en Asie Mineure , dura jusqu’à
l’avènement de Romain Lécapène qui, même avant la conclusion de l’alliance
bulgare, donna une nouvelle impulsion à la défensive de l’Empire en cherchant
des diversions contre les Arabes. Ce fut ainsi qu’il rendit plus étroite
l’alliance avec le roi de Grande Arménie, Aschod II, qui était venu à
Constantinople (914-915) . L’émir d’Azerbaïdjan
ayant envahi le royaume d’Aschod, Romain n’hésita pas à envoyer une armée qui
repoussa l’émir dans sa province (923) . L’année précédente les
Byzantins avaient remporté un grand succès naval : le trop célèbre Léon de
Tripoli fut surpris par le drongaire Jean Radinos au moment où il ravageait
l’île de Lemnos. Sa flotte fut coulée et lui-même échappa à peine à la
captivité . Mais on était au moment
de l’attaque de Syméon contre Constantinople et comme Romain ne pouvait envoyer
aucune force en Asie, les coups de main à la frontière recommencèrent . Le basileus chercha
alors à conclure une trêve avec le calife, et après avoir été d’abord repoussé,
y parvint en 925 et obtint un échange des prisonniers .
En 926 Romain, tranquille du côté de
Syméon, engagé dans ses guerres yougoslaves, réorganise la défense des
frontières d’Orient et oblige les petits chefs arabes, qui avaient profité des
circonstances pour éluder leurs obligations, à acquitter le tribut en retard,
sous peine de voir leur territoire dévasté. Comme ils refusaient d’obéir, il
envoya contre eux une armée commandée par son meilleur stratège, Jean
Courcouas, qui ravagea les environs de Mélitène sans pouvoir s’emparer de la
ville .
La paix définitive avec la Bulgarie rendit
à Romain Lécapène sa liberté d’action et il prit franchement l’offensive contre
le califat . Son principal objectif
était la pénétration en Cilicie et en Haute Mésopotamie avec l’appui de
l’Arménie. La première guerre dura onze ans (927-938) et fut conduite presque
exclusivement par Jean Courcouas, « cet autre Trajan, cet autre
Bélisaire » . Pénétrant jusqu’à la
vallée de l’Euphrate, il occupe temporairement Samosate en 927 et envahit
l’Arménie arabe où il échoue devant Towin (928) , mais, malgré cet
insuccès, il se maintient dans la région et s’empare de plusieurs villes musulmanes
dont il transforme les mosquées en églises . Les villes de Mésopotamie
assiégées réclamaient en vain des secours de Bagdad et devaient se soumettre à
l’empereur . La réaction arabe ne
se manifestait que par des razzias en Asie Mineure, suivies d’ailleurs de
représailles . En 931 l’émir de
Tarse, Souml, allait piller Amorium et Ancyre sans rencontrer de
résistance . Ces diversions
n’atteignaient pas leur but et Jean Courcouas continuait son expédition victorieuse
en Orient. Ce fut probablement en 931 qu’il s’empara de Théodosiopolis (Erzeroum)
après un siège de 7 mois et, à la fin de la même
année, fit capituler Mélitène et assiégeait de
nouveau Samosate.
Ce fut alors qu’intervint pour la première
fois un membre de cette famille des Hamdanides, qui allait opposer une si
longue résistance à la conquête byzantine ; Saïd-ibn-Hamdan força
Courcouas à lever le siège de Samosate et reprit Mélitène (fin de 931) , mais en 934 Jean
Courcouas, dont l’armée était renforcée par un corps d’Arméniens, obligeait
cette ville d’une importance considérable à capituler de nouveau : l’empereur
en fit un état vassal . Les opérations se
ralentirent plusieurs mois, puis en 938 les armées impériales se heurtèrent à
l’homme qui devait être le plus farouche adversaire de l’Empire : l’émir
hamdanide Seïf-ad-Daouleh attaqua les postes grecs sur le haut Euphrate, battit
en retraite devant Jean Courcouas, puis s’arrêta subitement sur une position
bien choisie et lui infligea une grosse défaite . Romain Lécapène,
comprenant à quel ennemi il avait affaire, hâta les négociations déjà
commencées avec Bagdad et signa une trêve accompagnée d’un échange de
prisonniers .
La durée de cette trêve, conclue avant
juillet 938, ne fut pas longue. Dès la fin de l’automne 939 Seïf-ad-Daouleh la
rompait de son propre chef et envahissait l’Arménie . Dès lors commença une
seconde guerre qui se poursuivit jusqu’à la chute des Lécapènes (939-945) et
eut le caractère d’un duel entre l’Empire et les Hamdanides.
Cette famille des Hamdanides appartenait à
une tribu arabe, les Taglib, émigrés en Mésopotamie, qui avaient gardé de leur
origine l’amour de l’indépendance et le goût des entreprises audacieuses. Établis
sur le territoire de Mossoul, les Hamdanides comptèrent parmi les personnages
influents du califat. L’un d’eux, Aboul-Khaidj, gouverneur de Mossoul au début
du xe siècle, eut deux
fils : l’aîné, Chosan, reçut du calife le gouvernement de Mossoul avec le
titre de Nazir-ad-Daouleh (défenseur
de la dynastie), le second, Ah, né en 916, le gouvernement d’Alep et le titre
de Seïf-ad-Daouleh (épée de la dynastie) . D’une bravoure sans
égale, aventureux et chevaleresque, Seïf-ad-Daouleh était en même temps un
lettré, entouré de poètes qui célébraient ses exploits et poète lui-même . Ennemi implacable des
Grecs, complètement indépendant du calife, il se souciait peu des traités
conclus avec l’Empire et poursuivait sa politique personnelle, dont le but
était la création d’un État autonome.
C’est ce qui explique son attaque subite
contre l’Arménie, marquée par des succès éclatants, la destruction de la ville
que les Grecs avaient bâtie en face d’Erzeroum, qui produisit un tel effet que
plusieurs chefs arméniens et géorgiens vinrent lui faire leur soumission, et le
ravage du thème des Arméniaques, à la suite d’une lettre où Romain Lécapène le
défiait d’entrer sur le territoire de l’Empire . Le cours de ses
exploits fut arrêté par son conflit avec des chefs turcs qui battirent ses
troupes et l’obligèrent à s’enfuir à Bagdad. Là les Hamdanides prirent une
grande part aux guerres civiles qui suivirent la mort du calife Ar-Râdi et
furent un moment les maîtres de la capitale (940-942) . Il en résulta pour
l’Empire une période de répit qui fut employée à préparer une nouvelle
offensive.
Elle commença en novembre 942. A la tête
d’une forte armée, Jean Courcouas envahit l’Arménie, où il s’empara d’Arzen au
nord du lac de Van, puis pénétrant dans la Mésopotamie septentrionale, il en
occupa les villes, Maïafaryqin (Martyropolis), Diarbékir, Dara,, Nisibe, sans
les annexer, en se contentant de faire des prisonniers. Puis, évacuant la
vallée du Tigre, il alla attaquer Édesse qu’il obligea à capituler et à livrer
la relique insigne, le portrait miraculeux du Christ envoyé par lui au roi
Abgar, dont la possession fait l’orgueil de la cité . Ce fut avec
l’autorisation du calife, après une consultation demandée aux ulémas, qu’en
échange de la libération des prisonniers musulmans, l’émir d’Édesse céda
l’icône qui fut transportée triomphalement à Constantinople . Rien ne pouvait mieux
contribuer à rehausser le prestige de l’Empire en Orient que la capture de
cette relique, regardée comme une grande victoire.
Jean Courcouas termina sa campagne par la
prise de la place importante de Germanicia (Marasch), mais à son retour à
Constantinople, en butte à la jalousie des fils de Lécapène, il fut envoyé en
disgrâce et remplace par un incapable, Panthérios, qui se fit battre par
Seïf-ad-Daouleh . Un événement néfaste
pour l’Empire fut l’installation de Seïf-ad-Daouleh à Alep, qu’il enleva au
gouverneur d’Égypte et de Syrie, 1’Ikhchide, et dont il fit sa résidence . Après avoir pu la
réoccuper quelque temps, l’Ikhchide céda cette ville au Hamdanide ainsi
qu’Antioche et Émèse (novembre 945) .
L’attaque des Russes. — Pendant que
Romain Lécapène profitait des guerres civiles du califat pour reconstituer ses
forces en vue d’une future offensive, Constantinople fut de nouveau attaquée
par une immense flotte russe de monoxyles qui avait descendu le Dniéper sous la conduite du
prince Igor, le plus jeune des fils de Rurik et successeur d’Oleg, son oncle.
L’expédition préparée dans le secret fut un effet de surprise et paraît avoir
eu pour but le pillage, peut-être aussi, comme on l’a supposé, le désir de
contraindre Byzance à accorder aux marchands russes, répandus déjà dans toute
la Méditerranée, des clauses commerciales avantageuses . Pris au dépourvu, la
flotte impériale croisant dans l’Archipel, Romain rassembla toutes les forces
dont il disposait et rappela d’Asie l’armée de Jean Courcouas . Lorsque les
innombrables barques russes arrivèrent devant Constantinople le 11 juin 941,
elles furent inondées de feu grégeois, dont les appareils (siphones) avaient
été disposés sur 15 navires lourds (chelandia) qu’on avait découverts dans le
port et dont le protovestiaire Théophane avait pris le commandement . L’effet fut
immédiat ; la flotte russe désemparée aborda sur la côte de Bithynie et
des bandes de guerriers se dispersèrent entre Héraclée et Nicomédie en
ravageant toute la région et en infligeant les plus cruelles tortures aux
habitants et en particulier aux clercs. Bardas Phocas avec une petite troupe détruisit
un grand nombre de ces bandes de partisans et l’arrivée de l’armée de Jean
Courcouas acheva leur défaite. Lorsqu’en automne ils voulurent retourner dans
leur pays, Théophanes leur barra le chemin et, comme ils essayaient de passer
en Thrace, il les attaqua et les inonda encore une fois de feu grégeois. Très
peu d’entre eux parvinrent à regagner la Russie .
Cependant Igor ne se tint pas pour battu et
en 944 prépara une expédition encore plus formidable en enrôlant de nombreuses
tribus slaves et en s’alliant aux Petchenègues : il s’agissait d’une
expédition par terre. Averti de ces préparatifs par les Bulgares, Romain envoya
à Igor une ambassade qui le rejoignit sur le Danube et parvint à force de présents
à le déterminer, lui et ses alliés, à conclure une trêve et à envoyer des
plénipotentiaires à Constantinople, où fut signé un traité qui reproduisait les
accords précédents, donnait un statut avantageux aux commerçants russes dans
l’Empire et portait la promesse que les princes russes n’attaqueraient jamais
Kherson et les autres villes de la Crimée . Igor mourut peu après
dans une expédition .
La politique italienne. — En Italie,
après la brillante victoire du Garigliano, la puissance byzantine subit une
véritable éclipse jusqu’au dénouement des guerres bulgares (915-927).
Environnés d’ennemis, les stratèges de Longobardie avaient peine à défendre les
possessions byzantines contre le nouvel État des Fatimites d’Afrique qui,
devenus maîtres de la Sicile, s’emparèrent de Reggio et auxquels Zoé dut payer
un tribut , et contre les princes
lombards, qui avaient répudié la suzeraineté impériale et attaquaient les
territoires byzantins ou fomentaient les
révoltes des indigènes .
C’est entre 922 et 926 que l’anarchie
atteint son plus haut degré. En 922 des bandes de Hongrois ravagent la
Campanie, les Sarrasins attaquent la Calabre, les corsaires slaves de
l’Adriatique opèrent pour le compte du Mahdi Africain . En 925 les Sarrasins
d’Afrique pillent Tarente et forcent son gouverneur à payer une forte
rançon . L’année suivante cette
ville est prise par l’émir de Sicile, appuyé par la flotte du chef slave Saïan,
qui force les villes maritimes de Campanie et de Calabre à lui payer
tribut . Byzance ne réagit pas
et n’envoie plus aucune flotte de guerre.
Ce fut seulement à partir de 934 que Romain
Lécapène, dont les armes étaient victorieuses en Orient, put intervenir en
Italie, mais renonçant aux grandes expéditions, il agit surtout par la
diplomatie en empêchant les princes lombards de recevoir des secours de leurs
voisins du nord. De là ses rapports cordiaux avec les maîtres de Rome, la trop
célèbre Marozie qui songeait à faire épouser une de ses filles par un fils du
basileus , puis avec Albéric II,
prince des Romains, ainsi qu’avec son beau-père et rival Hugue de
Provence . En 934 le patrice
Cosmas, envoyé en Italie avec une petite escadre, détermine le prince de
Capoue, Landolf, à évacuer l’Apulie . En 935 c’est une autre
ambassade qui apporte des présents au roi Hugue, afin de gagner son alliance
contre les princes lombards . La révolte des Arabes
de Sicile contre les Fatimites de Kairouan (937-941), favorisée par les
stratèges byzantins, qui envoient du blé aux rebelles, fait cesser les incursions
sarrasines sur les côtes d’Italie . Voyant encore plus
loin, Lécapène accorde des secours à son allié Hugue pour déloger les Sarrasins
de leur repaire de Fraxinet , d’où ils écumaient les
côtes de Provence et envoyaient des expéditions à travers les Alpes jusqu’en
Haute Italie. Afin de rendre cet accord encore plus étroit, Romain demanda en
échange la main d’une fille du roi pour le jeune fils de Constantin Porphyrogénète,
dont il était lui-même l’aïeul . Grâce à cette habile
politique, Romain put écarter les dangers qui menaçaient l’Italie byzantine et
la transmettre à son successeur dans son intégrité.
La chute de Romain Lécapène. — En 944, Romain
Lécapène, qui régnait depuis 25 ans, s’était montré l’un des meilleurs
souverains que Byzance ait jamais eus. Il avait sauvé l’Empire, en voie de
dissolution à son avènement, apaisé les querelles religieuses qui se
perpétuaient depuis Photius, supprimé le péril bulgare, repris l’offensive
contre l’islam et, grâce à son habileté diplomatique, donné à l’Empire un
immense prestige en Orient comme en Occident. Son gouvernement intérieur était
essentiellement humain et il s’était inquiété du sort des petits, menacés
d’être réduits à l’état de serfs.
Malheureusement on ne lui savait aucun gré
de ces services et il ne fut jamais populaire. Dans l’opinion publique il était
resté l’usurpateur. On lui reprochait de vouloir supplanter l’héritier légitime
du trône et substituer sa famille à la dynastie macédonienne. De là des
complots et même des révoltes, dont le prétexte était de soutenir les droits de
Constantin Porphyrogénète, comme celle du stratège de Chaldia, Bardas Boeslas,
en 923, fait prisonnier par Jean Courcouas et simplement enfermé dans un
monastère , ou celle d’un aventurier
qui se faisait passer pour Constantin Doukas, l’ancien rival de Lécapène en
932 ;
mais, comme on l’a fait remarquer , ce fut moins à ce sentiment
légitimiste qu’aux ambitions de ses fils que fut due la chute de Romain
Lécapène. Déjà en 928 le beau-père de Christophe Lécapène, Nicétas, avait
entrepris de détrôner Romain pour donner le pouvoir suprême à son gendre.
Christophe ne fut pas inquiété, mais sa femme, Sophia, fut chassée du palais et
Nicétas enfermé dans un monastère . Christophe, le favori
de son père et le plus apte à l’exercice du pouvoir, mourut en août 938 , ne laissant que des
enfants en bas âge. Avec lui disparut la principale chance qu’avait Romain de
fonder une dynastie.
Les deux autres fils de Romain en effet,
Constantin et Étienne, avaient la réputation de débauchés et d’incapables. On
ne voit pas d’ailleurs que pendant son règne leur père leur ait confié une
affaire quelconque, mais ils entendaient bien lui succéder au pouvoir. Aussi
commencèrent-ils à être inquiets lorsqu’ils apprirent que leur père voulait faire
épouser une fille de Jean Courcouas à son petit-fils Romain, fils du
Porphyrogénète et d’Hélène Lécapène : ils s’en prirent au glorieux
stratège, qu’ils trouvèrent moyen de faire casser du commandement qu’il
exerçait si brillamment depuis plus de 22 ans . Le danger leur parut
encore plus grand lorsqu’ils virent Romain fréquenter la société des moines qui
l’incitaient à accomplir de bonnes œuvres, comme pour racheter son
usurpation . Dans le testament
qu’il rédigea en 944 il manifesta ses remords en plaçant le nom de Constantin
Porphyrogénète avant ceux de ses propres fils .
Ce fut certainement cet acte qui détermina
Constantin et Étienne Lécapène à agir contre leur père, dans la crainte qu’il
ne les exclue du pouvoir, mais un dernier événement vint hâter leur décision.
Ce fut l’arrivée à Constantinople de Berthe de Provence, dont le mariage avec
le jeune Romain, fils du Porphyrogénète, fut célébré en grande pompe (septembre
944) .
Cette union, qui semblait assurer l’avenir de la dynastie macédonienne, ne
pouvait qu’être odieuse aux Lécapènes et c’est à ce moment que Luitprand, bien
informé, place la révolte des fils Lécapène contre leur père . Le 20 décembre 944
Étienne Lécapène enleva Romain du Grand Palais, le fit jeter dans une barque et
conduire à l’île de Proti où on lui coupa les cheveux et où on le revêtit de la
mandya monastique. Le bruit ayant couru que Constantin Porphyrogénète avait
aussi été enlevé, la foule furieuse s’assembla autour du palais et il fallut
pour faire cesser l’émeute que l’héritier légitime, la chevelure encore en
désordre, se montrât à une fenêtre du palais .
Cependant un semblant d’accord entre les
deux complices et Constantin VII, reconnu empereur en premier, dura quelques
semaines , puis le Porphyrogénète
échappa à un complot des fils Lécapène pour l’enlever et les envoya rejoindre
leur père à Proti (27 janvier 945) . Cette révolution
s’accomplit sans que la cause des Lécapène trouvât un défenseur et du jour au
lendemain Constantin Porphyrogénète devint seul maître des affaires. Romain
Lécapène mourut à Proti le 15 juin 948 dans des sentiments de pénitence, après
avoir renié l’œuvre de toute sa vie, qui avait été pourtant bienfaisante pour
l’Empire . L’histoire est moins
sévère pour lui qu’il ne le fut lui-même.
LIVRE DEUXIÈME. L’EMPIRE ROMAIN HELLÉNIQUECHAPITRE II. — L’expansion (945-1057)1. Les débuts de l’expansion byzantine (944-963)
|