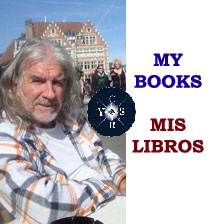 |
BIZANTIUM |
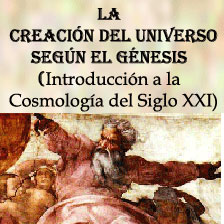 |
Louis Brehier. Le monde byzantin :Vie et mort de Byzance.LIVRE DEUXIÈME. L’EMPIRE ROMAIN HELLÉNIQUEChapitre IIL’expansion (945-1057)
En raffermissant la situation extérieure de l’Empire, en
conjurant le péril bulgare, en opposant une barrière infranchissable à
l’offensive musulmane, Romain Lécapène avait non seulement sauvé l’œuvre de la
dynastie amorienne et des deux premiers empereurs Macédoniens, mais, par les
victoires de ses armées, servies par une diplomatie habile, jeté les bases de
l’expansion territoriale qui se développa sous ses successeurs. La
contre-attaque gigantesque qui restitua à l’Empire des provinces perdues depuis
le viie siècle et
étendit ses frontières du Danube à la Mésopotamie, a mérité à juste titre le
nom d’épopée byzantine. Elle est l’œuvre d’une série d’empereurs, de chefs de
guerre et d’hommes d’État remarquables. En face des États musulmans divisés et
des peuples d’Occident encore en pleine crise de croissance, l’Empire byzantin
est devenu la première puissance militaire de l’Europe chrétienne et du
Proche-Orient. Un magnifique développement commercial alimenté par des
industries de luxe, un mouvement artistique, véritable renaissance dite avec
raison le second âge d’or de l’art byzantin, un développement intellectuel
incomparable et une nouvelle expansion des missions chrétiennes à laquelle fut
due la conversion de la Russie, achevèrent de faire de Byzance le centre du
monde civilisé et de faire rayonner son influence et sa civilisation dans les
pays les plus lointains.
Cette expansion se poursuivit jusqu’à la deuxième moitié du xie siècle, puis une
fidélité trop grande au principe dynastique, étendu aux femmes, mit sur le
trône une série d’aventuriers et d’empereurs incapables dont le mauvais
gouvernement compromit la situation extérieure, au moment où de nouveaux
ennemis redoutables, les Turcs et les Normands, attaquaient l’Empire.
L’expansion byzantine se heurta à l’expansion des peuples d’Occident qui
atteignit son plus haut degré avec la croisade. Une dynastie qui eut
successivement trois empereurs remarquables, celle des Comnènes, fit face
pendant un siècle à ces dangers nouveaux, mais les ressources de l’Empire
étaient épuisées et, après les règnes désastreux d’Andronic Comnène et des deux
représentants de la dynastie des Anges, il ne put résister aux convoitises des
Occidentaux et s’effondra lamentablement.
1. Les débuts de l’expansion byzantine (944-963)
La première phase de cette longue période de trois siècles
correspond aux règnes de Constantin Porphyrogénète (944-959) et de Romain II
(959-963) et aux premières conquêtes des armées byzantines.
Constantin Porphyrogénète. — Empereur en
titre depuis 25 ans sans avoir jamais pris une part quelconque aux affaires,
bien qu’âgé de 38 ans, sa figure paraît bien effacée à côté de celle de son
prédécesseur. A la différence de Lécapène, il était peu propre à l’action et il
ne pouvait d’ailleurs renoncer subitement à la vie solitaire et studieuse qu’il
menait depuis si longtemps au Grand Palais. Très instruit, représentant de la
science byzantine de son temps, érudit et archéologue, ses goûts le portaient
vers le passé de l’Empire et il employait ses faibles ressources à acheter des
manuscrits . Il aimait à s’entourer
de lettrés, d’artistes, de juristes, et son esprit curieux embrassait toutes
les connaissances, y compris celle des arts industriels comme l’architecture,
la construction des navires de guerre, la toreutique. Il pratiquait lui-même la
peinture, la sculpture, l’orfèvrerie et l’on vantait la treille qu’il avait
modelée au plafond du Triclinium des Dix-neuf lits, l’aigle d’argent étouffant
un serpent placée au-dessus d’un jet d’eau, et une table d’argent incrustée de
bois précieux. Il était également musicien, composait des cantiques et
dirigeait lui-même les chœurs . Il était même
linguiste, connaissait les langues des peuples voisins de l’Empire, et il donne
dans ses ouvrages des étymologies slaves et scandinaves.
Un savoir aussi dispersé était forcément superficiel, comme le
montrent les erreurs qu’il a commises et les fables qu’il a acceptées sans
aucun sens critique . Son œuvre personnelle
ne fut pas d’ailleurs inutile à l’Empire. Maître du pouvoir, disposant de
ressources abondantes, il put satisfaire ses goûts et il entreprit
l’établissement d’un immense inventaire de toutes les richesses de Byzance, de
ses traditions politiques et juridiques, de son historiographie, de ses connaissances
ethnographiques, etc. Il fut vraiment l’empereur-archiviste, avec le désir de
revenir à la grande tradition impériale et d’instaurer un régime définitif et
permanent dans tous les domaines, cérémonies, hiérarchie, enseignement, droit
public, techniques. Ce fut là son rôle historique .
Le xe siècle est l’époque des compilations et des encyclopédies, dont la Bibliothèque de Photius est le type,
composée d’extraits des auteurs anciens et modernes, mais la nouveauté consista
à séparer les différents ordres de connaissances. Il existait déjà une encyclopédie
juridique, les Basiliques, œuvre monumentale achevée sous Léon VI. Constantin
VII paraît avoir eu l’ambition de constituer sur le même modèle une série de
grandes collections embrassant toutes les branches du savoir humain. Plusieurs
d’entre elles portent sa marque personnelle ; les autres sont l’œuvre
d’une équipe de lettrés qui travaillaient probablement sous sa direction. La
plus importante était l’Encyclopédie historique en 53 livres, dont il ne reste
que les Extraits des ambassades (livres 26-27), puisés dans les Archives impériales . Le Livre des Cérémonies, dû en grande
partie à l’empereur, soucieux de restaurer les anciens usages, est une
encyclopédie du même genre qui conserve des pièces de diverses époques et qui
reçut des compléments postérieurs . L’administration de
l’Empire est représentée par le Livre des Thèmes dont l’attribution au basileus
est douteuse et par le De administrando Imperio , œuvre authentique
de Constantin, dédiée à Romain son fils, qu’il veut faire profiter de sa propre
expérience et de celle de ses prédécesseurs dont il a pu consulter les archives .
D’autres encyclopédies comme les Γεωπονικά
(encyclopédie agricole) et peut-être les Ἰατρικά
(encyclopédie de médecine) sont des remaniements d’œuvres antérieures . Enfin une entreprise
considérable qui passe pour avoir été sinon commandée, tout au moins encouragée
par Constantin, est l’Encyclopédie
hagiographique à laquelle s’attache le nom de Syméon Métaphraste , qui dut pour la
composer se procurer un nombre important de manuscrits écrits en copte ou en
syriaque et les faire traduire en grec. Les arguments d’après lesquels il
aurait vécu au xie siècle sont démentis par les allusions
très claires de certaines translations où il se donne lui-même comme un contemporain
de Léon VI .
Constantin ne se contenta pas d’encourager ces travaux. Il
réorganisa l’Université impériale réformée déjà par Bardas et chercha comme lui
à recruter les professeurs parmi les principaux savants de l’Empire. Non
seulement il fonda des chaires nouvelles, mais il attribua aux maîtres qui les
occupaient un rang honorable dans la hiérarchie et se préoccupa du recrutement
et des progrès des étudiants, qui devaient dans sa pensée former une pépinière
de lettrés parmi lesquels il pourrait recruter ses fonctionnaires .
Il y avait là une conception d’homme d’État, qui était un
retour à la tradition de Théodose II et de Bardas et qui domine l’histoire
universitaire de Byzance. On a d’ailleurs exagéré l’incapacité de Constantin à
s’occuper des affaires. S’il ne fut pas un homme d’action, s’il ne parut jamais
à la tête de son armée, il fut loin de se désintéresser du gouvernement. Ses
historiens ont toujours été embarrassés par les témoignages contradictoires du
Continuateur de Théophane, son contemporain, qui vante son humanité pour ses
sujets, sa clémence, son souci de l’administration des provinces, et des
chroniques postérieures, Skylitzès, Glycas, Zonaras, qui lui reprochent sa
paresse, son amour de la bonne chère et même sa cruauté pour ses ennemis . Ce sont là des
calomnies qui proviennent vraisemblablement d’une source, chronique ou
pamphlet, favorable aux Lécapènes.
En fait on ne peut refuser au
Porphyrogénète certaines initiatives importantes. A peine a-t-il ressaisi le
pouvoir qu’il songe à assurer l’avenir de la dynastie macédonienne et, le
dimanche de Pâques 6 avril 945, il fait couronner basileus Romain, son fils,
par le patriarche Théophylacte . De même un de ses
premiers actes fut d’écarter de l’armée et de l’administration les créatures de
Romain Lécapène et de rappeler aux affaires ceux qui avaient été disgraciés
sous le règne précédent, en particulier Bardas Phocas, fils du rival de Romain,
qui devint domestique des scholes, et ses deux fils, Nicéphore, promis à de
hautes destinées, et son frère Léon, dont il fit des stratèges d’Anatolie et de
Cappadoce .
Avec le patriarche Théophylacte, pour les
écarts duquel les chroniqueurs reprochent à Constantin son indulgence , un autre Lécapène fut
épargné : ce fut un bâtard de Romain, Basile l’Oiseau, dont on avait fait
un eunuque. Il s’insinua dans les bonnes grâces de Constantin, qui le créa
protovestiaire, patrice, puis parakimomène et en fit son confident . Basile lui fut fidèle
et ne prit aucune part aux complots dirigés contre Constantin par de hauts
dignitaires qui, comme Théophane, devaient leur fortune à Romain et avaient
conservé leurs places : le danger était d’autant plus grand que l’empereur
déchu vivait encore, mais Constantin se borna à exiler les conspirateurs ou à
les reléguer dans des monastères .
Enfin le souci réel que le Porphyrogénète
avait des intérêts de l’État et de la protection des petits contre les sévices
des grands apparaît dans les novelles qu’il a publiées. Les unes ne font guère,
et ceci est significatif, que reproduire la législation de Romain Lécapène sur
la protection des biens militaires ; les autres avaient pour objet de réglementer
les frais de justice dans les tribunaux des thèmes et d’obliger les juges et
les hommes de loi à abréger les longs délais imposés aux plaideurs .
Mais si Constantin VII avait le sens de
l’intérêt de l’État et de la majesté impériale, dont il était imbu depuis son
enfance, il manquait absolument de volonté à l’égard des siens. Son panégyriste
le Continuateur de Théophane peint un tableau idyllique de son intérieur
familial . Il préparait son fils
à son métier impérial en lui enseignant tout ce qu’un basileus doit penser,
comment il doit se tenir, parler, rire, s’habiller, s’asseoir. Mais cette
éducation toute formelle, consistant en leçons de maintien, glissa sur l’esprit
frivole de Romain qui se montra paresseux et débauché. Veuf de Berthe de Provence,
il épousa pour sa beauté une certaine Anastasie, fille de Cratéros, de
naissance illustre d’après le panégyriste , ancienne servante
d’auberge connue sous le sobriquet d’Anastaso d’après les autres chroniques : non seulement
Constantin approuva ce mariage, mais il le fit célébrer en grande pompe au
Justinianos et donna à sa bru le nom de Théophano , sans se douter qu’il
préparait ainsi sa perte. Ce fut en effet cette femme ambitieuse et éhontée,
qu’on a pu appeler la Frédégonde byzantine, qui poussa Romain à empoisonner son
père à deux reprises . Constantin montra
d’ailleurs la même faiblesse pour l’impératrice Hélène et pour Basile l’Oiseau
qui s’entendaient pour vendre les dignités et les fonctions et pour des
fonctionnaires tarés comme le Préfet de la Ville, Théophile, voleur avéré,
qu’il voulut destituer plusieurs fois et qu’il finit par créer patrice et
questeur, chef de la justice .
Affaibli par la maladie et probablement par le poison,
Constantin Porphyrogénète se rendit aux thermes de Pythia en Bithynie , fit un pèlerinage aux
couvents de l’Olympe et mourut à son retour (novembre 959) .
Romain II. — Il laissait sa
succession à un adolescent débauché et criminel, dont les chroniqueurs vantent
les dons naturels qui auraient été corrompus par son entourage , mais qui avait en
réalité une nature vulgaire, incapable de s’intéresser à une affaire sérieuse
et qui ne vit dans le pouvoir qu’une facilité plus grande à satisfaire ses
goûts cynégétiques et crapuleux. Il s’adonna à ses plaisirs avec une telle
fougue qu’il mourut à la suite d’un surmenage physique, à moins que, selon une
autre version incontrôlable, mais douteuse, il n’ait été empoisonné par
Théophano , à laquelle cependant
il avait laissé toute liberté, allant, pour satisfaire sa haine contre
l’impératrice Hélène et ses filles, jusqu’à chasser ses cinq sœurs du palais et
les forcer à entrer en religion .
Heureusement pour l’Empire, l’indifférence même que Romain
montrait pour les affaires publiques permit à l’homme d’État remarquable sur
lequel il s’était déchargé entièrement des soucis du pouvoir, de sauvegarder
les résultats acquis sous Constantin VII : Joseph Bringas, eunuque en
grande faveur sous le règne précédent, successivement logothète du trésor, puis
grand-drongaire de la flotte, fut créé parakimomène par Romain II et gouverna
l’Empire sans contrôle, aidé par de bons collaborateurs . Ce fut à lui qu’on dut
les magnifiques succès militaires de ce règne si bref. La seule initiative du
basileus fut de nommer grand-hétériarque et patrice le moine défroqué Jean
Chœrina, chassé du palais par Constantin VII pour ses mœurs infâmes .
Romain II mourut le 15 mars 963, à l’âge de 24 ans, après
avoir régné 3 ans et 4 mois . Théophano lui avait
donné deux fils, Basile et Constantin, couronnés empereurs, le premier à l’âge
de 3 ans (22 avril 960) , le second en 961 , et deux filles, Théophano
et Anne, la future épouse du grand prince russe Vladimir.
Affaires extérieures. — Romain Lécapène avait
si bien organisé la diplomatie, l’armée et la marine que, malgré
l’insignifiance de ses deux premiers successeurs, la situation extérieure de
l’Empire non seulement resta excellente, mais fut encore améliorée par des
succès diplomatiques et militaires qui furent comme la préface de l’épopée
byzantine. Grâce à ses ressources l’Empire put lutter en même temps sur quatre
fronts : sur le Danube, dans la Méditerranée orientale, en Mésopotamie, en
Italie.
Au nord la paix continua à régner du côté des Bulgares et
Constantin VII eut les meilleures relations avec le tsar Pierre, dont les ambassadeurs
prenaient le pas sur ceux des autres souverains . Avec les Hongrois le
traité signé en 943 fut sans doute
renouvelé et des princes magyars fréquentèrent la cour de Constantin VII et
furent baptisés . L’écrasement des
Hongrois par Otton Ier à la bataille d’Augsbourg (955) diminua
beaucoup leur prestige et en 958 leurs bandes ayant envahi la Thrace furent
massacrées en grande partie ou mises en fuite . Des relations
commerciales se développèrent entre Byzance et la Hongrie, mais les tentatives
pour attirer le peuple magyar vers l’Église grecque produisirent peu de
résultats .
Du côté de la Russie un succès diplomatique
important fut la réception à Constantinople, en 955, de la veuve d’Igor, la
princesse Olga.
Il est faux qu’elle ait été instruite et
baptisée par Polyeucte (qui n’était pas encore patriarche), comme l’affirment
Nestor et des chroniques postérieures . Déjà chrétienne, elle
amenait avec elle son chapelain. La magnifique réception qui lui fut faite n’en
préparait pas moins la conversion de la Russie par des missionnaires
byzantins .
Fronts arabes. — La lutte contre
l’islam en Asie Mineure et en Mésopotamie, dans l’Archipel et dans la
Méditerranée occidentale, reste le principal souci du gouvernement impérial et
il existe une continuité parfaite entre la politique arabe de Romain Lécapène
et celle en vigueur dans la période suivante : entreprises diplomatiques
distinctes dans les divers États musulmans afin d’isoler l’adversaire du moment,
esprit d’offensive, accord des opérations terrestres et maritimes, armées
solides dirigées par des chefs de guerre de premier ordre.
En Orient le principal ennemi est toujours
le Hamdanide Seïf-ad-Daouleh, émir d’Alep, mais par bonheur pour l’Empire sa situation
n’est pas bien assise et il est toujours en difficulté avec l’Ikhchide, maître
de l’Égypte et de Damas et allié de Byzance . Redevenu émir de
Tarse, après la mort de l’Ikhchide, Seïf-ad-Daouleh consentit à l’échange de
prisonniers, décidé entre son prédécesseur et l’Empire . Ce ne fut qu’une
courte trêve. Profitant des embarras de l’émir hamdanide en Égypte et en Syrie,
le gouvernement impérial envoya Bardas Phocas réoccuper les villes de
Mésopotamie et de la frontière arménienne, Germanicia (Marasch) et Erzeroum
(948-949) . Seïf ne réagit pas,
étant occupé par des luttes intestines qui suivirent le meurtre de son fils par
son poète favori. La situation étant calme en Asie, le gouvernement impérial
crut le moment favorable à l’exécution d’un grand dessein préparé depuis
longtemps : la reprise de la Crète, dont les corsaires continuaient à
écumer impunément les côtes de la Grèce et les îles .
L’expédition fut précédée de grands
préparatifs diplomatiques et militaires. Deux ambassades furent envoyées de
Constantinople à Cordoue au calife Abd-er-Rahmân III (les Sarrasins de Crète
continuant à avoir des relations avec l’Espagne), en 947 et 949. Elles
aboutirent à la signature d’un traité d’amitié, gage de la neutralité du
calife, et à de curieuses relations littéraires et artistiques . Un immense effort
naval et militaire fut accompli . De petites escadres
allèrent croiser dans la Méditerranée occidentale et l’Adriatique pour
interdire toute tentative d’intervention en faveur des corsaires. Chaque thème
dut fournir son contingent de troupes ou de navires. Malheureusement
l’expédition était dirigée par un chef inexpérimenté, Constantin
Gongylès ; après avoir pu débarquer heureusement en Crète, il laissa
surprendre son armée, qui fut massacrée presque entièrement par les Arabes
(949) . Les pirateries
recommencèrent de plus belle.
Quelques mois plus tard, au mois d’août
950, Seïf-ad-Daouleh prenait l’offensive et commençait contre l’Empire une
guerre sans merci qu’il devait poursuivre jusqu’à sa mort en 967. Il débuta par
une attaque brusquée, envahissant la Cappadoce et marchant sur Constantinople,
mais, l’hiver venant, abandonné d’une partie de ses contingents alliés, il dut
battre en retraite et le 26 octobre tomba dans une embuscade que lui tendit le
domestique des scholes, Bardas Phocas : une grande partie de son armée fut
tuée ou capturée et le butin des Grecs fut considérable . Une deuxième tentative
de l’émir pour pénétrer en Cappadoce en 951 échoua de nouveau et la guerre fut
reportée par les stratèges byzantins en Cilicie et en Mésopotamie avec des
alternatives de succès et de revers (952-959) . Jusqu’en 958
Seïf-ad-Daouleh soutint victorieusement les attaques des Grecs, mais sa
résistance commença à faiblir. En 958 le futur empereur Jean Tzimiskès prenait
les villes de la Mésopotamie septentrionale, allait assiéger avec succès
Samosate sur l’Euphrate, infligeait une grande défaite à l’émir lui-même et
poursuivait son armée en déroute en faisant de nombreux prisonniers . Dès 960 la région située
à l’est de l’Euphrate devenait le thème de Mésopotamie .
La situation des armées byzantines en
Orient était donc excellente au moment de la mort de Constantin Porphyrogénète
et ce fut ce qui décida le chef du gouvernement de Romain II, Joseph Bringas, à
tenter une nouvelle expédition en Crète, tout en laissant en Mésopotamie une
armée commandée par Léon Phocas ; son frère, Nicéphore. qui avait succédé
comme domestique des scholes à son père en 954 , fut rappelé d’Orient
et désigné comme chef de l’expédition, dont le projet rencontrait une assez
forte opposition au Sénat .
En un temps assez court une armée composée
des corps d’élite de la garde et de troupes des thèmes d’Asie et d’Europe fut
rassemblée, tandis que, sous le commandement du chitonite Michel et des
stratèges des thèmes maritimes des Cibyrrhéotes et de Samos, une flotte immense
était formée de transports et de navires de guerre munis de feu grégeois . Nicéphore Phocas
s’embarqua avec l’élite de l’armée à Constantinople (fin juin 960) , mais la concentration
de l’armée et de la flotte se fit à Phygèles, petit port au sud d’Éphèse, d’où
partit l’expédition . Le débarquement eut
lieu après un combat assez vif avec les Sarrasins et Nicéphore, après
avoir reformé son armée, marcha sur la capitale de l’île, Chandax (Candie),
dont il établit le blocus par terre et par mer. L’émir de Crète avait demandé
des secours au calife fatimite d’Afrique et à celui de Cordoue, mais son appel
ne fut pas entendu et les quelques milliers d’Arabes qui débarquèrent furent
taillés en pièces. L’hiver fut également dur pour les assiégés comme pour les
assiégeants auxquels Bringas dut envoyer des approvisionnements. Sept sorties
des habitants furent successivement repoussées. Grâce à ses machines de siège
Nicéphore put faire ouvrir une brèche dans les murailles de Chandax et le 7
mars 961 la ville fut prise d’assaut et les habitants massacrés en masse ou
faits prisonniers .
La prise de Chandax fut suivie de la
soumission de l’île entière, à laquelle Nicéphore donna une organisation
provisoire, jusqu’au moment où elle fut érigée en thème sous le gouvernement
d’un stratège .
La reprise de la Crète à l’islam était un événement d’une
portée considérable. Depuis 137 ans elle était le repaire des pirates, qui arrêtaient
la navigation dans la Méditerranée et désolaient périodiquement ses rivages.
D’autre part l’expédition de Nicéphore, à laquelle avait participé un nombreux
clergé, revêtait le caractère d’une guerre sainte qui s’était terminée par la
victoire du Christ. La fermeture des mosquées, le rétablissement du culte
chrétien, la conversion des Arabes entreprise par des missionnaires donnèrent à
l’Empire un immense prestige dans la chrétienté entière aussi bien que dans le
monde musulman. Le vainqueur de la Crète, déjà très populaire dans l’armée, fut
acclamé avec enthousiasme à son retour à Constantinople et reçut les honneurs
du triomphe .
Pendant que Nicéphore Phocas se couvrait ainsi de gloire, son
frère Léon infligeait une défaite retentissante à Seïf-ad-Daouleh, qui revenait,
chargé de l’immense butin qu’il avait fait par un raid audacieux dans le thème
de Charsian, situé au-delà de l’Halys : surpris au passage du Taurus
oriental, l’émir dut abandonner son butin et s’enfuir jusqu’à Alep, après avoir
perdu la plus grande partie de son armée (novembre 960) .
Le gouvernement impérial résolut de profiter de cet
affaiblissement des forces du Hamdanide pour reprendre l’offensive en Orient.
Après un bref séjour à Constantinople, Nicéphore Phocas fut renvoyé en Asie
avec pour objectif la conquête de la Cilicie d’où partaient les incursions en
territoire byzantin et qui était le principal centre de piraterie après la
Crète ; d’autre part, la Cilicie était la porte de la Syrie .
Dans une première campagne (janvier-février
962) Nicéphore réussit à prendre en 22 jours 50 à 60 villes ou châteaux , et de nombreux
prisonniers ; puis, au début du carême, il se retira en Cappadoce pour
réorganiser son armée. Ce fut seulement dans l’automne de 962 qu’il reparut en
Cilicie où il prit Anazarb (Aïn-Zarba), qui commandait la route de Syrie, des
abords de laquelle il s’empara . Seïf-ad-Daouleh, qui
n’avait plus que des forces insuffisantes, ne put disputer les passes de
l’Amanus à Nicéphore, qui, après avoir pris plusieurs villes, atteignit
l’Euphrate à Mabough (Hiérapolis) et marcha sur la grande
ville d’Alep, capitale de Seïf, puissamment fortifiée, dont il s’empara après
un siège de 11 jours (20-31 décembre 962), mais sans pouvoir prendre la
citadelle. Ne se sentant pas en force pour occuper la Syrie, Nicéphore battit
en retraite en emmenant une nombreuse troupe de prisonniers et un butin
considérable . Ce fut pendant son
retour qu’il apprit que Romain II était mort le 13 mars 963 : cet événement
allait changer le cours de sa destinée.
La politique italienne. — Pendant la
même période des règnes de Constantin VII et Romain II, l’Empire ne remporta
pas en Italie de succès aussi éclatants qu’en Orient, mais sa domination s’y affermit
peu à peu et son prestige s’accrut aux yeux des populations et des princes
indigènes. Au moment de la chute de Romain Lécapène, le thème de Longobardie
était troublé par des révoltes et une émeute sanglante éclata, à Bari en 946.
Réconciliés avec les Fatimites d’Afrique, auxquels Constantin VII avait refusé
de payer le tribut habituel, les Arabes de Sicile occupaient Reggio ainsi que
plusieurs villes de Calabre et soutenaient les révoltes des sujets de
Byzance .
La situation fut donc très critique jusqu’à
956, année où le gouvernement impérial put envoyer en Italie une flotte
importante avec une armée tirée des thèmes de Thrace et de Macédoine sous le
commandement du patrice Marianos Argyros, investi de l’autorité suprême en
Italie avec le titre de stratège de Calabre et de Longobardie. Marianos réprima
les révoltes, rétablit l’influence impériale en Campanie et prit l’offensive
contre la Sicile où il s’empara de la ville de Termini. Après une dernière et
infructueuse tentative pour envahir la Calabre, l’émir de Sicile signa avec
l’Empire une trêve qui dura jusqu’à l’avènement de Nicéphore Phocas
(958-963) , tandis que Constantin
entretenait de bons rapports avec les Fatimites .
En même temps le gouvernement impérial
continuait à étendre son influence sur l’Italie centrale. Constantin VII se
déclarait le protecteur de Lothaire, fils de son allié Hugue de Provence,
détrôné par Bérenger, marquis d’Ivrée. Lothaire, frère de la fiancée de Romain
II, avait été proclamé roi d’Italie sous la tutelle de Bérenger qui crut
prudent de charger Luitprand, évêque de Crémone, d’aller négocier à
Constantinople (948)
[1207]
, mais Lothaire mourut
en 950 et les rapports avec Bérenger paraissent avoir cessé : le prestige
de Byzance était prédominant même à Rome, où le pape Jean XII, fils d’Albéric
II, prince des Romains , datait ses actes par
les années de règne du basileus suivant un protocole abandonné depuis Hadrien Ier .
2. La grande offensive (963-976)
Les victoires magnifiques du règne de Romain II, l’anéantissement
du principal centre de piraterie dans la Méditerranée, la capture pour la
première fois d’une capitale musulmane de l’importance d’Alep ne furent que le
prélude d’une expansion en Orient, qui se poursuivit sans interruption, à peine
ralentie par les difficultés intérieures, jusqu’à la mort de Basile II en 1025
et même, à certains égards, jusqu’au dernier quart du xie siècle. La première période a pour
protagonistes deux chefs militaires dont l’association au trône fut imposée aux
représentants de la dynastie légitime, la seconde partie de cette épopée est
l’œuvre du plus illustre représentant de cette dynastie.
Les princes-tuteurs. Nicéphore Phocas. — Romain II
laissait pour lui succéder deux enfants déjà associés à la couronne, mais dont
l’aîné, Basile, avait six ans et le second, Constantin, trois ans. Avant sa
mort, il avait décidé que Théophano exercerait la régence, que Bringas
continuerait à diriger le gouvernement et Nicéphore Phocas à commander l’armée
d’Asie . Les événements
rendirent ces dispositions caduques. Théophano, qui détestait Bringas, appela à
Constantinople Nicéphore Phocas, qui reçut un accueil triomphal, mais à qui le
parakimomène voulait faire crever les yeux pour avoir abandonné son armée
(avril 963). Bientôt le danger fut tel que Nicéphore se réfugia à
Sainte-Sophie, mais grâce à l’intervention du patriarche Polyeucte, il fut
amené au palais où, après s’être engagé par écrit à ne rien entreprendre contre
les droits des deux jeunes empereurs, il reçut la confirmation de son
commandement de l’armée d’Asie et alla en reprendre possession (mai 963) .
Bringas ne se tint pas pour battu et dans sa haine aveugle il
entreprit de susciter un rival à Nicéphore parmi ses compagnons d’armes et
s’adressa à Jean Tzimiskès et à Romain Courcouas, qui s’empressèrent de tout
révéler à leur chef et le mirent en demeure de se laisser proclamer basileus.
Le 3 juillet 963, à Césarée en Cappadoce, Nicéphore Phocas était hissé sur le
pavois, puis couronné par le métropolite. Un ultimatum au nom de l’armée fut
dépêché à Bringas et au Sénat et le nouveau basileus marcha sur
Constantinople . Le 9 août il était à
Chrysopolis, tandis que dans la Ville Impériale une émeute formidable éclatait
contre Bringas désemparé . Le 16 août, grâce à
l’intervention de l’ancien parakimomène de Constantin VII, Basile, bâtard de
Romain Lécapène, Nicéphore Phocas faisait son entrée solennelle à
Constantinople et était couronné à Sainte-Sophie par le patriarche
Polyeucte . Le 20 septembre
suivant, son mariage avec Théophano était célébré à la Nouvelle Église de
Basile, non sans une opposition, assez vive et difficile à expliquer, du patriarche .
A la différence de Romain Lécapène, Nicéphore devait l’Empire
à une révolte militaire, mais son pouvoir reposait sur la même fiction, d’après
laquelle, tout en étant basileus, pleno
jure, il était simplement associé au trône des deux héritiers légitimes. En
outre sa situation de prince-époux eût dû consolider son pouvoir, mais ce fut
justement ce qui causa sa perte.
Issu d’une maison de l’aristocratie militaire, qui avait donné
à l’Empire deux familles de chefs de guerre et d’hommes d’État de premier
ordre, Nicéphore Phocas était âgé de 50 ans au moment de son avènement. Sa
glorieuse carrière avait commencé sous Constantin VII, qui l’avait nommé
stratège d’Anatolie, puis l’avait fait succéder à son père comme domestique des
scholes d’Orient . Ses magnifiques
victoires sur les Arabes lui assuraient une immense popularité, qui est la
vraie raison de son arrivée à l’Empire. Parfait chef de guerre, il ne vivait
que pour ses soldats, qu’il savait entraîner et auxquels sa vigueur
exceptionnelle lui permettrait de donner l’exemple dans la mêlée. Mais il avait
un caractère taciturne et sombre qui le rendait impitoyable pour les crimes
militaires. Ce soldat accompli était en même temps un grand mystique. Il avait
puisé son goût pour l’ascétisme auprès de son oncle, Michel Maleinos, higoumène
d’un monastère thessalien, qui lui donna comme directeur spirituel le moine
Athanase, regardé de son vivant comme un thaumaturge. Athanase exerça une
influence profonde sur Nicéphore, qu’il détourna d’entrer dans un monastère, le
trouvant plus utile à la défense de la chrétienté. Il fut à ses côtés pendant
l’expédition de Crète et une part du butin lui fut attribuée pour fonder la
célèbre Laure dans les solitudes de l’Athos . Il n’en blâma pas
moins le mariage de son fils spirituel avec Théophano et il fallut pour
l’apaiser que Nicéphore lui promît d’accomplir son vœu monastique dès que les
affaires publiques le lui permettraient .
Le gouvernement de Nicéphore fut donc, avant tout, celui d’un
empereur militaire. Non seulement pendant son règne si court il dirigea
lui-même trois expéditions en Cilicie (965) et en Syrie (966 et 968) mais
toutes les mesures qu’il prit furent subordonnées aux intérêts de l’armée, à
son recrutement, à son équipement, à son bien-être. C’est ce qui explique le
caractère de ses lois sociales, fiscales et même religieuses. Représentant de
la noblesse foncière, il revient sur la législation de Lécapène en accordant
aux puissants le droit de préemption sur les grandes propriétés tombées en
déshérence et, s’il permet aux
possesseurs de ces biens de revendiquer leur lot après trois ans
d’absence , il triple la valeur de
ces lots et donne ainsi au
recrutement de l’armée un caractère aristocratique.
Lorsqu’il s’agissait des intérêts de l’armée, Nicéphore Phocas
ne ménageait même pas l’Église, et ce fut certainement le souci de protéger son
recrutement qui inspira sa novelle de 964 interdisant toute fondation nouvelle,
monastique ou autre, et enrayant ainsi le mouvement qui poussait vers le
cloître un nombre de plus en plus important d’hommes valides et de jeunes gens
au détriment de la défense de l’Empire .
Cependant il faut voir dans cette loi qui fut tant reprochée à
Nicéphore une autre intention bien nette. Les considérants si durs qui
l’accompagnent et qui ressemblent à une satire de la vie monastique montrent
chez ce disciple d’Athanase, porté par ses goûts vers le cloître, un vif désir
de faire cesser les scandales qui déshonorent l’Église et de l’engager sur la
voie de la réforme .
L’intérêt de l’armée n’en reste pas moins sa préoccupation dominante.
Ne va-t-il pas jusqu’à vouloir faire honorer comme martyrs les soldats tués à
l’ennemi ? Et le désir
d’assurer le bien-être de ses magnifiques régiments et de pouvoir les combler
de cadeaux explique son âpreté
fiscale qui lui fit perdre sa popularité, l’augmentation de l’impôt sur la
propriété bâtie (Kapnikon) et la rigueur de sa perception , ainsi que
l’établissement d’impôts spéciaux destinés à alimenter les caisses militaires
et maritimes . Il alla jusqu’à
altérer les monnaies en émettant des nomismata d’une valeur plus grande que
leur poids réel et il fut accusé de
spéculer sur les blés de concert avec son frère Léon Phocas . Enfin le droit qu’il
se fit accorder par le synode de nommer de sa seule autorité tous les évêques
de l’Empire lui servit de prétexte à lever des taxes abusives sur leurs diocèses .
Le basileus était d’ailleurs très dur pour les soldats sous
les armes et d’une indulgence sans bornes pour leurs méfaits au préjudice des
civils . Il n’est donc pas
étonnant que pour toutes ces raisons il ait fini par devenir aussi odieux à
tous ses sujets qu’il était auparavant aimé d’eux. A son retour de sa deuxième
expédition de Syrie (fin 966) le mécontentement se manifesta ouvertement à
Constantinople. En voulant improviser à l’Hippodrome un simulacre de combat
entre ses soldats, il provoqua une telle panique que les spectateurs, croyant
leur dernière heure venue, se précipitèrent vers les sorties et beaucoup périrent
étouffés . Mais ce fût surtout le
jour de l’Ascension, 9 mai 967, qu’une émeute violente éclata sur son passage,
alors que suivant l’usage il se rendait au monastère de la Source. Les émeutiers furent
cruellement châtiés et Nicéphore, craignant pour ses jours, fit fortifier le
Grand Palais et construire au Boucoléon, sur la côte de la Propontide, un
véritable château fort, où il s’enferma au grand mécontentement du peuple .
Ces précautions étaient vaines et il ne put échapper au destin
que des inconnus lui avaient prédit plusieurs fois . Après une entente entre
Théophano, qui avait fini par abhorrer son époux, et Jean Tzimiskès, que le
basileus soupçonneux avait disgracié et éloigné du palais , dans la nuit du 11 au
12 décembre 969 Nicéphore Phocas fut atrocement massacré dans son château du
Boucoléon, et le chef des assassins était son meilleur ami d’autrefois, son
plus fidèle lieutenant, Jean Tzimiskès, qui ne craignit pas, le meurtre achevé,
de prendre la place de sa victime sur le trône impérial .
Jean Tzimiskès. — Comme Nicéphore
Phocas, Jean Tzimiskès appartenait à la haute aristocratie. D’origine
arménienne (son vrai nom était Tchemchkik ou Tchémeschaguig), il était allié
par son père aux Gourguen (Courcouas) et par sa mère aux Phocas ; sa
première femme était de la famille de Skléros. Age de 45 ans en 969, de petite
taille, il était renommé pour sa souplesse et sa bravoure. Plein de fougue au
combat, il était adoré des soldats, mais dans la vie ordinaire il montrait un
caractère doux, mesuré, patient, en parfait contraste avec celui de Nicéphore
Phocas ; il était en outre très généreux, mais libertin, aimant les femmes
et la bonne chère. En 969 il était veuf de Marie, sœur de Bardas Skléros .
Pendant que ses complices, à la lueur des torches,
proclamaient son nom dans tous les quartiers de la ville, Jean Tzimiskès
commençait par constituer son gouvernement en appelant au palais le parakimomène
Basile Lécapène, disgracié par Nicéphore. Comme il se promettait de diriger
lui-même les expéditions, Jean voulait laisser un homme sûr à Constantinople.
Basile accepta cette mission, prit toutes les mesures nécessaires au maintien
de l’ordre et fit une véritable hécatombe de tous les fonctionnaires connus
pour leur attachement à Nicéphore Phocas, sans d’ailleurs aucun acte de
violence .
Mais ce pouvoir enlevé par la force restait précaire tant
qu’il n’avait pas été légalisé par le couronnement solennel et, pour y procéder,
il fallait compter avec l’intransigeance bien connue du patriarche Polyeucte.
Jean Tzimiskès, qui tenait avant tout au pouvoir, accepta toutes ses
conditions . Il osa jurer qu’il
n’avait pas porté la main sur Nicéphore et désigna comme coupables deux
patrices qui furent condamnés à mort et exécutés . Il n’hésita pas à
chasser du palais Théophano et à l’exiler à Proti . Il révoqua les
ordonnances de Nicéphore Phocas sur les fondations religieuses et la nomination
des évêques . Enfin, comme
l’exigeait le patriarche, il abandonna sa fortune mobilière et immobilière
moitié aux pauvres de la banlieue, moitié aux hospices de Constantinople . Ces conditions
acceptées et remplies, le couronnement eut lieu deux semaines après le meurtre,
le jour de Noël 969, et le basileus fut absous par un acte synodal de la part
qu’il y avait prise .
Mais la maison des Phocas était trop
puissante pour se résigner au fait accompli. Une des premières mesures de
Tzimiskès avait été d’en exiler les membres les plus influents . Bardas Phocas parvint
à s’échapper de l’île de Lesbos, où il était interné avec son père, le
curopalate Léon : grâce à de nombreuses complicités il put gagner Césarée
de Cappadoce où il rallia les nombreux clients de sa famille et fut proclamé
basileus . Avec une armée qui
grossissait sur son chemin il marcha sur Constantinople et rejeta la tentative
de conciliation de Tzimiskès . Celui-ci fit appel à
son meilleur général, en même temps son beau-frère, Bardas Skléros, le vainqueur
des Russes à Arcadiopolis , qui atteignit Phocas
en Phrygie sur la route militaire de Césarée à Éphèse, et, grâce à des espions
déguisés porteurs de promesses, lui débaucha presque toute son armée et le
força à capituler après l’avoir assiégé dans la forteresse où il s’était
réfugié avec quelques fidèles (fin 970). Tzimiskès se contenta de l’interner
dans un monastère de l’île de Chio avec toute sa famille . Quelques mois plus
tard, Léon Phocas et son fils Nicéphore s’échappaient de Lesbos pendant que
Tzimiskès était en Bulgarie, ralliaient quelques partisans, arrivaient à
Constantinople et essayaient à l’aide d’intelligences de pénétrer au Grand
Palais. Dénoncés, à la suite d’une imprudence, au parakimomène, ils se
réfugièrent à Sainte-Sophie, d’où ils furent tirés de force, conduits aux îles
des Princes et aveuglés .
Tous les efforts que les Phocas firent pour ressaisir le trône
échouèrent donc et, comme pour légitimer son pouvoir désormais consolidé, Jean
Tzimiskès épousa en secondes noces Théodora, sœur de Romain II (novembre
971) .
Prenant en tout le contre-pied de la politique fiscale de Nicéphore Phocas, il
avait fini par se rendre populaire à force de largesses de toute sorte. C’est
ainsi qu’à son avènement il exempte d’impôts les habitants du thème des
Arméniaques, dont il était originaire , que pour remédier à la
disette qui sévissait à Constantinople il réunit de grands
approvisionnements , qu’au retour de sa
campagne victorieuse de Bulgarie il fit faire d’abondantes distributions de vivres
au peuple et supprima au moins pour une année la levée de l’impôt impopulaire
du Kapnikon, imaginé par Nicéphore le Logothète et augmenté par Nicéphore
Phocas . L’armée n’était pas
oubliée dans ces faveurs, comme le montre la novelle exemptant les soldats des
droits sur les esclaves pris à la guerre .
Cependant, malgré cette bienveillance et ces concessions qui
lui étaient imposées par sa situation, Jean Tzimiskès savait à l’occasion se
montrer aussi autoritaire que son prédécesseur, comme le prouve sa politique
religieuse. Très sincèrement dévot, il fut le premier empereur qui fit
représenter le buste du Christ au droit de ses monnaies d’or et de cuivre, avec
au revers la légende en latin Iesus
Christus rex regnantium . Comme son
prédécesseur, il aimait la société des ascètes et il se fit même le protecteur
zélé de la Grande Laure de l’Athos, à laquelle il confirma en les augmentant
les privilèges accordés par Nicéphore Phocas et dont il apaisa le
différend avec la communauté des ermites de l’Athos. Son chrysobulle de 970 est
la véritable charte de fondation de la fédération athonite .
C’est cette prédilection pour le monachisme
qui explique certaines de ses interventions dans le gouvernement de l’Église.
Ainsi, le patriarcat d’Antioche reconquise étant vacant, Jean Tzimiskès imposa
au synode l’élection d’un ermite aussi grossier qu’ignorant, dont le principal
mérite était de lui avoir prédit autrefois l’Empire, Théodore de Coloneia, qui
fut consacré par Polyeucte le 8 janvier 970 . Quelques jours plus
tard Polyeucte mourait après avoir exercé le patriarcat de Constantinople
pendant 13 ans et 10 mois. Par un nouvel acte d’autorité et sans consulter
aucun évêque, le basileus força le synode à lui donner pour successeur un
ascète de l’Olympe, Basile le Scamandrien, qu’il présenta lui-même à
l’assemblée encore vêtu de sa casaque de peaux de bêtes .
Mais si, comme on l’a pensé, Jean
Tzimiskès, échappé à la tutelle sévère et tatillonne de Polyeucte, avait cru
trouver dans la personne de Basile un prélat insignifiant et de tout repos, il
ne tarda pas à être détrompé : en 974 Basile fut accusé d’avoir promis la
succession de Jean à un haut personnage, de mal administrer l’Église et de
transgresser les canons. Cité devant le tribunal impérial, il refusa de
comparaître et déclara qu’il ne se justifierait que devant un concile
œcuménique. Il fut exilé, déposé et remplacé par un autre ascète, son syncelle,
Antoine le Studite (974) .
Au début de l’an 976 le pouvoir de Jean Tzimiskès paraissait
définitivement établi : la seule opposition sérieuse qu’il ait rencontrée,
celle des Phocas, était brisée. Tenant son armée bien en main, il ajoutait à
chacune de ses campagnes un peu plus de gloire au nom romain. Sa dernière
expédition en Syrie avait été une succession de triomphes et il revenait à
Constantinople en rapportant des reliques insignes dans son butin. Il avait
déjà atteint la Bithynie et reçu l’hospitalité d’un grand seigneur, petit-fils
de Romain Lécapène, lorsqu’il fut atteint d’une maladie mortelle, qui passa
chez les contemporains comme due à un poison violent qui aurait été mêlé à ses
aliments, mais qui, d’après la description des chroniqueurs, présentait les
symptômes du typhus, et il revint à Constantinople pour y mourir le 10 janvier
976 .
Les guerres d’expansion. —
L’accroissement territorial de l’Empire à la fin du xe siècle, la reconquête de pays devenus musulmans
depuis Héraclius est l’œuvre de trois empereurs, chefs de guerre et diplomates
de premier ordre : Nicéphore Phocas et jean Tzimiskès, qui n’ont fait que
continuer sur le trône l’œuvre qu’ils avaient commencée comme chefs d’armée,
Basile II, qui les a dépassés par l’ampleur de ses vues et de son génie
stratégique et dont l’œuvre mérite d’être étudiée à part.
L’offensive contre l’islam, qui avait produit de si beaux
résultats sous Romain II, s’est développée de 963 à 976, mais par la volonté de
Nicéphore Phocas, tout en poursuivant la conquête de l’Orient, l’Empire a dû
combattre sur un nouveau font, celui de Bulgarie. D’autre part, dans la période
précédente le principal ennemi de Byzance était l’émir hamdanide ; à la
fin du xe siècle
surgissent devant elle trois adversaires plus redoutables encore : en
Italie, les empereurs germaniques qui, depuis le couronnement impérial d’Otton
le Grand (962), revendiquent l’héritage carolingien ; dans la péninsule
des Balkans, la menace des Russes qui cherchent à s’établir sur le
Danube ; en Orient, les califes fatimites, qui ont conquis l’Égypte
(969-970) et dont leur ardeur de propagande fait pour l’Empire des voisins bien
plus dangereux que le califat dégénéré de Bagdad.
Front d’Orient. — De 963 à 967 la lutte
entre Byzance et l’émir hamdanide se poursuit. La révolution de Constantinople
qui arrêta les opérations permit à Seïf de rentrer à Alep dévastée et de
relever les murailles d’Anazarb en Cilicie, mais il dut bientôt faire face à la
révolte de Nadjâ, son principal lieutenant . Jean Tzimiskès, devenu
domestique des scholes d’Orient, ne put prendre Massissa (Mopsueste), mais
infligea près d’Adana une grande défaite à l’émir de Tarse, venu au secours de
la place (été de 963) ; la famine qui régna en Cilicie arrêta les opérations .
Elles reprirent et d’une manière méthodique
au printemps de 964, lorsque Nicéphore Phocas, bien assis sur le trône, dirigea
lui-même une expédition en Cilicie, après avoir fait de Césarée en Cappadoce
une base importante d’armements et d’approvisionnements. Puis ayant passé les
Portes Ciliciennes, il prit d’assaut Anazarb, Adana et plus de 20 châteaux
sarrasins, ainsi qu’Issus à l’entrée de la Syrie . Après avoir hiverné en
Cappadoce, il reprit sa marche en 965, fit assiéger Tarse par Léon Phocas,
tandis que lui-même attaquait Mopsueste où il entrait par la brèche le 15
juillet, puis il alla rejoindre son frère devant Tarse qui capitula , La Cilicie, qui était
depuis près de trois siècles la base des opérations sarrasines par terre et par
mer contre l’Empire, était délivrée sans qu’il y ait eu la moindre réaction de
la part de Seïf-ad-Daouleh. Elle devenait un thème nouveau, dont le stratège
avait Tarse comme résidence . Durant l’hiver de la
même année la flotte de Nicétas Chalkoutzès occupait l’île de Chypre, qui
redevint un thème particulier . Les possessions
maritimes des Arabes tombaient ainsi une à une et Nicéphore Phocas pouvait
aller célébrer un triomphe éclatant à Constantinople (octobre 965) .
Seïf-ad-Daouleh, qui avait eu fort à faire
pour réprimer les révoltes d’Antioche et d’Alep , obtint de Nicéphore
Phocas un échange de prisonniers qui eut lieu cette fois sur les bords de
l’Euphrate le 23 juin 966 , mais l’émir hamdanide
était à bout de forces et mourut à Alep le 8 février 967, à l’âge de 52 ans,
après avoir passé sa vie à se mesurer avec le grand empire chrétien, dont il
tint souvent les forces en respect .
Ainsi avait disparu le principal ennemi de
Byzance, dont les possessions se présentaient comme un obstacle insurmontable à
sa marche vers l’Orient, et l’occupation de la Cilicie facilitait l’invasion de
la Syrie et de la Mésopotamie. L’expédition entreprise par Nicéphore Phocas
dans l’hiver de 966 en Haute Mésopotamie et dans laquelle il atteignit Dara,
Nisibe, anciennes places-frontières entre l’Empire et la Perse au vie siècle, Maboug d’où il
rapporta la relique insigne dite la sainte
Brique , Antioche, dont il
essaya d’obtenir la reddition, eut le caractère d’un raid, d’une reconnaissance
destinée à frapper les populations, plutôt que d’une entreprise méthodiquement
préparée .
Retenu en Europe par sa rupture avec la
Bulgarie, Nicéphore Phocas ne put reprendre l’offensive en Orient qu’à
l’automne de 968. Par une marche rapide il se dirigea sur Alep, dont le fils de
Seïf-ad-Daouleh avait eu beaucoup de mal à se mettre en possession. Une troupe
de mercenaires égyptiens, commandée par l’ancien secrétaire de Seïf, Kargouyah,
qui voulait défendre les approches de la place, fut culbutée, mais, au lieu
d’assiéger Alep, Nicéphore envahit la Syrie septentrionale, s’empara de Homs
(Émèse), où il fit sa prière dans la mosquée qu’il incendia ensuite, de Djibleh
(Gabala), Arqa (Césarée du Liban), Tortose. Il n’osa assiéger Tripoli, devant
laquelle il se trouvait le 5 novembre 968 . Ayant laissé des
garnisons dans ces villes, il battit en retraite vers le nord et parut devant Antioche,
dont le siège était déjà commencé et dont il organisa le blocus en faisant
reconstruire le château de Bagras, qui commandait le défilé étroit où passait
la route d’Antioche au golfe d’Alexandrette, et en y mettant une forte garnison
commandée par le patrice Michel Bourtzès. Il reprit ensuite le chemin de Constantinople
où il fit une entrée triomphale en janvier 969 .
Avant son départ il avait laissé le
commandement en chef à son neveu Pierre Phocas en interdisant toute attaque de
la ville jusqu’à son retour, mais les événements déjouèrent ses plans. Des
chrétiens d’Antioche firent savoir aux assiégeants que la ville, tombée au
pouvoir d’un aventurier, était en pleine anarchie . A cette nouvelle
Michel Bourtzès, sans avertir les autres chefs, partit la nuit de son château
avec des échelles, escalada les murs de la ville, mais l’alarme ayant été donnée
à la garnison, il aurait été massacré avec les siens, s’il n’eût fait appel, au
bout de trois jours, à Léon Phocas, déjà en marche sur Alep. Rétrogradant aussitôt,
il arriva à temps pour délivrer Bourtzès et il entra lui-même à Antioche avec
toute son armée . Ainsi fut prise cette
ville immense, qui appartenait aux Arabes depuis 638 et dont la vaste
enceinte de Justinien semblait défier les armées les plus fortes. Ce succès eut
un immense retentissement dans le monde musulman, mais Nicéphore Phocas, qui
voulait se le réserver, ne l’apprit pas sans amertume et priva de son
commandement Bourtzès qui, quelques semaines plus tard, devait être son
meurtrier .
Mais l’enthousiasme et l’élan de l’armée
impériale étaient tels que, deux mois après la prise d’Antioche, Pierre Phocas
faisait capituler la capitale des Hamdanides, Alep, défendue par Kargouyah, qui
en avait évincé l’émir et qui signa un traité par lequel il se reconnaissait le
vassal de l’Empire (décembre 969) , à la grande
consternation des Arabes qui voyaient l’Égypte et la Mésopotamie menacées
directement par Byzance.
Les deux guerres russo-bulgares et l’insurrection de Bardas
Phocas empêchèrent Jean Tzimiskès de reprendre l’avance byzantine en Orient.
Cependant, dès qu’il fut délivré du danger des Russes, il se proposa d’en finir
avec le califat de Bagdad, de libérer la Palestine du joug musulman et de
reprendre Jérusalem. Il avait d’ailleurs à compter avec la puissance nouvelle
du calife fatimite, à qui son vizir, Djauher, avait conquis l’Égypte et la
province de Damas, d’où avait été détachée une armée qui tenta de reprendre
Antioche et l’assiégea pendant cinq mois (fin de 970-971) .
Tzimiskès se contenta de nommer Michel Bourtzès
duc d’Antioche avec la mission d’en remettre les fortifications en état . Ce ne fut qu’en 973
qu’il put envoyer en Orient une expédition sous les ordres du domestique des
scholes, l’Arménien Mleh, qui alla ravager les territoires de Haute Mésopotamie,
s’empara de Mélitène, mais échoua devant Amida, où il fut fait prisonnier et
envoyé à Bagdad où il mourut .
Jean Tzimiskès reprit lui-même la direction
de la guerre d’Orient et en deux expéditions mémorables remporta des victoires
décisives. En 974 il se proposa Bagdad comme objectif et, reprenant la route
suivie autrefois par Héraclius, il pénétra dans la haute vallée de l’Euphrate,
puis dans la province arménienne de Taron à l’ouest du lac de Van, où il signa
des traités d’alliance avec le roi Aschod et des dynastes arméniens . Se détournant ensuite
vers le sud, il s’empara d’Amida, brûla Mayafarikin, prit Nisibe (12 octobre)
et conclut avec l’émir hamdanide de Mossoul un traité par lequel celui-ci se
reconnaissait vassal de l’Empire . Traînant après lui un
immense butin, il revint célébrer son triomphe à Constantinople .
Au printemps de 975 il repartait en
campagne, mais cette fois ayant concentré ses troupes à Antioche, il se
dirigeait vers la Palestine, traversant des pays déjà soumis, mais qui devaient
être repris. Comme il marchait sur Damas, le gouverneur arabe prévint son
attaque en signant un acte de vassalité et en acceptant une garnison
chrétienne. Tzimiskès arriva bientôt dans la région des souvenirs évangéliques,
au bord du lac de Tibériade, à Nazareth qu’il épargna, au Thabor qu’il gravit.
Sur sa route il recevait des actes de soumission avec promesse de tribut de la
plupart des villes, de Ramleh, de Jérusalem, d’Acre, de Génésareth et il y établissait
des commandants militaires. Mais toutes les forces envoyées par le calife
fatimite s’étaient retranchées dans les villes de la côte : menacé
d’attaques de flanc et d’encerclement, Tzimiskès remonta vers le nord en
s’emparant de Sidon, de Beyrouth, d’où il rapporta une icône célèbre , de Djebeil (Byblos),
de Gabala où il trouva les sandales du Christ, laissant partout des garnisons.
D’après sa lettre à Aschod III, il se vantait d’avoir soumis en cinq mois toute
la Syrie et il se retrouvait avec toute son armée à Antioche en septembre 975.
Malgré le caractère triomphal de cette expédition, il n’en avait pas moins
reculé devant la puissance fatimite et l’on a vu qu’une maladie mortelle
contractée pendant son retour l’empêcha de jouir du fruit de ses
victoires .
Front des Balkans. Conquête de la Bulgarie
danubienne. — A côté de la guerre perpétuelle contre les Arabes, la
guerre bulgaro-russe, qui n’a duré que quatre ans (967-971) fait figure d’un
simple épisode, mais de son issue dépendait le sort de Constantinople.
La guerre de Bulgarie fut voulue par Nicéphore Phocas. A son retour
de l’expédition victorieuse dans laquelle il avait vaincu définitivement l’émir
hamdanide, il chercha à profiter des embarras intérieurs de la Bulgarie,
affaiblie sous le tsar Pierre par les révoltes des boliades et l’agitation
religieuse des Bogomiles, pour reculer la frontière de l’Empire jusqu’au
Danube . Les Bulgares
fournissaient d’ailleurs un prétexte à la rupture en s’acquittant mal de
l’engagement qu’ils avaient pris, en échange du tribut que leur payait l’Empire,
d’empêcher les Hongrois de passer le Danube pour aller piller la Thrace . Dans l’été de 967 des
ambassadeurs bulgares étant venus réclamer le tribut, Nicéphore leur répondit
par des injures et les fit souffleter en pleine audience , puis il envoya un
ultimatum au tsar Pierre en le sommant de prendre des mesures pour arrêter les
Hongrois. Sa réponse n’ayant pas été jugée satisfaisante, Nicéphore s’empara
des forteresses que les Bulgares occupaient dans la région du Rhodope .
Il y avait juste un demi-siècle que la paix régnait entre la
Bulgarie et l’Empire. Nicéphore ne se dissimula pas qu’il s’engageait dans une
aventure dont l’issue pouvait être lointaine, alors que la lutte contre l’islam
était loin d’être terminée. Il eut donc recours au procédé classique de
Byzance : il fit proposer au prince russe Sviatoslav, fils d’Olga, de
s’allier avec lui contre les Bulgares et lui envoya pour le décider le patrice
Kalocyr, qui parlait le slavon, avec une nombreuse suite et beaucoup d’or . Sviatoslav accepta la
proposition avec empressement, rassembla ses guerriers et sa flotte et débarqua
au sud des embouchures du Danube, à la grande terreur des Bulgares. En quelques
jours il conquit la Bulgarie danubienne et s’installa dans la capitale même du
tsar, à Preslav, entouré de boliades révoltés contre Pierre , comme s’il voulait en
faire le centre de ses États.
Rappelé à Kiev par une invasion des
Petchenègues qui menaçaient de prendre la ville, où se trouvait Olga,
Sviatoslav abandonna la Bulgarie (été de 968), mais il y revint après avoir
repoussé les envahisseurs, plus décidé que jamais à s’installer dans la
péninsule des Balkans, poussé d’ailleurs par Kalocyr qui comptait sur son appui
pour s’emparer du trône impérial .
Nicéphore Phocas, informé de ce plan au
retour de sa dernière expédition en Syrie (janvier 969), n’hésita pas à se
rapprocher des Bulgares, à conclure une alliance avec le tsar Pierre et à
fiancer deux princesses bulgares aux deux jeunes empereurs Basile et
Constantin . Il fit en outre de
grands préparatifs pour attaquer les Russes . Mais le 30 janvier 969
le vieux tsar Pierre mourait après un règne de 42 ans. Nicéphore renvoya
aussitôt en Bulgarie ses deux fils qu’il tenait en otages et l’aîné, Boris, fut
proclamé tsar, mais beaucoup de boliades refusèrent de le reconnaître et le
pays était en pleine anarchie lorsque Sviatoslav à la tête d’une immense armée
traversa le Danube, conquit toute la Bulgarie au nord des Balkans et s’empara
de la Grande Pereiaslavets où se trouvait le trésor royal, ainsi que des deux
héritiers du trône (automne de 969). Au
moment où Nicéphore Phocas était assassiné, les Russes se préparaient à marcher
sur Constantinople et prévenaient l’attaque byzantine en franchissant les
Balkans et en s’emparant de Philippopoli (mars 970) .
La panique fut grande à Constantinople.
Jean Tzimiskès dont le trône était encore mal assuré, essaya de négocier, mais
par deux fois il se heurta aux exigences et à l’insolence de Sviatoslav, dont
les troupes répandues dans toute la Thrace se livraient au pillage . Alors, ne disposant
que d’une petite armée de 12 000 hommes, il la confia à Bardas Skléros,
qui établit son quartier général à Andrinople et, à l’apparition des Russes, se
retira lentement sur Constantinople en évitant la bataille ; mais à la
hauteur d’Arcadiopolis (Lullé-Bourgas), il leur tendit à la faveur des bois une
embuscade qui lui permit de les encercler et de les forcer à s’enfuir en
désordre vers Philippopoli (été de 970) .
Malheureusement Tzimiskès ne put profiter de
cette brillante victoire pour accabler les Russes. Pendant qu’il faisait ses
préparatifs, éclata l’insurrection de Bardas Phocas, contre lequel il fallut
envoyer Skléros avec toutes les forces disponibles laissant en face des Russes
un simple corps d’observation qui ne les empêchait pas de faire des razzias en
Thrace et en Macédoine . Ce fut seulement au
printemps de 971 que le basileus put reprendre ses opérations contre les
Russes. Le 28 mars il passait en revue une flotte de 300 navires qui appareillait
et se dirigeait vers la mer Noire pour pénétrer dans le Danube et prendre les
Russes à revers, tandis que lui-même, avec l’armée qu’il avait formée, allait
rejoindre à Andrinople le corps d’observation commandé par l’incapable Jean
Courcouas . Les Russes n’avaient
pas cherché à défendre les passes des Balkans qui furent franchies sans
difficulté (2 avril). Deux jours plus tard Tzimiskès, après une bataille
acharnée, mettait en déroute le gros des forces russes qui défendaient la
Grande Pereiaslavets (Preslav), prenait la ville d’assaut et y célébrait la
Pâque, le 7 avril .
Sviatoslav s’était posté à Dorystolon pour défendre le
passage du Danube. Sentant les Bulgares prêts à trahir, il avait fait décapiter
300 boliades. Un dernier ultimatum que lui avait envoyé Jean Tzimiskès avait
achevé de l’exaspérer . Aussi, après avoir
formé son armée en phalange serrée, hérissée de lances, avec la cavalerie sur
les ailes, se défendit-il avec acharnement lorsque l’empereur vint l’attaquer
le 23 avril. Il fallut 13 charges de la cavalerie impériale, dont la dernière
fut dirigée par Tzimiskès lui-même, pour venir à bout des Russes et les obliger
à s’enfermer dans Dorystolon. L’empereur en commença aussitôt le siège avec le
secours de la flotte, qui parut devant la place le 25 avril. Après un siège de
trois mois, pendant lequel il fallut repousser de furieuses sorties des Russes,
Sviatoslav livra une dernière bataille dans laquelle la plus grande partie de
ses guerriers fut massacrée et demanda un armistice en offrant de livrer Dorystolon
et de se retirer dans son pays (24 juillet) . Après une entrevue
entre le basileus et le chef russe sur le Danube, Sviatoslav signa un traité
par lequel il s’engageait à ne jamais reparaître dans la péninsule, à ne pas
attaquer Kherson, à prêter son appui à l’Empire contre ses ennemis .
C’était là un immense succès politique, qui fut complété par
l’annexion à l’Empire de la Bulgarie orientale, après l’abdication forcée de
Boris II et la déposition du patriarche Damien. Le Danube redevenait la
frontière de l’Empire, mais la reconquête des territoires perdus depuis le
temps de Constantin Pogonat était incomplète, car une Bulgarie indépendante se
reformait dans la Macédoine occidentale autour des « quatre fils du
comte ».
Politique italienne. — A côté des combats de
géants qui se sont livrés pendant cette période dans les Balkans et en Orient,
l’Italie apparaît comme un théâtre secondaire d’opération, une sorte de colonie
extérieure. Cependant, sous peine de voir anéantis les résultats acquis depuis
Basile le Macédonien et de perdre tout prestige en Occident, l’Empire a dû
défendre ses possessions contre les Fatimites d’Afrique, toujours menaçants, et
contre une puissance nouvelle, celle du roi germanique Otton, couronné empereur
à Rome le 2 février 962 et décidé à revendiquer tout l’héritage carolingien.
Néanmoins Nicéphore Phocas, conquérant de
la Crète, désireux de rétablir complètement la puissance navale de Byzance dans
la Méditerranée, tenta d’affranchir la Calabre du tribut payé aux Sarrasins de
Sicile, mais l’expédition du Patrice Manuel, chargé de porter secours à
Rametta, la dernière ville sicilienne restée à l’Empire, échoua complètement
(octobre 964) et les Arabes levèrent le tribut en Calabre .
Puis, devant la menace germanique, les
ennemis se réconcilièrent et la paix fut signée à Mehedia en 967 entre
Nicéphore Phocas et le calife Al-Muizz , Maître de l’Italie du
Nord et de Rome, Otton, comme successeur de Charlemagne, revendiquait le regnum Italicum tout entier et en 966 il
était descendu en Italie avec une forte armée, désireux d’expulser les Grecs de
l’Apulie et de la Calabre . Comme ses
prédécesseurs il trouva un appui auprès des princes lombards qui cherchaient à
se maintenir indépendants entre les deux empires. Il fit ainsi alliance avec Landolf,
prince de Capoue et de Bénévent, auquel il donna le duché de Spolète et en février 967 il
tenait sa cour à Bénévent et y recevait l’hommage du prince de Salerne .
Nicéphore Phocas, qui ignorait la défection
de Landolf, essaya d’abord la conciliation. Plusieurs ambassades furent
échangées entre les deux souverains (967-968) . Otton, qui eût préféré
acquérir pacifiquement le territoire byzantin, demanda au basileus la main
d’une princesse porphyrogénète pour son fils Otton II qu’il fit couronner
empereur à Rome le 25 décembre 967 . Nicéphore, informé de
ce qui se passait en Italie, fit une réponse évasive qui mécontenta Otton et,
pour se venger, sans déclaration de guerre, il attaqua Bari, capitale des possessions
byzantines, puis, ne pouvant bloquer la ville par mer, il battit en retraite
(mars 968) , il avait cru que ce
coup de force ferait réfléchir Nicéphore et il lui envoya en ambassade
Luitprand, évêque de Crémone, choisi à cause de sa connaissance de la cour
byzantine et du succès de la mission que lui avait confiée Bérenger auprès de
Constantin Porphyrogénète .
Mais le malheureux évêque s’aperçut que les
temps étaient changés dès le jour de son arrivée (4 juin 968) . Dans un récit très
vivant, qui est une des sources les plus précieuses que l’on possède sur la
cour impériale du xe siècle, il fit part à son maître de sa déconvenue. Outré de la conduite
d’Otton, Nicéphore se vengea sur son ambassadeur. Il ne négligea rien pour le
vexer, l’humilier, l’irriter. Devant ses colères naïves se dressait le mur
infranchissable de l’étiquette impériale. Ce fut à dessein qu’il fut mal reçu
et abreuvé d’outrages qui s’adressaient surtout au souverain qu’il
représentait . A la demande en
mariage Nicéphore répondit qu’il donnerait son consentement si Otton renonçait
au titre d’empereur, restituait à Byzance Rome et Ravenne, rompait son alliance
avec Pandolf , Jusqu’à son départ, le
2 octobre, et même pendant son voyage de retour, Luitprand subit toutes les
avanies possibles .
Pendant que l’ambassadeur était mis au
secret Nicéphore Phocas avait
envoyé une flotte de guerre en Italie et Otton, en ayant été averti, n’attendit
pas le retour de Luitprand pour attaquer les thèmes byzantins. Parti de Ravenne
le 31 octobre 968, il célébrait les fêtes de Noël en Apulie et parcourait la
Calabre, mais sans pouvoir en prendre les villes. Son allié Pandolf, qui
assiégeait Bovino, en Apulie, fut fait prisonnier et envoyé à
Constantinople , Dans une seconde campagne
(fin de 969), Otton infligea une défaite aux Grecs à Ascoli et força plusieurs
villes de Pouille à lui payer tribut, mais ne put prendre Bovino qui résistait
toujours au moment où Jean Tzimiskès s’emparait du pouvoir . Le nouvel empereur, se
souciant peu de disperser ses forces, préféra un accommodement avec Otton et
prit comme intermédiaire Pandolf, toujours captif à Constantinople, qui décida
Otton à lever le siège de Bovino et à évacuer les possessions byzantines .
Le résultat de cette négociation fut
l’envoi à Constantinople par Otton de Géro, archevêque de Cologne, qui obtint
pour Otton II la main de Théophano, fille de Romain II et sœur des deux jeunes
empereurs . En échange de cette
alliance, l’empereur germanique renonça à réclamer la Pouille et la Calabre.
Ainsi, avec des forces réduites, l’Empire avait réussi à
sauvegarder ses possessions d’Italie et ce fut même à cette époque qu’elles reçurent
une nouvelle organisation qui resserra leurs liens avec Byzance. Cette réforme
est l’œuvre de Nicéphore Phocas, qui établit en Italie l’unité de commandement
en plaçant sous l’autorité du magistros Nicéphore les deux thèmes de Calabre et
de Longobardie, dont les stratèges étaient jusque-là indépendants l’un de
l’autre (965) . En 975 apparaît le
titre de catepano ou catapan d’Italie, mais son institution date de Nicéphore
Phocas qui, en substituant le terme d’Italie à celui de Longobardie, voulut
s’opposer ainsi aux prétentions d’Otton .
Ce fut dans la même intention qu’il compléta sa réforme administrative
par une réforme ecclésiastique en étendant à l’Apulie l’hellénisation du clergé
qui régnait en Calabre. Il fit de l’archevêque d’Otrante un métropolite en lui
donnant 5 suffragants, mais, si, comme l’avance Luitprand, il fit interdire le
rite latin en Apulie et en Calabre, il faut croire que le décret ne fut pas
observé, car la liturgie romaine demeura en usage en Apulie .
3. L’Œuvre administrative et militaire de Basile
II (976-1025)
L’expansion byzantine, œuvre d’une pléiade d’hommes de guerre
et d’administrateurs, dont trois occupèrent le trône, fut achevée par un
représentant de la dynastie légitime, Basile II, qui donna à l’empire romain
hellénique son maximum d’extension dans des limites territoriales correspondant
à une véritable unité géographique : péninsule des Balkans, Asie Mineure,
Syrie septentrionale, Haute Mésopotamie, Arménie, Transcaucasie, région de
l’Adriatique et de l’Italie méridionale.
Le règne de Basile II, abstraction faite de sa minorité, est
le plus long de l’histoire byzantine. Il a régné effectivement 49 ans . Et c’est aussi le
règne le plus glorieux depuis celui de Justinien, mais entre les deux princes
le contraste est grand. Ni intellectuel, ni théologien, Basile est avant tout
un soldat : il a passé la plus grande partie de son règne hors de
Constantinople à la tête de ses armées et il fut en outre un remarquable
administrateur, préoccupé de questions sociales et de l’avenir de la Romania.
Mais il lui fallut d’abord conquérir son pouvoir.
La lutte pour la couronne. — La mort de
Tzimiskès sans enfant laissait le trône aux héritiers légitimes, tous deux
adolescents, Basile âgé de 19 ans, Constantin de 16 ans, sous la tutelle du
parakimomène Basile Lécapène, qui partageait le pouvoir avec Bardas Skléros, le
héros de la guerre russe. Il était certain que l’aristocratie militaire et terrienne,
dont la puissance sociale était considérable, chercherait à perpétuer le régime
des princes-tuteurs, qui avaient en somme reculé les limites de l’Empire et
abattu ses ennemis. De là entre les grandes maisons féodales une rivalité qui
eut pour conséquence 13 ans de guerre civile. Cette « fronde
asiatique », comme on l’a justement appelée , faillit disloquer
l’Empire et compromettre l’œuvre d’un siècle.
Elle commença par la révolte de Bardas
Skléros, qui voulut enlever au parakimomène la tutelle des empereurs. Destitué
de sa charge de domestique des scholes et nommé duc de Mésopotamie, il fut
proclamé basileus par ses troupes , tint la campagne pendant
trois ans (976-979), marcha sur Constantinople, mit en déroute deux armées
envoyées contre lui, régna en maître dans toute l’Asie Mineure : en 978 il
avait pris Nicée et paraissait sur le Bosphore . Il fallut, pour en
venir à bout, faire appel à Bardas Phocas, enfermé dans un monastère de Chio
depuis sa révolte contre Tzimiskès . Par des manœuvres
savantes Phocas força son adversaire à abandonner le Bosphore, mais se fit
battre par lui près d’Amorium (19 juin 978) . L’année suivante
Phocas qui avait reçu des secours du prince pagratide de Géorgie, rencontra
encore Skléros à l’est d’Amorium et, au cours de la bataille, lui proposa un
combat singulier qui fut accepté et se termina par la défaite du prétendant et
la débandade de son armée (24 mars 979) . Skléros s’enfuit en
territoire arabe où il fut considéré comme un otage , que le grand vizir
Aoud-ed-Daouleh offrit en vain de négocier contre la restitution au califat des
conquêtes byzantines .
Le second acte de cette tragédie fut une
révolution de palais. Pendant la captivité de Skléros à Bagdad, la guerre
civile fut interrompue, mais l’affaiblissement du prestige de l’Empire, qui en
avait été la conséquence, se manifesta par des difficultés que le gouvernement
impérial rencontra dans les pays nouvellement conquis, soit sur la frontière
arabe, soit dans la Péninsule des Balkans où s’était formé un nouvel État
bulgare, soit en Italie où Otton II menaçait les possessions byzantines. Or ce
fut à ce moment que l’aîné des deux empereurs, Basile, qui jusque-là avait mené
une vie de plaisirs, commença à s’intéresser aux affaires de l’État et à
intervenir d’une manière autoritaire dans les résolutions, au grand mécontentement
du parakimomène, inquiet de voir son pouvoir menacé. Une lutte sourde s’engagea
entre le basileus et son tuteur, qui finit par s’entendre avec les chefs
militaires, Bardas Phocas et Léon Mélissénos, mécontents de voir le jeune
empereur régler les opérations sans les consulter. Basile prévint l’attaque,
obligea le parakimomène à se démettre de sa charge et à entrer dans un
monastère, ordonna la confiscation de ses biens, enleva à Bardas Phocas sa
dignité de domestique des scholes pour en faire un duc d’Antioche et pardonna à
Léon Mélissénos . L’Empire avait
retrouvé un chef (983).
A partir de ce moment Basile II, au dire des chroniqueurs,
devint tout autre et comprit « la grandeur de son rôle et les difficultés
de sa haute situation ». Le viveur qu’il était jusque-là se transforma en
ascète couronné. Il ne s’occupa plus que des affaires de l’État, renonçant à
tout luxe, portant des vêtements sombres, sans bijoux, ne songeant plus qu’à
établir son autorité personnelle, jaloux de tout autre pouvoir, même de celui
de son incapable frère, qu’il laissa tout entier à ses plaisirs. Agé à ce moment
de 28 ans, il voulut commander les armées et gouverner par lui-même .
Mais cette transformation n’était du goût
ni de ses conseillers, ni de ses généraux, qui se montrèrent pleins de mauvaise
volonté pendant la première campagne qu’il mena contre les Bulgares en 986 et
qui fut malheureuse . Sur ces entrefaites
Bardas Skléros parvint à obtenir sa libération de l’émir-al-oumarâ et arriva
d’une traite de Bagdad à Mélitène, où il fut proclamé de nouveau empereur . La guerre civile
recommençait avec cette aggravation que Bardas Phocas, aigri par sa disgrâce,
se révoltait à son tour et faisait cause commune avec son vieil adversaire . Mais cet accord entre
les deux Bardas ne fut pas de longue durée. Phocas, convaincu que Skléros le
trahissait, le fit arrêter au cours d’une entrevue et emprisonner dans un
château patrimonial de sa maison (14 septembre 987). Le
même jour il se faisait proclamer empereur et ralliait la plupart des partisans
de Skléros . Au début de l’année
suivante il apparaissait à Chrysopolis et envoyait Mélissénos surprendre Abydos
afin de bloquer Constantinople .
Le danger était pressant et Basile avait
peu de troupes à opposer aux brillants escadrons des thèmes d’Asie et du
Caucase. Avec un esprit de décision il fit appel au grand prince russe Vladimir
qui songeait à convertir son peuple au christianisme et à épouser une
porphyrogénète. Après avoir signé un traité mémorable par ses conséquences
Vladimir envoya à Constantinople 6 000 Russes qui aidèrent les impériaux à
chasser l’armée de Bardas de ses positions . Obligé de battre en
retraite le prétendant alla rejoindre Mélissénos devant Abydos poursuivi par
Basile, qui parvint à incendier sa flotte et l’obligea à livrer une bataille
dans laquelle il trouva la mort et qui fut désastreuse pour ses
troupes .
Cependant le drame n’était pas terminé.
Bardas Skléros, mis en liberté par la femme de Phocas, reprit la campagne et
chercha à intercepter le ravitaillement de Constantinople, mais Basile avait le
très vif désir de terminer la lutte et il fit assurer à Skléros sa grâce
entière s’il se soumettait . Le prétendant accepta
et cessa de porter les chaussures écarlates. Une entrevue touchante et cordiale
eut lieu entre le jeune souverain et le vieux partisan . Skléros, créé
curopalate, se retira à Didymotika, où il mourut le 6 mars 991 .
Le gouvernement de Basile II. Intérieur. — Psellos a
tracé de Basile un portrait physique qui correspond assez bien à la magnifique
peinture du psautier de Venise où il est figuré en costume de guerre, recevant
l’hommage des chefs bulgares vaincus. On y reconnaît le teint clair, le front
vaste, les joues garnies d’une barbe épaisse, le corps bien proportionné, le
regard assuré et franc que décrit l’historien . Entraîné à la marche,
excellent cavalier, la parole brève et sans apprêt, sujet aux accès de colère
et, quand il était joyeux, riant à gorge déployée, Basile avait le tempérament
d’un soldat, mais, comme les grands chefs de guerre, il possédait aussi les
qualités d’un administrateur.
Délivré du parakimomène et des deux Bardas, il n’agit plus
jamais que par lui-même et n’eut ni premier ministre, ni favori, ni favorite
et, ce qui est plus étrange, il ne semble pas qu’il ait jamais été marié et on
ne connaît de lui aucune descendance. Il savait d’ailleurs s’entourer d’hommes
de valeur, guerriers et administrateurs, mais il prenait seul toutes les
décisions importantes. Assurer la prépondérance et la prospérité de l’Empire,
conserver et accroître les résultats acquis, tel fut le but de toute sa vie.
Une de ses principales préoccupations était de grossir son trésor et il laissa
à sa mort 200 000 livres d’or ainsi qu’une grande quantité de joyaux et de
bijoux enfouis dans des caveaux qu’il avait fait creuser en forme de
labyrinthes .
La première œuvre de Basile fut de rétablir la tranquillité
dans l’Empire, mais l’année 989 fut déplorable. L’hiver fut si froid que la mer
fut prise par les glaces. Il y eut en outre le 25 octobre un tremblement de
terre qui renversa des tours de défense et les coupoles de 40 églises, dont
celle de Sainte-Sophie, que Basile fit reconstruire par l’architecte arménien
Tiridate . Mais surtout
l’empereur travailla à la pacification morale et son autorité fut bientôt
incontestée. Pendant tout son gouvernement, de 989 à 1025, il n’y eut à
réprimer qu’un seul mouvement séditieux, celui de Nicéphore Xiphias, stratège
d’Anatolie, et de Nicéphore Phocas, fils de Bardas (1022) .
Basile se souvint surtout que la guerre civile menée par les
deux Bardas avait trouvé son point d’appui parmi les grands propriétaires
d’Asie Mineure, qui, en accaparant les terres des pauvres et en réduisant en
servage les paysans libres, malgré les lois, tendaient à former une féodalité
oppressive pour la population et dangereuse pour l’État, dont elle violait impunément
la législation.
Les plaintes innombrables reçues par l’empereur de ceux qui
avaient été lésés ainsi le déterminèrent à publier sa novelle du 1er janvier 996, par laquelle il abolissait la prescription de 40 ans qui couvrait
les acquisitions illégales des biens des pauvres ; tous les biens de cette
catégorie acquis depuis la première loi de Romain Lécapène (922) devaient être
restitués à leurs propriétaires primitifs sans aucune indemnité, même s’il
s’agissait de biens acquis par l’Église. Les considérants de cette novelle,
regardés comme des scolies ajoutées par Basile, s’élèvent avec indignation
contre le scandale donné par les grandes familles, comme les Phocas ou les
Maleinoi, qui possèdent depuis cent ans des biens injustement acquis .
La loi fut appliquée avec la plus grande rigueur. Philokalès,
simple paysan, qui avait acquis de grands biens par des usurpations et acheté
des dignités palatines, fut ravalé à sa condition première, et on alla jusqu’à
détruire les édifices qu’il avait élevés . Eustathe Maleinos, un
des plus puissants potentats d’Anatolie, ancien auxiliaire de Bardas Phocas,
ayant offert à Basile, à son retour d’Ibérie en 1001, une somptueuse
hospitalité, fut vivement remercié, mais emmené à Constantinople, d’où il ne
put jamais rentrer dans ses domaines, qui furent saisis par le fisc après sa
mort .
Dans cette lutte Basile II, ainsi qu’on l’a dit, dépassait
donc souvent les bornes de la loi et de la justice , mais sa principale
arme contre le maintien de la grande propriété fut le rétablissement de l’allelengyon (caution mutuelle),
obligation pour les puissants d’une
circonscription fiscale de répondre des pauvres incapables de payer la
capitation et les autres impôts ; auparavant
l’allelengyon pesait sur les communautés de villages. Le coup porté ainsi aux
grands propriétaires souleva les plus vives protestations et par deux fois le
patriarche Sergius, appuyé par les plus hauts dignitaires ecclésiastiques,
intervint pour faire revenir l’empereur sur sa décision, mais Basile resta inflexible .
Affaires religieuses. — Le parakimomène était
encore au pouvoir lorsque Antoine le Studite, patriarche depuis 974,
démissionna, au moment où se terminait la première révolte de Bardas Skléros
(980). On a supposé sans preuves qu’il avait favorisé le rebelle, mais
l’histoire religieuse de cette époque est remplie d’obscurités. C’est ainsi
qu’on ignore pourquoi le successeur d’Antoine, Nicolas Chrysoberge, ne fut élu
qu’après un interrègne de quatre ans, qui laisse supposer un conflit entre le
gouvernement et le synode (août 984).
Sous Nicolas Chrysoberge une des premières
initiatives de Basile II, maître du pouvoir, fut la révocation de la novelle de
Nicéphore Phocas interdisant de nouvelles fondations pieuses (4 avril
988) ,
acte de circonstance et peu conforme aux principes de l’empereur, publié au
moment où Bardas Phocas menaçait Constantinople.
Il semble que Basile II ait manifesté son
esprit autoritaire dans l’administration de l’Église, mais à cause du silence
des chroniqueurs, on est réduit à des conjectures. A Nicolas Chrysoberge
succéda en 995 un simple laïc, le
médecin Sisinnius, puis en 1001 le patriarcat échut à un moine, Sergius II
(1001-1019), de la famille de Photius, higoumène du monastère de Manuel, qui,
ainsi qu’il a été dit, désapprouva les lois sociales de Basile .
Bien que les chroniques soient muettes sur ce point, la
question des rapports de Constantinople avec le Saint-Siège a dû tenir une
place importante dans le choix des patriarches. C’était l’époque où la papauté
n’avait échappé à l’ingérence de l’aristocratie romaine que pour subir
l’autorité des empereurs germaniques, qui avaient repris leurs attaques contre
les thèmes byzantins d’Italie .
Aucune question religieuse n’était en
cause, mais on s’explique que Basile II ait cherché à diminuer l’influence
allemande à Rome en prenant parti pour les papes issus de l’aristocratie
romaine contre les papes impériaux. Ce fut d’ailleurs le parakimomène qui dut
accueillir à Constantinople vers 974 le trop célèbre Francon, élu pape sous le
nom de Boniface VII, grâce au tribun Crescentius, et qui lui fournit en 983 les
moyens de rentrer à Rome, où il emprisonna et laissa mourir de faim Jean XIV,
le pape d’Otton II, mais périt lui-même dans une émeute en 985 .
Par contre on n’a aucune preuve que Basile
II ait soutenu Jean Philagathos, archevêque de Plaisance envoyé en ambassade à
Constantinople en 996 par la régente Théophano, qui voulait marier son fils
Otton III à une princesse porphyrogénète : en 997 Philagathos fut porté à
la papauté par le second Crescentius et Grégoire V, le pape allemand, chassé de
Rome. Basile a-t-il favorisé cette élection comme le veut Gfroerer ? Ce
n’est là qu’une conjecture .
Mais ce qu’il serait important de connaître, c’est l’attitude des
patriarches vis-à-vis de Rome à cette époque. On regarde comme apocryphe
l’envoi par Sisinnius et Sergius de l’Encyclique de Photius aux patriarches
d’Orient, affirmé sans preuve par Baronius . S’il y eut un schisme
sous Sergius, ce fut après l’année 1009, le nom du pape étant alors mentionné
dans les diptyques de l’église Sainte-Sophie, au témoignage de Pierre, plus
tard patriarche d’Antioche . Cependant Nicétas
Chartophylax, archevêque de Nicée, affirmait en 1055 la réalité du schisme de
Sergius , et on a été frappé du
fait qu’en 1054 Michel Kéroularios n’avait pas eu à rayer des diptyques le nom
du pape, qui n’y figurait plus depuis longtemps . On a supposé que la
cause de ce schisme était l’élection à la papauté de Benoît VIII, de la maison
de Tusculum, élection appuyée par l’empereur Henri II contre le candidat des
Crescentii. En reconnaissance le pape offrit à Henri II un globe d’or surmonté
d’une croix, symbole de la domination universelle, geste qui aurait été
considéré à Byzance comme une usurpation et un acte d’hostilité .
On sait en somme peu de choses de cette rupture qu’aucune
source historiographique ne mentionne, dont il n’est même pas question au
moment du schisme de 1054 et qui est incompatible avec la démarche que fit à
Rome, auprès du pape Jean XIX, le successeur de Sergius, le patriarche
Eustathe, pour faire reconnaître à l’Église de Constantinople une autonomie
complète et transformer en dyarchie le gouvernement de l’Église
universelle . Le pape était disposé
à céder, mais l’affaire s’étant ébruitée, il recula devant les protestations
des partisans de la réforme ecclésiastique, Guillaume, de Saint-Bénigne de Dijon
et Richard, abbé de Saint-Vanne . On a supposé, sur la
foi d’un obscur chroniqueur allemand dont le témoignage est isolé, qu’une rupture
entre Rome et Constantinople eut lieu en 1028, après l’expédition en Italie de
Conrad II, que le pape Jean XIX couronna solennellement empereur : on
aimerait à voir cet événement confirmé par d’autres sources .
La dernière intervention de Basile II dans les affaires de
l’Église fut un acte d’arbitraire, dont on ignore d’ailleurs la raison.
L’higoumène du monastère de Stoudios, Alexis, ayant apporté le chef de saint
Jean-Baptiste à l’empereur, qui était à l’article de la mort, Basile le créa
patriarche pour remplacer Eustathe qui venait de mourir et le fit introniser
immédiatement sans aucune consultation du synode (15 décembre 1025) .
Conversion de la Russie au
christianisme.
— Mais l’événement religieux le plus considérable de cette période fut la
conversion de la Russie au christianisme, qui étendit en même temps les limites
de la chrétienté et la zone d’influence de l’Empire. On a vu qu’en retour des
6 000 Varègues amenés par Vladimir pour lutter contre Bardas Phocas,
Basile II avait accordé au prince russe par un traité la main de sa sœur, Anne
porphyrogénète .
Sur l’enchaînement des faits on a admis longtemps le récit de
la chronique dite de Nestor : l’enquête de Vladimir sur la meilleure des
religions, sa préférence pour le rite byzantin à cause de la splendeur des
cérémonies, son attaque et sa prise de Kherson pour peser sur la décision des
empereurs qui se hâtent de lui accorder la main de leur sœur, son baptême à
Kherson par des clercs byzantins, suivi de son mariage et de son retour à Kiev
où il détruit les idoles et impose le baptême à son peuple en 989 .
Mais des textes littéraires du xie siècle retrouvés dans les dépôts de
manuscrits, un éloge de Vladimir d’un moine Jacques, une Vie des saints Boris
et Gleb, une homélie du métropolite Hilarion, Sur la grâce, présentent les mêmes faits d’une tout autre manière
qui s’accorde assez bien avec les renseignements des sagas scandinaves et des
historiens arabes .
Il résulte de ces documents qu’en 989 il y avait déjà
longtemps que le christianisme était répandu en Russie et qu’il y avait été
apporté par des missionnaires latins venus de Scandinavie, d’Allemagne, de Moravie,
et une chronique russe mentionne une ambassade du pape Benoît VII (974-984) à
Iaropolk, fils aîné et successeur de Sviatoslav (972-978) . On apprend aussi par
eux que Vladimir s’est fait baptiser de son propre mouvement, que le baptême
lui a été donné à Kiev par des prêtres indigènes en 987, deux ans avant son
mariage avec la princesse byzantine, qu’il a pris Kherson trois ans après son
baptême, par conséquent après avoir traité avec Basile II et à son retour de la
campagne contre Bardas Phocas . On doit donc supposer
que les empereurs n’ayant pas observé les clauses du traité en retardant le
départ de leur sœur pour la Russie, Vladimir a voulu leur forcer la main . Il arriva ainsi à ses
fins et dans l’automne de 989 la princesse Anne partit pour Kherson escortée
par des métropolites et des clercs qui apportaient à Vladimir une couronne
royale et les reliques du pape saint Clément . Après son mariage,
Vladimir restitua Kherson à l’Empire et aida même l’armée et la flotte byzantines
à chasser les derniers Khazars de Crimée et des régions environnantes
(1016) .
De retour à Kiev, Vladimir travailla à la conversion du peuple
russe et à l’extirpation du paganisme, non sans rencontrer des résistances,
particulièrement à Novgorod . On connaît mal
l’organisation primitive de l’Église russe. Les sources grecques n’en disent
rien et les sources russes ont été profondément remaniées par des interpolateurs
hostiles aux Latins, non sans commettre d’énormes anachronismes . Ce qui paraît certain,
c’est qu’avec Anne la Porphyrogénète l’influence de l’Église byzantine s’est
introduite en Russie. Des églises ont été dédiées par Vladimir à saint Basile
et à la Dormition de la Vierge, celle-ci construite en 991 par des architectes
grecs et consacrée en 996 . D’autre part, il
existait déjà une chrétienté russe qui avait ses traditions, sa liturgie, sa
discipline empruntées à l’Occident, peut-être même à l’Église morave des saints
Cyrille et Méthode. Des usages occidentaux sont attestés en Russie, par exemple
la dîme instituée par Vladimir et inconnue à Byzance . On est frappé en outre
des rapports de tout genre entre Vladimir et l’Occident : échanges
d’ambassades avec les papes Jean XV (990-994) et Sylvestre II (1000) , protection accordée au
camaldule Bruno, apôtre des Petchenègues , mariage en secondes
noces du prince russe avec une petite-fille d’Otton II .
Cependant les usages et les rites byzantins finirent par
triompher en Russie, mais ce fut seulement en 1037 qu’un évêque grec fut envoyé
à Kiev et que cette ville devint le siège d’une métropole rattachée au
patriarcat de Constantinople. Elle figure pour la première fois comme telle
dans la notice épiscopale rédigée sous Alexis Comnène .
L’œuvre militaire et territoriale de Basile II. — Les
prédécesseurs de Basile II avaient surtout dirigé leurs efforts contre les
Arabes et il avait fallu l’agression des Russes pour obliger Tzimiskès à
distraire une partie de ses forces du côté des Balkans et du Danube. L’œuvre
militaire de Basile II est d’une plus grande envergure. Il a trouvé moyen de
rassembler des forces suffisantes pour lutter à la fois sur quatre fronts. Il a
fait porter son principal effort du côté du nouvel État bulgare ; il est
arrivé à maintenir et à organiser les conquêtes faites aux dépens des
Arabes : il a poussé la pénétration byzantine chez les peuples du
Caucase ; il a conservé la défensive en Italie jusqu’à la fin de la guerre
bulgare.
Incomparable chef de guerre, connaissant à fond l’organisation
de l’armée et les ouvrages de stratégie, Basile II n’a pour ainsi dire jamais
cessé pendant 39 ans (986-1025) de diriger ses armées en personne sur le
théâtre dont l’importance lui paraissait la plus grande. Ses succès sont dus
d’ailleurs à un coup d’œil sûr qui lui permettait de discerner les endroits
sensibles où il fallait concentrer des forces. Il eut une véritable conception
stratégique qui embrassait l’Empire tout entier. Jamais il ne sacrifia au
hasard ; toutes ses entreprises étaient raisonnées. Comprenant toute
l’importance de la rapidité dans l’action, à la différence des autres
stratèges, il ne tenait aucun compte des saisons et imposait parfois à ses soldats
des campagnes d’hiver .
Si glorieuse qu’ait été l’œuvre de ses deux derniers
prédécesseurs, elle était restée incomplète. Ils n’avaient pu venir à bout ni
du calife fatimite d’Égypte, désireux de reprendre la Syrie et de dominer
l’islam, ni de la maison germanique des Ottons qui continuait à élever des
prétentions sur toute l’Italie, ni de la Bulgarie dont ils n’avaient pu
soumettre que la partie orientale. Obligé de consacrer toutes ses forces à la
lutte contre les Arabes, Jean Tzimiskès n’avait pu s’emparer de la Macédoine
occidentale, où les Bulgares qui fuyaient la domination byzantine s’étaient
groupés autour des quatre comitopouloi,
les fils du comte Nicolas, qui avaient réorganisé l’État bulgare autour
d’Ochrida et étendaient leur autorité sur l’Albanie et l’Épire . En 980 trois des
quatre comitopouloi, David, Maurice et Aaron, avaient péri de mort violente. Le
dernier survivant, Samuel, avait pris le titre de tsar, s’était mis en
relations avec le pape Benoît VII qui lui envoyait une couronne en 982, ainsi
qu’avec les Ottons .
De toutes les menaces contre l’Empire, le soulèvement bulgare
était la plus dangereuse. Basile porta donc tous ses efforts de ce côté, sans
perdre de vue les autres fronts, en y envoyant des expéditions et même en y intervenant
en personne. La seule manière d’apprécier cette œuvre est d’en suivre les
grandes lignes en signalant les résultats dans leur ordre chronologique :
on peut les répartir en quatre périodes dont chacune est marquée par un
événement caractéristique.
La première période, 976-989, est celle des
révoltes qui affaiblissent l’empire et remettent en question les résultats
acquis pendant les deux derniers règnes.
L’offensive bulgare éclate en 980 à
l’avènement de Samuel, qui ne songe pas à reconquérir la Bulgarie danubienne,
mais marche sur la Grèce et, après plusieurs tentatives déjouées par la ruse de
son gouverneur Kékaumenos, finit par prendre Larissa en 986 et s’avancer jusqu’à
l’isthme de Corinthe. Ce fut alors que Basile II, impatient d’agir par lui-même,
organisa une campagne qui força Samuel à abandonner la Grèce, mais se termina
par un grave échec devant Sofia (17 août) . Basile dut faire face
ensuite à la révolte des deux Bardas.
Sur le front arabe il n’y eut pas de grande
opération. Rentré à Alep, l’émir hamdanide Saïd essaya à plusieurs reprises de
s’affranchir du tribut que Bagkour s’était engagé à payer à l’Empire. Il fallut
pour le mettre à la raison trois expéditions de Bardas Phocas contre Alep (981,
983, 986). La dernière provoqua un conflit avec le calife fatimite sous la
protection duquel Saïd s’était placé et Basile, alors en pleine guerre civile,
dut signer avec le calife El-Aziz un traité, qui entre autres clauses
spécifiait que le nom du calife serait prononcé dans les prières de la mosquée
qui se trouvait à Constantinople depuis le viiie siècle .
L’Italie byzantine enfin était mal défendue
pendant cette triste période et n’avait d’autres forces que des milices locales
impuissantes à lutter contre les incursions des Sarrasins de Sicile . Il semble qu’Otton II,
en dépit de son mariage avec une porphyrogénète, ait voulu profiter de cette
situation pour reprendre les projets de son père sur l’Italie méridionale. Ce
fut en vain que le gouvernement byzantin informé essaya de l’en faire
dissuader . Dans l’été de 981 il
était dans l’Italie centrale, mais la mort de son fidèle allié Pandolf, prince
de Salerne et de Bénévent, fut pour lui un affaiblissement . Cependant en janvier
982 il envahissait l’Apulie byzantine qu’il parcourut impunément pendant cinq
mois en prenant ses villes ; mais étant passé
en Calabre, il se heurta à une armée de Sarrasins de Sicile qui lui infligea
une sanglante défaite près de Stilo (13 juillet 982). Lui-même se sauva à
grand-peine en poussant son cheval dans les flots jusqu’à un navire byzantin
qui le recueillit. Ayant reformé son armée à Rossano, il battit en retraite
jusqu’en Longobardie et mourut à Rome en décembre 983 . Les Sarrasins étant
retournés en Sicile, ce furent les Grecs qui profitèrent de la défaite de Stilo
pour rétablir l’autorité impériale en Apulie.
Pendant la deuxième période (989-1001),
Basile II, enfin maître du pouvoir, peut porter ses principaux efforts du côté
de la Bulgarie et de l’Orient. En paix avec la Russie et le calife fatimite, il
s’attaque d’abord aux Bulgares. Ceux-ci, avant la fin de la révolte de Skléros,
marchaient sur Thessalonique et s’emparaient de Berrhoé (Verria), qui en
défendait l’approche à l’ouest . La situation était
grave. Pendant les guerres civiles Samuel s’était emparé d’une partie de la
Dalmatie, du port de Dyrrachium (Durazzo), point de départ pour l’Italie, et du
littoral albanais ; il régnait sur les deux tiers de la péninsule
balkanique . Au printemps de 990
Basile alla lui-même mettre Thessalonique en état de défense et entreprit
contre les Bulgares une guerre qui dura quatre ans et aboutit à la reprise de
Berrhoé . Appelé subitement en
Orient en 995, l’empereur laissa Nicéphore Ouranos, domestique de scholes
d’Occident, continuer la guerre contre les Bulgares .
Basile avait reçu en effet de très
mauvaises nouvelles de Syrie. Rompant la trêve conclue avec l’Empire, le calife
fatimite El-Aziz voulut profiter de la mort d l’émir hamdanide Saïd-ed-Daouleh
(991), laissant un fils en bas âge, pour s’emparer d’Alep, qu’il fit assiéger
(992) . Le mamlouk
Loulou-el-Kébir, régent au nom du jeune Saïd, demanda secours à l’empereur au
moment où les Égyptiens infligeaient une défaite à Michel Bourtzès, duc
d’Antioche, qui avait cherché à secourir Alep (bataille du gué de l’Oronte, 15
septembre 994) . Avec un esprit de
décision remarquable, Basile, abandonnant le champ de bataille bulgare, rassembla
des troupes, ordonna que chaque soldat, monté sur une mule de course rapide,
tiendrait en laisse une mule de rechange, et accomplit l’exploit inouï de
traverser l’Asie Mineure en 16 jours en plein hiver. Après avoir rallié les
contingents d’Antioche, il marcha sur Alep, où son arrivée subite démoralisa
les Égyptiens qui s’enfuirent précipitamment sur Damas . A son retour Basile
trouva moyen de s’emparer de plusieurs places syriennes qui obéissaient au
calife et dans l’automne de 995 il était de retour à Constantinople .
Sur le front bulgare, à la nouvelle du
départ de Basile, Samuel marcha sur Thessalonique, dont le gouverneur,
l’Arménien Aschod de Taron, périt dans une embuscade , mais, n’osant
entreprendre le siège de la grande ville, il envahit la Grèce, s’avança
jusqu’au golfe de Corinthe, puis battit en retraite vers le nord ; mais au
passage du Sperchios, au pied des Thermopyles, il fut arrêté par Nicéphore
Ouranos qui tomba à l’improviste sur son armée, lui infligea une grosse défaite
et l’obligea à s’enfuir dans les montagnes de Thessalie et à franchir le Pinde
pour pouvoir regagner l’Épire (été de 996) . Rentré à Constantinople
d’où il dirigeait les opérations, Basile ne put exploiter cette victoire à
fond, se contenta d’envoyer Ouranos ravager la Bulgarie , mais ne put empêcher
Samuel de s’étendre encore du côté de l’Adriatique où en 998 il s’empara de la
Dioclée (Monténégro) .
Les opérations de la guerre bulgare furent
suspendues et en 999 Basile dut retourner en Syrie où le calife fatimite
El-Hakem, successeur d’El-Aziz, avait infligé une déroute complète au duc
d’Antioche, Damien Dalassenos, tué en combattant (juillet 998) . L’objectif de Basile
paraît avoir été de dégager Antioche menacée, de soumettre les émirs arabes et
de s’assurer de l’obéissance de ceux qui étaient, comme l’émir d’Alep, vassaux
de l’Empire. Le 20 septembre 999 il était à Antioche, s’emparait de Césarée et
de Homs (octobre), mais échouait devant Tripoli (6-17 décembre) et allait
passer l’hiver à Tarse .
Basile avait sans doute l’intention de
continuer sa campagne au printemps suivant, lorsqu’il reçut la nouvelle du
meurtre de David, roi de Haute Géorgie , qui avait prêté
secours à Bardas Phocas révolté et avait dû, pour conserver son État, le léguer
à l’Empire par testament . Basile n’hésita pas à
se mettre en route avec des forces importantes, gagna Mélitène à marches
forcées, reçut un excellent accueil des chefs arméniens, passa près des sources
du Tigre, franchit l’Euphrate et trouva à Havatchich sur l’Araxe un brillant
cortège de princes et de chefs de Géorgie auxquels il distribua des titres.
Après avoir annexé tous les États de David, nommé des gouverneurs dans les
forteresses et reçu les serments des vassaux qui « mettaient le pied sur le tapis », il rentra à Constantinople
par Erzeroum avec de nombreux otages, après avoir accompli une véritable promenade
militaire et porté très haut le prestige de l’Empire dans ces régions .
Les résultats de ces succès ne se firent
pas attendre. A son retour à Constantinople, Basile y trouva le patriarche de
Jérusalem, Oreste, envoyé par le calife fatimite El-Hakem pour demander la
paix. Une trêve de dix ans fut signée entre les deux chefs d’État .
En Italie il ne se passe pas d’événement
important pendant cette période et les possessions byzantines ne sont pas
menacées. La situation n’en est pas moins constamment troublée, soit par des
incursions arabes (siège de Tarente en 991, prise de Matera en Calabre en 994)
ou des révoltes lombardes comme celle de Smaragdus qui s’entend avec les
Sarrasins et tient la campagne de 997 à l’an 1000 . Les garnisons
byzantines sont peu nombreuses et les milices locales peu sûres ; les
habitants de l’Apulie sont réduits à la misère . Il n’y a plus du moins
d’attaque germanique. Théophano est morte en 991 et en 996 Otton III envoie ses
deux précepteurs, Jean Philagathos et Bernward d’Hildesheim, à Constantinople
demander pour lui la main d’une princesse porphyrogénète . Ce ne fut qu’en 1001
que les négociations aboutirent, après une seconde ambassade, celle d’Arnulf,
archevêque de Milan, mais quand il ramena la fiancée impériale en Italie, il
apprit en débarquant à Bari (janvier 1002) qu’Otton III venait de mourir à
Paterno, à l’âge de 22 ans .
Après ces douze années si bien remplies, on arrive à une
période décisive (1001-1018) qui se termine par la soumission de la Bulgarie.
La fin de la guerre avec les Fatimites assurait la sécurité relative de la
frontière d’Orient, ce qui permit à Basile de concentrer toutes ses forces
contre les Bulgares. La conquête totale de la Bulgarie remplit donc cette
période de 17 ans. Disposant d’armées solides et bien entraînées, ainsi que
d’un état-major de premier ordre, Basile II n’en traçait pas moins lui-même les
plans et en dirigeait l’exécution dans le détail. D’une santé robuste, il
bravait les intempéries, mais ne faisait pas en général de campagne
d’hiver : regagnant son quartier général de Mosynopolis, il s’arrangeait
pour faire presque chaque année une apparition à Constantinople. La cause de sa
supériorité était due à l’habileté de ses plans stratégiques qui consistaient à
diviser les forces de l’ennemi pour les envelopper et aussi à sa mobilité
extrême, à son coup d’œil qui le faisait courir au plus grand danger,
n’hésitant pas à abandonner une opération en cours pour aller réparer le
désastre d’un lieutenant.
A la fin de la guerre l’acharnement était inouï des deux
côtés. Basile avait d’abord cherché à gagner les chefs bulgares en leur distribuant
des titres et des honneurs, mais quand il se vit trahi, il devint féroce et
pratiqua le système de la terreur avec une cruauté froide pour abattre les
résistances : lorsque sa victoire fut assurée, il redevint humain et
bienveillant.
Malheureusement les renseignements que l’on possède sur cette
lutte de géants sont rares et incomplets. Une phrase de Yahya nous apprend
qu’après la trêve avec l’Égypte, Basile passa 4 ans en Bulgarie, prenant et
détruisant de nombreuses forteresses et forçant Samuel à fuir devant lui . Skylitzès, dont la
chronologie est défectueuse, rapporte des faits que l’on peut attribuer à cette
période .
Par une attaque dirigée contre la plaine de
Sofia (1001-1002), Basile coupe Samuel de la Bulgarie danubienne, retombée en
son pouvoir pendant les troubles, et la fait réoccuper par ses
lieutenants . En 1003 il dégage les
abords de Thessalonique en reprenant Berrhoé et Servia, séjourne en Thessalie,
où il rebâtit les villes et les châteaux détruits par Samuel. Il envoie les
Bulgares faits prisonniers coloniser le territoire d’Aenos à l’embouchure de la
Maritza, puis en automne, marchant vers le nord-ouest, il s’empare de Vodena,
se rapprochant ainsi du centre de la puissance de Samuel . En 1004 il complète la
conquête de la Bulgarie en s’emparant de Vidin après huit mois de siège, malgré
la diversion de Samuel qui parait brusquement devant Andrinople dont il
massacre les habitants .
Mais Samuel dut évacuer Andrinople
lorsqu’il apprit que Basile, laissant une forte garnison à Vidin, marchait vers
le sud et s’enfonçait au cœur de la Macédoine occidentale. Les deux armées se
rencontrèrent sur le Vardar devant Skoplje (Uskub) : Samuel subit une
grave défaite et dut abandonner le butin d’Andrinople. Romain, dernier fils du
tsar Pierre et gouverneur de Skoplje, capitula et Basile le nomma patrice et
stratège d’Abydos . En quatre ans Samuel
avait perdu la moitié de son empire, dont, à part quelques places, toute la
partie orientale était aux mains de Basile. Ces succès furent complétés en 1005
par la reprise de Dyrrachium, la place la plus importante de Samuel sur
l’Adriatique, qui fut livrée à Basile par son gouverneur, l’Arménien Aschod, le
propre gendre du tsar bulgare .
Entre 1005 et 1014 les sources ne donnent
que des renseignements épars sur les opérations de Basile, qui semble s’être
approché de plus en plus du centre de la domination de Samuel, auquel il ne
restait plus que la région des grands lacs, les montagnes de l’Albanie et la
haute vallée du Strymon . Ce fut dans cette dernière
région qu’eut lieu, le 29 juillet 1014, la bataille la plus décisive de la
guerre. Samuel essaya de défendre la passe de Kimbalongos que Basile empruntait
chaque année pour envahir la Macédoine occidentale . Elle était barrée par
des palissades derrière lesquelles des troupes nombreuses couvrirent les Grecs
de projectiles, mais, pendant que Basile l’attaquait de front, Nicéphore
Xiphias tourna la position et attaqua subitement par derrière les Bulgares qui
s’enfuirent en désordre . Avec une cruauté
raffinée Basile fit aveugler 15 000 prisonniers bulgares et les envoya à
Samuel en laissant un borgne par centaine pour servir de guide. La vue de cette
troupe lamentable fit un tel effet sur le tsar qu’il tomba foudroyé par une
attaque d’apoplexie et mourut le 6 octobre 1014 . Quelques jours après
le fils de Samuel, Gabriel Radomir, était proclamé tsar : la guerre devait
durer encore quatre ans .
Basile exploita sa victoire en achevant
l’occupation des districts du versant occidental du Rhodope (prise de Melnic,
fin 1014) et en envahissant la Macédoine occidentale où Bitolia (Monastir),
Prilep et Ischtip tombèrent entre ses mains (fin décembre) . Les Bulgares étaient réduits
aux hautes terres de la Pélagonie que Basile commença à attaquer en 1016 (prise
de la forteresse de Moglena, août) . Il apprit là que les
Bulgares étaient en pleine guerre civile et que Gabriel Radomir avait été tué
par son cousin Jean Vladislas, fils d’Aaron, acclamé tsar, qui lui offrait de
se soumettre , mais Basile, croyant
cette offre peu sincère, continua sa marche vers l’ouest et occupa Ochrida, la
capitale de Samuel (automne) , puis, au début de
1017, il assiégea Castoria. Une tentative des Bulgares pour s’allier aux
Petchenègues le fit abandonner le siège et remonter vers le nord, mais apprenant
l’échec des négociations, il revint en Pélagonie où Jean Vladislas voulut arrêter
sa marche et subit une grosse défaite (fin de 1017) .
Cependant avec une grande énergie, pendant
que Basile regagnait Constantinople, le dernier tsar bulgare reformait son
armée et allait attaquer Dyrrachium (janvier 1018), mais il était tué dans un
combat . C’était la fin de la
Bulgarie et l’expédition de 1018 fut pour Basile une marche triomphale jusqu’à
Ochrida et à Prespa, où il reçut la soumission des chefs bulgares et des fils
de Jean Vladislas . Après un séjour à
Athènes , Basile célébrait sa
victoire par une entrée triomphale à Constantinople .
La conquête de la Bulgarie était due à la supériorité de
l’armée byzantine sur l’organisation à moitié féodale des Bulgares et d’autre part la paix
avec le calife fatimite avait permis à Basile de disposer de toutes ses forces
pour mener à bien cette gigantesque entreprise ; mais, si favorables que
fussent tous ces avantages, il avait fallu le génie militaire d’un Basile II
pour les mettre en œuvre : pour la première fois depuis Justinien un
empereur régnait sur la péninsule des Balkans tout entière, du Danube à l’extrémité
du Péloponnèse : avec les annexions faites en Orient, l’Empire avait
recouvré son véritable domaine géographique .
Basile montra la même maîtrise dans l’organisation de sa
conquête. Il avait pu apprécier l’humeur farouche des boliades et leur désir
d’indépendance. Aussi il se garda bien d’assimiler de suite la Bulgarie aux
autres thèmes de l’Empire et il nomma pour l’administrer des basilikoi ou commissaires chargés de
l’expédition des affaires en tenant compte le plus possible des coutumes indigènes . Tout en plaçant la
Bulgarie sous un régime militaire, en nommant des Grecs gouverneurs des
forteresses, il conserva la plupart des vieilles institutions bulgares, comme
l’impôt en grains dû par tout propriétaire d’une paire de bœufs . Il montra la même
modération dans l’organisation ecclésiastique en respectant l’autocéphalie de
l’Église bulgare, dont le chef fut l’ancien patriarche, devenu simple
archevêque d’Ochrida, mais dont le successeur fut un Grec du clergé de
Sainte-Sophie .
La quatrième période des entreprises
militaires de Basile (1020-1025) est marquée par son expédition en Géorgie et
par la pacification de l’Italie.
Loin de se reposer après l’heureuse issue
de la guerre bulgare, Basile repart presque immédiatement pour la lointaine Transcaucasie,
où Giorgi, roi des Abasges , avait profité de la
guerre bulgare, s’était emparé de territoires que son père, Bagarat, mort en
1014, avait cédés à l’Empire en échange du titre de curopalate, ainsi que de la
région du Basian , qui avait fait partie
de l’héritage de David, dont Giorgi avait été le fils adoptif . Basile attachait la
plus grande importance à la possession de ces territoires, menacés déjà par la
migration des Turcs Seldjoukides, et n’était sans doute pas fâché de montrer à
ses vassaux du Caucase que l’éloignement ne leur assurait pas l’impunité.
Après avoir concentré son armée à
Philomelion (thème d’Anatolie, sans révéler le but de son expédition, Basile
gagna la région de Karin (Erzeroum) (printemps 1021), où il attendit en vain la
soumission de Giorgi , puis, traversant la
chaîne de partage entre l’Euphrate et l’Araxe, déboucha dans la plaine de
Basian où il rencontra l’armée de Giorgi, lequel, après une bataille indécise
qui coûta de lourdes pertes aux deux adversaires, s’enfuit vers l’Abkhazie,
poursuivi par Basile. Sur son passage l’empereur brûlait les villes de Giorgi
et il gagna ainsi la région de Tiflis où aucun de ses prédécesseurs n’avait
pénétré depuis Héraclius . Là il s’arrêta et alla
hiverner à Trébizonde, où il reçut la soumission de Jean Sempad, roi de la
Grande Arménie, qui avait été l’allié de Giorgi et qui promit de léguer son
royaume à l’Empire après sa mort . Il traita avec le roi
du Vaspourakan (sud du lac de Van), qui, incapable de défendre son État contre
les Turcs Seldjoukides, le céda à l’Empire en échange du titre de magistros et
du gouvernement de la Cappadoce . Giorgi lui-même, à la
nouvelle que Basile se préparait à attaquer l’Abkhazie par mer, fit sa
soumission et céda à l’Empire les territoires en litige .
Tout semblait ainsi terminé et Basile
allait prendre possession de ces territoires, lorsqu’il fut arrêté par la
révolte de Nicéphore Xiphias, stratège d’Anatolie, un des meilleurs généraux de
la guerre bulgare, de concert avec Nicéphore au col tors, fils de Bardas
Phocas. Basile suspendit sa marche et se contenta d’envoyer le stratège des
Arméniaques contre les rebelles, mais Nicéphore Phocas fut assassiné et
Xiphias, fait prisonnier, fut simplement interné aux îles des Princes . Sa révolte avait été
fomentée par Giorgi au moment même où il traitait avec Basile. Invité à
renouveler sa soumission, il ne fit aucune réponse. Exaspéré par cette
duplicité, Basile marcha contre lui, l’atteignit dans le Basian et lui infligea
une déroute complète (11 septembre 1022) . Giorgi, qui s’était
enfui en abandonnant son camp et son trésor, serré de près par les troupes
impériales, implora la paix, que Basile lui accorda aux mêmes conditions qu’au
traité précédent, mais il dut livrer de nombreux otages, dont son fils
unique . Après avoir fait une
démonstration militaire à la limite des terres chrétiennes au nord-ouest du lac
d’Ourmiah, Basile battit en retraite et rentra à Constantinople au début de
l’année 1023 . Il avait achevé
d’annexer à l’Empire en fait ou en expectative toute l’Arménie et la Géorgie,
qui auraient pu devenir le glacis d’une forteresse opposée aux peuplades de
l’Asie centrale.
En Italie, entre les années 1001 et 1025,
pendant que Basile était occupé en Bulgarie et en Orient, les possessions
byzantines furent de nouveau menacées par la reprise des incursions arabes, la
révolte des Lombards alliés aux Normands, l’agression de l’empereur Henri II.
Par une politique habile Basile sut faire face à toutes ces difficultés. Non
seulement il laissa l’Italie pacifiée, mais il se préparait à y intervenir en
personne et à reprendre la Sicile aux Sarrasins lorsqu’il mourut.
Tout d’abord Basile ne sépare pas la
question de l’Italie byzantine de celle de l’Adriatique, dont les rives sont
occupées par Venise, encore à moitié vassale de l’Empire, par la Croatie, par
le thème impérial de Dyrrachium et par celui d’Italie. Tous ces territoires
sont menacés par les mêmes ennemis : les Bulgares, les pirates slaves, les
Sarrasins. Tout entier à la guerre bulgare, Basile fait alliance avec la jeune
puissance maritime de Venise, dont il se considère comme le suzerain. En 992 il
accorde au commerce vénitien dans l’Empire une diminution des droits de douane
et le met à l’abri des extorsions habituelles des officiers impériaux, à
condition que les navires vénitiens seront mis, le cas échéant, à sa
disposition pour transporter des troupes en Italie . En 998 il autorise le
doge Pierre Orseolo à défendre les villes du thème de Dalmatie contre les
attaques des pirates slaves , L’expédition d’Orseolo
en Dalmatie (1001) est un véritable triomphe pour la république de Saint-Marc
et c’est de là que datent ses prétentions sur la Dalmatie . Enfin, en 1004, Venise
s’acquitte de ses obligations envers l’Empire en envoyant une flotte secourir
la capitale du thème byzantin d’Italie, Bari, assiégée par les Sarrasins de
Sicile et prête à succomber . En reconnaissance et
pour renforcer son alliance avec Venise, Basile fit venir le fils du doge à
Constantinople et le maria à une patricienne . Ces événements étaient
gros de conséquences : une nouvelle puissance était née dans l’Adriatique.
Basile entretenait d’ailleurs d’excellents
rapports avec les autres villes maritimes d’Italie et en 1005 c’était une
flotte de Pise qui aidait les Grecs à détruire une escadre sarrasine à la
hauteur de Reggio . La même année
l’empereur envoyait une ambassade à Cordoue, destinée sans doute à obtenir la
fin des pirateries andalouses dans la mer Tyrrhénienne .
Mais un danger bien plus grave encore menaça
bientôt les possessions byzantines. Le 9 mai 1009 éclatait à Bari une
insurrection dirigée par deux membres de l’aristocratie lombarde, Mélès et son
beau-frère Datto, qui chassèrent la garnison byzantine restée sans chef par la
mort du catapan . La faiblesse des
forces byzantines, incapables d’assurer la défense contre les Sarrasins, la
fiscalité et l’insolence des fonctionnaires byzantins vis-à-vis des indigènes
furent les causes de cette révolte, soutenue par des milices locales bien
organisées . Le mouvement s’étendit
bientôt à toute l’Apulie et ce fut seulement 10
mois après le début de la révolte que des forces envoyées en toute hâte par
Basile débarquèrent en Italie (mars 1010) .
Le chef de l’expédition, Basile Argyros,
entra à Bari après un siège de 61 jours et y rétablit l’autorité
impériale . Mélès, sur le point
d’être livré par les habitants, s’enfuit à Bénévent et passa de là en Allemagne
où Henri II lui conféra le titre de duc d’Apulie .
Il se produisit alors un événement dont les
conséquences devaient être incalculables et qui allait singulièrement
compliquer la lutte pour l’Italie méridionale. Depuis les premières années du xie siècle, un grand nombre
de chevaliers normands fuyaient un pays trop peuplé pour ses ressources et trop
bien gouverné pour l’humeur indépendante de ces descendants des vikings , Pèlerins à Compostelle,
à Rome, à Jérusalem, guerriers ou marchands à l’occasion, on les trouvait sur
toutes les routes de l’Europe, partout où il y avait des coups à donner ou à
recevoir et particulièrement dans l’Italie méridionale, où ils ne manquaient
pas de fréquenter le pèlerinage de Saint-Michel au Monte Gargano, en relations
mystiques avec leur Saint-Michel-au-Péril-de-la-Mer , Ce fut là que Mélès
aurait rencontré une troupe de ces pèlerins, auxquels il demanda d’exciter
leurs compatriotes à venir combattre en Italie , mais ce fut
probablement Guaimar, prince de Salerne, qui eut l’idée d’envoyer des
émissaires recruter des troupes en Normandie pour aider les Lombards
révoltés .
Après avoir grossi son armée de ces
auxiliaires, qui arrivaient en grand nombre, Mélès attaqua l’Apulie au
printemps de 1017, infligea plusieurs défaites au catapan Léon Tornikios et
occupa en quelques mois toutes les forteresses des Pouilles . Tornikios fut rappelé
à Constantinople et remplacé par un soldat énergique, Basile Bojoannès, qui
débarqua en Italie avec une armée et des subsides importants en décembre 1017.
Il lui fallut 10 mois pour réprimer les révoltes locales et reconstituer son
armée, puis en octobre 1018, au moment même où Basile en finissait avec la
Bulgarie, il infligea à l’armée lombardo-normande une défaite décisive dans la
plaine de Cannes sur la rive droite de 1’Ofanto. Mélès s’échappa à grand-peine
et gagna l’Allemagne où il mourut en 1020 .
La conséquence de ces deux victoires fut le
rétablissement de l’autorité byzantine en Apulie, en Dalmatie et en
Croatie . Pour défendre le thème
d’Italie, Bojoannès créa une sorte de Marche militaire qui bloquait le massif
du Gargano et lui donna un réduit défensif en créant la ville de Troja sur une
colline élevée qui dominait la route de Bénévent à Siponto et la peupla
d’habitants entraînés à la guerre . Il rétablit enfin
l’autorité de Byzance sur les principautés lombardes . Ce fut en vain que
l’empereur Henri II inquiet de cet accroissement de la puissance byzantine,
entreprit en 1021 une grande expédition qui échoua devant Troja, dont il ne put
s’emparer après un siège de trois mois ; il obtint simplement la
soumission nominale des princes lombards, qui se hâtèrent de reporter leur hommage
à Byzance après son départ .
Ces succès ne suffisaient pas à Basile et
après son retour de sa deuxième expédition d’Arménie, il songea à supprimer le
principal repaire de pirates qu’était devenue la Sicile et à conduire lui-même
les opérations. En avril 1025 il se faisait précéder en Italie par une armée
commandée par le protospathaire Oreste. Après avoir restauré les fortifications
de Reggio, Basile Bojoannès commençait la campagne en s’emparant de Messine,
mais un échec de l’armée d’Oreste le força à rester dans l’inaction .
Basile II, âgé de 68 ans, se préparait à
s’embarquer pour rejoindre Bojoannès lorsqu’il fut terrassé par un mal subit et
il expira le 15 décembre 1025, laissant l’Empire plus grand et plus puissant
qu’il n’avait jamais été depuis Justinien .
4. L’Arrêt de l’expansion byzantine et la fin de la dynastie macédonienne (1025-1057)
La mort de Basile II ne marque pas la fin
de l’expansion byzantine, qui continue à se développer après lui, grâce au
personnel d’élite qu’il a su former et au prestige universel qu’il a donné à
l’Empire, mais il eut pour successeurs une série de princes incapables, dont
les fautes accumulées finirent par compromettre cette magnifique situation. Il
se produisit en effet dans le gouvernement un changement profond qui fut un
véritable retour en arrière : de nouveau la direction des affaires fut
accaparée par les eunuques du Koubouklion impérial, ce qu’on n’avait pas vu
depuis la disgrâce du parakimomène Basile en 980. De là sortit un antagonisme
désastreux entre le gouvernement civil du Palais et les chefs militaires,
comblés d’honneurs et d’avantages sous Basile. Cette rivalité produisit de nouvelles
révoltes militaires qui compromirent la défense de l’Empire au moment où il
était menacé sur ses deux flancs par les ennemis nouveaux qui avaient fait leur
apparition sous Basile : les Normands en Italie, les Turcs en Mésopotamie.
Constantin VIII. — Après la mort
de Basile II sans enfant, le pouvoir passa naturellement à son frère Constantin
VIII, co-empereur depuis sa naissance, mais qui n’avait jamais pris la moindre
part aux affaires. Frivole et indolent, vivant contraste avec son glorieux
frère, taillé en hercule, il ne s’occupait que de sports, luttes, courses de chevaux,
mais ne pouvait supporter la moindre fatigue et détestait tout ce qui pouvait
rappeler la guerre. A son avènement, sa santé était ruinée et son règne
effectif ne dura même pas trois ans (16 décembre 1025 - 11 novembre 1028) , mais fut assez long
cependant pour lui permettre de confier le gouvernement de l’Empire aux
eunuques du Palais et de destituer les meilleurs chefs militaires et les
fonctionnaires qui devaient leur fortune au choix clairvoyant de Basile II, en
les remplaçant par ses créatures. Il était d’ailleurs dur et cruel, accueillant
toutes les calomnies sans discernement et punissant les fautes vénielles de
l’ablation des yeux : il avait la violence des faibles et des poltrons .
De sa femme, Hélène Alypios, Constantin
VIII avait eu trois filles, dont l’aînée, Eudoxie, entra dans un monastère, et
dont les deux cadettes, Zoé et Théodora, étaient ses seules héritières, mais
n’avaient pas encore été mariées . Ce fut seulement en
novembre 1028 que Constantin, étant tombé malade et se sentant perdu, songea à
donner un époux à l’une de ses filles et à lui-même un successeur. Aussitôt les
intrigues allèrent leur train au Palais, les eunuques étant partagés entre deux
membres de la noblesse, Constantin Dalassenos et Romain Argyre. Ce fut celui-ci
qui l’emporta bien que déjà marié. Appelé avec son épouse au chevet du
moribond, il fut mis en demeure d’avoir les yeux crevés ou de divorcer d’avec
sa femme et d’épouser l’une des princesses. Théodora s’étant récusée, Romain
Argyre fut marié à Zoé le 8 novembre, trois jours avant la mort de Constantin.
Les deux conjoints étaient parents, mais le patriarche Alexis leva la
difficulté dans l’intérêt de l’État .
Le régime des princes-époux et adoptés. — L’Empire
connut de nouveau de 1028 à 1057 le régime des princes-époux ou adoptés, mais,
tandis qu’au xe siècle
ce rôle fut tenu par des hommes de premier ordre, qui firent la grandeur de
l’Empire, les princes-époux du xie siècle sont des parvenus médiocres, mal préparés à la mission grandiose que le
hasard leur avait assignée. Incapables de faire face aux dangers très graves
qui menacèrent l’Empire, ils compromirent irrémédiablement la puissance et le
prestige que lui avaient donnés leurs grands prédécesseurs.
Parmi les cinq parvenus qui occupèrent le
trône pendant un demi-siècle, Romain Argyre fut le seul auquel son passé
donnait quelque prestige, le seul capable de commander une armée, mais non
d’obtenir la victoire, ayant plus de prétentions que de qualités réelles . Il appartenait à la
noblesse militaire, dont il partageait toutes les passions, et l’un des actes
les plus importants de ses six années de règne fut l’abolition de l’allelengyon
que Basile II avait institué comme une digue contre l’extension abusive des
grands domaines. Désormais la petite propriété était livrée sans défense aux
accaparements des puissants et ce qui est plus grave, l’existence des biens
militaires, source de recrutement de l’armée des thèmes, était compromise. Les
conséquences néfastes de cette mesure ne devaient pas tarder à se faire
sentir .
Le court règne de Romain Argyre fut
d’ailleurs agité par des intrigues de palais et des complots dans lesquels,
compromise, Théodora fut enfermée au monastère de Pétrion et obligée par Zoé,
qui la détestait, de prononcer ses vœux monastiques . Romain périt lui-même
victime d’une de ces intrigues, dont l’origine fut des plus vulgaires.
Délaissée par son impérial époux, qui avait perdu l’espoir d’avoir d’elle une
postérité , Zoé se vengea en
prenant comme amant le frère d’un eunuque de Romain, paphlagonien d’origine,
que celui-ci avait créé orphanotrophe . Michel, c’était son
nom, fit semblant de répondre à la passion de la vieille basilissa, qui fit
étouffer Romain Argyre dans les bains du palais (12 avril 1034) et, quelques heures
après, fit célébrer son mariage avec le jeune aventurier par le patriarche
Alexis, puis le proclama basileus .
Avec la famille paphlagonienne la dignité
impériale décroît d’un échelon social. Avant d’être basileus, Michel IV avait
été changeur, ainsi que son frère Nicétas. Ses trois autres frères étaient
eunuques et deux d’entre eux, Georges et Constantin, exerçaient le métier
décrié de guérisseur ou empirique. Une de ses sœurs avait épousé un ouvrier
calfat du port de Constantinople . Mais le véritable chef
de la famille et l’artisan de sa fortune était son frère aîné, Jean
l’Orphanotrophe, moine et eunuque, qui avait su se glisser dans la faveur de
Romain Argyre et encourager la passion de Zoé pour son jeune frère, qu’il avait
littéralement poussé au trône et qui prit lui-même, sous le nom de Michel, le
gouvernement de l’Empire. Il commença d’ailleurs par bien établir ses autres
frères et, malgré leur nullité et leur mauvaise conduite, leur confia des
postes de premier ordre . Pour trouver un
exemple d’une pareille ascension sociale il faut remonter jusqu’au fondateur de
la dynastie macédonienne.
L’Orphanotrophe travaillait d’ailleurs avec
zèle à l’expédition des affaires et montrait la plus grande vigilance. Rien
d’important ne lui échappait. Il parcourait lui-même la nuit les rues de
Constantinople, où sa robe de moine lui assurait l’incognito et déjouait, grâce
à sa police, les menées des fauteurs de désordres. On a dit qu’il représentait
la centralisation bureaucratique antérieure à l’influence prise par la
noblesse et il ne ménageait pas
l’aristocratie militaire d’Asie Mineure.
Cependant la seule opposition qui se
manifesta à l’avènement de Michel fut celle de Constantin Dalassène, le
prétendant malheureux à la main de Zoé. Jean l’Orphanotrophe sut l’attirer au
palais, lui fit un excellent accueil et le créa anthypatos , mais peu après, une
émeute ayant éclaté à Antioche, Nicétas, que l’Orphanotrophe avait créé
gouverneur de cette ville, dénonça Constantin Dalassène comme le principal
instigateur des troubles et Jean saisit ce prétexte pour le déporter dans l’île
de Plati (3 août 1034). De plus, il emprisonna son gendre, Constantin Doukas,
qui avait protesté et confisqua les biens de plusieurs archontes d’Asie
regardés comme ses partisans, en faisant profiter ses frères de leurs dépouilles . C’était là un
véritable camouflet pour l’aristocratie militaire qui prétendait gouverner
l’Empire.
Quant au basileus Michel, qui ne voyait rien
que par les yeux de son frère, il cessa, à peine couronné, de feindre sa
passion pour Zoé et la relégua au Gynécée en renvoyant toutes ses femmes et les
eunuques de Basile II dont l’Orphanotrophe redoutait les intrigues . Les Paphlagoniens
étaient les maîtres de l’Empire et l’eunuque Jean, ne connaissant plus de
bornes à son ambition, entreprit même de se substituer à Alexis sur le trône
patriarcal en prétextant l’irrégularité de sa nomination, mais le vieux
patriarche lui fit une réponse telle qu’il abandonna ce projet .
De toute cette famille de parvenus sans
scrupules, Michel IV paraît avoir été le seul honnête homme, le seul qui ait
témoigné des remords de l’origine criminelle de son pouvoir. Tous les
chroniqueurs, à commencer par Psellos, son contemporain, sont d’accord pour
vanter son esprit sérieux et réfléchi et reconnaître que, malgré son peu
d’instruction, il s’acquitta consciencieusement du rôle auquel rien ne l’avait
préparé, ne bouleversant rien dans l’administration, n’élevant pas ses amis
trop vite et résistant à la cupidité de ses frères. Il s’occupait surtout de
l’armée et lorsque éclata le soulèvement bulgare en 1040, il eut le courage,
bien qu’agonisant, de commander lui-même une expédition .
Malheureusement Michel avait une santé très
précaire et était sujet à des attaques d’épilepsie qui devenaient de plus en
plus fréquentes à mesure qu’il avançait en âge. C’était en vain qu’il demandait
des prières à tous les moines de l’Empire, qu’il multipliait les actes de
piété, les fondations, allant en pèlerinage au tombeau de saint Démétrius à
Thessalonique, s’entourant d’ascètes qu’il servait lui-même, allant jusqu’à les
faire coucher dans son lit : son mal était inguérissable . Devenu incapable de
s’occuper des affaires, il abandonnait le gouvernement de l’Empire à
l’Orphanotrophe, que ses exactions rendaient de plus en plus odieux et qui
laissait transparaître la vulgarité de ses origines en prenant part à des
orgies scandaleuses, sans d’ailleurs, d’après Psellos, perdre un seul des propos
assez libres de ses compagnons d’ivresse, qu’il obligeait plus tard à lui en
rendre compte .
Mais la maladie de son frère finit par
l’inquiéter et il songea à lui trouver un successeur dans sa famille. Son choix
tomba sur son neveu Michel, le fils de Marie, sa sœur, et de l’ancien ouvrier
calfat Étienne, qu’il avait, malgré sa nullité, donné comme successeur à
Georges Maniakès, en Sicile .
Après avoir démontré à l’empereur que le
peuple, au courant de sa maladie, qu’il croyait mortelle, finirait par se
soulever et le renverser du trône, il l’amena habilement à accepter sa solution
et il obtint aussi, on ignore par quel moyen, l’acquiescement de Zoé . Il fut donc procédé à
une cérémonie solennelle à l’église de la Vierge des Blachernes : Zoé, qui
représentait la légitimité, adopta comme fils Michel le Calfat et l’assit sur
ses genoux devant toute la cour, puis, suivant les rites anciens, on lui
conféra la dignité de César . Esprit faux et caractère
dissimulé, le nouvel héritier du trône ne tarda pas à provoquer l’antipathie de
tous, si bien que l’Orphanotrophe le relégua dans la banlieue de
Constantinople . Ce fut pourtant cet
indigne personnage qui fut appelé à gouverner la Romania lorsque, le 10 décembre
1041, Michel IV expira au monastère des Saints-Anargyres qu’il avait fondé,
après y avoir reçu la robe monastique .
Le règne de Michel V devait durer
exactement 132 jours (10 décembre 1041 - 21 avril 1042). Afin de se faire
accepter, il montra d’abord le plus grand respect pour Zoé et pour l’Orphanotrophe
qu’il affectait de consulter sans cesse, mais, excité par son autre oncle, le
domestique des scholes, Constantin, à qui il fit conférer par Zoé la dignité de
nobilissime , il changea bientôt
d’attitude et, après avoir cherché querelle à l’Orphanotrophe, il l’exila dans
un monastère et, comme Jean était très impopulaire, il n’y eut pas de
protestation . Très habilement guidé
sans doute par son oncle Constantin, Michel V chercha à mettre l’opinion de son
côté en faisant sortir de prison les victimes de l’eunuque Jean, comme
Constantin Dalassenos et Georges Maniakès qu’il nomma catapan d’Italie. Il
confia la direction des affaires au juriste érudit Constantin Lichoudès et il
envisagea une réforme administrative . Il montra de la haine
contre la noblesse, s’entoura d’une garde de Bulgares et affecta une allure démagogique
qui lui valut la faveur de la foule .
Mais il voulut aller trop loin et vint
buter contre un écueil. Jaloux des honneurs rendus à Zoé, il entreprit de s’en
débarrasser. Il l’interna d’abord au Gynécée, puis l’accusa d’avoir voulu
l’empoisonner, la déporta à Prinkipo et lui fit couper les cheveux (18 avril 1042). Non
content de cet exploit qu’il justifia par un manifeste , il voulut s’attaquer
au patriarche Alexis , mais celui-ci fit
sonner les cloches et souleva contre Michel une formidable émeute (39 avril),
appuyée par la garde des Varanges russes . Le Grand Palais fut
assiégé. Ce fut en vain que pour sauver sa vie le basileus rappela Zoé et la
montra au peuple du haut du Kathisma . Il était trop tard.
Les émeutiers tirèrent Théodora du monastère de Petrion, la conduisirent toute
tremblante à Sainte-Sophie et la firent couronner basilissa par le patriarche.
Le 20 avril le Grand Palais était pris : Michel et Constantin s’enfuirent
par mer au monastère de Stoudios, où, par ordre de Théodora, on leur creva les
yeux et on les enferma chacun dans un monastère différent (23 avril).
La légitimité représentée par Zoé et
Théodora, derniers rejetons de la dynastie macédonienne, avait donc remporté
une nouvelle victoire. Les émeutiers qui avaient tiré Théodora de son monastère
craignaient que Zoé ne se réconciliât avec Michel V , mais il paraissait
difficile de faire régner ensemble les deux sœurs qui se détestaient. Cependant
Zoé, cédant aux circonstances « et bien contre son gré » , invita sa sœur à venir
au palais et la pressa sur son cœur . « Pour la
première fois le Gynécée fut changé en salle du conseil impérial » et rien n’est plus
curieux que la description laissée par Psellos d’une audience tenue par les
deux impératrices . Leurs décisions furent
d’ailleurs des plus sages : à part les révocations des créatures de Michel
V et la condamnation pour péculat du nobilissime Constantin , elles ne bouleversèrent
pas l’administration et firent même une bonne réforme en supprimant la vénalité
des charges, qui n’existait pas en droit, mais en fait, par suite des sommes
extorquées aux nouveaux fonctionnaires .
Dans la pensée des deux sœurs ce régime
n’était que provisoire, chacune d’elles cherchant à supplanter l’autre et ayant
ses partisans qui les poussaient à prendre un prince-époux, mais Théodora était
réfractaire au mariage tandis que Zoé n’hésita pas, malgré son âge, à convoler
en troisièmes noces. Constantin Dalassène, auquel elle songea d’abord,
l’inquiéta par son ton autoritaire ; un second prétendant mourut à la
veille de réussir ; à la fin son choix se porta sur Constantin Monomaque,
d’une bonne famille de la noblesse byzantine, mais qui n’avait jamais exercé
aucune charge, personnage très remuant, fils d’un conspirateur, impliqué
lui-même dans un complot et exilé par Michel IV à Mytilène, où il passa sept
ans. Zoé l’avait rappelé et l’avait nommé juge du thème de l’Hellade. Ce fut de
là qu’elle l’appela pour en faire un basileus. Le patriarche Alexis fit quelque
difficulté pour unir deux conjoints qui en étaient chacun à leurs troisièmes
noces, mais il trouva un moyen terme en faisant célébrer le mariage par le
premier clerc du Palais et en couronnant lui-même les deux époux . Constantin Monomaque,
qui devait survivre à Zoé, allait régner sur l’Empire pendant plus de 12 ans
(12 juin 1042 - 11 janvier 1055).
Affaires extérieures (1025-1042). — Pendant cette
période si agitée à l’intérieur, malgré l’insuffisance et l’impéritie des
empereurs, l’excellente organisation diplomatique et militaire de Basile II n’a
pas périclité et l’expansion de l’Empire, bien que moins active, n’en a pas
moins continué, mais les succès sont déjà moins grands et amoindris par
quelques désastres : on s’aperçoit que l’Empire n’est plus dirigé d’une
main ferme.
Cependant la police des frontières et de la
mer est encore active. Il y a encore des tentatives de surprise et de piraterie
mais elles sont réprimées immédiatement, comme celle du russe Chrysocheir,
parent de Vladimir, qui parvint avec ses 20 monoxyles jusqu’à Lemnos (1024),
mais fut arrêté par les stratèges des Cibyrrhéotes et de Thessalonique . Basile II était encore
vivant, mais en 1025 le gouverneur de Sirmium repousse une incursion des Petchenègues,
qui reviennent d’ailleurs en 1033 et en 1036 ; en 1027 les
stratèges de Sarnos et de Chio détruisent dans l’Archipel une flotte de
corsaires venus d’Afrique et une nouvelle tentative de leurs congénères en 1035
a le même sort . Plus grave fut en 1040
le soulèvement des Bulgares, dû à l’abandon des sages mesures de Basile II, en
particulier par la transformation en numéraire de l’impôt en nature des
paysans, sur l’ordre de Jean I’Orphanotrophe. Un aventurier, Pierre Dolianos,
se donna comme le descendant de l’ancienne dynastie et fut proclamé tsar. Il
marcha sur Thessalonique, mit en déroute l’armée impériale et envoya des armées
en Grèce et contre Dyrrachium. Mais le siège de Thessalonique par Dolianos et
un autre prétendant, Alousianos, échoua grâce à une sortie victorieuse des
assiégés le jour de la fête de saint Démétrius (26 octobre 1040). Dès lors,
leurs affaires périclitèrent. Alousianos creva les yeux à son rival et se fit
battre par une armée impériale. A la fin de 1041 la Bulgarie était soumise.
En revanche la position de l’Empire était
compromise sur le versant de l’Adriatique par suite de la révolte des Serbes de
la Dioclée à la voix d’Étienne Boïthslav, époux d’une petite-fille du tsar
Samuel, gardé comme otage à Constantinople, d’où il s’était échappé.
L’insurrection battait son plein en 1041. Du moins la ville de Zara avait été
annexée à l’Empire et son toparque (magistrat local) était en même temps
stratège impérial et anthypatos .
Sur le front d’Orient non seulement les
positions de l’Empire furent maintenues, mais il y eut de nouvelles
annexions . Le traité conclu en
1027 entre le calife fatimite Al-Zahir et Constantin VIII autorisant la
réédification de l’église du Saint-Sépulcre détruite en 1009 par l’ordre de
Hakem, montre que l’Empire n’avait rien perdu de son prestige . Par contre ce prestige
fut amoindri par la désastreuse expédition de Romain Argyre contre l’émir
d’Alep, un Bédouin, dont les troupes avaient fait des incursions au-delà de la
frontière (1030) . Fort heureusement le
mauvais effet produit par la fuite honteuse du basileus fut atténué par la
résistance des gouverneurs des places fortes comme celle de Georges Maniakès , et par les
contre-attaques victorieuses du nouveau duc d’Antioche, Nicétas, qui
déterminèrent l’émir d’Alep à signer un traité par lequel il redevenait vassal
de l’Empire (septembre 1031). Peu
auparavant l’émir de Tripoli, révolté contre l’Égypte, s’était placé aussi sous
la protection impériale , mais un succès encore
plus éclatant fut l’annexion de la grande ville d’Édesse livrée à Georges
Maniakès, créé catepano de la Basse Médie (Vaspourakan), à la suite d’une
guerre civile entre deux chefs musulmans . Non seulement cette
acquisition portait la frontière au-delà de l’Euphrate, mais la place
qu’occupait Édesse dans l’histoire du christianisme explique l’effet moral
produit par cette victoire. A plusieurs reprises des émirs sarrasins essayèrent
vainement de reprendre la ville (1035-1037) . En 1033 la paix avec
l’Égypte avait été rompue, l’émir de Tripoli ayant été chassé de sa résidence
par une armée égyptienne et réintégré à la suite d’une expédition byzantine,
pendant qu’une escadre impériale faisait une démonstration devant
Alexandrie ; mais en 1036 la
paix fut renouvelée entre l’Empire et la veuve d’Al-Zahir, régente au nom de
son fils Al-Mostancer .
La politique impériale fut moins heureuse
dans les pays du Caucase. Sous Constantin VIII une tentative d’annexion du
royaume de Géorgie, après la mort de Giorgi, laissant un fils mineur (1027),
échoua complètement et en 1038 une
expédition du domestique des scholes, Constantin, frère de Michel IV, aboutit à
une défaite . De même après la mort
du roi de Grande Arménie, Jean Sempad, et de son frère Aschod, Michel IV voulut
profiter de la guerre civile qui éclata en Arménie, pour revendiquer l’héritage
de Sempad, cédé à l’Empire par le traité de 1021, mais l’armée qu’il envoya
pour saisir Ani fut taillée en pièces et le jeune Kakig II, fils d’Aschod, fut
sacré roi des rois (1042) .
Enfin l’Italie byzantine courut les plus
grands dangers pendant cette période, sans cependant avoir été entamée. La
disgrâce du catapan Bojoannès prononcée par Constantin VIII (1028) et son remplacement par
un incapable encouragèrent les Sarrasins de Sicile à recommencer leurs
incursions (1030-1031) . En 1032 ils parurent
même dans la mer Ionienne et l’Adriatique, mais ils ne purent tenir contre les
forces réunies du stratège de Nauplie et de la république de Raguse et en mai 1035 l’émir
de Sicile concluait une trêve avec Michel IV .
Mais d’autres dangers menaçaient les
possessions byzantines : tout d’abord les entreprises du nouvel empereur
germanique, le Franconien Conrad II (1024-1039), couronné à Rome le 6 janvier
1027 ,
qui fait reconnaître sa suzeraineté par les princes lombards et envoie Werner,
archevêque de Strasbourg, à Constantinople demander pour son fils âgé de 10 ans
la main d’une princesse impériale . Ce sont ensuite les
bandes normandes que les princes lombards, en querelles continuelles les uns
contre les autres, prennent à leur solde : en 1029 Sergius ayant recouvré
son duché de Naples, dont il avait été chassé par Pandolf III, prince de
Capoue, fait don à Rainolf, chef de ses auxiliaires normands, du territoire et
de la ville d’Aversa . Pour la première fois
les Normands ont un établissement territorial en Italie sous un chef des plus
habiles et c’est là le point de départ de leurs prodigieux succès.
Cependant l’état d’anarchie qui régnait en
Italie, divisions des princes lombards, guerres civiles entre les Sarrasins de
Sicile et d’Afrique, était favorable à une action de l’Empire byzantin, dont
tous les partis recherchaient l’alliance. Une seconde intervention de Conrad II
(1038), qui mit un terme aux usurpations de Pandolf III, prince de Capoue, en
train de se constituer un puissant État aux dépens de ses voisins, fut plus
avantageuse que nuisible à Byzance .
C’est ce qui explique la reprise des
projets de Basile II sur la Sicile, dont les partis en pleine guerre civile
sollicitaient une intervention byzantine . Dès 1037 le catapan
d’Italie, Constantin Oropos, passait en Sicile, battait à plusieurs reprises
les troupes africaines, délivrait des milliers d’esclaves chrétiens, mais ne pouvait
se maintenir dans l’île . Mais une expédition importante
avait été préparée par Jean l’Orphanotrophe qui avait mis son frère Étienne à
la tête de la flotte et confié à Georges Maniakès une armée composée des
meilleures troupes de l’Empire, dont un corps de Varanges sous Harald le
Sévère, roi de Norvège, et 300 chevaliers normands commandés par le Lombard
Ardouin . La campagne commença
dans l’été de 1038 par la reprise de Messine, puis il semble que Maniakès ait
voulu marcher sur Palerme en suivant la côte septentrionale, car il est
vainqueur d’une armée africaine à Rametta qui commande cette route. Il exploita
sa victoire en prenant des villes, mais on ignore la suite de ses
opérations et on le retrouve en
1040 devant Syracuse, qu’il est obligé d’abandonner pour faire face à une
diversion venue de l’intérieur. La brillante victoire de Troïna, au nord-ouest
de l’Etna, lui permit de continuer le siège de Syracuse dont il s’empara (été
de 1040) .
Malheureusement la division se mit dans
cette armée composite. Les Normands et les Scandinaves mal payés regagnèrent
l’Italie . Maniakès aurait maltraité
le chef de la flotte, Étienne, en lui reprochant d’avoir laissé échapper le
chef musulman vaincu à Troïna. Dénoncé à Constantinople, Maniakès fut rappelé
et emprisonné . Ses incapables
successeurs laissèrent les Sarrasins reprendre toutes ses conquêtes. En 1041
Byzance ne possédait plus en Sicile que Messine, défendue héroïquement par
l’Arménien Kékaumenos Katakalon .
Enfin pendant que l’armée impériale était
encore en Sicile, les Lombards sujets de Byzance se révoltaient une seconde
fois, mais, circonstance aggravante, avec le concours des Normands. Le
principal artisan de cette révolte fut Ardouin, ulcéré des affronts que lui
avait infligés Maniakès. Gagnant la confiance du catapan Michel Dokeianos, il
se fit nommer gouverneur de Melfi , s’allia avec les
Normands d’Aversa et en introduisit une bande dans la place au moment où toutes
les villes d’Apulie se soulevaient. Melfi devint alors le centre de
l’insurrection et la place forte où les Normands, grands pillards, venaient
déposer leur butin. Le catapan Michel, battu en plusieurs rencontres, dut
s’enfuir à Bari (mars 1041) ; le fils de Bojoannès qui lui succéda ne fut
pas plus heureux et fut fait prisonnier à la bataille de Montepeloso (3
septembre). Le fils de Mélès, le chef de la première révolte, Argyros, qui
avait quitté Constantinople, où il était prisonnier en 1029, fut proclamé chef
des Normands et des Lombards dans l’église Saint-Apollinaire de Bari (février
1042). Les troupes impériales ne tenaient plus que quelques places fortes du
sud, Brindisi, Otrante et Tarente
[1570]
. Telle était la
situation de l’Italie byzantine à l’avènement de Constantin Monomaque.
Constantin Monomaque. — Constantin
Monomaque, porté à l’Empire par son heureuse étoile, continue la série des
princes-époux. Jusqu’à son avènement, sauf en Italie, l’Empire avait maintenu
partout ses positions. Avec lui, bien que son règne présente certains aspects
assez brillants, commence la liquidation de la politique de conquête. L’Empire
perd sa force offensive et se voit menacé à son tour sur toutes ses frontières
par de nouveaux ennemis, les Turcs en Orient, les Petchenègues sur le Danube,
les Normands en Italie.
Pour faire face à ces périls il eût fallu
un nouveau Basile II et il n’y avait au Palais Sacré qu’un parvenu banal,
supérieur sans doute par son éducation aux Paphlagoniens, mais frivole et
indolent, bellâtre bien vu de toutes les femmes, ne demandant que la paix et la
tranquillité, considérant le pouvoir impérial comme une retraite dorée qui lui
permettait de s’amuser, comme il en fit l’aveu cynique à Psellos . Il n’était pas
d’ailleurs sans qualités. Simple et avenant il séduisait les gens par sa
bienveillance, ni hautain, ni vindicatif, toujours de bonne humeur, même dans
les circonstances pénibles, un vrai Philinte couronné avec tout ce que ce
caractère comporte d’égoïsme et même de lâcheté .
Avant son avènement Monomaque avait une
liaison déjà ancienne avec une petite-fille de Bardas Skléros, le prétendant.
Ayant été marié déjà deux fois, il n’avait osé l’épouser, mais les deux amants
ne pouvaient se passer l’un de l’autre et Sklérène était venue le consoler dans
son exil de Mytilène. Contre toute attente Constantin trouva moyen d’obtenir de
Zoé que sa favorite vînt habiter le palais, qu’elle y eût une situation
officielle, le titre de Sébasté en
vertu d’un contrat d’amitié, qu’elle
assistât au conseil où elle faisait parfois prévaloir son avis et qu’elle parût
dans les processions impériales, au grand scandale du peuple qui craignait
qu’elle ne supplantât Zoé et manifestât sa réprobation par une véritable
émeute . Mais la favorite ne
tarda pas à mourir, à la grande douleur du basileus, qui la fit ensevelir au
monastère des Manganes qu’il avait fondé .
Cependant la mort de Sklérène ne changea
pas grand-chose à la physionomie de la cour. Constantin continua à mener la
même existence oisive, remplaça Sklérène par une jeune Alaine qu’il n’osa
introduire au palais du vivant de Zoé, mais qu’il créa Sébasté ; d’autre part il
prenait plaisir aux facéties ineptes de son favori Romain Boïlas, véritable
bouffon qui s’enhardit jusqu’à devenir amoureux de la favorite et à comploter
la mort du basileus et reçut d’ailleurs son
pardon. Constantin était en outre d’autant moins disposé à mener une vie active
que dès le début de son règne il devint paralytique au point de ne pouvoir plus
faire le moindre mouvement, bien qu’avec un réel courage il n’ait jamais cessé
de s’acquitter des fonctions qui incombaient à sa dignité . D’une prodigalité inouïe,
il épuisa le trésor laissé par ses prédécesseurs, soit en comblant de richesses
ses nombreux favoris et favorites, soit par ses fondations fastueuses comme
celles de l’église Saint-Georges des Manganes ou de la Nea Moni de Chio .
De son côté Zoé n’avait pas plus de goût
que Constantin pour les affaires et passait son temps au Gynécée à fabriquer
des parfums et à chercher l’avenir en contemplant une icône du Christ,
l’Antiphonétès, qu’elle avait confectionnée elle-même « et dont elle avait
fait une image presque vivante » . Elle avait dédié une
église à cette icône et par ses générosités irraisonnées elle aidait le
basileus à dilapider les finances publiques. Elle mourut à l’âge de 72 ans en
1050 et reçut de son triste époux autant d’honneurs que si elle eût été une
sainte .
Malgré ces misères, le règne de Constantin
Monomaque est remarquable par une tentative curieuse de gouvernement au moyen
des lettrés et par une réorganisation de l’Université impériale destinée à devenir
une pépinière d’hommes d’État et d’administrateurs. Il s’agissait en fait de
soustraire le pouvoir à l’ingérence des eunuques du Palais d’une part, des
chefs de l’aristocratie militaire d’autre part.
Déjà, à son avènement, Michel V avait choisi comme ministre le juriste Constantin Likhoudès et Monomaque l’avait conservé en cette qualité . Il avait profité de son arrivée au pouvoir pour protéger ses compagnons d’études, de famille pauvre comme Jean Xiphilin de Trébizonde , ou de petite bourgeoisie comme Michel Psellos, qu’il fit nommer juge à Philadelphie, puis sous-secrétaire (hypogrammateus) au Palais . Constantin IX, qui se piquait de littérature, mais qui cherchait surtout à battre en brèche la noblesse militaire, protégea les lettrés et Psellos fut en faveur auprès de lui et de Sklérène . Bientôt il confia aux lettrés les plus hauts emplois. En 1043, à 25 ans, Psellos était nommé vestarque et protoasecretis (chef de la chancellerie impériale), Jean Byzantios dit Mauropous devenait conseiller intime de l’empereur et Jean Xiphilin, déjà juge de l’Hippodrome, reçut la charge nouvelle de nomophylax qui faisait de lui le chef de la faculté de Droit réorganisée et destinée à fournir des magistrats choisis d’après leur mérite et non d’après leur naissance (1045) . Psellos reçut plus tard le titre pompeux de consul des philosophes qui lui donnait la direction des études littéraires et un rang dans la hiérarchie des dignitaires palatins . Mais cet enthousiasme pour les lettrés ne
dura pas. La franchise et la rudesse de Constantin Likhoudès, qui critiquait
ses dilapidations, déplurent à l’empereur et dans un mouvement de colère il le
destitua (1050). La disgrâce de Jean Mauropous suivit de près et il devint évêque
d’Euchaïta. Psellos et Xiphilin, s’apercevant du changement d’attitude du
souverain à leur égard, se retirèrent dans un monastère de l’Olympe et un favori plus
souple, mais tout à fait incapable, le logothète Jean, prit la direction des
affaires .
Ce changement subit est un exemple de
l’incohérence et du désordre qui paraît avoir régné dans le gouvernement
intérieur de Constantin IX. Cet homme qui cherchait avant tout son repos, mais
dont le caractère était impulsif, n’a cessé de se créer des difficultés par ses
caprices et ses fantaisies déraisonnables. Psellos l’accuse d’avoir bouleversé
tous les usages et les règles de l’avancement dans la hiérarchie en ouvrant le
Sénat à des gens de bas étage . Il faillit même être
victime de ce manque de discernement : l’un de ces nouveaux sénateurs,
sachant qu’il ne prenait aucune précaution pour se garder la nuit, mais que sa
chambre était ouverte à tout venant, résolut de l’assassiner et faillit
réussir . D’autre part, à la fin
de son règne ses fantaisies et ses libéralités devinrent de plus en plus
coûteuses et lorsqu’il eut vidé
complètement le trésor, cet homme si généreux eut recours à la fiscalité la
plus éhontée pour se procurer des ressources : il envoya partout des
collecteurs d’impôts qui employaient les moyens les plus illicites pour
récolter de l’argent et, ce qui fut plus grave encore, il alla jusqu’à
licencier des troupes pour employer à d’autres objets les sommes levées sur les
populations pour leur entretien .
Événements extérieurs. — Une invasion
russe, deux grandes révoltes militaires, la violation de la frontière du Danube
par les Petchenègues, les invasions des Turcs Seldjoukides en Orient et des Normands
en Italie, le schisme avec la papauté, tel est le bilan du règne d’un empereur
qui n’a jamais quitté le Grand Palais de son avènement à sa mort, non par
manque de courage, il a donné des preuves du contraire, mais par indifférence
néfaste pour les choses de l’armée et par un détachement coupable des affaires,
qu’il laissait diriger par ses ministres. C’est tout au plus si, mêlés à ces
événements désastreux, se montrent les derniers succès de la politique
impériale : le maintien de la paix avec le calife fatimite, la protection
officielle des chrétiens de Palestine, la dernière annexion byzantine, celle du
royaume pagratide d’Arménie, compromise d’ailleurs bientôt par l’avance des
Turcs.
C’est d’abord la révolte de Georges
Maniakès, que Zoé avait renvoyé en Italie comme l’avait décidé Michel V. Arrivé
à Tarente en avril 1042, il commença à châtier par de cruelles exécutions les
villes qui avaient accueilli les Normands (1600), mais une
intrigue se tramait contre lui à Constantinople : Romain Skléros, frère de
Sklérène, qui était son ennemi personnel, obtint son rappel et la même ambassade
chargée de la lui notifier parvenait à détacher Argyros de la cause lombarde . Maniakès se révolta,
fut proclamé empereur par son armée (octobre 1042) et, assiégé dans Otrante par
Argyros, s’embarqua pour Dyrrachium, d’où il comptait marcher sur
Constantinople par la Via Egnatia, grâce à son alliance avec le chef serbe
Boïthslav ; mais dès la
première rencontre avec l’armée impériale envoyée contre lui, le prétendant
reçut une blessure mortelle et ses soldats se débandèrent. Constantin n’eut que
la peine de célébrer un triomphe éclatant à l’Hippodrome (premiers mois de 1043).
Quelques mois plus tard Constantinople
était attaquée par une expédition russe. La cause de la rupture aurait été une
rixe entre Grecs et Russes au faubourg de Saint-Mamas : un des principaux
marchands de Novgorod ayant été tué, la république demanda le prix du sang et,
sur le refus qui lui fut opposé, recruta des troupes dans les régions nordiques
et équipa une flotte considérable de monoxyles, commandée par son prince,
Vladimir, fils du grand prince de Kiev, Iaroslav . Il semble d’ailleurs
que la vraie cause de la guerre fut le désir des Novgorodiens d’obtenir un
traité de commerce plus avantageux. Vladimir s’arrêta en effet à l’entrée du
Bosphore . La terreur régnait à
Constantinople, mais Vladimir ayant refusé les propositions de paix du
basileus , celui-ci se mit
lui-même à la tête d’une escadre improvisée qui couvrit la flottille russe de
feu grégeois et la mit en déroute (juin 1043) , Poursuivis dans la mer
Noire, les survivants de cette expédition regagnèrent à grand-peine leur pays.
Ce fut seulement en 1046 que la paix fut signée : un fils de Iaroslav
devait épouser une princesse grecque ; on ignore les autres clauses,
vraisemblablement commerciales et militaires .
La révolte de Léon Tornikios en 1047 eut un
caractère beaucoup plus grave que celle de Maniakès, dont l’entreprise fut
isolée. Ici il s’agit d’un soulèvement général des thèmes d’Occident, exaspérés
par la politique antimilitariste de Constantin Monomaque. Le centre de la
révolte était Andrinople où résidaient plusieurs généraux en disgrâce et le
chef de la conjuration était Jean Vatatzès. Les conjurés firent appel à
Tornikios, Arménien de la famille des Pagratides dont les terres avaient été
annexées à l’Empire. Patrice et vestiarios, il était mal vu du basileus, dont
une sœur, Euprepia, avait au contraire pour lui une véritable inclination . Se sentant en danger
(Constantin avait déjà voulu l’enfermer dans un monastère), et confiant dans
des prophéties d’après lesquelles il devait régner, Tornikios quitta Constantinople
le 14 septembre 1047 avec plusieurs chefs de l’armée et franchit en un jour les
240 kilomètres qui le séparaient d’Andrinople. Proclamé empereur, il se mit
aussitôt à la tête de l’armée rebelle, marcha sur la ville impériale et, le 25
septembre, il établit son camp en face du faubourg des Blachernes. Pris au
dépourvu, Constantin appela à son secours l’armée des thèmes d’Orient, mais en
attendant, et bien que souffrant de la goutte, il dirigea courageusement la
défense avec les quelques troupes qu’il avait pu rassembler et en armant les
citadins. La lutte, fertile en péripéties, ne dura que quatre jours (25-28
septembre). Après deux assauts qui échouèrent, Tornikios battit en retraite et
l’armée d’Orient vint achever sa défaite (décembre 1047) .
La guerre avec les Petchenègues (1048-1053)
participe à la fois de l’invasion et de la révolte militaire. L’établissement
de ce peuple turc sur le Danube, depuis
le règne de Basile II, présentait pour l’Empire le même danger qu’autrefois les
Bulgares et désormais la péninsule balkanique n’était plus à l’abri des
invasions .
En 1048 une querelle entre le Khan
petchenègue Tyrach et le chef militaire Kégénis obligea celui-ci à se réfugier
dans l’Empire où il fut bien accueilli , mais, par sa
maladresse, le gouvernement impérial entra en conflit avec Tyrach qui passa le
Danube sur la glace avec une forte armée (décembre 1048). Grâce aux troupes des
thèmes d’Occident appuyées par Kégénis, Tyrach subit un gros désastre :
des milliers de Petchenègues entrèrent au service de l’Empire et furent envoyés
en Bithynie pour marcher contre les Turcs. Mais ces barbares indisciplinés se
révoltèrent, repassèrent le Bosphore et s’établirent dans la plaine de Sofia où
ils furent rejoints par de nombreux compatriotes cantonnés en Bulgarie (1049) .
Le gouvernement impérial ne put venir à
bout de cette révolte. Trois armées impériales furent successivement battues et
si les barbares ne purent prendre Andrinople en 1050, si Nicéphore Bryenne avec
une armée d’auxiliaires francs et varègues les força à évacuer la Thrace et
leur infligea une sanglante défaite, Tyrach avec d’autres bandes put
s’installer dans la Bulgarie danubienne et occuper la Grande Preslav. L’effort
suprême que fit Constantin en 1053 pour l’en déloger en réunissant les forces
d’Orient et d’Occident échoua complètement et l’armée impériale mal commandée
fut décimée au passage des Balkans . Malgré leur victoire,
ce furent les Petchenègues qui demandèrent la paix Leurs incursions cessèrent,
mais beaucoup d’entre eux restèrent cantonnés en Bulgarie.
En Orient au contraire la situation de
l’Empire paraissait excellente. La paix avec le calife fatimite Al-Mostancer
fut renouvelée (1047-1048) et les rapports les plus cordiaux s’établirent entre
les deux États. Constantin IX ravitailla en blé la Syrie musulmane en proie à
la famine (1053) et put en retour coopérer à la reconstruction du
Saint-Sépulcre et exercer une sorte de protectorat sur les chrétiens de
Palestine .
Dans la région du Caucase les frontières de
l’Empire furent élargies par l’annexion de la Grande Arménie, à vrai dire d’une
manière peu glorieuse qui ne releva guère le prestige de Byzance. Jean Sempad
étant mort en 1041, Constantin IX réclama à son neveu Kakig II, qui avait pris
le titre de roi des rois, l’application du testament par lequel Sempad avait
légué son royaume à l’Empire . Kakig ayant résisté et
battu une armée byzantine devant Ani, Monomaque n’eut pas honte de faire
alliance avec l’émir de Dwin, qui s’empara pour son compte de plusieurs
territoires arméniens, et d’attirer traîtreusement Kakig à Constantinople,
puis, sur son refus de céder son royaume, de l’interner dans une île . Mais, en l’absence du
roi, le catholikos et les chefs arméniens livrèrent Ani et son territoire au
stratège de Samosate : à Constantinople Kakig dut ratifier le traité et
reçut en échange de son royaume deux petites villes sur la frontière de
Cappadoce . Une expédition dirigée
contre l’émir de Dwin (1045-1047) l’obligea à restituer une partie des
forteresses arméniennes dont il s’était emparé . Quelques mois plus
tard le gouvernement impérial intervenait avec succès dans les querelles
intérieures du royaume de Géorgie, placé de fait sous la suzeraineté byzantine .
Par l’annexion du royaume d’Ani l’Empire
avait atteint son maximum d’extension , mais l’étendue
démesurée de la frontière n’en rendait la défense que plus difficile au moment
où elle était menacée par les Turcs et où Constantin Monomaque par sa politique
militaire désorganisait cette défense.
Ce fut en effet sous son règne que les
Turcs seldjoukides commencèrent à violer la frontière de l’Empire. A la fin du xe siècle, horde formée sous
le commandement de Seldjouk, de la tribu des Oghouz, établis près de la mer
d’Aral, ils se mirent au service des Ghaznévides qu’ils aidèrent à conquérir
l’Inde, puis, révoltés contre le sultan Mas’oûd, s’établirent dans le Khorassan
(1038-1040) sous le commandement de Toghroul-beg . Attirant tous les
Turcomans d’Asie centrale, dont le seul métier était la guerre, ils eurent
bientôt une nombreuse armée, menaçante à la fois pour l’empire, l’Arménie et le
califat.
Par l’annexion de la Grande Arménie
l’Empire semblait pouvoir défendre avec succès les principales voies
d’invasion , mais Constantin IX
ayant remplacé par un impôt le service de la protection des frontières, qui
incombait aux Ibères , le nombre des défenseurs
se trouva tellement insuffisant que les chefs byzantins adoptèrent la tactique
qui avait réussi avec Seïf-ad-Daouleh : laisser les grosses armées turques
passer la frontière et les attaquer à leur retour quand elles revenaient
chargées de butin .
Ce fut en 1048 qu’eut lieu la première
incursion des Seldjoukides, qui ravagèrent le Vaspourakan, mais les forces
byzantines les obligèrent à repasser la frontière . Fort heureusement pour
l’Empire, l’infériorité numérique de la défense fut compensée par les qualités
de premier ordre de chefs tels que Katakalon, qui infligea une sanglante
défaite à Ibrahim, frère de Toghroul, à Gaboudrou (province d’Ararat) le 17
septembre 1048 . Liparit, qui avait
amené les contingents géorgiens, fut fait prisonnier et, pour le délivrer,
Constantin IX signa une trêve avec Toghroul (début de 1050) . L’empereur ayant
envoyé une partie des troupes d’Asie contre les Petchenègues (1052), les Turcs
en profitèrent pour recommencer leurs attaques.Toghroul dirigea lui-même une
campagne dans le Vaspourakan (1053-1054), mais il subit un échec devant
Mantzikert, dont il ne put s’emparer . En somme, malgré de
mauvaises conditions, la défense avait été efficace et l’Empire conservait ses
frontières intactes.
Ce fut en Occident que se produisit le
premier fléchissement de la puissance impériale. Pendant que les provinces
d’Orient étaient défendues avec succès contre les Turcs, les Normands faisaient
la conquête de l’Italie byzantine. Les années qui suivent la révolte de
Maniakès sont marquées par un nouvel afflux de ces aventuriers (1043-1046).
C’est à cette époque que les autres fils de Tancrède de Hauteville viennent
rejoindre leurs, frères et que Robert Guiscard arrive en Italie, où il commence
par mener d’abord la vie d’un chevalier brigand Ils ont pour allié
Guaimar, prince de Salerne, qui a pris le titre de duc de Pouille et de Calabre
et en distribue les territoires aux chefs normands . Mais ils commencent à
oublier complètement la cause lombarde et font aux indigènes une guerre atroce,
pillent, rançonnent, brûlent les églises, détruisent les cultures, torturent
leurs prisonniers avec des raffinements de cruauté : leur nom est honni
dans toute l’Italie .
Devant cet assaut la défense byzantine est
insuffisante et ne peut empêcher les Normands d’envahir la terre
d’Otrante : seules les villes maritimes tiennent encore, mais leurs
habitants sont prêts à la révolte . Argyros est rappelé à
Constantinople (1046), où il prit une part active à la défense de la ville
contre Tornikios et fut admis en récompense au conseil impérial . On ignore quels
pourparlers il eut avec le basileus pendant son séjour qui dura jusqu’en 1051.
On sait seulement qu’il entra en conflit avec le patriarche Michel Kéroularios,
qui le priva plusieurs fois de la communion, au sujet du pain azyme employé en
Occident pour les hosties. Cet incident montre qu’Argyros devait préconiser
pour les populations lombardes une politique de ménagement, à laquelle le
patriarche était formellement opposé .
Pendant ce temps des interventions
nouvelles se produisaient dans l’Italie méridionale à l’effet d’y rétablir un
peu d’ordre. Ce fut d’abord celle de l’empereur Henri III, qui, après la
déposition de trois papes, au concile de Sutri, vint installer à Rome le nouvel
élu, Clément II (début de 1047), et tint sa cour à Capoue (3 février). Il
affaiblit la puissance de Guaimar de Salerne en lui enlevant la principauté de
Capoue et il fortifia la situation des Normands en donnant l’investiture des
territoires qu’ils occupaient à Rainolf et à Dreu qui, de simples aventuriers,
devenaient princes souverains . Et à ses dons
l’empereur germanique ajoutait la ville de Bénévent qui avait refusé de le
recevoir. Cette politique était défavorable aux intérêts byzantins, bien qu’en
1049 Constantin et Henri III eussent échangé des ambassades amicales .
En deux ans en effet la situation s’est
modifiée et un nouveau facteur apparaît dans la politique italienne. Un nouveau
pape réformateur énergique, Léon IX , poursuit les abus de
toute sorte qui troublent la vie religieuse : usurpation des églises et de
leurs biens par des laïcs, simonie, nicolaïsme, violation des canons
ecclésiastiques aussi bien dans l’Italie méridionale que dans le reste de
l’Europe. D’une grande activité, il tient des conciles disciplinaires à Rome
(1049), à Siponto (1050), dépose des prélats simoniaques, fait lui-même des
enquêtes, à Salerne, à Melfi, où il reproche aux Normands leurs déprédations . Les malheureuses
populations le considèrent comme un sauveur ; les habitants de Bénévent se
donnent à lui (mars 1041) et il vient prendre possession de cette ville et
négocier avec Guaimar et Dreu (juillet) .
Mais le 10 août 1051 Dreu était assassiné
et avec lui disparaissait le seul espoir qu’on eût de discipliner les
Normands . Argyros venait
d’arriver de Constantinople avec le titre de magistros, duc d’Italie, Calabre
et Sicile et de grosses sommes
d’argent qui lui permettraient d’acheter les chefs normands et de leur
persuader d’aller combattre les Turcs en Orient . Cette mission ayant
échoué, il aurait provoqué le meurtre des principaux chefs ; Dreu fut la
seule victime de ce complot . Ce fut alors
qu’Argyros fit alliance avec le pape Léon IX, qui se trouvait à Naples en juin
1052 .
On ignore les clauses de l’accord, mais le pape, déterminé à défendre les
droits du Saint-Siège par la force, se rendit en Allemagne pour recruter des
troupes et se faire confirmer par Henri III la possession de Bénévent .
Cette double action fut mal combinée.
Argyros entra en campagne avant le retour du pape et subit trois défaites
successives, à Tarente, à Crotone et à Siponto (1052-1053) . Le pape revint
d’Allemagne (février 1053) et avec une armée composite, où l’on voyait, à côté
des auxiliaires allemands, des milices féodales et urbaines de l’Italie
centrale, attaqua les Normands et subit une défaite complète à Civitate au pied
du Monte Gargano, le 17 juin 1053 . Prisonnier des Normands
et traité avec les plus grands honneurs, Léon IX fut ramené à Bénévent, qu’il
ne devait pas quitter avant le mois de mars 1054 . Rentré à Rome, il y
mourut le 19 avril suivant . Argyros envoya
l’évêque de Trani à Constantinople demander des secours au basileus, mais
celui-ci avait déjà reçu de l’évêque d’Ochrida la lettre qui allait déclencher
une autre offensive contre le Saint-Siège, celle du patriarche de
Constantinople .
Le schisme de 1054. — Les causes du
conflit qui s’est produit avant la mort de Léon IX entre les Églises de Rome et
de Constantinople, sont liées intimement aux événements de l’Italie
méridionale. L’alliance politique et militaire conclue par Argyros avec Léon IX
et ratifiée par Monomaque avait pour adversaire
le patriarche Michel Kéroularios qui avait succédé à Alexis le Studite le 25
mars 1042 . La cause de cette
hostilité était le progrès de l’influence spirituelle du pape dans l’Italie
byzantine dont les évêchés, occupés presque tous par des Grecs, relevaient du
patriarcat œcuménique. Mais ce conflit de juridiction ne suffit pas à expliquer
la violence de la lutte et le désaccord final. Il faut tenir compte du
caractère entier et des ambitions du patriarche qui se heurtèrent à une intransigeance
non moins grande de Léon IX et surtout du cardinal Humbert.
Sorti d’une bonne famille bourgeoise de
Byzance, Michel Kéroularios avait manifesté dès sa jeunesse son ambition
politique en conspirant contre Michel IV, qu’il aurait remplacé sur le
trône . Découvert et exilé aux
îles des Princes avec son frère, qui se suicida de désespoir, Michel se fit
tonsurer, fut rappelé d’exil par Michel IV et gagna la faveur de Constantin
Monomaque, ancien conspirateur comme lui. Élevé à la dignité de syncelle qui
lui donnait un rang dans la hiérarchie palatine , il succéda au
patriarche Alexis bien qu’il n’eût pas reçu les ordres ecclésiastiques, ce qui
devait permettre à Léon IX de le traiter de néophyte . En dépit des
contradictions du témoignage de Psellos, qui fut tour à tour l’accusateur et le
panégyriste de Kéroularios , on est frappé de
l’autorité qu’il avait su acquérir aussi bien à la cour du basileus que dans le
clergé et le peuple. Il devait sa popularité à de réelles qualités de
bienveillance et de justice , mais il les mettait au
service d’une ambition effrénée, qui n’allait à rien moins qu’à un vif désir de
domination dans l’Église comme dans l’État.
Au milieu du xie siècle les conquêtes temporelles et
spirituelles des hommes d’État et des missionnaires avaient étendu prodigieusement
les limites et le champ d’action du patriarcat de Constantinople. De grands
pays comme la Russie, la Bulgarie, l’Arménie, la Géorgie étaient sous son
obédience directe ou indirecte, et la paix qui régnait entre le calife fatimite
et l’Empire favorisait les relations entre le patriarche œcuménique et ses
collègues orientaux . Régnant ainsi sur la
moitié du monde chrétien, Kéroularios se considérait comme l’égal du pape, dont
il supportait mal l’ingérence sur le territoire de son patriarcat, notamment
dans l’Italie du sud. On voit, par la lettre qu’il écrivit à Léon IX (janvier
1054) et qui n’est connue que par la réponse du pape, qu’il réclamait non
seulement l’autocéphalie de l’Église de Constantinople, telle que la revendiqua
son prédécesseur Eustathe en 1024, mais qu’il exigeait l’égalité complète entre
le pape et le patriarche byzantin . Or ses desseins
étaient contrariés par la politique d’alliance avec Léon IX, inspirée au
basileus par Argyros, d’où la haine du patriarche contre le duc d’Italie et son
attaque brusquée contre l’Église romaine. A ce moment les rapports entre la
papauté et Byzance étaient loin d’être rompus , comme le prouve
l’envoi à Rome de la synodique, à son avènement en 1052, du patriarche
d’Antioche, Pierre, ancien clerc de Sainte-Sophie . Ce fut donc bien
Kéroularios qui prépara cette rupture.
Elle prit la forme d’une véritable querelle
cherchée à l’Église romaine sur ses rites et ses usages. En septembre 1053
l’archevêque d’Ochrida, Léon, ancien clerc de Sainte-Sophie, écrivit à Jean,
archevêque de Trani, une lettre dans laquelle il blâmait l’usage du pain azyme
par les Latins dans l’eucharistie, ce qui était pour lui un reste de judaïsme,
ainsi que le jeûne du sabbat et, reproche plus blessant encore pour les
réformateurs occidentaux, il s’élevait avec violence contre le célibat des
prêtres .
Que cette lettre fût inspirée par le
patriarche, c’est ce que prouve la suite des événements : le traité du
moine Nicétas Stéthatos de Stoudios contre les usages latins et la fermeture
violente des églises de rite latin à Constantinople . Par cette triple
offensive Kéroularios rendait tout accord impossible.
L’évêque de Trani avait communiqué la
lettre de Léon d’Ochrida au cardinal Humbert qui la traduisit en latin pour la
montrer au pape . Dès lors commença une
correspondance active entre Léon IX, l’empereur Constantin et Kéroularios . Loin d’améliorer les
rapports entre les deux Églises, ces lettres, pleines de récriminations, ne
firent qu’envenimer le conflit. Il semble bien cependant que dans sa deuxième lettre
au pape (janvier 1054) le patriarche, probablement suivant les instructions
impériales, ait fait un effort de conciliation, mais en même temps, nous
l’avons vu, il exigeait l’égalité complète avec le pape .
Dès lors les événements se précipitèrent.
Dans l’espoir de faire agir l’empereur sur la volonté du patriarche, Léon IX
envoya à Constantinople trois légats accrédités auprès du seul basileus et il
les choisit parmi les défenseurs les plus ardents de la réforme
ecclésiastique : le cardinal Humbert , Frédéric de Lorraine,
chancelier de l’Église, Pierre, évêque d’Amalfi, tous incapables de faire la
moindre concession au patriarche. L’inévitable se produisit donc : deux
intransigeances se heurtèrent et la rupture fut consommée. Les légats reçus
avec honneur par le basileus n’eurent point la moindre conférence avec le
patriarche, qui affecta de les considérer comme de faux légats envoyés par
Argyros . Le seul succès obtenu
par eux fut la rétractation solennelle de Nicéphore Stéthatos (24-25
juin) , mais le patriarche
resta irréductible. Alors le 15 juillet 1054, à Sainte-Sophie, en présence du
peuple assemblé pour l’office quotidien, ils déposèrent sur l’autel une bulle
d’excommunication , puis, après avoir
consacré des églises de rite latin, ils partirent. Le patriarche voulut alors
conférer avec eux et ils avaient déjà atteint Selymbria quand on les rappela,
mais l’empereur, flairant un piège, exigea d’être présent à la conférence.
Kéroularios ayant refusé d’accepter cette condition, les légats continuèrent
leur voyage .
A cette excommunication le patriarche
répondit en déchaînant une émeute à Constantinople et il fallut pour l’apaiser
que l’empereur fît emprisonner le fils et le gendre d’Argyros et fouetter
l’interprète qui avait traduit la bulle en grec . Mais il restait à
accomplir l’acte décisif qui répondrait à la bulle d’excommunication par une
autre excommunication et romprait ainsi toutes les relations religieuses entre
Rome et Constantinople. Kéroularios réunit dans les catéchumènes de Sainte-Sophie
un synode auquel prirent part 12 métropolites et 2 archevêques. L’édit synodal
qu’ils rédigèrent reproduisait en partie l’Encyclique de Photius aux évêques
d’Orient et énumérait tous les griefs du patriarche contre l’Église romaine
ainsi que toutes les erreurs reprochées aux Latins. Le 20 juillet, au Grand
Tribunal du patriarche, l’anathème fut lancé contre la bulle pontificale et sur
ses rédacteurs, puis, le 25 juillet, tous les exemplaires de la bulle furent brûlés
devant le peuple, à I’exception d’un seul qui fut déposé aux archives patriarcales .
Ce schisme était une victoire pour le
patriarche, soutenu par la plus grande partie du clergé , mais il était une
défaite pour le pouvoir impérial et il peut être regardé comme la première
manifestation de l’antinomie qui s’est affirmée de plus en plus entre les
intérêts de l’Église orthodoxe et ceux de l’Empire.
La fin de la dynastie macédonienne. — Constantin
Monomaque ne survécut que quelques mois à ces événements et mourut le 11 janvier
1055. Suivant la doctrine légitimiste, le pouvoir revenait à Théodora, dernier
rejeton de la famille macédonienne. Bien que Constantin ait essayé de l’écarter
du trône, ce fut elle qui lui succéda . On pensait qu’elle
prendrait un prince-époux, mais les eunuques qui l’avaient portée au pouvoir
écartèrent cette solution. Nicéphore Bryenne, cantonné avec son armée en Asie
Mineure, s’avança jusqu’à Chrysopolis, mais fut déclaré rebelle et
emprisonné . Le patriarche Kéroularios,
qui voulait peut-être donner à Théodora un époux de son choix, essaya en vain
de s’ingérer dans son gouvernement et fut écarté . On tenta même de le
compromettre dans le procès intenté à deux moines thaumaturges de Chio et à la
voyante qu’ils exhibaient : Kéroularios, qui s’intéressait aux sciences
occultes, avait avec eux de nombreux rapports et les protégeait .
Théodora exerça donc seule l’autorité et se
montra très active, s’occupant d’ambassades, de justice, de lois. En réalité
ses eunuques gouvernaient l’Empire sous son nom et elle leur distribuait les
grandes charges dont elle destituait les conseillers de Constantin IX et les
meilleurs chefs des armées . Ce fut sous son règne
que s’exaspéra la rivalité, déjà sensible sous Monomaque, entre le gouvernement
du Palais et l’aristocratie militaire.
A l’extérieur ce règne de 19 mois fut
néfaste pour l’Empire. La disgrâce des conseillers de Monomaque eut pour effet
l’arrêt malencontreux de l’action qu’ils exerçaient dans les pays étrangers,
leurs successeurs prenant le contre-pied de leur politique et engageant
l’Empire dans de nouveaux conflits. L’exemple le plus typique est la rupture de
la paix avec le calife fatimite, qui avait été le fondement de la politique
étrangère des règnes précédents : Théodora voulant transformer en alliance
la convention par laquelle Constantin IX s’était engagé à ravitailler en grains
les sujets syriens du calife et celui-ci ayant refusé, les envois de grains cessèrent.
Al-Mostancer répondit à cette mesquinerie en interdisant l’entrée du
Saint-Sépulcre aux pèlerins et en molestant les chrétiens de Jérusalem . Par contre le Turc
Toghroul-beg était devenu le maître dans le califat de Bagdad et exigeait que
son nom fût substitué dans la prière à celui du calife fatimite à la mosquée de
Constantinople . Du côté de l’Italie,
en dépit du schisme, on constate un nouvel effort pour organiser une alliance
avec le pape contre les Normands. Argyros revient à Constantinople au moment
même de la disgrâce du patriarche, et sa politique d’alliance avec les
puissances d’Occident reçoit l’approbation de Théodora qui accueille un
ambassadeur d’Henri III et le renvoie avec une ambassade byzantine chargée de
négocier un traité d’alliance entre les deux empires .
Ce fut seulement lorsqu’ils virent Théodora
à l’article de la mort que ses conseillers s’avisèrent de lui donner un
successeur. Il s’agissait pour eux d’écarter du trône les chefs d’armée et de
découvrir un homme incapable de leur enlever la direction des affaires. Leur
choix se porta sur un vieux sénateur, ancien intendant de la caisse militaire,
Michel le Stratiotique , « homme simple et
inoffensif, ne connaissant rien en dehors de l’administration de
l’armée » . Pour légitimer son
élévation, on le fit adopter par Théodora et le patriarche ne put faire
autrement que de le couronner : il se garda bien
de prendre au sérieux la tentative d’un parent de Constantin Monomaque, le
proèdre Théodose, pour s’emparer du trône quelques heures avant la mort de
Théodora .
Le règne de Michel VI, qui dura un an et
dix jours, ne fut qu’une longue lutte du gouvernement des eunuques, dont le
basileus n’était que le porte-parole, contre les chefs de l’armée . Aucune occasion de les
humilier n’était perdue et toutes leurs demandes étaient systématiquement
repoussées . L’incident décisif fut
celui du dimanche de Pâques, 30 mars 1057 ; à l’audience solennelle dans
laquelle le basileus avait coutume de faire des largesses parurent les
principaux chefs de l’armée d’Asie ; Michel Bourtzès, Constantin et Jean
Doukas, Isaac Comnène, Katakalon, résolus à faire une démarche collective
auprès de Michel ; mais à leurs demandes il répondit par des éloges et de
bonnes paroles et, comme ils insistaient, il entra subitement en fureur et se
mit à les invectiver . Le résultat de cette
scène fut le complot qu’avant de se séparer les chefs militaires ourdirent à
Sainte-Sophie avec la connivence du patriarche on convint de demander l’appui
de Bryenne, stratège des contingents macédoniens de Cappadoce, et d’élever
Isaac Comnène à l’Empire .
La révolte faillit échouer faute d’entente
entre les conjurés. Trop impatient de se soulever, Bryenne se fit prendre, fut
aveuglé et envoyé enchaîné à Constantinople . Ce fut alors que les
conjurés se décidèrent à agir. Le 8 juin 1057 Isaac Comnène était proclamé empereur
à Gomaria en Paphlagonie , où Katakalon, après
avoir entraîné son armée en produisant un faux ordre de Michel VI, vint rejoindre
les chefs rebelles (juillet) . Tous les thèmes d’Asie
reconnurent Isaac Comnène et l’armée, très bien disciplinée, marcha sur Constantinople,
infligea une défaite meurtrière aux troupes d’Europe, envoyées contre elle par
Michel, devant Nicée (20 août) . Dans le plus complet
désarroi, Michel VI dépêcha à Comnène Psellos et plusieurs sénateurs, lui promettant
le titre de César s’il licenciait son armée (24 août) . Isaac reçut les
envoyés à Nicomédie au milieu d’un appareil guerrier, mais il était en fait
d’accord avec eux et il leur donna des instructions pour ses partisans et des
contre-propositions fictives pour Michel VI. Celui-ci se déclara prêt à tout
accepter et renvoya les ambassadeurs à Comnène (30 août). Mais à peine
étaient-ils partis qu’une émeute éclatait à Constantinople et le patriarche,
secrètement d’accord avec les révoltés, feignait de se laisser imposer par la force
la proclamation de Comnène et envoyait à Michel une députation de métropolites
qui engageaient le vieux basileus à abdiquer et à entrer dans un monastère.
Michel VI ne fit aucune résistance.
Kéroularios se trouva pendant un jour le
maître de Constantinople. Il fit proclamer partout Isaac Comnène et toléra des
représailles contre les ennemis du nouveau basileus, dont les émeutiers
allèrent détruire les maisons . Le jour suivant Isaac
Comnène, arrivé à Chrysopolis, faisait une entrée triomphale dans le port de
Constantinople sur un navire couvert de fleurs, au milieu des
acclamations .
LIVRE DEUXIÈME. L’EMPIRE ROMAIN HELLÉNIQUECHAPITRE III. — Le déclin et la chute (1057-1204)
|