 |
 |
HISTOIRE DU BAS-EMPIRE. |
 |
LIVRE QUARANTE-DEUXIÈME.JUSTINIEN. 532-534
Durant le cours des négociations qui dévoient terminer la
guerre entre les Romains et les Perses, 532, Justinien s’occupait d’un projet
encore plus important. Il songeait à chasser les Vandales de l’Afrique, et à
remettre l’empire en possession de cette riche et vaste contrée. Genséric s’en était
rendu maître depuis le détroit de Cadix jusqu’à la Cyrénaïque; il y avait
ajouté les îles de Corse et de Sardaigne. Toute la puissance romaine n’avait
pu lui arracher sa proie. Zénon se vit obligé de conclure avec lui un
traité de paix perpétuelle; et si les grandes qualités de ce conquérant
eussent passé à ses successeurs, les Vandales se seraient vus en moins d’un
siècle maîtres de la Sicile, de l’Italie et de la Grèce. Mais, loin
d’acquérir de nouvelles forces, ils perdirent en peu de temps celles
qu’ils avoient apportées. Cette chaleur martiale, concentrée dans le cœur
de ces peuples par les frimas du nord, se dissipa peu à peu sous les
climats méridionaux. Les vainqueurs avoient reçu en propriété chacun
leur part de la conquête, contre l’ancienne coutume dés Germains, dont César
fait l’éloge. De là vinrent le luxe et l’avarice qui efféminèrent leur
courage. La terre et la mer leur fournissaient toutes les délices
de la vie; ils changèrent leur façon de vivre: ils eurent de grandes
habitations, des bains, des tables somptueuses, des habits tissus d’or et
de soie. Les spectacles, les tournois faisaient leur occupation la plus
sérieuse, et la chasse leur unique travail. De tous les arts, ils ne cultivaient
que la musique et la danse: ils avoient passé sans aucun milieu d’une
férocité barbare à une languissante mollesse. La plupart ne choisissaient pour
demeure que des situations délicieuses, de riantes campagnes plantées
d’agréables vergers, et arrosées de ruisseaux et de fontaines. Ils
épousèrent des Africaines spirituelles, voluptueuses, adroites à subjuguer
leurs maris. Ils ne se contentèrent pas de ces femmes: ces peuples, sobres, chastes,
austères à leur arrivée, se plongèrent sans réserve dans l’ivresse des
plaisirs, et l’Afrique vaincue se vengea en leur communiquant tous ses
vices.
La politique de Genséric se trompa dans l’ordre qu’il établit
pour sa succession. Il avait ordonné de mettre toujours sur le trône celui
de ses descendants qui se trouverait le plus âgé, sans avoir égard à la ligne
de primogéniture. Son dessein était de donner à son peuple des souverains plus
sages et plus expérimentés, et il remplit sa maison d’assassinats. Hunéric, pour faire tomber la couronne à son fils Hildica, fît massacrer ses frères et leurs enfants
mâles. Cruel persécuteur, il s’abreuva du sang des catholiques avec plus
de fureur que son père. Lâche et voluptueux il ne sut point faire d’autre
guerre. Les Maures révoltés s’emparèrent du mont Aurase en Numidie, et s’y maintinrent jusqu’à la fin du royaume des
Vandales. Ce mauvais prince, acharné pendant les huit ans de son règne à
la destruction de sa famille , n’avait pu cependant faire périr deux des
fils de son frère Genzon. Gondamond,
l’aîné des deux’ lui succéda par le privilège de l’âge. Il traita
humainement les orthodoxes, fit ouvrir leurs églises, et rappela leurs
évêques. Il combattit les Maures, mais avec si peu de succès,
que ceux-ci se rendirent maîtres de toute la côte, depuis le détroit
de Cadix jusqu’à Césarée. Etant mort de maladie, après onze ans et neuf mois de
règne, il eut Trasamond son frère pour successeur. Ce
nouveau prince faisait espérer un règne doux et heureux; il était
bien fait de sa personne, généreux , spirituel; il aimait
les lettres. Il n’employa d’abord que la séduction des récompenses, et
l’attrait des honneurs et des grâces pour engager les catholiques à
l’apostasie. Mais, voyant le peu de succès de ses artifices, il devint furieux,
et ne mit plus en œuvre que les rigueurs et les supplices.
Son mariage avec Amalfride, sœur du grand
Théodoric, le rendit maître de Lilybée en Sicile. Il vécut en
paix avec Anastase, et mourut, la vingt-septième année de son règne,
du chagrin que lui causa une grande défaite de son armée vaincue par les
Maures.
Hildéric, fils d’Hunériç, monta
sur le trône le 24 de mai de l’an 523. Trasamond, au
lit de la mort, portant jusque dans le tombeau la haine dont il était animé contre
les orthodoxes, l’avait forcé de jurer que, lorsqu’il serait roi, il n’ouvrirait
pas les églises des catholiques, et qu’il ne rappellerait pas leurs évêques
exilés.
Hildéric, conservant dans son cœur les instructions qu’il
avait reçues de sa mère Eudocie, ne se crut pas obligé de garder ce serment
impie. Mais, par une fausse subtilité, il crut l’éluder en ne prenant la
couronne qu’après avoir rappelé les évêques et fait ouvrir les églises.
Ce prince était doux, affable, bienfaisant, mais si timide, qu’il ne pouvait
entendre parler de guerre. Il chargea son frère Hoamer du commandement des armées. Hoamer remporta plusieurs
victoires sur les Maures; et sa valeur était si renommée, que les Vandales lui
donnèrent le surnom Achille. Cependant l’armée vandale reçut
un affront signalé; elle fut taillée en pièces par les Maures de la
Byzacène, que commandait Antalas. Hildéric,
dès le vivant de Justin, avait contracté avec Justinien une amitié
très-étroite; et les deux princes entretenaient cette liaison par des
ambassades fréquentes et des présents réciproques. Le roi des Vandales s’attendait
à recevoir bientôt des preuves de cette bonne intelligence par
les secours dont il croyait qu’il aurait incessamment besoin contre
les Goths d’Italie. Sur le soupçon d’une conspiration formée contre lui, il avait
fait enfermer Amalfride, et massacrer les Goths qui
avoient en grand nombre suivi cette princesse en Afrique. Théodoric était mort
avant que d’avoir pu en tirer vengeance. Athalaric, son successeur, demandait
une satisfaction éclatante, et menaçait d’une sanglante guerre. Mais
Hildéric se vit attaqué par un ennemi beaucoup plus proche, et
dont il n’avait aucun soupçon. Gélimer, fils de Gélaride, petit-fils
de Genzon, et arrière-petit-fils de Genséric, tenait
le premier rang à la cour. C’était l’héritier présomptif de la couronne, comme
le plus âgé des princes du sang royal. Il avait toutes les qualités
propres à faire une révolution: fourbe, remuant, ambitieux, hardi, il
s’ennuyait d’attendre la couronne, quoique Hildéric fût dans un âge
avancé. Le roi lui-même aidait à sa propre perte, laissant Gélimer usurper
l’autorité royale et disposer de tout en souverain. Gélimer engagea
dans ses intérêts les plus braves d’entre les Vandales, en
leur exagérant la défaite de l’armée battue par les Maures; il leur
fit entendre que le roi trahissait la nation, et que, par jalousie contre
la postérité de Genzon, il voulait le priver du trône
et livrer l’Afrique à Justinien; que c’était là le sujet de tant
d’ambassades envoyées à Constantinople. Les seigneurs vandales, séduits
par ces fausses insinuations, se donnent à Gélimer. Il se
saisit d’Hildéric et de ses deux frères Hoamer et Evagès; il fait massacrer les officiers les
plus attachés à leur prince légitime , et prend le titre de roi. Hildéric
avait régné sept ans et trois mois; il fut détrôné au mois d’août
de l’an 53o.
Justinien, sensible au malheur de son ami, et encore plus
animé sans doute par le désir de profiter de cette occasion pour
reconquérir l’Afrique, sût mettre de son côté les apparences de douceur.
Il écrivit à Gélimer pour lui représenter son crime: «Ne donnez pas, lui disait-il, ce
pernicieux exemple à votre successeur. Rétablissez Hildéric ; laissez à un
vieillard l’ombre de l'autorité souverain : vous en possédez déjà toute la
réalité. Ne vaut-il pas mieux arriver au trône par des voies légitimes quelques
moments plus tard que de passer pour un usurpateur et pour un tyran dans toute
la postérité? Si vous attendez un héritage qui ne peut vous échapper,
vous acquerrez eu même temps l’alliance de l'empire et mon amitié.»
Gélimer ne répondit à cette lettre que par des cruautés. Il fit crever les
yeux à Hoamer, qu’il craignait le plus, et
resserrer Hildéric ainsi qu’Evagès dans
une prison plus étroite, sous prétexte qu’ils voulaient s’enfuir à
Constantinople. Un mépris si manifeste des remontrances de l’empereur lui
attira une lettre menaçante. Justinien lui mandait: « Que, s’il n’écoutait
ni la voix du sang, ni celle de la justice, du moins l’humanité l’obligeait
de ne pas refuser à ces malheureux princes la consolation de venir à
Constantinople finir leurs jours entre les bras de leurs amis; que, s’il s’obstinait
à se montrer gratuitement cruel, en attendant la vengeance du ciel, il allait
attirer sur lui celle de l’empire; qu’en le poursuivant à outrance, l’empereur,
loin de rompre le traité fait autrefois avec Genséric, prétendrait le cimenter
de nouveau, puisqu’il attaquerait, non pas le successeur de ce prince,
mais l’ennemi de sa postérité.» Gélimer, piqué de ces menaces, répondit: «Qu’on
n’avait point de violence à lui reprocher; que les Vandales, indignés
contre un prince qui trahissait son pays et sa propre maison, avoient jugé
à propos de lui ôter la couronne pour la donner à un autre, à qui elle appartenait
de droit; que, chaque souverain ne devant s’occuper que du gouvernement
de ses propres états, l’empereur pouvait s’épargner le soin de porter ses
regards sur l’Afrique: qu’après tout, s’il aimait mieux rompre les nœuds
sacrés du traité fait avec Genséric, on saurait lui résister, et que les serments
par lesquels Zénon avait engagé ses successeurs ne seraient pas impunément
violés.» L’empereur, irrité d’une réponse si fière, ne songea plus qu’à
terminer promptement la guerre de Perse pour tourner toutes ses forces
contre l’Afrique. Il craignait que Gélimer ne s’appuyât du secours des
Goths, maîtres de l’Italie et de la Sicile: il pria par lettre Athalaric
de ne pas honorer ce tyran du titre de roi. Athalaric, quelque sujet qu’il
eût de se plaindre d’Hildéric, écouta ce conseil, et refusa de donner
audience aux ambassadeurs que lui envoyait Gélimer.
Dès que l’empereur eut appris que Chosroès se disposait à
signer le traité de paix, et que l’Orient était tranquille, il assembla son
conseil, et lui fit ouverture de son dessein. Il représenta que la conjoncture
ne pouvait être plus favorable pour se remettre en possession d’un riche
et ancien domaine. L’insolence du tyran, la nécessité de venger un allié,
l’affaiblissement des Van qui pouvaient à peine résister aux Maures révoltés, l’oppression
des sujets naturels de l’empire, les dépouilles de Rome que l’on retrouverait à
Carthage, les cris de la religion persécutée, qui, depuis tant
d’années, au milieu des plus cruels supplices, appelait les Romains à son
secours: tous ces motifs furent présentés avec force: «Et si l’on se refusait
à des raisons si pressantes, pouvait-on être sourd à la voix de ces généreux
confesseurs auxquels le tyran Hunéric avait
fait arracher la langue jusqu’à la racine, et qui, par un prodige
inouï, partaient librement au milieu de Constantinople, où ils s’étaient réfugiés?
Plusieurs d’entre eux vivent encore (disait-il); et cette merveille n’est elle
pas tout à la fois un témoignage de la cruauté des Vandales et de la
puissance divine qui déconcerte leur barbarie, et qui vous exhorte à la
vengeance?» Il ajoutait à cela les prédictions de saint Sabas, ce
respectable vieillard qui avait promis la victoire dans cette religieuse
expédition. J’aurais passé sous silence le miracle dont il est ici question,
quoiqu’il soit rapporté par tous les écrivains de ces temps là, si l’empereur
ne l’eût pas attesté à la face de tout l’empire dans une de ses
lois, où il se donne lui-même pour témoin d’un fait sur lequel il ne pouvait
ni tromper ni être trompé. Cet événement surnaturel réunit si fortement les
preuves d’une vérité historique, qu’il a été adopté parle judicieux
Grotius, que l’incrédulité même n’oserait taxer de superstition.
L’empereur ne trouva pas dans le conseil le même
empressement qu’il témoignait pour cette entreprise. La proposition effrayait
la plupart des officiers. Ils se rappelaient la funeste expédition de Basilisque, qui, après avoir perdu tant d’argent et de
soldats, n’avait rapporté que de l’ignominie. Le préfet du prétoire
et celui de l’épargne tremblaient de voir que, le trésor public étant
épuisé par la guerre de Perse, il faudrait fournir de nouvelles sommes pour les
frais d’une guerre si dispendieuse. La fatigue et le péril alarmaient les
capitaines, qui, sans avoir eu le temps de se remettre de leurs longs
travaux, se voyaient obligés de courir sur mer de nouveaux dangers qui
leur étaient inconnus, et de traverser ensuite des sables brûlants pour
aller combattre une nation redoutable. Cependant personne n’osait contredire
l’empereur; il avait trop clairement manifesté ses intentions. Enfin Jean de
Cappadoce, plus hardi que les autres, rompit le silence, et, après
avoir protesté au prince qu’il était entièrement soumis à
ses volontés, il lui représenta «l’incertitude du succès, déjà trop
prouvée par les malheureux efforts de Zénon; l’éloignement du pays, où l’armée
ne pouvait arriver par terre qu’après une marche de cent quarante jours;
et par mer, qu’après avoir essuyé les risques d’une longue et dangereuse
navigation, et franchi les périls d’un débarquement qui trouverait sans
doute une vice goureuse opposition; qu’il faudrait à l’empereur près
d’une année pour envoyer des ordres au camp et en recevoir des nouvelles; que, s’il
réussissait dans la conquête de l’Afrique, il ne pourrait la conserver, n’étant
maître ni de la Sicile, ni de l’Italie: que, s’il échouait dans son
entreprise, outre le déshonneur dont ses armes seraient ternies, il attirerait
la guerre dans ses propres états. Ce que je vous conseille, prince
(ajouta-t-il), n’est pas d’abandonner absolument ce projet, vraiment digne
de votre courage, mais de prendre du temps pour délibérer. Il n’est pas
honteux de changer d’avis avant qu’on ait mis la main à l’œuvre:
lorsque le mal est arrivé, le repentir est inutile. »
Les raisons du préfet du prétoire, et plus encore la
tristesse et le découragement de tout le conseil, ébranlaient l’empereur. Il était
prêt à renoncer à ce dessein, lorsqu’un évêque d’Orient arrivant à
Constantinople lui demanda audience: «Prince, lui dit ce prélat,
Dieu, qui révèle quelquefois dans les songes sa volonté à
ses serviteurs, m’envoie ici pour vous faire des reproches de ce que,
par une vaine timidité, vous laissez l’église catholique gémir sous la tyrannie
des Vandales; qu'il prenne les armes, m’a-t-il-dit, je combattrai pour
lui, et je le rendrai maître de l'Afrique.» Ces paroles ramenèrent à
l’empereur à sa première résolution; il commanda de lever des troupes, de
construire et d’équiper des vaisseaux; il nomma de nouveau Bélisaire général de
ses armées, avec ordre de disposer tout pour l’expédition d’Afrique.
Deux événements imprévus confirmèrent ses espérances. Un
habitant de la Tripolitaine, nommé Pudentius, s’étant
mis à la tête des Maures nommés Leucathes, se révolta
contre les Vandales, les chassa de la province, saccagea la grande Leptis,
et envoya demander du secours à l'empereur, lui promettant de le mettre
sans peine en possession de tout le pays. Justinien fit
aussitôt partir un officier hérule, nommé Tattimuth, avec quelques troupes; et Pudentius tint parole. Gélimer se proposait à marcher de ce côté là, lorsqu’il fut arrêté
par une nouvelle plus affligeante. Les Vandales possédaient la Sardaigne,
dont ils tiraient un grand tribut. Elle était alors gouvernée par un
officier goth attaché depuis longtemps au service des Vandales. Il se nommait Godas,
homme hardi, entreprenant, et qui s’était jusqu’alors distingué par son zèle
pour Gélimer. Il s’ennuya de recevoir des ordres, et prit le parti de
retenir le tribut, et de se rendre souverain. Pour s’appuyer
d’un puissant secours, il écrivit à l’empereur qu’il n’avait point
personnellement à se plaindre de son maître; mais que les cruautés de
Gélimer lui inspiraient une telle indignation, qu’il croirait s’en rendre
complice s’il continuait de lui obéir; que, préférant le service
d’un prince équitable à celui d’un tyran, il se donnait à l’empereur,
et qu’il le priait de lui envoyer des troupes pour le soutenir contre les
Vandales. Justinien, pour s’assurer davantage de sa sincérité, lui dépêcha
Euloge, avec une lettre, dans laquelle il louait son zèle pour
la justice, et promettait de lui envoyer incessamment un général et
des troupes pour le mettre en état de ne rien appréhender. Lorsque Euloge
arriva, Godas avait déjà pris le titre de roi et tout l’appareil de la
royauté. Il répondit au député, qu’il serait bien aise de
recevoir des soldats, mais qu’il n’avait nul besoin de général. Avant
que cette réponse fût parvenue à Constantinople, Justinien avait déjà fait
partir Cyrille avec quatre cents hommes pour défendre l’île conjointement
avec Godas. Il fut prévenu par la diligence de Gélimer. Ce
prince, ayant remis à un autre temps l’expédition de la Tripolitaine, ne
songea qu’à recouvrer la Sardaigne. Son frère Zazon partit avec cinq mille
hommes dans cent vingt barques. Il aborda au port de Carale,
aujourd’hui Cagliari, prit la ville d’emblée, et tailla en pièces
Godas, qui périt dans le combat avec toutes ses troupes.
Cyrille, après une longue navigation, trouvant les Vandales maîtres de
l’île, fit voile vers l’Afrique, et se rendit auprès de Bélisaire, qui était déjà
dans Carthage.
L’hiver, (An. 533), s’étant passé en préparatifs, la flotte
et l’armée se trouvèrent à partir à la
fin du printemps l’année suivante, sous le troisième consulat de Justinien.
Basilisque,
pour une pareille expédition, avait épuisé Suidas toutes les forces de l’empire. Bélisaire ne fit embarquer que dix mille
hommes de pied et six mille chevaux. Cet habile capitaine n’aimoit pas les grandes armées; mais, avec peu de
soldats qu’il savait conduire, et des officiers qu’il savait choisir, il faisait
ce que n’auraient pu faire des généraux tels que Basilisque à la tête de l’armée de Xerxès. Les barbares de son armée, tous
cavaliers, avoient pour commandants Dorothée, qui s’était signalé en
Arménie, et Salomon, né sur la frontière orientale de l’empire, dans le
lieu où fut ensuite bâtie la ville de Dara. Les autres chefs des barbares étaient
Cyprien, Valérien, Martin, Althias, Jean,
Marcel, auxquels Bélisaire joignit Cyrille, lorsque celui-ci fut arrivé
en Afrique. La cavalerie romaine était commandée par Rufin, Augan, Barbatus et Pappus. Rufin passait pour le plus brave
officier de l’armée, et Bélisaire l’avait choisi pour porter l’étendard
général dans les batailles. Augan était Hun de nation; il s’était
distingué à la journée de Dara. Jean de Dyrrachium, commandant
de l’infanterie, avait sous ses Kordres,
Théodore surnommé Crénal, Térence, Zaïde, Marcien et Sarapis. Excepté ceux dont je viens
de marquer la patrie, tous les autres étaient de Thrace, province qui fournissait
alors les meilleurs soldats et les plus vaillants officiers. Pharas commandait
quatre cents Hérules; Sinnion et Balas, renommés pour
leur valeur, étaient à la tête de six cents cavaliers huns, armés d’arcs
et de flèches. La flotte était composée de cinq cents bâtiments de
transport, de diverses grandeurs, depuis le port de cinquante mille
médimnes, jusqu’à celui de trois mille. Le médimne était une mesure de six
boisseaux. Ces barques, chargées des chevaux, des bagages, des munitions de
guerre et de bouche, étaient servies par vingt mille matelots égyptiens, ioniens,
ciliciens. Le pilote général était Calonyme d’Alexandrie. Il y avait de
plus quatre-vingt-douze vaisseaux armés en guerre, fort légers, à un seul rang
de rames, couverts d’un pont, afin que les rameurs fussent à l’abri
des traits. Ces rameurs étaient au nombre de deux mille, tous de
Constantinople. Le patrice Archélaos, qui avait été deux fois préfet du
prétoire, s’embarqua en qualité d’intendant de la flotte et de
l’armée. Bélisaire avait une garde nombreuse, composée de guerriers vaillants
et expérimentés. L’empereur lui donna les plus amples pouvoirs, et lui
remit toute son autorité pour ce qui concernait la guerre d’Afrique. Il
fit partir d’avance Valerien et Martin, avec
ordre d’attendre dans le Péloponnèse le reste de la flotte. Bélisaire se
fit accompagner de sa femme Antonine et de Procope son secrétaire, auquel
il procura dans la suite le titre d'illustre, en récompense de ses services.
Vers le milieu du mois de juin, la flotte étant sur le point
de faire voile, l’empereur fit amener au rivage devant le palais le vaisseau
amiral; le patriarche Epiphane y monta; et, après avoir imploré la
bénédiction du ciel, il fit entrer dans le vaisseau un soldat nouvellement
baptisé, pour sanctifier cette grande entreprise. La flotte partit au
bruit des acclamations et des vœux d’un peuple innombrable qui couvrit au
loin le rivage, alla mouiller à la rade d’Héraclée, où elle s’arrêta
cinq jours, pendant qu’on rassemblait des haras de la Thrace un grand
nombre de chevaux, dont l’empereur faisait présent à Bélisaire. D’Héraclée
la flotte se rendit au port d’Abyde, où le calme
la retint quatre jours. En ce lieu deux cavaliers huns, s’étant enivrés,
comme il était ordinaire à ceux de cette nation, prirent querelle avec-un
de leurs camarades et le tuèrent. Bélisaire, sentant l’importance d établir
d’abord la discipline par un exemple imposant, les fit pendre sur le haut d’une
colline aux portes de la ville. Cet acte de sévérité révolta les Huns; ils
s’accordaient à dire que s’engageant par bienveillance au service des
Romains, ils n’avoient pas prétendu s’assujettir aux lois romaines; que,
suivant celles de leur pays, un emportement d’ivresse n’était
pas puni de mort. Les autres soldats, qui ne cherchaient
qu’à introduire l’impunité, se joignirent à eux, et tout le camp retentissait
de murmures. Bélisaire, sans s’effrayer de cette émeute, les assembla
tous: «Qu’entends-je? (leur dit-il) êtes-vous donc de nouveaux soldats
qui, faute d’expérience, se figurent qu’ils sont maîtres des succès?
Vous avez plusieurs fois taillé en pièces des ennemis égaux en valeur et
supérieurs en forces : n’avez-vous pas appris que les hommes combattent et
que Dieu donne la victoire? C’est en le servant qu’on parvient à servir
efficacement le prince et la patrie: et le culte principal qu’il demande,
c’est la justice; c’est elle qui soutient les armées plus que la force
du corps, l’exercice du courage, et les munitions de guerre. Qu’on ne
me dise pas que l’ivresse excuse le crime: l’ivresse est elle-même un
crime punissable dans un soldat, puisqu’elle le rend inutile à son
prince et ennemi de ses compatriotes. Vous avez vu le forfait, vous en
voyez le châtiment : abstenez-vous des quête relies; abstenez-vous du pillage;
il ne sera pas moins sévèrement puni. Je veux des mains pures pour
porter les armes romaines. La plus haute valeur n’obtiendra point de
grâce, si elle se déshonore par la violence et par l’injustice». Ces
paroles, prononcées avec fermeté, portèrent dans les cœurs une impression
de crainte qui contint les plus turbulents dans les bornes du
devoir.
Bélisaire prit des précautions pour faire en sorte
que la flotte allât toujours de conserve, et qu’elle abordât dans les
mêmes ports. Il savait qu’un grand nombre de vaisseaux, surtout lorsque les
vents soufflent avec violence, se séparent pour l’ordinaire et s’écartent de
leur route. Pour y remédier, on marqua de rouge de haut des voiles du
vaisseau amiral et de deux autres qui portaient les équipages de
Bélisaire, et l’on attacha à la poupe des fanaux suspendus à de longues
perches. Le reste de la flotte avait ordre de suivre toujours ces
trois vaisseaux, qu’il était aisé de distinguer de jour et de nuit.
Quand il fallait sortir du port, on donnait le signal avec la trompette.
D’Abyde ils arrivèrent à Sigée par un vent frais, qui leur manqua tout à coup, en sorte qu’ils
mirent beaucoup de temps à traverser la mer Egée jusqu’au cap de Malée. Mais ce calme les servit très-heureusement aux
approches de ce dangereux parage. Comme le port était fort étroit, les pilotes
et les matelots eurent besoin de toute leur adresse pour empêcher les
navires de se briser en se heurtant les uns les autres. Ils gagnèrent
ensuite le port de Ténare, qu’on nommait alors Cœnopolis,
c’est-à-dire la nouvelle ville; et de là à Méthone, aujourd’hui Modon, où
ils trouvèrent Martin et Valérien qui les attendaient. Le vent étant tombé
tout-à-fait, Bélisaire fit débarquer ses troupes, et passa quelques jours
à les exercer aux évolutions militaires. Pendant ce séjour, la maladie se
mit dans le camp par un effet de la sordide avarice de Jean le
Cappadocien, préfet du prétoire. Pour gagner sur le pain des soldats, il
ne l’avait fait cuire qu’à moitié, afin qu’il pesât davantage. Lorsqu’ils
furent à Méthone, ce n’était plus qu’une pâte moisie, qui se réduisait
en poudre, en sorte qu’on leur distribuait le pain, non pas au poids,
mais par mesure. Ce mauvais aliment, joint à la chaleur du pays et de la
saison, produisit des maladies qui emportèrent en peu de jours cinq
cents hommes; il en aurait péri un plus grand, nombre, si le général
n’eût fait cuire du pain dans le lieu même. Lorsque Justinien en fut
instruit, il loua Bélisaire; mais Jean ne fut pas puni. De Methone ils
passèrent à Zacynthe, aujourd’hui l’île de Zante. Ils
y trouvèrent les esprits cruellement ulcérés contre les Vandales. Les habitants n’avoient
pas oublié l’horrible barbarie de Genséric à l’égard de leurs aïeux. Dans
une course sur les côtes du Péloponnèse, ce prince ayant été repoussé avec
perte de devant la forteresse de Ténare, était venu, frémissant de
dépit et de rage, aborder à Zacynthe; et, après y
avoir fait un sanglant carnage, il avait chargé de fers et transporté dans
ses vaisseaux cinq cents des principaux insulaires. S’étant ensuite embarqué,
il les avait fait hacher en pièces et jeter dans la mer. Les Zacynthiens reçurent Bélisaire comme s’il eût été
envoyé de Dieu pour venger le sang de leurs pères et pour exterminer une
nation inhumaine. Ils épuisèrent leur île pour augmenter
les provisions de sa flotte, elle comblèrent, à son arrivée et à son
départ, de bénédictions et de vœux. On prit dans cette île de l’eau pour
le reste du voyage jusqu’en Sicile. Le vent était si faible, qu’ils mirent
seize jours à faire ce trajet, pendant lesquels l’eau de tous les
vaisseaux se corrompit, excepté celle que buvait Bélisaire. Sa femme
avait renfermé la sienne dans des flacons de verre, qu’elle enterra dans
le sable au fond de son navire, afin que la chaleur du soleil n’y pût
pénétrer. Cette précaution, encore inconnue dans ce temps-là,
fit grand honneur à Antonine.
On aborda sur une côte déserte au pied du mont Etna. Bélisaire,
tout occupé de l’importance de son expédition, se trouvait dans de grandes
inquiétudes. Il ne connaissait ni les côtes d’Afrique, ni les forces des
ennemis, ni leur manière de faire la guerre. Les soldats disaient hautement
que, lorsqu’ils seraient a terre ils feraient le devoir des gens de cœur;
mais que, s’ils se voyaient attaqués sur mer, ils ne balanceraient pas
de prendre la fuite, n’étant pas instruits à combattre à la fois les
ennemis et les flots. Dans cette perplexité, Bélisaire envoya Procope à
Syracuse pour y acheter des vivres, et le chargea de s’informer de l’état
présent des Vandales; s’ils se mettaient en état de venir
au-devant de la flotte ou de s’opposer à la descente; à quel
endroit de la côte il était à propos d’aborder, et par où il fallait commencer
la guerre. Il lui donna rendez-vous au port de Cancanes, à dix lieues de
Syracuse, où il allait faire passer sa flotte. Procope s’acquitta de sa
commission. On lui vendit autant qu’il voulut de vivres, selon les
ordres d’Amalasonte, mère et tutrice d’Athalaric, qui, étant liée
d’amitié avec Justinien, lui avait promis d’ouvrir ses magasins à la
flotte romaine. Pour les informations qu’il était chargé de faire, un
heureux hasard le servit au-delà de ses espérances. Il trouva dans
Syracuse un de ses compatriotes qu’il avait connu à Césarée en Palestine,
et qui s’était établi en Sicile, où il faisait le commerce. Ce marchand lui
amena un de ses facteurs arrivé de Carthage depuis trois jours. Celui-ci
assura Procope que les Vandales étaient dans une parfaite sécurité; qu'ils
ignoraient qu'il y eût en mer une flotte romaine; que leurs meilleures
troupes étaient parties pour la Sardaigne; et que Gélimer, sans inquiétude pour
Carthage et pour les autres villes maritimes, était allé passer
la belle saison à Hermione en Byzacène, a quatre journées de la mer;
que les Romains pourraient aborder où ils voudraient sans rencontrer aucun
obstacle. Procope, tenant cet homme par la main, et l’amusant par
diverses questions, le conduisit à son vaisseau, qui l’attendait au port
d’Aréthuse; et, l’ayant fait monter avec lui comme pour l’entretenir
encore un moment, il leva l’ancre, et cingla vers Caucanes.
Il cria en même temps au marchand qui était demeuré sur le rivage qu’il
le priait de lui pardonner cette innocente supercherie; qu’il était
nécessaire que son commis fût présenté au général pour l'instruire de vive
voix, et pour guider la flotte en Afrique; que, dès quelle serait arrivée,
on le renverrait à Syracuse avec une récompense considérable. En arrivant à
Cancanes, Procope trouva la flotte dans un grand deuil. Dorothée venait de
mourir, et la perte de ce brave guerrier affligeait sensiblement
Bélisaire. Les nouvelles que lui donna le facteur adoucirent
sa tristesse; il partit, et toucha à File de Malte, d’où un bon vent
le conduisit le lendemain à Caputvada, sur
la côte d’Afrique, à cinq journées de Carthage. Ce lieu était ainsi
nommé parce que c’était l’entrée d’un banc de sable qui s’étendait dans la
mer.
Bélisaire fit jeter les ancres, et assembla le conseil dans
le vaisseau amiral pour délibérer sur le lieu du débarquement. Les avis
étant partagés, Archélaos re- présenta qu’on ne pouvait descendre en cet
endroit sans exposer à un péril évident et la flotte et l’armée qu’il n’y avait aucun port dans l’étendue
de neuf journées de chemin, et que la flotte resterait a la merci des
vents; que, les troupes étant débarquées, s’il survenait un
orage, les vaisseaux seraient dispersés en mer ou brisés contre les
côtes; en ce cas, d’où les troupes tireraient-elles leurs subsistances?
Qu’on ne trouverait dans le pays aucune place de sûreté, Genséric ayant
fait démanteler toutes les villes, excepté Carthage; que c’était un
terrain sans eau, où les soldats mourraient de soif; que son avis était
de gagner le port de l’Etang, a deux lieues de Carthage; qu’il était sans défense
et assez spacieux pour contenir toute la flotte; que de la il serait aisé
d’aller attaquer Carthage, qui ne ferait nulle résistance en l’absence
de Gélimer; et que la prise de la capitale rendrait les Romains maîtres de
toute l’Afrique. Bélisaire, qui était d’un sentiment contraire, parla en
ces termes: «Ne pensez pas que je me sois réservé à parler le dernier
pour vous forcer à suivre mon avis; je vais l’exposer; et vous, sans
prévention comme sans crainte, choisissez le plus avantageux.
Souvenez-vous de ce que vous avez entendu dire à nos soldats, que, s’ils étaient
attaqués sur mer, ils ne rougiraient pas de fuir. Nous formions alors des vœux
pour faire notre descente sans opposition. Quelle inconséquence de
demander «au ciel une faveur; et de la rejeter quand elle est acte cordée!
Si nous rencontrons une flotte ennemie sur la route de Carthage, à qui
faudra-t-il nous en prendre de la fuite de nos soldats? On nous allègue la
crainte d’une tempête pour nous engager à ne pas quitter la flotte;
mais lequel des deux est-il préférable, ou de perdre nos vaisseaux seuls,
ou de nous perdre avec eux? Maintenant l’ennemi est pris au dépourvu;
il nous est facile de l’accabler; si nous lui donnons le temps de
respirer, il se mettra en défense, et nous paierons bien cher ce délai.
Peut-être serons-nous obligés de forcer la descente et de verser du sang
pour obtenir l’avantage dont nous sommes en possession sans coup
férir. Notre dessein n’est pas de rester ici; la flotte et l’armée se rendront
à Carthage; la question est de savoir si l’armée , déjà maîtresse du
rivage, doit y marcher par terre sans péril, ou si, perdant son avantage,
elle doit demeurer attachée à la flotte pour courir le hasard de périr
ensemble. Pour moi, je pense qu’il faut descendre à l’instant, débarquer
nos chevaux, nos armes, nos munitions; nous retrancher derrière un
fossé et une palissade, et nous mettre en état de soutenir les assauts. Ne
craignons pas de manquer de vivres, si nous ne manquons pas de courage. La
victoire porte avec elle tous les biens pour les déposer entre les mains du
vainqueur.» Le conseil revint au sentiment du général. On prit terre le
troisième mois depuis le départ de Constantinople.
On ne laissa dans chaque bâtiment qu’une garde de cinq
archers. Les vaisseaux de guerre se rangèrent autour des autres pour leur
servir de défense en cas d’attaque. Les soldats et les matelots commencèrent
aussitôt à se retrancher; et la crainte, jointe à l’activité de Bélisaire,
animant les travailleurs, le fossé fut achevé, et la palissade plantée dès ce
même jour. Ce qu’ils craignaient beaucoup plus qu’ils ne redoutaient
l’ennemi, c’était de mourir de soif dans ce lieu aride, comme
sont toutes les plaines de la Byzacène. Ils furent délivrés de ce
péril par un événement singulier, que Bélisaire n’eut pas de peine à faire
passer pour miraculeux. Un soldat, en bêchant la terre, fit jaillir une
source abondante, qui forma bientôt un ruisseau capable d’abreuver
les hommes et les chevaux de l’armée. Ce fut pour conserver la mémoire de
cette faveur du ciel qu’a près la guerre Justinien fit bâtir en ce lieu
une ville considérable; cette contrée, déserte et sauvage, prit en peu
de temps une face riante, et devint riche par la culture et par le commerce.
L’armée passa la nuit dans le camp, dont la tranquillité fut assurée par
des patrouilles et par des gardes avancées.
Le lendemain, quelques soldats s’étant répandus dans les
campagnes pour y piller des fruits, alors en maturité, le général les fit
battre de verges, et prit cette occasion de représenter à son armée que «le
pillage, criminel en lui- même, était encore contraire à leurs intérêts;
que c’était soulever contre eux les habitants de l’Afrique, Romains
d’origine, et ennemis naturels des Vandales: quelle folie de compromettre
leur sûreté et leurs espérances par une misérable avidité! Que
leur en coûterait-il pour acheter ces fruits que les possesseurs étaient
prêts a leur donner presque pour rien? Vous allez donc avoir pour ennemis
et les Vandales et les naturels du pays, et Dieu même, toujours armé
contrée l’injustice. Votre salut dépend de votre modération, celle-ci
vous rendra Dieu propice, les Africains affectionnés, et les Vandales faciles à
vaincre». Bélisaire, voulant s’assurer de quelque place, apprit qu’à
une journée du camp, sur le chemin de Carthage, était la ville de
Syllecte , voisine de la mer , sans murailles, mais dont les habitants avaient
fortifié leurs maisons pour se défendre contre les incursions des Maures. Il
y envoya un de ses gardes, nommé Moraïde, à la
tête de quelques soldats, avec ordre d’essayer de s’en rendre maître,
mais de ne faire aucun tort aux habitants, et de leur déclarer que les
Romains ne venaient que pour les affranchir du joug des barbares. Cette
troupe arriva le soir près de la ville, dans un vallon, où elle se
tint cachée pendant la nuit. Au point du jour ils entrèrent sans
bruit avec des paysans des environs; et, s’étant saisis des portes, ils
mandèrent l’évêque et les principaux habitants, qui, sur la parole de Bélisaire,
remirent les clefs de la ville. Le même jour, le directeur général des
postes conduisit au camp des Romains tous les chevaux dont il était
maître. On arrêta un courrier de Gélimer. Bélisaire lui fit présent d’une
somme considérable; et, après en avoir tiré parole qu’il s’acquitterait
fidèlement de la commission, il le chargea de remettre à tous les commandants
des Vandales des lettres de Justinien, dont voici la teneur: «Nous ne prétendons
pas faire la guerre aux Vandales, ni rompre le traité de paix conclu avec
Genséric. Nous n’en voulons qu’à votre tyran, qui, au mépris du testament
de Genséric, tient dans les fers votre roi légitime. Ce cruel
usurpateur, après avoir massacré une partie de la famille royale, a fait
crever les yeux aux autres, dont il ne diffère la mort que pour prolonger
leurs tourments. Aidez-nous à vous délivrer d’un si dur esclavage. Nous
prenons Dieu à témoin que notre dessein est de vous rendre la paix et la
liberté». Ces lettres ne produisirent aucun effet, parce que le courrier,
n’osant les rendre publiques, se contenta d’en faire part à ses amis.
Comme on ignorait la situation des ennemis, l’armée marcha
vers Carthage en ordre de bataille, en côtoyant le rivage qu’elle avait à
droite. Pour éviter toute surprise, Bélisaire fit prendre le devant à trois
cents hommes choisis, sous la conduite de Jean l’Arménien, intendant de sa
maison, homme de tête et plein de courage. Cet officier avait ordre de
devancer toujours d’une lieue, et d’avertir dès qu’il apercevrait
l’ennemi. Les Huns marchaient à la même distance sur la
gauche. Bélisaire suivait avec le reste des troupes, s’attendant à
tous moments d’être attaqué par Gélimer, qui sans doute viendrait
d’Hermione fondre sur lui avec toutes ses forces. La flotte devait
accompagner la marche de l’armée sans s’en écarter. Lorsqu’on approcha de
Syllecte, Bélisaire défendit aux soldats d’y faire aucune violence, aucune
insulte; ce qui gagna tellement le cœur des Africains, que, dans tout le
reste de la route, les habitants venaient sans crainte offrir leurs
denrées. Nul ne prenait la fuite; nul ne cachait ses provisions,
ni ne fermait sa cabane. On eût dit que l’armée traversait les terres
de l’empire. On faisait quatre lieues par jour; et le soir on s’arrêtait
ou dans les villes ou dans des retranchements aussi avantageux que la situation
des lieux pouvait le permettre. Après avoir passé la petite Leptis et Adrumète, on arriva à Grasse, éloignée de
Carthage de seize lieues. C’était une maison de plaisance des
rois vandales. L’armée campa dans des vergers délicieux, arrosés de
sources, et si abondants en fruits, que les soldats, après en avoir cueilli
autant qu’ils voulurent, laissèrent encore les arbres chargés.
Dès que Gélimer eut appris à Hermione l’arrivée des
Romains, il dépêcha un courrier à son frère Ammatas, qui
était à Carthage, pour lui donner ordre de se défaire d’Hildéric et de tout ce
qui restait de sa famille, de faire prendre les armes aux Vandales et à
tous les habitants capables de les porter, et de marcher à leur tête vers
Décime, pour y attaquer de front les Romains tandis qu’il les chargerait
lui-même par-derrière. Décime était un défilé sur le chemin à dix milles de Carthage. Ammatas, suivant ses ordres, fit égorger Hildéric, Evagès et leurs amis. Hoamer était
mort avant ce massacre. Les Vandales se tinrent prêts à partir lorsqu’il serait
temps. Gélimer suivait d’abord les Romains, sans qu’ils en eussent connaissance
; mais la nuit qu’ils campèrent à Grasse, les coureurs des deux armées
s’étant rencontrés et séparés après une escarmouche, ceux des Romains
portèrent au camp la nouvelle de l’approche des ennemis. Le lendemain on
perdit la flotte de vue, parce que le promontoire de Mercure, fort avancé
dans la mer et bordé d’écueils, l’obligeait à prendre un long circuit;
Bélisaire fit dire à Calonyme de ne pas approcher de Carthage de plus de trois
lieues jusqu’à nouvel ordre.
Cependant Gélimer détacha son neveu Gibamond avec deux mille hommes, et lui ordonna de prendre les devants sur la gauche,
afin d’envelopper les Romains, qui, en arrivant à Décime, se trouveraient
enfermés entre la mer à leur droite, Ammatas devant eux, Gibamond à leur gauche, et derrière eux
le gros de l’armée. Une disposition si bien concertée aurait jeté Bélisaire
dans un péril digne de lui, sans la précipitation d’Ammatas.
Au lieu de venir avec toutes ses forces, et de compasser sa marche pour
n’arriver à Décime qu’au moment où l’armée romaine s’engagerait dans le
défilé, il se hâta de partir de Carthage avec un escadron de cavalerie,
après avoir ordonné au reste de le suivre; et, étant arrivé avant midi lorsque
les Romains étaient encore éloignés, il rencontra Jean l’Arménien
qu’il chargea incontinent. L’action fut vive entre les deux troupes,
mais elle ne dura pas longtemps. Ammatas, emporté
par une ardeur téméraire, se jette au milieu des ennemis, tue de sa main
douze des plus braves, et est enfin tué lui-même; ses cavaliers prennent
la fuite, et portent l’épouvante parmi les autres Vandales qui venaient
les joindre en désordre et par pelotons. Tous s’enfuirent vers Carthage
croyant avoir déjà sur les bras l’armée entière. Jean l’Arménien, avec ses
trois cents cavaliers, les poursuivit jusqu’aux portes de la ville, et,
dans cet espace de mille pas, il fit un si grand carnage, qu’on aurait cru que
les vainqueurs étaient du moins au nombre de vingt mille. Gibamond n’eut pas un sort plus heureux. A deux lieues
de Décime, dans une plaine stérile et déserte, où les eaux sont si
salées qu’on la nommait la campagne de sel, il rencontra
le détachement des Huns qui couvraient la gauche de Bélisaire. Le cavalier
hun, qui, suivant l’usage de la nation, avait le privilège héréditaire d’aller
le premier à l’attaque, s’avança seul pour combattre; et, comme
les Vandales, étonnés de cette audace , demeuraient immobiles', il
retourna vers les siens, en criant: «Chargeons, camarades; c’est une proie
qui n attend qu’à être dévorée». Les Huns fondent avec furie sur les Vandales,
qui se débandent aussitôt, et périssent tous avec leur chef.
Les deux armées ignoraient également la défaite d’Ammatas et celle de Gibamond.
Bélisaire, arrivé à une lieue et demie de Décime, trouva un terrain
propre pour un campement; il y logea son infanterie, et
ayant assemblé toutes les troupes, il leur parla en ces termes:
«Romains, et vous
braves alliés, voici l’occasion de montrer votre valeur. L’ennemi approche;
notre flotte est éloignée; toutes nos ressources sont dans notre courage.
Nous n’avons point de places de sûreté, point de remparts pour nous
couvrir après une défaite; mais, si nous combattons aujourd’hui en gens de
cœur, la guerre est terminée. Que de motifs doivent animer notre
confiance! Nous avons pour nous la justice; l’Afrique est notre patrimoine:
le ciel trahira-t-il une entreprise si légitime? Gélimer est un usurpateur
couvert du sang de ses rois. Quels efforts voudra faire le soldat vandale
pour un tyran qu’il déteste? Depuis un siècle que nos ennemis ont envahi
l’Afrique, plongés dans une molle oisiveté, ils ont perdu l’habitude de la
guerre; ils ne l’ont faite qu’aux Maures, nation fuyarde, aussi désarmée et
aussi timide que ses troupeaux. Vous, au contraire, toujours dans
les alarmes, vous n’avez cessé d’entretenir cette chaleur martiale
qui décide du sort des combats. Ramassez aujourd’hui toutes les forces que vous
avez tant de fois employées contre les Perses, et ne doutez pas qu’une
victoire encore plus complète ne couronne vos efforts contre un ennemi
beaucoup moins redoutable.»
Après les avoir animés par ces paroles, il laissa
l’infanterie dans le camp, et sortit à la tête de ses cavaliers, voulant reconnaître
les forces de l’ennemi avant que délivrer une bataille générale. Il fit prendre
les devants aux escadrons des peuples alliés, et suivit avec la cavalerie
romaine. Les alliés, étant arrivés à Décime, virent étendus par terre les
douze Romains qu’Ammatas avait tués, le cadavre
d’Ammatas même, et, autour de lui, quelques
Vandales. Ayant appris des paysans du voisinage ce qui s’était passé en ce
lieu, ils ne savaient de quel côté diriger leur route pour rejoindre Jean
l’Arménien. Comme ils jetaient les yeux de toutes parts, ils aperçurent du
côté du midi une nuée de poussière, au sein de laquelle ils découvrirent
bientôt toute la cavalerie vandale. Ils envoyèrent en diligence en donner
avis à Bélisaire. Les uns voulaient, sans l’attendre, courir sur
l’ennemi; les autres représentaient que la partie était trop inégale.
Pendant cette contestation, Gélimer approchait, et se trouvait en
présence. Il marchait entre la cavalerie de Bélisaire et le corps des
Huns, qui avaient défait Gibamond; mais les
coteaux qui les séparaient les avoient empêchés de se voir les uns les
autres. Au milieu de la plaine s’élevait une colline dont les
alliés des Romains et les Vandales voulaient également s’emparer, comme
d’un poste avantageux, soit pour se retrancher, soit pour fondre sur l’ennemi.
Les Vandales gagnèrent de vitesse, et tombant de là sur la cavalerie des
alliés, ils l’enfoncèrent, et la mirent en déroute. Les fuyards
rencontrèrent, à une lieue de Décime, Vliaris, garde de Bélisaire, à la
tête de huit cents cavaliers, qui formaient l’avant-garde. Vliaris, au
lieu de rallier ceux qui fuyaient, prit lui-même la fuite, et tous
ensemble, saisis d’épouvante, allèrent joindre le général. C’en était fait
des Romains, si Gélimer, profitant de ce désordre, eût alors attaqué
Bélisaire, fort inférieur en forces, et dont les troupes étaient
effrayées. Il pouvait encore tourner vers Carthage, tailler en pièces les
cavaliers de Jean l’Arménien, dispersés dans la campagne, où ils s’arrêtaient
à dépouiller les morts, s’assurer de la ville, se rendre maître de la
flotte romaine, qui n’en était pas éloignée, et de toutes les munitions de
l’armée. C’eût été ravir aux Romains et les moyens de subsister
en Afrique, et l’espérance d’en sortir. Il ne fit rien de ce qu’il devait
faire; mais, à la descente de la colline, ayant aperçu le cadavre de son
frère, il s’abandonna aux regrets et aux pleurs, et perdit des moments si
précieux à lui rendre les honneurs funèbres. L’occasion de vaincre
lui échappa et ne revint plus. Bélisaire, ayant rencontré les
fuyards, les rallie, leur reproche leur lâcheté, apprend le succès de Jean l’Arménien,
s’instruit de la situation des lieux et de l’état des ennemis, et, sans
perdre un moment, il court aux Vandales. Ceux-ci, mal en ordre, et plus
occupés des funérailles que des dispositions nécessaires pour un combat,
ne tiennent pas contre cette attaque imprévue. Ils se débandent; il en
périt un grand nombre, et la nuit seule mit fin au carnage. Gélimer,
aveuglé par la terreur, au lieu de se sauver à Carthage ou dans la Byzacène,
prit la route de Numidie, fuyant jour et nuit, et ne s’arrêta que dans
les plaines de Bule, à quatre journées de
Carthage. Sur le soir, Jean l’Arménien et les Huns se rendirent auprès
de Bélisaire; et, après avoir appris sa victoire, et raconté eux-mêmes
leurs succès, ils passèrent la nuit ensemble près de Décime dans la joie
et dans le repos.
Le lendemain, l’infanterie étant venue les joindre, ils marchèrent
tous vers Carthage, où ils arrivèrent à l’entrée de la nuit. Ils trouvèrent les
portes ouvertes. Les habitants avoient illuminé toutes les rues: ils célébraient
ce moment heureux comme celui de leur délivrance, tandis que les Vandales
éperdus se réfugiaient dans les églises, ou, pales de frayeur, ils tenaient les
autels embrassés. Pour recevoir la flotte romaine qu’on commençait à découvrir,
on retira la chaîne qui fermait l’entrée du port. Cependant Bélisaire ne
voulut pas entrer pour lors dans la ville, soit par défiance de quelque
trahison, soit qu’il appréhendât qu’à la faveur des ténèbres
les soldats ne s’abandonnassent au pillage. Il passa la nuit à
quelque distance, auprès d’une église de Saint-Cyprien. C’était la veille
de la fête de cet illustre martyr, qu’on célébrait à Carthage avec grande
solennité le quatorze de septembre. Tandis qu’Ammatas était allé attaquer les Romains à Décime, les prêtres ariens, établis en
ce lieu depuis que les Vandales en étaient maîtres, se tenant assurés
de la victoire, avoient paré l’église de ses plus riches ornements pour la
fête du lendemain. A la nouvelle de la défaite des Vandales, ils avoient pris
la fuite, et Bélisaire trouva les catholiques déjà en possession
de l’église, et qui achevaient de tout préparer. Il posta des gardes
aux portes, et défendit aux soldats d’en approcher. Pendant cette nuit les
prisonniers romains furent délivrés, sans être obligés d’attendre cette
faveur de Bélisaire. Dans le palais voisin du port était un cachot vaste
et profond, où le tyran tenait enfermés plusieurs marchands romains, qu’il
accusait d’avoir excité l’empereur à la guerre. Il avait déjà prononcé leur
sentence, et ordonné qu’on les réservât pour être mis à mort
au milieu delà pompe de son triomphe, lorsqu’il rentrerait victorieux.
Le concierge , instruit de l’arrivée des Romains, descendit au cachot; et,
comme les prisonniers tremblaient à sa vue, s’imaginant qu’il venait les
chercher pour les conduire au supplice: Que me donnerez-vous, leur dit-il,
si je vous rends la liberté? Tous répondirent qu’ils étaient prêts à lui
abandonner ce qu’ils possédaient: «Eh bien! ajouta-t-il ne vous
demande ni or ni argent; jurez-moi seulement que, quand vous serez
libres, vous vous intéresserez de tout votre pouvoir en ma faveur auprès de vos
maîtres et des miens». En même temps, ayant ouvert une fenêtre, il leur
fit voir, à la clarté de la lune, les vaisseaux romains qui entraient
dans le port, et les mit en liberté.
Ces vaisseaux étaient ceux de Calonyme, qui, malgré la
défense de Bélisaire, venaient piller la ville. Voici comment la chose
arriva. Calonyme, ne sachant rien de ce qui se passait à terre, envoya au
promontoire de Mercure pour en apprendre des nouvelles. Instruit
du succès de Bélisaire, il continua sa route vers Carthage. On n’en était
qu’à sept lieues, lorsque Archélaos fit jeter les ancres pour assembler le
conseil, et délibérer sur le parti qu’on devait prendre. Il voulait, selon
les ordres du général, s’arrêter à trois lieues en-deçà de la
ville, et les gens de guerre étaient de son avis. Mais Calonyme et
les gens de mer représentaient que tout ce parage n’avait point d'abri, et
qu’on était à la veille d’essuyer la violente tempête nommée la Cyprienne
, parce qu’elle ne manquait jamais de revenir tous les ans vers la
fête de saint Cyprien; qu’il n’en échapperait pas un seul vaisseau.
Pour obéir à Bélisaire, autant qu’on le pouvait sans danger, on fut d’avis de
ne point aller jusqu’à Carthage, d’autant plus qu’on croyait la chaîne
encore tendue à l’entrée du port, qui d’ailleurs était trop
petit pour contenir toute la flotte, mais de se mettre en sûreté dans
le port de l’Etang, à deux lieues de la ville. Ils arrivèrent sur le soir.
La nuit étant venue, Calonyme, avec quelques vaisseaux, sans avoir égard aux
ordres de Bélisaire, cingla vers Carthage, entra dans le port nommé pour
lors Mandracium, descendit à terre avec ses
matelots bien armés, et, après avoir pillé les magasins et les maisons
voisines, il retourna, chargé de butin, rejoindre le reste de la
flotte.
Le jour suivant Bélisaire fit débarquer les soldats des
vaisseaux, et, les ayant joints aux autres troupes, il marcha en ordre de
bataille, crainte de quelque surprise. Avant que d’entrer dans la ville,
il fit faire halte, et représenta aux soldats «qu'ils étaient redevables de
leurs succès a leur modération à l’égard des Africains; que Carthage était
une ville romaine qui n’avait subi que par force le joug des Vandales;
qu’elle avait gémi sous la tyrannie des barbares, et que c'était pour l’en
délivrer que l’empereur avait entrepris la guerre; qu’ils dévoient y
observer la plus exacte discipline; que ce serait une perfidie criminelle
de maltraiter des peuples qu’ils étaient venus mettre en liberté». Il
entra dans Carthage au milieu des acclamations, et marcha au palais, où il
s’assit sur le trône de Gélimer. Les habitants, accourus en foule, regardaient
le général romain comme un ange tutélaire . ils embrassaient ses soldats;
ils s’embrassaient les uns les autres en versant des larmes de joie; ils craignaient que
ce ne fût un songe. Tout respirait la plus vive allégresse. Mais ceux qui occupaient
les maisons voisines du port vinrent en grand nombre se plaindre au
général du pillage de la nuit précédente. Bélisaire fit venir Calonyme, et
l’obligea de jurer qu’il ferait rapporter fidèlement et rendre aux
propriétaires tout ce qui leur avait été enlevé. Calonyme jura , et retint
tout ce qu’il put. Procope attribue à une punition divine
l’accident qui lui survint peu après son retour à Constantinople: ce
parjure tomba en frénésie, et mourut en se déchirant la langue avec les
dents.
Deux jours avant l’arrivée de Bélisaire, on avait fait les
apprêts d an grand festin, qui devait couronner la victoire de Gélimer. Le
général, s’étant mis à table avec ses principaux capitaines, se fit servir
les mêmes viandes, dans la même vaisselle, par les officiers du roi des
Vandales: spectacle frappant, qui faisait sentir combien est caduque et
passagère la propriété des possessions humaines. Le vainqueur fit connaître en
ce jour qu’il n’avait pas moins de force pour contenir ses
troupes que pour vaincre les ennemis. Depuis la décadence de la
discipline romaine, il semblait impossible d’empêcher le désordre dans une
ville où auraient seulement passé cinq cents soldats. L’armée entra dans
Carthage comme elle serait entrée dans Constantinople; on
n’y entendit, pas une parole outrageante, pas une plainte. Le
commerce ne fut point interrompu; les boutiques demeurèrent ouvertes; les
officiers de la ville distribuèrent tranquillement aux soldats des billets de
logement, et les soldats payèrent les vivres qu’ils voulurent acheter.
Bélisaire leur partagea les richesses qui furent trouvées dans le palais
de Gélimer. Il donna parole de sûreté aux Vandales qui s’étaient réfugiés
dans les églises. Aussitôt il s’occupa du rétablissement des murailles, tellement
ruinées, que la ville était hors d’état de soutenir un siège. Comme il payait libéralement
les ouvriers, les brèches furent incontinent réparées, et les murs
environnés d’un fossé profond et d’une forte palissade. Ce fut ainsi que
les Romains rentrèrent dans Carthage, quatre-vingt-quinze ans depuis
qu’elle avait été prise par Genséric.
Gélimer n’avait pas encore perdu toute espérance. Il
engagea par argent les paysans africains à massacrer les Romains qu’ils trouveraient
dispersés dans les campagnes, leur promettant une récompense pour
chaque tête qu’ils lui apporteraient. Ils en égorgèrent en effet un
assez grand nombre; mais ce n’étaient que des valets de l’armée, qui s’écartaient
du camp pour piller les villages voisins. Gélimer, croyant que c’étaient autant
de soldats, paya ces têtes plus cher qu’elles ne valaient. Un des gardes
de Bélisaire, nommé Diogène, échappa du danger par sa bravoure. Envoyé
avec vingt-deux cavaliers pour reconnaître l’ennemi, il s’arrêta dans
un hameau à deux journées de Carthage. Les habitants, ne se sentant
pas assez forts pour se rendre maîtres de cette troupe, en donnèrent avis
à Gélimer, qui détacha sur-le-champ trois cents cavaliers, avec ordre de s’en
saisir et de les lui amener. Diogène, qui savait que les ennemis étaient
loin de là, s’était logé dans une métairie, où il reposoir tranquillement.
Les Vandales, arrivés avant le jour, ne jugèrent pas à propos de forcer
l’entrée, craignant de se méprendre dans un combat de nuit, et de se tuer
les uns les autres, tandis que l’ennemi leur échapperait à la faveur de
l’obscurité. Ainsi, en attendant le jour, ils se contentèrent d’investir
la maison. Un Romain, réveillé plus tôt que les autres, entendit un
murmure et un cliquetis d’armes; et, devinant ce que c’était, il courut avertir
Diogène et ses camarades. Ils se lèvent en diligence, prennent
leurs armes, sellent leurs chevaux, et, s’étant rangés sans bruit
derrière la porte, ils l’ouvrent tout à coup, et s’élancent au travers des
gardes, se couvrant de leurs rondaches, et frappant à droite et à gauche à
grands coups de piques. Diogène sauva ainsi sa troupe, dont il
ne perdit que deux cavaliers. Il reçut lui-même quatre blessures, qui
ne se trouvèrent pas mortelles.
La possession de Carthage livrait aux Romains l’Afrique
entière, où Genséric n’avait pas laissé une seule place fortifiée.
Bélisaire dépêcha Salomon pour instruire l’empereur de ces heureux succès.
Dès le commencement de la guerre, Gélimer avait fait demander du secours
à Theudis, qui régnait avec gloire en Espagne
sur les Visigoths. Ses députés, marchant à petites
journées, traversèrent le détroit de Cadix, et se rendirent auprès du
prince, qui les reçut avec honneur. Il était déjà informé de l’état de
l’Afrique par un vaisseau marchand parti de Carthage le jour même que les
Romains y étaient entrés; mais il avait tenu cette nouvelle
secrète. Dans un grand repas qu’il donna aux députés, il leur demanda
quelle était la situation de Gélimer. Ils avoient laissé ce prince à la
tête d’une belle armée, et ils ignoraient absolument tout ce qui s’était passé
depuis leur départ. Ils répondirent que Gélimer était à la
veille d’écraser une misérable poignée de brigands romains, s’il n’était
pas même déjà vainqueur. «Quel est donc le sujet qui vous amène?» reprit Theudis. Comme ils répliquaient qu’ils venaient lui
proposer une alliance aussi avantageuse aux Visigoths qu’aux Vandales: «Retournez, leur
dit-il, à Carthage, et informez-vous de l’état de vos affaires». Ils
prirent ce discours pour celui d’un homme ivre, dont les paroles ne méritaient
pas d’être relevées. Mais le lendemain, ayant réitéré la même proposition
et reçu la même réponse, ils commencèrent à craindre qu’il ne fût
arrivé quelque disgrâce à leur nation. Cependant, bien éloignés de croire le
mal aussi grand qu’il l’était en effet, ils firent voile vers Carthage. A
leur entrée dans le port ils furent arrêtés et conduits à
Bélisaire, qui, sans leur faire aucun mal, apprit de leur bouche tout
le secret de leur ambassade.
Le tyran, frustré de l'espérance qu’il avait fondée sur le
secours de Theudis, rassembla dans les plaines
de Bule tout ce qu’il put de Vandales et de
Maures. Ceux-ci n’étaient que des brigands sans chef et en petit
nombre. Tous les princes de Mauritanie, de Numidie et de Byzacène avoient
envoyé assurer Bélisaire de leur soumission, et lui avoient promis des
troupes. Plusieurs d’entre eux lui donnèrent même leurs enfants en otage,
et voulurent recevoir de lui les marques de la royauté. C’était
un ancien usage que les princes maures ne prissent la qualité de rois
qu’après avoir reçu de l’empereur romain une sorte d’investiture; et parce que,
depuis la conquête, ils ne la tenaient que de la main des Vandales, ils ne
se croyaient pas solidement établis. Ces ornements étaient un sceptre
d’argent doré, un diadème d’argent orné de bandelettes, un manteau blanc
qui s’attachait sur l’épaule droite avec une agrafe d’or, une tunique
blanche, peinte de diverses figures, et des brodequins relevés
en broderie d’or. Bélisaire envoya ces parures avec une somme
d’argent à chacun de ces petits princes, qui passaient sous la protection de
l’empire. Cependant aucun d’eux ne lui fournit des troupes non plus qu’aux
Vandales; ils gardèrent la neutralité, attendant la destruction totale de
l’un des deux partis pour se déclarer en faveur de l’autre.
La nouvelle d’une si soudaine révolution n’arriva en Sardaigne
qu’avec les lettres de Gélimer. Son frère Zazon, après la défaite et la mort de
Godas, lui avait écrit en ces termes: «L’usurpateur a subi la peine due
à ses forfaits; nous sommes maîtres de l’île entière. Célébrez notre
victoire par des fêtes. J’apprends que nos ennemis ont osé porter la
guerre en Afrique: leur audace ne sera pas plus heureuse que n’a été celle de
leurs pères». Ceux qui furent chargés de cette lettre arrivèrent au
port de Carthage sans nulle défiance. Ils furent bien surpris de se voir
arrêtés et conduits devant Bélisaire, qui, après les avoir interrogés, les
retint à Carthage sans leur faire aucun mauvais traitement.
Cependant Gélimer, abattu par ses malheurs, résolut de rappeler Zazon,
dont la valeur était célèbre, et dont il ignorait encore les succès. Le
Vandale chargé de sa dépêche trouva heureusement un vaisseau prêt à
partir; et, étant arrivé à Carale, il remit à
Zazon la lettre de son hère.
«Ce n’est pas Godas (disait Gélimer), c’est la colère divine
qui nous a enlevé la Sardaigne pour vous séparer de nous, et pour détruire
plus facilement la maison de Genséric en lui ôtant le secourt de votre valeur,
et l’élite de nos guerriers. Votre départ a rendu Justinien maître de
l’Afrique. Nos désastres font bien sentir que le ciel avait résolu notre
perte. Bélisaire n’est descendu qu’avec peu de, troupes; mais le courage
des Vandales a disparu, et notre fortune est détruite. Ammatas et Gibamond ne sont plus; nos villes, nos ports,
Carthage et l’Afrique entière sont aux ennemis. Les Vandales, insensibles
à la perte de leurs biens, de leurs femmes et de leurs enfants, paraissent
s’être oubliés eux-mêmes. Il ne nous reste que la plaine de Bule, où nous vous attendons comme notre dernière
ressource. Laissez là le tyran, abandonnez-lui la Sardaigne; venez nous joindre
avec vos braves soldats. Quand le cœur est en danger, c’est tout
perdre que de s’occuper à sauver les autres parties. Venez, mon frère; en
réunissant nos forces, nous réparerons nos infortunes, ou nous les adoucirons
en les partageant ensemble». La lecture de cette lettre pénétra Zazon et
ses Vandales d’une douleur aussi sensible qu'elle était imprévue. Ils
s’efforcèrent néanmoins de cacher leur affliction aux habitants de l’île,
et ce n’était qu’entre eux qu’ils donnaient un libre cours à
leurs larmes. Après avoir mis ordre aux affaires de Sardaigne le plus
promptement qu’il fut possible, ils s’embarquèrent, et arrivèrent en trois
jours à la côte d’Afrique, sur les confins de la Numidie et de la
Mauritanie. Ils marchèrent de là vers la plaine de Bule , où ils se réunirent au reste des troupes. Ce fut une douloureuse
entrevue, et capable d’attendrir leurs ennemis mêmes. Gélimer
et Zazon se tenaient étroitement embrassés, et,
s’arrosant mutuellement de leurs larmes, ils ne s’exprimaient que par
leurs gémissements et leurs sanglots. Les Vandales des deux armées
s’abordèrent avec un empressement de désespoir; attachés les uns sur les
autres, et ne pouvant se séparer, ils se rassasiaient de la triste
consolation de se communiquer leur douleur. Le sentiment de leurs disgrâces
présentes avait absorbé tous les autres. Ils ne se demandèrent rien, les uns de
l’Afrique, les autres de la Sardaigne; ils ne s’informaient ni de leurs
femmes ni de leurs enfants, se persuadant que tout ce qu’ils ne voyaient
plus était perdu pour eux.
Avec ces troupes réunies, Gélimer marcha vers Carthage.
Lorsqu’il fut proche de la ville, il fit couper l’aqueduc, ouvrage d’une
structure admirable. Etant demeuré ce jour-là et le lendemain campé au
pied des murs, quand il vit que l’ennemi S’y tenait renfermé, il
s’éloigna, et partagea son armée sur toutes les avenues pour couper la
communication avec les campagnes et réduire la ville par la famine.
Voulant se concilier l’affection des peuples, il défendit le pillage,
ménageant les habitants des environs comme ses sujets. Il espérait quelque
trahison en sa faveur de la part des Carthaginois, et même des soldats ariens
qui se trouvaient dans l’armée de Bélisaire. Les Huns étaient mécontents;
la sévérité de la discipline romaine s’accordait mal avec leur
caractère brutal et indocile. D’ailleurs ils ne servaient qu’à regret en
Afrique, où ils craignaient qu’on ne les laissât mourir, sans leur
permettre de retourner dans leur pays. Gélimer profita de ces dispositions
pour les corrompre. Leurs chefs, gagnés par des offres séduisantes, promirent
de tourner leurs armes contre les Romains dès que le combat serait engagé.
Bélisaire, instruit de ces menées secrètes, différa de livrer
bataille jusqu’à ce qu’il eût achevé la réparation des murailles. Il
fit pendre un citoyen distingué, nommé Laurus, convaincu
de trahison. Cet exemple intimida les autres, et rompit les intelligences
que l’ennemi entretenait dans la ville. Le général romain sut si bien
regagner les Huns par ses caresses, par ses libéralités, par le vin qu’il
leur fit distribuer, et que cette nation aimait passionnément, qu’il
les amena au point de lui avouer eux-mêmes leur défiance, leur perfidie,
et les promesses du roi des Vandales. II les rassura en leur promettant avec
serment que, la guerre finie, il leur donnerait la liberté de retourner dans
leur patrie avec leur butin. Les Huns jurèrent de leur part qu’ils le serviraient
avec fidélité.
Gélimer entretenait des espions dans Carthage. Informé du
peu de succès de ses intrigues, et désespérant de réduire la ville par un
blocus, il se détermina à livrer encore une bataille; et, pour y attirer
l’ennemi, il alla camper à six lieues de là, dans un lieu nommé Tricamare. Tous les Vandales que le désespoir n’avait
pas emportés dans l’intérieur de l’Afrique s’étaient rendus auprès de
lui avec leurs familles; et son armée montait à plus de cent mille hommes.
Celle des Romains, quoique près dix fois moins nombreuse, avait conçu tant
de confiance en son général, et tant de mépris pour l’ennemi, qu’elle souhaitait
ardemment d’en venir aux main pour terminer la guerre. Bélisaire, aussi
capable d’enflammer le courage de ses soldats par son
éloquence guerrière que par l’exemple de sa bravoure, les
ayant harangués selon sa coutume, fit sortir de Carthage
Jean l’Arménien avec l’infanterie légère et toute la cavalerie, dont
il ne réserva que cinq cents hommes. Il lui donna ordre d’inquiéter
l’ennemi, et de le harceler par des escarmouches. Il partit lui-même le
lendemain, et vint camper à deux ou trois lieues des Vandales.
Pendant la nuit l’alarme fut grande dans le camp des Romains pour une
cause fort légère. La plupart des piques plantées en terre semblaient jeter des
flammes, et le fer paraissait embrasé. Ce prétendu prodige fut regardé,
après l’événement du combat, comme un pronostic de victoire; et, quelques
années après, dans la guerre d’Italie, le même phénomène causa autant de
joie qu’il avit causé d’inquiétude en Afrique.
Le jour suivant Gélimer ordonna aux Vandales de rassembler
au centre du camp leurs familles et leurs équipages. Et suite après avoir
encouragé ses soldats, il les fit défiler au milieu des cris lamentables de
leurs enfants et de leurs femmes. Les Romains ne s’attendaient pas à
combattre ce jour-là, et s’occupaient à préparer leur repas,
quand leurs coureurs vinrent les avertir que les Vandales marchaient à
eux. Entre les deux armées coulait un ruisseau, au bord duquel Gélimer rangea
ses troupes. Zazon se plaça au centre; les Maures faisaient
l’arrière-garde. Gélimer, courant au travers des rangs, exhortait
ses gens à bien faire: il leur avait déjà donné ordre de ne se servir
que de leurs épées, sans faire usage des armes de jet. Les Romains,
exercés par Bélisaire à faire avec précision et promptitude toutes les
évolutions, furent bientôt en bataille. A l’aile gauche était la cavalerie
des alliés, à la droite la cavalerie romaine. Au centre, autour de
l’enseigne générale, était un corps de cavalerie d’élite avec les gardes
de Bélisaire, sous les ordres de Jean l’Arménien. Les Huns, selon leur
usage, formaient un corps de réserve. Bélisaire conduisait l’infanterie,
qui composait l’arrière-garde avec cinq cents cavaliers. Comme elle marchait
plus lentement, il en détacha les cavaliers, et vint lui-même à leur tête
joindre le reste de la cavalerie, qui courut aussitôt à l’ennemi. Ils n’étaient
plus séparés que par le ruisseau, lorsque Jean l’Arménien, à la tête d’un
escadron, le passa par ordre de Bélisaire, et alla charger le centre de
l’armée vandale. Zazon le reçut avec vigueur, et l’obligea de repasser le
ruisseau sans oser le franchir lui-même. Jean revint à la charge avec un
corps plus nombreux, et fut encore repoussé. Enfin, ayant pris avec lui
l’enseigne générale, et se faisant suivre de tous les gardes de Bélisaire
, il se lança une troisième fois avec tant de furie en poussant de grands cris,
que les Vandales, malgré les plus vigoureux efforts, ne purent faire plier
cette troupe invincible. Les plus braves y périrent, et Zazon
avec eux. Dans ce moment toute la cavalerie de Bélisaire s’étant ébranlée,
franchit le ruisseau et chargea les ennemis. Le centre étant enfoncé et rompu,
les deux ailes, qui pouvaient aisément envelopper un si petit nombre
de cavaliers, ne songèrent qu’à la fuite. Les Huns se joignirent au reste
de la cavalerie pour tailler en pièces les fuyards. Mais la poursuite ne
fut pas longue; les vaincus eurent bientôt regagné leur camp, où
Bélisaire ne jugea pas à propos de les attaquer, son infanterie n’étant
pas encore arrivée. En l’attendant, les vainqueurs dépouillèrent les morts
qu’ils voyaient couverts de riches armures. Cette bataille, qui
décida en un moment du sort des Vandales, ne coûta que cinquante
hommes aux Romains et huit cents aux barbares. Une perte si légère causa la
déroute d’une armée de cent mille hommes; et, ce qui tient encore du
prodige, c’est que Bélisaire remporta cette grande victoire avec sa seule
cavalerie, qui n’était que de six mille hommes. Ce récit paraîtrait
fabuleux, s’il n’était attesté par un historien intelligent et témoin
oculaire. On peut dire à la vérité que les Vandales portaient d’avance
dans le cœur la fuite et l’épouvante, et que la terreur du nom de
Bélisaire, la valeur de Jean l’Arménien et la mort de Zazon ne firent
qu’achever leur défaite. Mais, malgré ces raisons, on ne peut s’empêcher
de conclure que Gélimer était un très-mauvais général. Ce fut Bélisaire
qui, le premier depuis Jule César, rendit aux Romains l’habitude de
vaincre des ennemis très-supérieurs en nombre.
L’infanterie arriva lorsqu’il était déjà tard, et Bélisaire
marcha sur-le-champ avec toutes ses troupes vers le camp ennemi. Dès que
Gélimer en fut averti, il sauta sur son cheval, et, sans dire une parole,
sans laisser aucun ordre, il s’enfuit à toute bride, et prit la route
de Numidie, n’étant suivi que d’un petit nombre de ses parents et de
ses domestiques. Les Vandales ne s’aperçurent pas d’abord de sa fuite; mais le
bruit s’en étant répandu, ce ne fut plus parmi eux que désordre et que tumulte.
Ils se précipitent en foule par toutes les portes, abandonnant leurs
richesses et les personnes qui leur sont les plus chères, et qui ne
peuvent les suivre que par leurs cris déplorables. Toute la plaine, est
remplie d’hommes, de chevaux, d’enfants, de femmes, de fuyards et de
désespérés. Les Romains s’emparent du camp, et courent à la poursuite,
massacrant les hommes, enlevant les femmes et les enfants. Le butin fut
immense. Les dépouilles de l’Italie, de la Sicile et de la Grèce tant de
fois pillées par Genséric; celles de Carthage et de toute l’Afrique; l’or et
l’argent entassés pendant un siècle par une nation avare, dans un pays
qui, sans avoir besoin de marchandises étrangères, nourrissait par sa
fertilité inépuisable les nations voisines, tant de trésors accumulés
furent la proie des vainqueurs. Cette dernière bataille se donna vers le
milieu de décembre, trois mois depuis l’entrée de Bélisaire dans Carthage.
Ce général passa la nuit dans une grande inquiétude. Une
bonne partie des troupes était hors du camp; il craignait que les ennemis ne
revinssent de leur épouvante, et ne fissent payer bien cher aux Romains la
joie de la victoire. Dans le désordre où se trouvaient les vainqueurs, un
corps de cinq à six mille hommes aurait suffi pour les tailler en pièces.
Dispersés de toutes parts, seuls ou deux ou trois ensemble, ils s’enfonçaient
dans les forêts, fouillaient les grottes et les cavernes, dans l’espérance
d’y trouver quelque fuyard ou quelque trésor. Enivrés de leur bonheur,
éblouis de la beauté de leurs prisonnières, ils semblaient avoir oublié
leur général et leur armée, et ne songeaient qu’à retourner à
Carthage pour y jouir de leur nouvelle prospérité. Une fortune de
quelques moments les rendit déjà presque semblables aux Vandales. Dès que
le jour parut, Bélisaire monta sur un tertre au bord du chemin. De là, à
mesure qu’il voyait passer des officiers ou des soldats, il les arrêtait et les
remettait en ordre, leur faisant de vives réprimandes. Ceux qui étaient à
portée de le voir et de l’entendre s’attroupaient autour de lui, et envoyaient
à Carthage leur butin et leurs prisonniers, sous la garde des valets
de l’armée. Il fit partir deux cents cavaliers sous la conduite de Jean
l’Arménien, avec ordre de poursuivre Gélimer jour et nuit, jusqu’à ce
qu’ils l’eussent pris vif ou mort. Il écrivit à Carthage de faire quartier aux
Vandales qui se seraient réfugiés dans les églises des environs, et de les
conduire à la ville pour les y garder jusqu’à son retour. Il parcourut en
personne les campagnes avec ce qu’il avait rassemblé de troupes, rassurant
les Vandales qu’il rencontrait, et leur donnant parole qu’il ne leur serait
fait aucun mal. Les églises des villages en étaient remplies; on se contentait
de les désarmer, et de les envoyer à Carthage sous bonne garde, par bandes
séparées, de crainte qu’étant en trop grand nombre, ils ne se portassent à
quelque violence. Après avoir donné ordre à tout, il marcha lui-même en
diligence avec une partie de ses troupes pour aller chercher Gélimer.
Il y avait déjà cinq jours que Jean l’Arménien poursuivait
sans relâche ce prince fugitif, et il était près de l’atteindre, lorsqu’un
funeste accident le priva d’une gloire que son éclatante valeur avait bien
méritée. Entre les officiers qui l’accompagnaient était Vliaris, garde
de Bélisaire, homme de cœur et d’une force de corps extraordinaire, mais
déréglé dans ses mœurs et fort adonné au vin. Le sixième jour, Vliaris,
déjà ivre au lever du soleil, courrait derrière Jean l’Arménien, et, voulant
abattre un oiseau perché sur un arbre, au lieu d’adresser à l’oiseau, il
perça le cou de Jean de part en part. On cessa la poursuite pour ne songer
qu’à la blessure du capitaine. Tous les soins furent inutiles, il expira peu
après. On fit savoir à Bélisaire cette triste nouvelle. II accourut aussitôt,
arrosa le tombeau de ses larmes, le fit décorer avec magnificence, et, pour
l’entretien de ce monument, il y assigna une rente annuelle. Toute l’armée
pleura ce généreux guerrier; il fut regretté des Carthaginois mêmes,
aussi charmés de sa bonté et de sa douceur que les Romains l’étaient de sa
grandeur d’âme et de sou courage. Bélisaire voulait faire punir Vliaris
qui s’était sauvé dans une église; les cavaliers calmèrent sa
colère en lui protestant que Jean leur avait fait promettre
avec serment qu’ils demanderaient grâce pour ce malheureux officier,
qui n’avait failli que par imprudence.
Ce retardement sauva Gélimer. Bélisaire arriva à Hippone,
à dix journées de Carthage, apprit que ce prince avait gagné le mont Pappuas, où il était en sûreté. C’est une montagne
escarpée et presque inaccessible, à l’extrémité.de la Numidie. Sur la croupe s’élevait
une ville ancienne, nommée Médène, habitée
par des Maures alliés de Gélimer, qui s’y renferma avec sa suite.
Bélisaire, ne voulant pas demeurer longtemps éloigné de Carthage, où sa
présence était nécessaire, donna commission à Pharas de tenir la montagne
bloquée pendant l’hiver, et d’en garder si bien les accès, que Gélimer ne
pût ni échapper, ni recevoir de vivres; ce que Pharas exécuta fidèlement.
C’était un Hérule de race royale, homme actif, vigilant, exempt des
vices qu’on reprochait à sa nation. Il eut soin de choisir
des soldats semblables à lui. Bélisaire trouva dans Hippone un grand
nombre de Vandales des plus distingués, qui s’étaient retirés dans des
asiles. Ils en sortirent sur sa parole, et furent envoyés à Carthage pour
y être gardés jusqu’à son retour.
Le bonheur qui accompagnait partout Bélisaire lui mit
alors entre les mains les trésors que Gélimer s’était réservés comme une
dernière ressource. Dès le commencement de la guerre, ce prince avait confié ce
qu’il possédait de plus précieux à Boniface, son secrétaire, dont il connaissait
la fidélité. Il l’avait envoyé à Hippone, avec ordre de se retirer en Espagne
auprès de Theudis, si la fortune se montrait
contraire aux Vandales. C’était l’asile qu’il avait choisi pour
lui-même. Tant que les affaires des Vandales ne furent pas désespérées,
Boniface demeura dans Hippone; mais, après la bataille de Tricamare, il s’embarqua, et fit voile pour l’Espagne.
Un vent impétueux l’ayant rejeté dans le port, il obtint des matelots, à
force de prières et de promesses, qu’ils feraient tous leurs efforts pour
gagner soit une île, soit quelque côte du continent: mais la tempête
rendant la mer impraticable, il crut reconnaître la main de Dieu qui voulait
livrer aux Romains toutes les richesses des Vandales. Il jeta l’ancre, et
se tint à la rade avec un grand danger. Lorsqu’il eut apprit l’arrivée du
général romain, il lui envoya un de ses gens pour lui offrir les trésors
dont il était dépositaire, à condition qu’on lui laisserait tout ce qui lui appartenait.
Bélisaire l’ayant promis avec serment, la chose fut sur-le-champ exécuté. Mais
Boniface, si fidèle aux intentions de la Providence, ne se fit aucun
scrupule de s’approprier une bonne partie de ce qu’elle abandonnait
aux Romains.
De retour à Carthage, (An. 534), Bélisaire déclara que
les prisonniers feraient voile pour Constantinople au commencement du
printemps. Il fit en même temps partir divers corps de troupes, pour remettre
l’empire en possession de ce que les Vandales lui avoient enlevé.
Comme les habitants de la Sardaigne doutaient encore de la défaite de
Gélimer, et refusaient de se soumettre aux Romains, de peur d’éprouver le
ressentiment des barbares, il y envoya Cyrille avec la tête de Zazon, et
lui commanda de passer ensuite en Corse, pour réduire cette île à
l’obéissance. Cyrille ne rencontra aucun obstacle dans cette double expédition.
Jean, à la tête d’une cohorte qu’il commandait, fut envoyé à Césarée de Mauritanie,
ville maritime, grande et peuplée, à trente journées de Carthage. Un autre
officier, qui portait le même nom, marcha jusqu’au détroit de Cadix, et
s’empara de la forteresse, nommée alors Septum, aujourd’hui Ceuta, bâtie
autrefois par les Romains au bord du détroit. Apollinaire fut chargé du
recouvrement de Majorque, Minorque et Ebuse,
maintenant Ivice. Cet officier, né en Italie,
ayant été transporté fort jeune en Afrique, s’était avancé à la cour
d’Hildéric. Lorsque ce prince eut été détrôné et mis dans les fers,
Apollinaire fut un de ceux qui allèrent implorer la protection
de Justinien en sa faveur. Il repassa en Afrique à la suite de
Bélisaire, et se signala dans toutes les rencontres. La confiance qu’il avait
méritée lui fit donner le gouvernement de ces îles. Bélisaire envoya aussi un
corps de troupes dans la Tripolitaine, pour secourir Pudentius et Tattimuth contre les Maures qui les fatiguaient
par des attaques continuelles.
Il survint alors un différend entre les Romains et les
Goths. Nous avons déjà rapporté que le grand Théodoric, en mariant sa sœur Amalfride à Trasamond,
lui avait donné en dot la ville de Lilybée en Sicile. Cette place
importante était restée entre les mains d’Hildéric, même après la mort d’Amalfride, qu’on le soupçonnait d’avoir fait périr, et
les Goths n’en avoient point disputé le domaine à Gélimer. Mais après sa
défaite ils s’en mirent en possession , et refusèrent de la rendre au
commissaire de Bélisaire. Ce général écrivit en Sicile aux commandants des
Goths que «ce refus était une déclaration de guerre; qu'ils agissaient contre
les intérêts, et sans doute contre les intentions de leur maître,
qui avait recherché avec empressement l'amitié de l'empereur; que c'était
une injustice criante de refuser à Justinien ce qu'on avait laissé sans
contestation à Gélimer. Je souhaite, ajoutoir-t-il, que les Goths ne
donnent jamais à l'empereur l'occasion de réveiller des querelles heureusement
assoupies; mais si vous vous obstinez à vous maintenir dans cette nouvelle
invasion, vous devez craindre qu’on ne répète sur vous à main armée,
non-seulement Lilybée, mais aussi tout ce que vous avez précédemment usurpé».
Cette lettre ayant été remise entre les mains d’Amalasonte, les Goths
répondirent, par ordre de cette sage princesse qu’ils étaient bien
éloignés de vouloir offenser l’empereur, dont ils savaient que la
bienveillance était précieuse à leur prince; mais que la Sicile entière était
sans exception du domaine des Goths; que, si Théodoric en avait cédé
quelque place aux Vandales, une pareille concession n’avait pas chez eux
force de loi, leurs princes n’étant pas en droit d’aliéner aucune portion
des dépendances de leur couronne; que Bélisaire ferait justice, s’il
consentait à terminer ce différend par les voies ouvertes entre deux
peuples amis; que, pour eux, ils s’en rapporteraient au jugement
de Justinien, et qu’ils s’y conformeraient de bon cœur; qu’ils souhaitaient
a leur tour que le général romain voulût bien ne rien précipiter, mais
attendre la décision de son souverain. Bélisaire se rendit à une,
proposition si raisonnable, et en instruisit l’empereur.
Pendant ce temps-là Pharas, qui tenait Gélimer assiégé,
s’ennuyant de passer l’hiver au pied d’une montagne stérile, essaya de s’en
rendre maître. Il fit prendre les armes à ses soldats, et monta lui-même à
leur tête. Mais les Maures, favorisés par la pente du terrain,
les ayant repoussés avec perte de cent dix hommes, ils regagnèrent leur
poste, et Pharas se contenta désormais d’établir de bonnes gardes pour
fermer tous les passages. Gélimer, avec ses neveux et les fidèles
compagnons de ses infortunes, se trouvait réduit à d’affreuses
extrémités. Les Vandales étaient alors la nation du monde la
plus voluptueuse, et les Maures la plus misérable. Ceux-ci, renfermés
dans des huttes étroites, où l’on respirait à peine, ne connaissaient même
aucun des préservatifs inventés par les hommes contre l’inclémence des saisons.
Ils n’avaient d’autre lit que la terre; c’était être riche que d’y pouvoir
étendre la peau d’un animal avec son poil. Couverts d’une tunique rude et
grossière, et d’un manteau de même étoffe, ils ignoraient l’usage du
pain, du vin et des autres aliments que prépare l’industrie
des hommes. Le pays ne leur fournissait que du seigle et de l’orge,
qu’ils broyaient avec les dents, sans le moudre ni le faire cuire. Gélimer
et ses compagnons succombaient aux horreurs d’une vie si sauvage; ils ne
souhaitaient que la mort, et ne regardaient plus la captivité comme le
dernier des maux.
Pharas, instruit de leur désespoir, écrivit ainsi à
Gélimer: «Prince, je suis barbare comme vous, et je n’ai reçu d’autres leçons
que celles de la nature; c’est elle qui me dicte ce que je vais vous
écrire. Est-il donc possible que vous vous soyez plongé, vous et votre
famille, dans cet abîme de misères au lieu de vous soumettre à votre
vainqueur? Vous chérissez la liberté, direz-vous sans doute, et vous êtes
résolu de tout souffrir pour conserver un bien si précieux: mais dites-moi,
Gélimer; n’êtes-vous pas actuellement esclave de la plus vile et de la plus
misérable nation de la terre? Ne vaudrait-il pas mieux mendier chez les
Romains que d’être roi des Maures et souverain du mont Pappuas?
Il est donc honteux, selon vous, d’obéir à un prince auquel obéit
Bélisaire? Revenez de cette erreur. Je suis né prince, et je me fais gloire de
servir l’empereur. Je sais que le dessein de Justinien est de vous
combler d’honneurs, de vous donner de grandes terres et beaucoup d’argent:
Bélisaire vous sera garant de ces avantages. Peut-être pensez-vous
qu’étant homme, vous êtes né pour supporter avec patience tous les
caprices de la fortune ; mais si Dieu vous offre une ressource, pourquoi la
refuser? Les faveurs de la fortune ne sont-elles pas faites pour lés
hommes aussi-bien que ses rigueurs? Etourdi par des coups si rudes, vous n’êtes
peut-être pas en état de prendre conseil de vous-même: suivez le mien;
consentez à être heureux, et ne vous faites pas plus de mal que l’ennemi
n’a voulu vous en faire.» Gélimer ne put lire cette lettre sans la
tremper de ses larmes. Il répondit en ces termes: «Je vous remercie de
votre conseil; mais je ne puis me résoudre à me rendre l’esclave d’un
injuste agresseur. Si le ciel était disposé à m’écouter, je le prierais
de me mettre en état de me venger d’un homme qui, sans avoir reçu de
ma part aucune injure, ni de fait ni de parole, m’a poursuivi par une
guerre cruelle. Il m’envoie je ne sais d’où un Bélisaire pour dévorer mes
états et me déchirer moi-même. Il est prince, il est homme comme moi;
qu’il sache qu’il peut devenir comme moi la victime de l’infortune. Je
ne puis en écrire davantage; le poids de mes malheurs m’accable l’esprit.
Adieu, cher Pharas; envoyez-moi, je vous en supplie, une guitare, un pain et
une éponge». Ces derniers mots semblaient une énigme à Pharas,
jusqu’à ce que le porteur de la lettre lui eût rendu raison d’une demande
si singulière: «Gélimer, (dit-il) demande du pain, parce qu’il n’en a ni
goûté ni même vu depuis qu’il est chez les Maures: il a besoin d’une
éponge pour nettoyer ses yeux, enflés par l’habitude des larmes jointe à la
saleté de son habitation: il aime à toucher la guitare, et, ayant composé une
chanson pour adoucir ses malheurs, il désirerait l’accompagner de cet
instrument». Pharas, attendri de cette triste peinture, lui envoya ce
qu’il demandait, et n’en fut pas moins attentif à garder toutes les
avenues.
Il y avait trois mois que Gélimer était enfermé; l’hiver approchait
de sa fin, et les maux de ce prince et de sa famille croissaient de jour
en jour. Agité de continuelles alarmes, il croyait à tous moments entendre
les Romains qui grimpaient sur les roches; ses neveux expiraient autour de lui
de faim et de misère. Ce qui le toucha le plus sensiblement, fut de voir
un des enfants de sa sœur, et un jeune Maure des plus misérables, se
battre ensemble à outrance, et se prendre à la gorge pour s’arracher de la
bouche un méchant gâteau d’orge écrasé, à demi-cuit, tout brûlant et plein
de cendres. Ce déplorable spectacle acheva de le dompter. Il manda à
Pharas qu’il était prêt à se mettre entre ses mains, si Bélisaire se rendait
caution des promesses de son lieutenant. Pharas fit porter cette lettre à
Bélisaire, le priant de lui envoyer ses ordres. Le général, qui souhaitait
ardemment de conduire à l’empereur cet illustre prisonnier, fut ravi de joie,
et dépêcha Cyprien pour porter parole à Gélimer, que non-seulement on lui conserverait la
vie, ainsi qu’à toute sa suite, mais même qu’il serait traité avec
honneur. Cyprien se rendit avec Pharas au pied de la montagne, où Gélimer
les vint trouver; et, sur la parole qui lui fut donnée avec serment, il
partit avec eux pour Carthage.
A la vue de sa capitale, à laquelle la réparation des
murs et des travaux avait donné une face toute nouvelle, Gélimer ne put
s’empêcher d’admirer l’intelligence et l’activité des Romains, et d’imputer ses
malheurs à sa négligence. Bélisaire le reçut dans le faubourg d’Aclas, où ce général avait choisi sa demeure.
En l’abordant, le roi prisonnier fit un grand éclat de rire, que les Romains
attribuaient à l’égarement de son esprit, ébranlé sans doute par les
violentes secousses de sa mauvaise fortune. Mais les amis de Gélimer prétendaient,
par une interprétation forcée, que c’était le ris d’un Démocrite; et que
ce prince, issu de race royale, roi lui-même, nourri dans la splendeur et
dans l’opulence, ensuite vaincu, fugitif, accablé de misère, enfin
captif, jugeait avec raison que toutes les grandeurs et les fortunes
humaines n’étaient dignes que de risée. Bélisaire fit savoir à Justinien qu’il tenait
Gélimer en ses mains, et demanda la permission de le conduire
à Constantinople. En attendant la réponse de l’empereur, il fit
garder Gélimer avec les autres Vandales, dont il eut soin de le distinguer
par un traitement très-honorable. Ce prince n’avait joui que trois ans du fruit
de son usurpation.
C’eût été l’intérêt de l’empire que Bélisaire demeurât en
Afrique assez longtemps pour affermir sa conquête, forcer à l’obéissance les
nations inquiètes et turbulentes des Maures, établir une forme également avantageuse
au prince et aux sujets dans l’administration politique, que ce génie supérieur
n’entendait pas moins que la guerre. Sa valeur héroïque, qui le faisait redouter
des étrangers; sa douceur et son équité incorruptible, qui lui conciliait
l’affection des peuples, auraient épargné sans doute à l’Afrique les
désordres, les rébellions, les rivalités funestes, qui furent les
suites tumultueuses d’une si paisible conquête; mais
l’envie, toujours ardente à se venger du mérite qui la
désespère, priva l’empire de cet avantage. Justinien était
obsédé d’un nombreux essaim de ces courtisans oisifs , qui, craignant
une comparaison peu honorable pour eux, font leur étude d’empoisonner les
succès, lorsqu’ils n’ont pu les traverser. Quelques officiers de Bélisaire,
d’intelligence avec eux, mandèrent à la cour que leur général songeait à
se faire en Afrique un état indépendant. Justinien, soit qu’il rendît
justice à ce vertueux capitaine, soit par politique, tint ce rapport secret,
dépêcha Salomon pour offrir à Bélisaire le choix de revenir à
Constantinople avec ses prisonniers, ou de les envoyer et de demeurer en
Afrique. Bélisaire n’avait garde de balancer sur le parti qu’il devait
prendre. Un hasard heureux l’avait instruit de la malignité de ses
envieux. Les ennemis qu’il avait entre ses officiers avoient
écrit deux lettres à la cour, et fait partir deux messagers sur différents
vaisseaux, pour mieux assurer le message. Cette précaution leur fut utile; et
plus encore à Bélisaire. L’un des deux émissaires parvint à Constantinople; l’autre,
ayant donné lieu à quelque soupçon, fut arrêté dans le port de Carthage;
et, se voyant pris, il livra le paquet dont il était chargé, et révéla
toute l’intrigue. La découverte d’une trame si noire excitait Bélisaire
à retourner au plus tôt à la cour, pour déconcerter la calomnie et
confondre ses ennemis.
Dès que Salomon lui eut apporté la permission de
Justinien, il donna ordre d’équiper la flotte, distribua les troupes en
divers quartiers, et régla le gouvernement militaire conformément aux ordres
qu’il recevait de l’empereur: nous en donnerons le détail dans
la suite. Après ces dispositions , il fit monter sur la
flotte Gélimer avec les autres prisonniers vandales, et s’embarqua
lui-même avec ses gardes et les Huns, selon la parole qu’il leur avait
donnée. Il n’était pas encore sorti du port, qu’on sentit évidemment que
la présence de ce grand capitaine était un puissant contre-poids
pour maintenir le repos de l’Afrique. Le bruit se répandit à Carthage
que les Maures s’étaient soulevés. Cette nation perfide n’était retenue ni
par les liens sacrés du serment, ni par la crainte de perdre leurs otages,
qu’ils sacrifiaient sans regret, fussent-ils les fils ou les
frères de leurs rois. Ils ne restaient en paix qu’autant qu’ils voyaient
le vainqueur sur leur frontière. Le nom de Bélisaire les avait contenus
jusqu’alors. Dès qu’ils apprirent que son départ était résolu, ils coururent
aux armes , et commencèrent leurs ravages, égorgeant les hommes,
traînant les femmes et leurs enfants en esclavage. Ce n’était dans tout le pays
que trouble et désolation. Les soldats romains, postés sur les frontières, n’étaient
ni en assez grand nombre, ni assez bien pourvus d’armes et de chevaux pour
arrêter ou pour atteindre des brigands déterminés, qui, sans cesse à
cheval, après avoir pillé les campagnes et massacré les habitants, disparaissaient
avec leur butin pour aller porter ailleurs l’épouvante et la mort. Bélisaire
apprit ces désordres dans le moment que la flotte appareillait; et, ne
pouvant retarder son départ, il fit débarquer Salomon, qu’il chargea de la
défense du pays. Il lui laissa ses plus braves officiers, et la plus
grande partie de ses gardes, qui formaient un corps redoutable et renommé
pour sa valeur. Peu de temps après, Justinien envoya à Salomon un renfort
considérable commandé par Théodore de Cappadoce et par Ildiger.
Bélisaire fut reçu à Constantinople avec une joie proportionnée
à la grandeur de ses exploits. L’envie fut réduite au silence, et Justinien,
dont il étendait l’empire, le combla d’honneurs. L’admiration publique se partageait
entre Bélisaire et Gélimer: dans l’un on contemplait le modèle de la plus haute
valeur, de la sagesse dans le conseil, de la promptitude dans l’exécution,
de la modestie dans les plus brillants succès; on voyait dans l’autre un
exemple éclatant de la fragilité des trônes les mieux affermis. Le
vainqueur et le vaincu portaient également l’empreinte de la puissance
divine, qui avait rendu Bélisaire, à la tête de seize mille hommes, supérieur
à Gélimer, soutenu de cent soixante mille: c’était le nombre des Vandales qui portaient
les armes en Afrique au temps de la descente de Bélisaire. On peut même
dire que cette glorieuse conquête fut l’ouvrage de six mille hommes de
cavalerie, puisque Bélisaire ne fit aucun usage de son infanterie dans les
deux batailles de Décime et de Tricamare. Pour
couronner de si grands exploits, Justinien renouvela un honneur qui,
depuis le règne d’Auguste, était réservé aux empereurs, et à leurs enfants.
Il décerna le triomphe à Bélisaire. Ce général, entouré de sa garde,
traversa la ville depuis sa maison jusqu’au Cirque, où l’attendait
l’empereur assis sur un trône élevé. Il marchait à pied; mais tout le
reste de la pompe ressemblait à celle des anciens triomphes. On portait devant
lui les dépouilles des rois vandales, des vases d’or et d’argent, des
armes, des couronnes, des meubles précieux, des robes de pourpre semées de
perles et de pierreries, sept grandes corbeilles remplies de monnaies
d’or, et le livre des Evangiles tout brillant d’or et de diamants. C’étaient
en grande partie les richesses que Genséric avait enlevées dans le pillage
de Rome. Les vases du temple de Jérusalem attiraient surtout les regards.
Un Juif qui les considérait, s’adressant à un des officiers de l’empereur: «Ne
prétendez pas, lui dit-il, garder ces trésors dans le palais de
Constantinople; ils ne peuvent être conservés que dans le lieu où les
plaça notre roi Salomon. C’est leur enlèvement sacrilège qui a causé autrefois
le pillage de Rome, et depuis peu celui du palais des rois vandales». Ces
paroles, rapportées à Justinien, lui firent craindre de retenir ces redoutables
dépouilles; il les envoya aux églises de Jérusalem.
A la suite de Bélisaire marchaient les prisonniers, et à
leur tête Gélimer, vêtu d’une robe de pourpre, environné de ses parents, et
suivi des autres Vandales, dont on avait choisi les plus grands et les
mieux faits. Lorsque le roi captif entra dans le Cirque, et qu’il vit devant
lui l’empereur, à droite et à gauche une foule immense que la curiosité avait
attirée, alors, plongé dans une réflexion profonde sur l’état présent de
sa fortune, sans laisser échapper une larme ni un soupir, il
répéta plusieurs fois ces paroles de l’Ecclésiaste: Vanité
des vanités, tout est vanité. Dès qu’il fut arrivé aux degrés du
trône, on lui ôta sa robe de pourpre, et on l’obligea de se prosterner aux
pieds de l’empereur, et d’en faire autant devant l’impératrice. Bélisaire,
par un effet de sa bonté naturelle, plus attendri du sort de son
prisonnier qu’enorgueilli de sa propre gloire, voulut bien le consoler de
son humiliation en se prosternant avec lui. Justinien et Théodora comblèrent de
richesses les filles d’Hildéric, et tous les descendants d’Eudôcie,
fille de Valentinien, et femme d’Hunéric. Pour
acquitter la parole de Bélisaire, ils donnèrent à Gélimer un
grand domaine en Galatie, où il vécut dans l’abondance avec sa
famille; il aurait été mis au rang des patrices, s’il n’eût refusé de
renoncer à l’arianisme. Le triomphe de Bélisaire était le premier qu’on
eût vu à Constantinople. Il triompha de nouveau au commencement de
l’année suivante lorsqu’il prit possession du consulat. Il fut porté
au sénat dans la chaise curule sur les épaules des prisonniers; et, dans
le chemin, il jeta au peuple une grande partie du butin qu’il avait
apporté d’Afrique, des vases d’argent, des ceintures d’or, et d’autres
dépouilles précieuses. Mais le plus grand honneur que Justinien fit à
Bélisaire, fut de le représenter sur le revers de ses monnaies avec ces
mots: Bélisaire, la gloire des Romains. Toute l’histoire de cette
guerre, ainsi que la pompe du triomphe, furent peintes en mosaïque
dans le vestibule du palais.
C’est ainsi que l’Afrique rentra au pouvoir de l’empire
cent sept ans après que Genséric y eut transporté sa nation. Cette importante
conquête ne coûta que trois mois, à compter depuis le débarquement de
Bélisaire jusqu’à la dernière défaite de Gélimer. Il fallut
quatorze ans aux autres généraux pour l’assurer. Dans ce long intervalle,
la paix fut souvent troublée par les séditions des soldats, qu’ils ne pouvaient
contenir, et par les incursions des Maures, qui ne craignaient que
Bélisaire. La tranquillité ne subsista qu’environ cent ans
jusqu’à l’invasion des Sarrasins. Les prisonniers amenés à Constantinople
se trouvaient en grand nombre; pour leur ôter l’espérance de retourner
dans leur pays, Justinien en composa cinq corps de cavalerie, qu’il envoya
en Orient. La plupart des autres Vandales avoient péri dans les
combats. Ceux qui restaient, s’étant dispersés dans les diverses contrées de
l’Afrique, furent exterminés par les Maures, ou se mêlèrent avec eux, en sorte
que cette révolution rapide anéantit en Afrique jusqu’au nom
des Vandales. C’eût été alors l’occasion de retourner dans leurs
anciennes demeures en Germanie; mais ils manquaient de vaisseaux pour repasser
en Europe; et d’ailleurs ils n’y auraient plus retrouvé les descendants de
ceux que Godigiscle avait laissés en Bohème pour
garder et cultiver les terres de leurs compatriotes, qui pourraient venir
s’y réfugier en cas d’infortune. Cette partie de leur nation avait été
détruite depuis ce temps-là par les autres barbares. C’est un trait digne
de mémoire que la bonne foi de ces Vandales sédentaires à l’égard de
leurs camarades, séparés d’eux par une si vaste étendue de terres et
de mers. Lorsqu’ils apprirent que Genséric était maître de l’Afrique, ils
lui envoyèrent des députés pour le féliciter de ses glorieux succès, et
pour lui demander en même temps la propriété des terres dont ils n’étaient que
les gardiens, et qui devenaient inutiles aux Vandales établis dans un climat
plus doux et plus fertile. Genséric et ses principaux officiers étaient
disposés à leur accorder leur demande, lorsqu’un vieillard, des plus
nobles de la nation, et renommé pour sa prudence, leur représenta que,
dans les choses humaines, il n'y avait nulle assurance, rien de ce qui subsistait
actuellement qui ne pût changer; rien qui ne pût arriver de ce qui n’était
pas encore. Cette réflexion arrêta Genséric; il congédia les députés avec un
refus. Les Vandales firent alors des railleries et du vieillard et du roi,
qui portaient la prévoyance jusque sur des accidents impossibles; mais la
sagesse de cet avis fut reconnue par leurs descendants, lorsqu’ils se
virent dépouillés de leur conquête, et privés de toute retraite.
Chosroès ne vit pas sans jalousie cet accroissement de l’empire.
Il se repentit d’avoir fait la paix, et de n’avoir pas traversé, par une
diversion puissante, une expédition si contraire à ses intérêts. Cependant il
envoya des ambassadeurs à Constantinople, et, en félicitant Justinien de sa victoire
il lui demandait par plaisanterie une part du butin; elle lui était due, disait-il,
parce que, sans la Paix fait avec les Perses jamais les Romains n’auraient
subjugué les Vandales. Justinien, craignant une rupture avec ce prince
belliqueux, lui envoya de riches présents. Aussitôt après la conquête , il avait
pris des mesures pour la conserver. Voici l’ordre qu’il y établit par
deux ordonnances datées du treizième d’avril de cette année 534, adressées
l’une à Archélaos, l’autre à Bélisaire, avant son départ. L’Afrique fut
divisée en sept provinces, la Tingitane, la Mauritanie, la Numidie,
la province de Carthage, la Byzacène, la Tripolitaine, et la
Sardaigne, qui fut jointe aux autres, parce qu’elle avait appartenu aux
Vandales. Il établit un préfet du prétoire résident à Carthage, et Archélaos
fut pourvu de cette charge en récompense des services qu’il avait rendus
en qualité d’intendant de la flotte et de l’armée. Justinien lui recommandait
de veiller à la conservation du pays, de traiter les habitants avec
douceur, et de leur faire sentir la différence de l’humanité romaine et de
la dureté des Vandales. Il réglait les gages et les émoluments des
officiers; et, pour leur ôter tout prétexte de concussion , il taxait à une
somme très-modique ce qu’ils dévoient payer pour l’expédition des brevets de
leurs charges, défendant, sous peine de mort, toute exaction au-delà
de ce qu’il prescrivit. La seconde ordonnance concernait l’ordre militaire:
elle établissait cinq commandants, avec titre de ducs en Tripolitaine, en Byzacène, en
Numidie, en Mauritanie et en Sardaigne. Bélisaire avait ordre de mettre en
garnison dans Ceuta autant de soldats qu’il jugerait à propos, sous le
commandement d’un tribun d’une prudence et d’une fidélité reconnue pour garder
le détroit de Cadix, et de veiller sur les mouvements qui se feraient en
Espagne et en Gaule, dont le tribun devait donner avis au duc de Mauritanie, et
celui-ci au préfet du prétoire. L’empereur voulait aussi qu’on tînt dans
le détroit des vaisseaux de course, en tel nombre que Bélisaire jugerait
convenable. Tous ces commandants dévoient non-seulement défendre
le pays qui leur était confié, mais aussi travailler à reculer les bornes
de l’empire et à lui rendre son ancienne étendue. L’empereur fixait la
paie des offices militaires; il défendait de faire aucune violence, aucun
tort aux habitants. Il permettait à Bélisaire de faire
resserrer l’enceinte des villes et des châteaux sur la frontière,
s’il les trouvait d’une trop grande étendue pour la défense. Dans la
première de ces ordonnances on voit que Justinien, encouragé par la réduction
de l’Afrique, se flattait de reconquérir, avec l’aide de la Providence
divine, les autres provinces dont les barbares s’étaient
rendus maîtres. II donna aux Africains cinq années pour rentrer eu
possession des biens qui leur avoient été enlevés par les Vandales. Il
voulut que toute l’Afrique ne reconnût d’autres lois que les lois romaines.
Jusque-là les dispositions de Justinien annonçaient un gouvernement
équitable; elles furent reçues avec joie. Mais il ne soutint pas longtemps
ce ton paternel. Comme on ne retrouvait pas le rôle des impositions
anciennes que Genséric avait fait brûler dès le commencement de
son règne , l’empereur envoya Typhon et Eustrace pour dresser un nouveau cadastre; et ces financiers, par un excès de
zèle, dont les princes croient quelquefois être l’objet, firent à
Justinien l’Afrique si riche et si opulente, qu’elle se trouva bientôt
appauvrie.
La plupart des villes tombaient en ruine. Les Vandales
avoient d’abord détruit les murailles, et ensuite laissé périr les édifices;
les plus riches d’entre eux, préférant au séjour des villes celui des
campagnes. Justinien travailla à les réparer. La grande Leptis était presque
abandonnée, et ensevelie sous des monceaux de sable que la mer y portait sans
cesse. Il la fit découvrir; la releva et l’embellit; mais il en diminua
l’enceinte, laissant sous les sables la partie la plus voisine de la
mer pour servir comme de boulevard à la nouvelle ville. Il y rétablit
le palais que l’empereur Septime Sévère, né en ce lieu, avait autrefois
fait bâtir comme un monument de sa fortune. Après avoir orné Carthage de
portiques, de thermes, d’églises et de monastères, il voulut qu’elle se nommât Justinienne; et, pour honorer sa femme Théodora, il donna le nom de Théodoriade à la ville de Baga, que Procope place dans la province de Carthage. Adrumète, métropole de la Byzacène, était sans
murailles, exposée aux incursions des Maure : il la fortifia; elle prit
aussi le nom de Justinienne. La Byzacène fut mise hors d’insulte
par les places et les châteaux qu’il releva, on qu’il fit construire de
nouveau sur la frontière. Il mit en état de défense la ville nommée le
camp de Trajan en Sardaigne. Le château de Ceuta tombait d’ancienneté : il
en fit une place imprenable ; et, comme c’était la clef de ses états d’Afrique,
il le mit sous la protection de la mère de Dieu, en l’honneur de
laquelle il fit bâtir une magnifique église. Un plus long détail passerait
les bornes de l’histoire. Il suffira de dire que l’on comptoir en Afrique
cent cinquante places bâties ou réparées en divers temps par les
ordres de Justinien.
Les rois vandales, ariens fanatiques, excepté Gondamond et Hildéric, avoient cruellement persécuté les catholiques.
Ce dernier prince leur avait rendu leurs églises sans leur en rendre les
biens. Justinien rétablit la religion dans tout son éclat. Comme il commençait à
traiter les Goths d’Italie avec moins de ménagement pour les raisons que
nous dirons bientôt, il dépouilla les ariens de ce qu’ils avoient usurpé,
et le restitua aux églises catholiques, à la charge de payer leur part
des impositions. Il défendit aux hérétiques de baptiser; il les exclut des
magistratures et leur interdit le culte public. Les privilèges de l’église de
Carthage furent renouvelés. Il y avait dans la Tripolitaine des peuplades de
Maures encore païens. Les uns étaient depuis longtemps attachés au service de
l’empire; on les nommait, pour cette raison, Pacati;
ils habitaient la ville de Cidama, près de la grande
Syrte. Les autres, nommés Gadabitains, vivaient
errans et sans dépendance à l’occident de la Tripolitaine. Tous ces
barbares embrassèrent la religion chrétienne. Justinien fit bâtir
pour l’usage des Gadabitains une grande église
dans la ville de Sabaratha, ancienne colonie
romaine qu’il enferma de murailles.
Pour ne pas interrompre le récit de la destruction des Vandales,
j’ai différé de rapporter quelques événements de l’année 533, que je
rappellerai en ce lieu. Théodora fit un voyage en Bythinie pour aller prendre les bains dans un lieu nommé Pythia,
célèbre alors par ses sources d’eaux minérales. Comme elle aimait
d’autant plus le faste et la magnificence que sa première vie en avait
été plus éloignée, elle traîna après elle tout l’appareil de sa grandeur. Sa
suite était de quatre mille hommes. Les principaux sénateurs, les
chambellans, grand nombre de patrices, entre autres Ménas,
ancien préfet du prétoire, et Elie, intendant des finances, faisaient
partie du cortège. Accoutumée à faire un mélange de crimes et d’œuvres
extérieures de piété, elle distribua dans sa route beaucoup d’argent aux
églises, aux hôpitaux, aux monastères. A son retour, elle donna une preuve
éclatante de l’empire qu’elle avait pris sur son mari. Priscus de
Paphlagonie, secrétaire de l’empereur, s’était emparé de la confiance de
son maître au point de donner de l’ombrage à Théodora. Aussi hautain
qu’il était riche et puissant, il se croyait dispensé, de
ramper devant cette princesse ainsi que les autres courtisans. Elle
essaya d’abord de le perdre dans l’esprit de l’empereur par des rapports
calomnieux. Cette voie n’ayant pas réussi, elle le fit enlever, jeter dans un
vaisseau, et transporter dans une retraite éloignée, où elle le
força de recevoir l’ordre de prêtrise pour le mettre hors d’état de
rentrer dans ses emplois. Justinien, subjugué, feignit d’ignorer cette
violence; il oublia Priscus dès qu’il ne le vit plus, et n’osa pas même
s’informer de ce qu’il était devenu.
Ce fut un bonheur pour Justinien d’être alors en paix avec
la Perse. Le hasard présentait à Chosroès une occasion favorable de se saisir
de Dara. Un soldat, nommé Jean Cottistis, fut
assez hardi pour soulever une partie de la garnison et pour s’emparer du
palais, qui était fortifié comme une citadelle. Il y avait déjà quatre
jours qu’il ordonnait en maître absolu, lorsqu’ Marnas, évêque de la
ville, et Anastase, un des principaux habitants, excitèrent le reste de la
garnison à s’affranchir de cette tyrannie. Les soldats qui n’avaient pas
trempé dans le complot montèrent au palais à l’heure de midi, portant
chacun un poignard caché sous leur casaque. Mais la crainte de n’être pas
les plus forts les retint à l’entrée. Un charcutier qui les avait suivis,
honteux de leur lâcheté, força la porte, son couteau à la main,
et blessa le tyran qui accourait au bruit. Celui-ci, dans le trouble
où il était, se jeta lui-même entre les mains des soldats, qui le lièrent
et le traînèrent à la prison de la ville. Un d’entre eux, craignant que
les compagnons de la révolte de Cottistis ne
vinssent le délivrer à main armée, le poignarda de son autorité. On brûla
le palais, de crainte qu’il ne servît encore de place forte à
quelque rebelle.
Nous pouvons rapporter à cette année un tremblement de
terre qui se fit sentir à Constantinople au mois de novembre. D’autres
auteurs le font arriver cinq ans plus tôt. Il commença le soir, et causa
une telle alarme, que les habitants passèrent la nuit dans la
place de Constantin à implorer la miséricorde divine. Les sectateurs
d’Eutychès, qui étaient en grand nombre parmi le peuple, croient: Vivez,
Justinien, mais délivrez-nous de ce décret odieux prononcé à Chalcédoine. Au
reste, ce tremblement de terre ne causa aucun dommage. Il fut plus violent à
Cyzique, où il détruisit plusieurs édifices. Une comète se montra pendant
quelques jours du côté de l’occident.
LIVRE QUARANTE-TROISIÈME. JUSTINIEN. 534-537
|
 |
HISTOIRE DU BAS-EMPIRE. |
 |
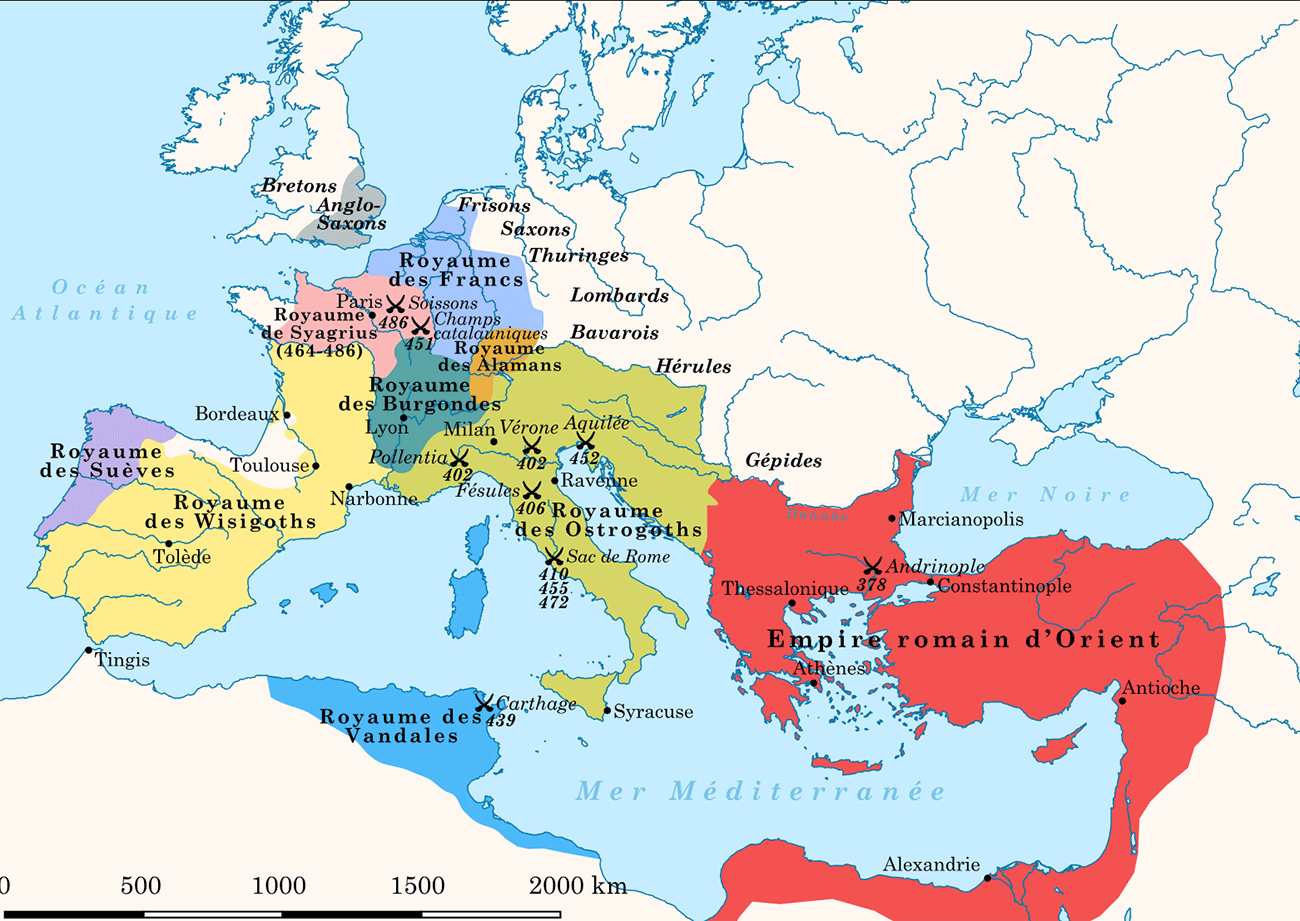
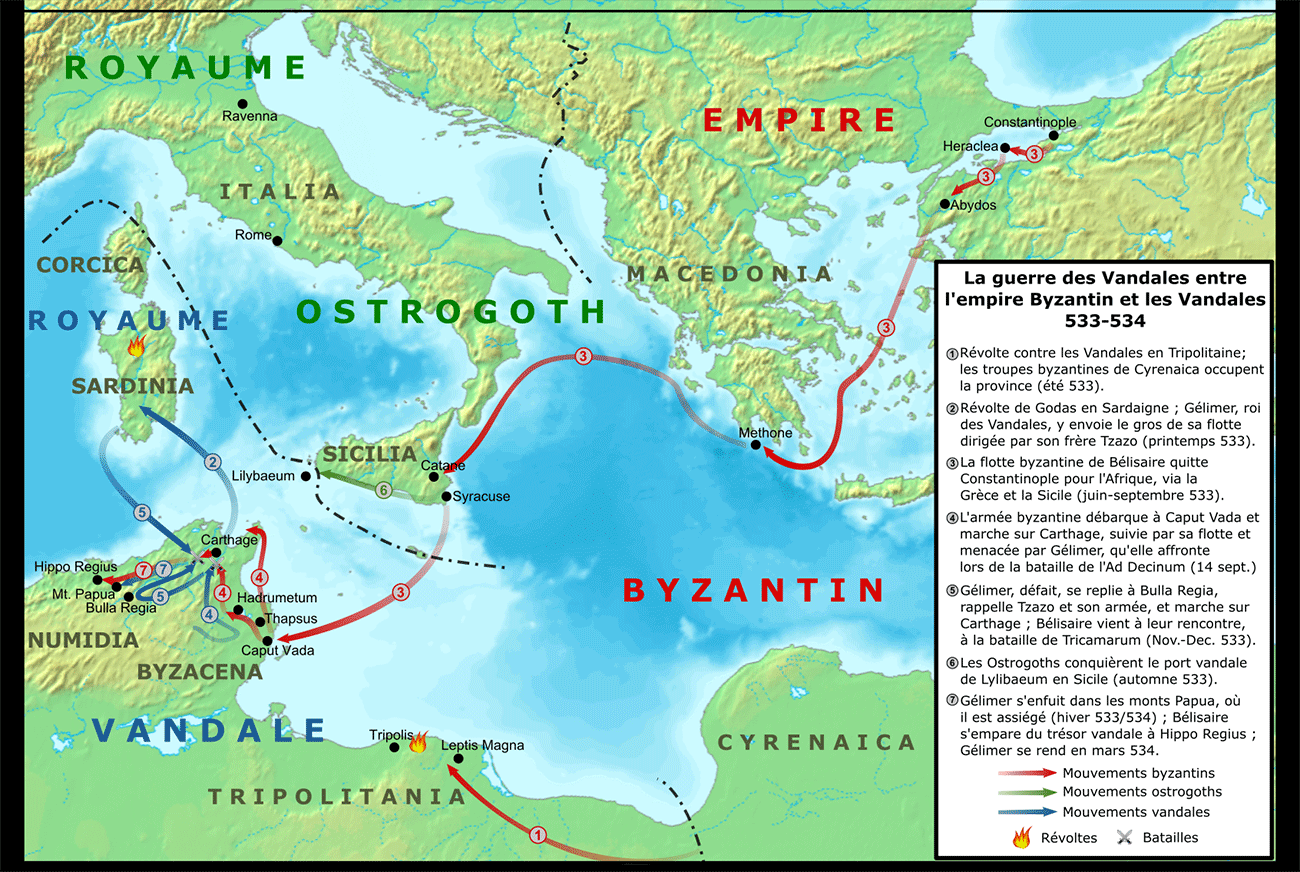
 |
 |
 |