 |
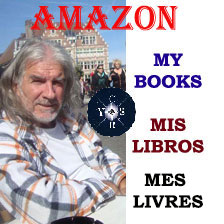 |
Amazon.com:LE CŒUR DE NOTRE-DAME MARIE DE NAZARETH:UNE HISTOIRE DIVINE |
 |
LES PERSÉCUTIONS PENDANT LA PREMIÉRE MOITIÉ DE TROISIÉME SIÉCLE (SEPTIME SÉVERE, MAXIMIN, DÈCE) |
 |
CHAPITRE VIII.
LA PERSÉCUTION DE DÈCE EN AFRIQUE.
I.
La promulgation de l’édit à Carthage.
Depuis la mort de Fabien jusqu’à l’élection de Corneille
, la communauté chrétienne de Rome, bien que privée de chef, donna le spectacle
de la discipline et de l’union. L’esprit modéré, pratique, le sens du gouvernement,
si remarquable chez les papes de ce temps, avait, en quelque sorte, passé dans
le collège presbytéral qui gérait pendant la vacance du siège les affaires
religieuses, et les fidèles persécutés s’étaient montrés dociles à cette sage
direction. Sans doute les chutes avaient été nombreuses, mais nombreux aussi
furent les martyrs et les confesseurs, et ces derniers n’essayèrent pas
d’empiéter sur le gouvernement des consciences, d’imposer leurs décisions au
clergé : ils se montrèrent presque toujours modestes et ne furent point un
embarras pour l’Église. Les païens de Rome semblent avoir assisté en curieux
plutôt qu’en acteurs passionnés à la guerre déclarée par le gouvernement à la société chrétienne : les documents contemporains ne mentionnent aucune émotion
populaire ni pour ni contre les fidèles: aux yeux de la population romaine, il
y a là une affaire tout administrative, qui ne la touche pas, et dont elle n’a
pas à se mêler.
Tout autre fut l’aspect de l’Église d’Afrique pendant la
même période. On se tromperait beaucoup en assimilant aux Romains d’Europe les
habitants les mieux romanisés de la province proconsulaire, de la Numidie ou de
la Mauritanie. Le vieux fond berbère et punique, sensuel, subtil, sauvage,
demeurait sous la couche uniforme de civilisation que Rome conquérante avait
répandue le long des rivages africains. Le peuple était resté grossier et
sanguinaire, toujours prêt à se lever pour l’émeute. Le scepticisme poli de
Rome ne l’avait pas atteint: il adorait ses dieux indigènes avec la naïveté
d’autrefois; il détestait les chrétiens, croyait aux calomnies débitées jadis
sur leur compte et auxquelles personne n’ajoutait plus foi de l’autre côté de
la mer; sa superstition leur imputait tous les fléaux, pestes, famines,
invasions de sauterelles, qui trop souvent, dans ce climat de feu, ravageaient
les campagnes ou dépeuplaient les villes. Les chrétiens eux-mêmes avaient leur
physionomie particulière. Ils étaient sans cesse portés à se diviser : les
Actes de sainte Perpétue montrent des dissensions existant dès le temps de
Septime Sévère entre l’évêque de Carthage et une partie de son clergé, les
fidèles se prononçant, et l’église transformée en une sorte de cirque, où des
factions diverses se disputent le pouvoir. Dans un tel milieu, les thèses excessives,
le faux rigorisme, l’orgueil doctrinal toujours prêt à se séparer et à maudire,
se développaient avec une facilité extraordinaire. Tertullien semble l’incarnation
de cet esprit, mais d’autres lui ressembleront, et c’est d’Afrique que partira Novat. On comprend l’effet que dut produire sur tout ce
monde agité la soudaine persécution de Dèce. Elle déchaîna les passions de la
foule païenne, et suscita parmi les fidèles d’admirables héros; mais en même
temps elle amena des chutes innombrables, et favorisa chez beaucoup de ceux qui
étaient restés debout, s tantes, les sentiments d’orgueil, les idées
d’indépendance. L’Église de la métropole africaine eût eu peine à surmonter
cette crise si l’évêque Cyprien, héritier des traditions romaines, bien
qu'originaire de Carthage, n’avait, du fond de sa retraite, dompté cette cavale
rétive, qui, tenue par une main moins ferme, se serait peut-être jetée d’un
bond dans l’apostasie ou la révolte.
La publication de l’édit de Dèce fit sur la population
chrétienne de Carthage, amollie par une longue paix, l’effet d’un coup de
foudre. Dans les précédentes persécutions, chacun pouvait conserver l’espoir
d’échapper à l’obligation de confesser sa foi. Au deuxième siècle, une
accusation privée était nécessaire pour qu’un chrétien fût déféré aux
tribunaux; sous Septime Sévère, puis sous Maximin, les poursuites furent
dirigées par l’autorité publique, mais elles n’atteignirent en général que les
plus en vue, et la masse obscure de la population, les humbles, les petits, ne
furent qu’accidentellement traduits en justice, quand une circonstance
particulière attirait sur eux les regards des magistrats. Sous Dèce, la persécution
était vraiment universelle et prenait tous les chrétiens pour les détruire,
comme d’un seul coup de filet. C’est en Afrique, et particulièrement à
Carthage, qu’on peut le mieux s’en rendre compte, grâce aux écrits de saint
Cyprien. Un délai avait été fixé, pendant lequel chacun était mis en demeure
de déclarer sa loi. À l’expiration de ce délai, tous ceux qui n’auraient pas
fait acte de paganisme seraient considérés comme chrétiens et, en cette
qualité, exposés aux poursuites. Personne, semble-t-il, ne pouvait échapper; la
population entière était mise à l’épreuve c’était une sorte de dénombrement et de recensement universel, où
l’administration comptait les âmes et, sur un registre tenu en partie double,
inscrivait les consciences.
On ignore si le proconsul était présent à Carthage
pendant cette première phase, cette sorte de préface de la persécution. Sa
présence, à la rigueur, n’était pas nécessaire : l’épreuve fut dirigée par les
magistrats municipaux, duumviri, auxquels on adjoignit soit
immédiatement, soit plus tard, quelques citoyens notables. Il est probable que
la population entière fut invitée à sacrifier pour le salut de l'empire, à
prendre part à quelque supplicatio solennelle.
Le lieu du rendez-vous était le Capitole. Carthage et plusieurs villes
d’Afrique possédaient, comme toutes les cités portant le titre de colonies
romaines, un temple de ce nom, consacré au culte de Jupiter, de Junon et de
Minerve, ordinairement situé sur une éminence dominant le forum. A Carthage, le
temple s’élevait sur la colline de Byrsa, qui présentait de grandes analogies
avec le mont Capitolin de Rome, et, dominant la mer, se dressait comme une
acropole naturelle, que l'homme n’avait pas eu besoin de fortifier pour la
rendre imprenable. A ses pieds, le forum, incendié sous Antonin le Pieux, puis
rebâti, étalait l’éclat de ses édifices et de ses colonnades, encore dans
toute leur fraîcheur de constructions nouvelles. Chaque matin, jusqu’à
l’expiration du délai, sur la colline sacrée s’alluma le feu des sacrifices.
Les riches amenaient soit des chèvres ou des brebis (hostia),
soit des bœufs (victima) (7). Les pauvres se
contentaient sans doute de jeter de l’encens sur l’autel. Tous, portant sur la
tête un voile et une couronne, prononçaient une formule de prière, dans
laquelle le Christ était maudit. L’après-midi, ceux qui avaient ainsi adoré les
dieux participaient d’une autre manière au sacrifice: soit dans les grandes
salles destinées aux repas et situées, avec les cuisines, dans les dépendances
du temple, soit sous les vastes portiques qui l’entouraient, sur l’esplanade
qui s’étendait devant lui, ou dans les espaces ouverts du forum, des tables
étaient dressées, chargées de la viande des victimes immolées; la coupe des
libations passait de main en main . Après cette communion païenne, le sacrilège
était consommé: on avait mangé les viandes consacrées aux démons, peut-être
parodié les rites eucharistiques; il n’y avait plus de chrétien.
Le nombre des apostats fut immense. Jamais l'Église
n’avait eu à pleurer sur tant de défections. Dans les persécutions précédentes,
plus d’un chrétien avait renié sa foi; mais il avait apostasié en présence du
tribunal, devant le magistrat menaçant, à la vue des instruments de supplice,
ou même le corps déjà brisé par la torture. Sa faiblesse était coupable, mais au
moins elle avait été précédée d’un essai de résistance. Il n’en est plus ainsi.
Avant tout procès, sur une simple invitation de l’autorité, les chrétiens se
présentent en masse devant les autels des dieux. La peur, l’ignoble peur, est
maîtresse des âmes. Les magistrats païens sont étonnés d’une si prompte obéissance.
On les voit remettre au lendemain des chrétiens trop pressés d’abjurer. Ils
semblent écœurés au spectacle des longues processions qui traversent le forum,
montent les degrés du Capitole, avec des fleurs, des victimes, de l’encens :
riches citoyens suivis d’esclaves, d’affranchis et de colons; parents amenant
leurs petits-enfants; maris traînant de force leur femme qui ne veut pas les
suivre; tous s’exhortant, se poussant les uns les autres, comme si la lâcheté
était moins grande quand elle était partagée, l’apostasie moins honteuse quand
elle avait beaucoup de complices. On vit de navrants épisodes. Ici, c’est une
famille divisée, le fils, le frère jetés en prison, la mère et la sœur allant
sacrifier. Ailleurs, c’est une femme menée au temple malgré elle : son mari,
ses parents tiennent ses mains, lui font jeter de l’encens sur l’autel; la
malheureuse se débat en criant : «Ce n’est pas moi, c’est vous qui l’avez fait».
Un jeune couple chrétien avait fui, laissant à la maison une petite fille : la
nourrice la porte au temple, et, comme elle ne mangeait pas encore de viande,
lui fait avaler un peu de pain trempé dans le vin consacré aux idoles. Mais le
plus triste fut de voir des membres du clergé mêlés aux apostats. A Carthage,
il y eut beaucoup de prêtres parmi les lapsi. A Saturnum,
autre ville de la province proconsulaire, l’évêque Repostus conduisit lui-même au temple une partie de son peuple. L’évêque d’Assur,
Fortunatus, et deux autres prélats africains, Jovinus et Maxime, dont les
sièges sont inconnus, eurent aussi la faiblesse de sacrifier.
Plus d’une fois les apostats furent terrifiés et les
fidèles avertis par les signes éclatants de la colère divine. L’un, après avoir
prononcé l’oraison sacrilège, était subitement frappé de mutisme. Une femme qui
avait renié le Christ était prise, au bain, de douleurs violentes, et, dans sa
folie, mordait la langue qui avait touché les viandes profanes et injurié son
Dieu: elle mourut bientôt dans d’horribles souffrances. Beaucoup, bourrelés de
remords, tombaient dans le désespoir, devenaient démoniaques ou fous.
Quelques-uns, croyant avoir échappé à l’attention de leurs coreligionnaires,
essayaient de se glisser encore parmi eux après l’abjuration, prétendaient même
participer aux sacrements. Une main invisible s’abattait sur eux. Une jeune
fille qui a sacrifié expire après avoir reçu l’eucharistie. Une renégate voit
sortir du feu du coffre où elle conservait le saint Sacrement. Un apostat
reçoit, selon l’usage, le pain eucharistique dans sa main, et, au moment de le
consommer, ne trouve plus qu’une poignée de cendres.
Même le pauvre petit enfant, dont une nourrice avait
souillé les lèvres du vin idolâtrique, ne peut plus boire au calice
sacramentel, et rejette avec des vomissements le sang du Sauveur. Ces
exemples, rapportés par le mieux informé des contemporains, l’évêque de
Carthage lui-même, durent frapper de terreur les chrétiens, et peut-être
arrêter au bout de quelque temps le cours des apostasies; mais le nombre de
celles-ci était déjà très grand: beaucoup de familles chrétiennes restaient en
proie au remords, à la honte; la cause de bien des divisions, de bien des déchirements
était posée pour l’avenir.
Ces apostats du premier degré, sacrificati, thurificati, n’étaient pas les seuls dont
l'Église eût à rougir. De faibles chrétiens essayèrent, au moyen d’une
transaction, de se faire passer comme ayant obéi aux ordres de l’empereur, tout
en s’abstenant en réalité des sacrifices commandés. Soit par faveur, soit à
prix d’argent, ils obtenaient d'être inscrits sur la liste de ceux qui avaient
sacrifié et recevaient en échange un certificat, une sorte de billet de confession
païenne, qui les mettait à l’abri des poursuites. Ordinairement ces
libellatiques, comme on les appela, s’étaient présentés en personne devant le
magistrat, qui se contentait de leur déclaration, sans les obliger à faire un
acte formel d’idolâtrie; quelquefois même l’inscription était faite et le
billet leur était remis sur leur demande, sans qu’ils eussent besoin de
comparaître. Cette conduite était certainement répréhensible : comme le disait
le clergé de Rome dans une lettre à saint Cyprien, « c’est être criminel que
de se faire passer pour apostat, alors même qu’on n’a pas apostasié».
Cependant les libellatiques étaient moins coupables que les apostats proprement
dits : avec la précision habituelle de son esprit, saint Cyprien savait
distinguer entre les uns et les autres. Entre les apostats eux-mêmes, sa
charité reconnaissait des nuances : il jugeait différemment « celui qui, à la
première injonction, vola au-devant d’un sacrifice impie, et celui qui
n’accomplit un acte si funeste que par contrainte et après une longue résistance;
celui qui obligea sa famille, ses amis, ses colons à sacrifier, et celui qui
sacrifia seul pour en dispenser les siens ». À plus forte raison mettait-il les
libellatiques dans une catégorie à part. « Puis donc que l’on doit distinguer
entre ceux-là même qui ont sacrifié, il y aurait une dureté et une injustice
révoltantes à confondre les libellatiques avec ces derniers. J’avais lu, vous
dira celui qui a reçu l’un de ces billets, les instructions de l’évêque, elles
m’avaient appris qu’il est défendu de sacrifier aux idoles, et qu’un serviteur
de Dieu ne doit pas adorer des simulacres. Voilà pourquoi, afin de m’épargner
un crime, et profitant d’une occasion que je n’aurais jamais cherchée, si elle
ne s’était offerte, j’allai trouver le magistrat, et je lui déclarai moi-même
ou par un intermédiaire que j’étais chrétien, qu’il ne m’était pas permis de
sacrifier, que je ne pouvais pas me présenter devant les autels du démon, et
que j’offrais de l’argent pour en être dispensé »
II.
Les martyrs, les bannis et les fugitifs.
Tel est le langage de saint Cyprien, raisonnable, modéré,
humain; mais probablement ne parla-t-il avec cette netteté que la crise finie,
quand il s’agit d’établir et de peser toutes les responsabilités et de
reconstituer les cadres à demi rompus de l’Église: tant que dura la période
aiguë de la persécution, il se borna sans doute à conseiller uniformément ce
qui était le devoir strict, la résistance. Celle-ci avait deux formes : on
pouvait refuser de sacrifier, et attendre intrépidement chez soi le martyre; on
pouvait se dérober et au sacrifice et au martyre par la fuite. Le premier
parti fut pris par un grand nombre d’héroïques chrétiens.
Dès le mois de janvier, des chrétiens qui ne s’étaient
pas présentés au temple dans le délai fixé, ou qui avaient publiquement déclaré
qu’ils ne se présenteraient pas, furent mis en prison. Le proconsul, nous
l’avons dit, était peut-être absent; mais l’autorité des officiers municipaux
suffisait sans doute, aux termes de l’édit, pour ordonner l’incarcération
provisoire. D'ailleurs, à leur défaut, le peuple impatient se serait chargé de
le faire. A la suite d’une émeute, le vieux prêtre Rogatianus,
et un laïque nommé Felicissimus, furent saisis et
jetés en prison; beaucoup d’autres, clercs, laïques, femmes même et enfants, y
furent envoyés à leur suite. On sait ce qu’étaient les prisons romaines et la
terreur qu’elles inspiraient aux natures délicates. Ténèbres, saleté,
promiscuité de toute sorte, grossièreté des geôliers et des soldats, froid
glacial ou chaleur insupportable, manque de nourriture, tous les tourments y
étaient réunis. Celles de Carthage étaient depuis longtemps redoutées des
chrétiens. Une seule consolation restait aux captifs: ces lieux de souffrance
s’ouvraient facilement, quand on y mettait le prix. Toute cette histoire donne
une idée peu avantageuse des mœurs administratives des Romains. On a vu tout à
l’heure des chrétiens peureux achetant des duumvirs des certificats constatant
de fausses apostasies; nous voyons maintenant—et ce n’est pas la première
fois—les fidèles corrompant les geôliers et obtenant d’eux la permission de
pénétrer près des captifs. Tantôt un prêtre vient, accompagné d’un diacre,
célébrer le saint sacrifice dans la prison et distribuer aux martyrs le pain
céleste; tantôt des personnes charitables leur portent la nourriture
matérielle nécessaire pour soutenir leurs forces épuisées, ou les vêtements
dont ils ont besoin. Saint Cyprien est obligé de recommander aux visiteurs de
ne pas venir en trop grande foule, afin de ne pas attirer les soupçons.
L’argent de la caisse ecclésiastique était employé à l’assistance des captifs;
c’était un de ses objets essentiels, et l’évêque de Carthage avait pris des
mesures pour assurer les ressources suffisantes. Malgré tant de soins,
l’incarcération prolongée fut mortelle à quelquesuns: Fortunio, Victorinus, Victor, Herennius, Gredula, Herena, Donatus, Firmus, Venustus,
Fructus, Julia, Martial, Ariston «périrent de faim en
prison». «Nous les suivrons bientôt, ajoute l’auteur de la lettre qui nous
apprend la fin glorieuse de ces détenus, car depuis huit jours nous venons
d’être remis au cachot. Auparavant, on nous donnait tous les cinq jours un peu
de pain et de l’eau à volonté». Depuis huit jours, les survivants étaient donc
entièrement privés de nourriture. C’est d’une main sans doute défaillante que
le confesseur Lucien écrivait ces nouvelles à son correspondant de Rome. Et
cependant, à cette époque, la peine de l’emprisonnement avait été abolie, et le
droit romain ne reconnaissait que la prison préventive!
Au moment où se passaient les scènes que nous venons de
rappeler, l’instruction criminelle, que les magistrats municipaux n’avaient pu
commencer, se poursuivait par les soins du proconsul : on peut fixer au mois
d’avril 250 le moment où les documents laissent apercevoir son intervention.
Depuis cette date jusqu’à la fin de l’année, les procès se succédèrent presque
sans relâche, procès insidieux, où, à la suite d’une torture demeurée sans
effet, le confesseur était ramené en prison, pour en être extrait de nouveau
après quelque temps : on ne se hâtait pas d’arriver au dénouement, on le
reculait au contraire le plus loin possible; mais par les tourments, par les
menaces, par la fatigue d’une instruction criminelle toujours continuée, jamais
finie, par l’ennui, les dégoûts et les souffrances de la prison, par les
rigueurs de la mise au secret, par une obsession continuelle, le proconsul se
flattait d’user la résistance, et de faire tomber le chrétien avant le martyre,
comme un voyageur à bout de force tombe sur la route au moment de toucher au
terme. Plus d’une fois ce calcul réussit. Saint Cyprien, dont les jugements
sont empreints de tant de mansuétude et de mesure, et donnent vraiment une
grande idée de la casuistique de ce temps-là, plaint ceux qui succombèrent dans
ces conditions, les distingue avec soin des lâches qui abjurèrent spontanément,
et se montre facile à leur pardonner. Tel fut le cas de Ninus,
de Clementianus et de Florus. Arretés au début de la persécution, ils avaient été amenés devant les duumvirs, et là,
méprisant les menaces des magistrats, dédaignant la colère du peuple, ils
avaient confessé le Christ. Après une longue détention, ils furent enfin
conduits au proconsul. Mis plusieurs fois à la torture, devant le représentant
irrité de Rome, en présence du peuple furieux, ils finirent par céder. «Malgré
leur ardent désir de la mort, on n’avait pas voulu les tuer, et, lentement, par
des tourments sans cesse répétés, on n’avait point vaincu leur foi, demeurée
invincible, on avait contraint leur chair infirme de succomber à la fatigue».
Heureux ceux dont la force d’âme résistait à une telle épreuve, et qui, comme
le jeune Aurelius, après avoir une fois soutenu l’assaut des magistrats
municipaux, bravaient dans une seconde comparution le proconsul en personne,
supportaient les tortures, et, renvoyés en prison, voyaient la persécution
finir, sans avoir faibli! Plus heureux encore ceux dont le corps débile ne
pouvait résister à la question, et qui mouraient après l’avoir subie, comme
Paul, Fortunio, Bassus, Mappalique et ses compagnons! Quand ces derniers
comparurent devant le proconsul, les tourments les plus raffinés furent mis en
œuvre pour les contraindre à l’abjuration. On lacéra leur corps avec des
ongles de fer, déchirant les entrailles, renouvelant les mêmes blessures, «torturant
non plus les membres, mais les plaies vives». Le sang coulait à flots : la
parole des martyrs n’en était pas moins libre, ni leur contenance moins fière.
S’adressant au proconsul: «C’est demain, s’écria Mappalique,
c’est demain que vous verrez le combat!». Le lendemain, en effet, eut lieu le
combat suprême: les bourreaux redoublèrent leurs efforts, et les martyrs,
expirant au milieu des tortures, reçurent la couronne céleste. La foule
elle-même, si hostile à Carthage aux disciples du Christ, avait plusieurs fois
témoigné son admiration.
Qu’on le remarque bien, c’est à la suite de la torture
que périrent ces martyrs: la sentence capitale n’avait pas été prononcée;
jusqu’à la fin le proconsul avait espéré triompher du courage des saints, et
leur arracher une parole d’apostasie. Telle était la politique de l’empereur
et de ses agents. Aucune haine ne les animait contre les chrétiens : ils ne
versaient pas le sang par fanatisme ou par colère, mais pour intimider les
courages, triompher des volontés les plus fermes, et ravir des âmes au Christ.
Plus d’une fois la foule s’irrita des lenteurs calculées de la répression, et,
incapable de comprendre ce qu’elles avaient d’insidieux et de redoutable,
devança les sentences des magistrats. Carthage fut un jour témoin d’une
horrible scène. Le peuple se rua sur un groupe de fidèles, les sommant
d’abjurer. Soutenus par les exhortations d’un d’entre eux, Numidicus,
ils refusèrent courageusement. Le fanatisme populaire les condamna et les exécuta
sur-le-champ. Les uns furent lapidés, les autres brûlés : atteint par les
pierres, ses vêtements en feu, Numidicus continuait à
prêcher la résistance, et, l’œil brillant d'une joie sublime, regardait sa
femme brûlée vive à ses côtés. Laissé pour mort avec les autres, il fut, le
lendemain, retrouvé par sa fille sous les pierres et les cadavres: il respirait
encore; on le ranima. Quelque temps après, saint Cyprien annonçait au clergé
et au peuple, par une lettre triomphante, l’élévation de ce héros au sacerdoce.
On vient de voir en action les sentiments haineux de la
foule à l’égard des chrétiens. Pour que le tableau soit complet, il convient d’ajouter
que, même à Carthage, la patience des martyrs produisait quelquefois sur les
spectateurs une impression profonde : les esprits sérieux en restaient frappés
et se demandaient quelle était cette religion qui apprenait aux hommes à
surmonter les plus cruelles douleurs, les plus déchirantes séparations, et les
soutenait par la certitude de récompenses éternelles. Quelquefois, autour du
chevalet sur lequel un chrétien était étendu, pendant que crépitait sous les
lames ardentes sa chair brûlée, d’étranges dialogues s’échangeaient entre les
spectateurs. Un contemporain, témoin des scènes sanglantes de la persécution de
Dèce, adressait de Carthage aux confesseurs de Rome Moïse et Maxime un traité
de la Gloire des martyrs. «Je l’ai bien comprise, dit-il, un jour que des
mains cruelles déchiraient le corps d’un chrétien et que le bourreau traçait
de sanglants sillons sur ses membres lacérés. J’entendais les conversations des
assistants. Les uns disaient: «Il y a quelque chose, je ne sais quoi, de grand
à ne point céder à la douleur, à surmonter les angoisses». D’autres ajoutaient: «Je pense qu’il a des enfants. Une épouse est assise à son foyer. Et cependant
ni l’amour paternel, ni l’amour conjugal n’ébranle sa volonté. Il y a là
quelque chose à étudier,
un courage qu’il
faut scruter jusqu’au fond. On doit faire cas d’une croyance pour laquelle un homme soufre et accepte de
mourir». Les
gens qui parlaient ainsi n’étaient plus de simples curieux : un travail se
faisait dans leur âme et le sang du martyr, selon le mot de l'apologiste,
semait en eux le chrétien.
Le proconsul ne prononçait pas seulement des sentences
de mort; un grand nombre de chrétiens furent condamnés au bannissement, ou,
pour employer l’expression juridique, à la relegatio.
Il y avait plusieurs sortes de relégation, mais l’une d’elles seulement pouvait
être prononcée par un gouverneur. C’était l’interdiction de résider dans la
province. Ce châtiment n’était pas compté parmi les peines capitales
entraînant la perte des droits de cité; il n’avait même pas, en règle générale,
pour corollaire la confiscation des biens, et, dans les cas exceptionnels où
cette aggravation accessoire était prononcée par la loi, la confiscation
n’atteignait jamais la totalité de la fortune. Mais, pour les chrétiens, les
conséquences de la relégation avaient été considérablement étendues par l’édit
de Dèce. Comme les peines capitales, elle entraînait la perte totale du
patrimoine, dévolu au fisc. Les magistrats municipaux avaient même reçu le
droit de la prononcer; une lettre déjà citée de saint Cyprien nous apprend que
le confesseur Aurelius fut exilé par eux. Il est question ailleurs des exilés
chassés de la patrie et privés de tous leurs biens. Un de ces groupes de
bannis, au nombre de soixante-cinq (deux seulement sont connus, Statius et Severianus), vint d’Afrique à Rome; des femmes
chrétiennes de cette ville qui avaient eu le malheur de sacrifier coururent,
pleines de repentir, les recevoir aux bouches du Tibre, et, depuis ce temps,
ne cessèrent de les assister. Deux autres exilés de Carthage sont connus: Sophronius et Repostus. Enfin, on
a les noms d’un prêtre de cette ville, Félix, de sa femme, Victoria, et d’un
laïque, Lucius, qui, ayant d’abord failli, furent, nous ne savons pourquoi,
soumis à une nouvelle épreuve, se rétractèrent courageusement et furent
condamnés à la relégation; le fisc s’empara de tous leurs biens. Cette femme
dont nous avons déjà parlé, Bona, que son mari et ses proches avaient contrainte
à sacrifier, fut également punie de l’exil pour avoir protesté contre la
violence qui lui était faite et déclaré qu’au fond du cœur elle n’avait pas
consenti au sacrilège.
A côté de ces bannis par sentence, il y eut un grand
nombre de bannis volontaires. Ceux-ci, à leur manière, confessaient le Christ,
car la fuite d'un chrétien entraînait de droit la confiscation, aux termes de
l’édit. «Celui, dit saint Cyprien, qui, abandonnant ses biens, s’est retiré
parce qu’il ne voulait pas renoncer Jésus-Christ, l’aurait sans doute confessé,
s’il eût été pris comme les autres». La situation des fugitifs était plus dure
encore que celle des bannis. Ces derniers, protégés par la sentence même qui
les condamnait, pouvaient s’éloigner librement et sans doute n’étaient pas
traduits de nouveau devant les tribunaux, puisqu’une peine les avait déjà
frappés: il y avait chose jugée à leur égard. Les autres vivaient dans des transes
continuelles; ils pouvaient à chaque instant être arrêtés; ils avaient fui à la
hâte, oubliant quelquefois dans leur maison ce qu’ils avaient de plus précieux.
Maintenant, «ils erraient dans la solitude et les montagnes, à la merci des
brigands, des bêtes féroces, exposés à la faim, à la soif, au froid», ou, pour
mettre la mer entre eux et leurs persécuteurs, ils s’embarquaient au hasard,
sur le premier navire venu. Aussi ne s’étonne-t-on pas que saint Cyprien, après
avoir placé au premier rang la confession de ceux qui proclamaient devant les
juges leur foi au Christ, mette immédiatement à la suite le courage de ceux qui
ont tout quitté, famille, repos, fortune, pour fuir les occasions de le
renoncer.
III.
La question des « tombés. »
Saint Cyprien avait lui-même, dès le commencement de la
persécution, cherché le salut dans la fuite, comme plusieurs des plus saints
évêques de ce temps, parmi lesquels Denys d’Alexandrie et Grégoire le
Thaumaturge. Il n’avait point pris sans hésitation ce parti: l’ordre direct de
Dieu, dit-il dans une de ses lettres, put seul l’y décider. On croit volontiers
que le premier mouvement de ce prélat énergique et fier, que nous verrons,
quelques années plus tard, affronter deux fois le proconsul avec une calme
intrépidité, avait été d’attendre le bourreau sur place, et, pour ainsi dire,
sur le siège épiscopal. Mais on comprend aussi qu’un homme de gouvernement tel
que Cyprien, connaissant le fort et le faible de son Église, les divisions de
son clergé, la mollesse d’un grand nombre de fidèles, ait résolu, après
réflexion, de chercher une retraite d’où il pût continuer à diriger les
intérêts que Dieu lui avait confiés. Le devoir du général n’est pas toujours
de faire le soldat et d'exposer sa vie dans la mêlée, au risque de laisser
l’armée sans chef capable de diriger le combat.
Dès la publication de l’édit, le peuple de Carthage, qui
connaissait l’influence, l’autorité de Cyprien, et prévoyait qu’il allait être
l’âme de la résistance, avait, à plusieurs reprises, demandé sa mort. Dans
l’amphithéâtre, au forum, partout où la foule élevait la voix, retentissait le
cri: «Cyprien au lion!». Le martyre était tout près, frappait, pour ainsi dire,
à sa porte: l’évêque eut le courage de s’y dérober, et se prépara à sortir
secrètement de la ville.
Avant son départ, bien des affaires durent être réglées,
car, au milieu du troisième siècle, l’administration spirituelle et temporelle
d’une grande Église comme celle de Carthage était fort compliquée. La
communauté chrétienne, organisée dans tous les centres importants sur le
modèle des corporations romaines, possédait une caisse commune, dont les
ressources, fournies par des cotisations régulières, servaient aux frais du
culte, à l’entretien des cimetières, à la subsistance du clergé, des veuves,
des vierges consacrées à Dieu, à l’assistance des pauvres et des prisonniers.
L’évêque voulut en assurer le fonctionnement pendant son absence. Plusieurs de
ses lettres sont relatives aux sommes qui doivent être distribuées aux confesseurs,
aux pauvres, à tous ceux dont l’Église avait pris l’entretien à sa charge.
Cyprien se préoccupa aussi de sauver de la confiscation ce qui restait de sa
fortune privée. L’histoire de cette fortune est curieuse. Lors de sa
conversion au christianisme, Cyprien s’en était dépouillé; il avait vendu tous
ses biens pour en donner le prix aux pauvres. Une partie de son patrimoine,
nous apprend son biographe, lui fut ensuite rendue, probablement par la
reconnaissance des fidèles, qui rachetèrent, pour les lui restituer, les terres
mises en vente. Il n’osa pas les vendre de nouveau, de peur d’attirer
l’attention malveillante des païens. On peut donc supposer qu’il était encore
riche au moment où éclata la persécution. Il emporta en exil des sommes
importantes, qu’il fit peu à peu passer à ceux qu’il avait chargés de l’administration
de la caisse ecclésiastique; il en déposa d’autres à titre de fidéicommis entre
les mains d’un prêtre investi de sa confiance. Probablement réussit-il à
mettre également ses immeubles sous le nom d’un tiers, car on l’en retrouve en
possession quelques années plus tard. Ces précautions étaient nécessaires;
l’édit ordonnait la confiscation du patrimoine de tout chrétien fugitif, et,
dès que le départ de Cyprien eut été connu, l’autorité fit apposer sur les murs
de la ville des affiches portant ces mots :«Quiconque possède ou détient des
biens de Cyprien, évêque des chrétiens, est obligé de le déclarer». Mais
Cyprien, administrateur habile, avait déjoué l’avidité du fisc et assuré, par
la conservation de sa fortune privée, l’alimentation de la caisse
ecclésiastique pendant les mauvais jours. Il pouvait maintenant s’éloigner:
les affaires temporelles et spirituelles de l’Église restaient en bon ordre:
il laissait, pour le remplacer pendant son absence, deux évêques voisins et
plusieurs prêtres dont la fidélité et l’énergie lui étaient connues.
Malheureusement il laissait aussi, dans son clergé même,
un parti hostile, à la tête duquel étaient cinq prêtres, qui s’étaient opposés
naguère à ce qu’il fût élu évêque. De ce groupe ambitieux et mécontent
partirent des rumeurs malveillantes au sujet de la retraite de Cyprien. Elles
se répandirent assez pour que le clergé de Rome s’y soit un instant laissé
prendre, et y ait fait de discrètes allusions dans une lettre au clergé de
Carthage, véritable modèle d’ironie ecclésiastique. Après la persécution,
saint Cyprien fut encore obligé de se défendre contre ces mauvais bruits, et le
soin avec lequel son biographe et ami, Pontius,
explique et excuse son absence, montre que même sa mort héroïque dans la
persécution de Valérien n’avait pas suffi à le laver de tout reproche de
faiblesse pendant celle de Decius. La justification de l’évêque était cependant
facile: il lui suffisait de faire connaître à ceux qui doutaient l’activité déployée
dans sa retraite, et d’en montrer les heureux fruits: c’est ce qu’il fit en
communiquant au clergé de Rome, facilement persuadé, treize lettres pastorales
écrites en exil. Du lieu où il se tenait caché, probablement à peu de distance
de Carthage, Cyprien n’avait cessé de gouverner son Église, communiquant
constamment avec elle, instruit des moindres détails, exhortant le clergé et le
peuple, encourageant les martyrs, veillant à l’assistance des pauvres, reprenant
le zèle exagéré des uns, corrigeant la mollesse des autres, se faisant tenir au
courant, par ses correspondants , du jour de la mort de chacun des confesseurs
décédés en prison, «afin que leur commémoration puisse être célébrée parmi les
mémoires des martyrs»
Malheureusement, le groupe des prêtres opposants ne
cessait d’apporter des obstacles à l’administration de l’évêque absent. Ces
habiles adversaires avaient, grâce aux circonstances, trouvé un terrain tout
préparé pour leurs manœuvres. Ils surent profiter de deux sentiments que la
crise traversée par la communauté chrétienne de Carthage rendait faciles à exploiter: l’impatience de beaucoup de renégats—de tombés, lapsi, comme on les
appelait—à être admis de nouveau dans la communion de l’Église, l’orgueil de
ceux qui étaient restés debout, avaient affronté les magistrats, subi
courageusement les tortures, mais, peu éclairés parfois, n’étaient pas tous de
force à repousser des flatteries intéressées. A toutes les époques, l’Église
avait reconnu aux confesseurs un pouvoir d’intercession: les canons
d’Hippolyte, œuvre du commencement du troisième siècle, leur assignent un rang
très élevé: dès le temps de Tertullien, ceux qui avaient eu le malheur de
faillir les prenaient pour médiateurs. Le même fait se produisit en Égypte et
en Asie, pendant la persécution de Dèce. Mais à Carthage, on semble l’avoir
érigé en système. Les tombés allaient en foule visiter les confesseurs dans les
prisons, pleuraient à leurs pieds, les entouraient de soins, les accablaient de
compliments, et revenaient après avoir obtenu des billets, dans lesquels la
paix leur était donnée. Ces billets, multipliés au-delà de toute mesure,
finirent par être distribués sans discernement. «Qu’un tel soit admis à la
communion avec les siens» cette formule vague se lisait quelquefois sur les
lettres de réconciliation. Quelques personnes, abusant de la facilité des confesseurs,
allèrent jusqu’à en faire trafic: ce fut, selon l’expression de saint Cyprien,
la foire aux billets. Le principal auteur de ces désordres était un confesseur
nommé Lucien, qui avait fait ses preuves de courage, mais avait l’esprit
étroit, le caractère obstiné. Les prêtres opposants trouvaient en lui un instrument
d'un maniement facile, et s’en servaient pour encourager les espérances des
tombés, faire violence à la modestie des confesseurs, mettre l’indiscipline
dans l’Église. Au moins, en accordant indiscrètement la paix, les confesseurs
avaient-ils entendu que leur décision serait subordonnée à la pénitence de
l’impétrant et au jugement définitif de l’évêque: les meneurs du clergé
passaient outre, admettaient à la communion les tombés munis de billets, s’érigeaient,
par conséquent, en chefs de l’Église, au mépris de toute hiérarchie.
Saint Cyprien avait trop le sentiment de l’autorité
attachée à sa charge pour tolérer, même de loin, un pareil abus. Il écrivit de
sa retraite trois lettres pastorales: l’une aux confesseurs, douce, presque
caressante, les exhortant à marquer nommément ceux à qui ils désiraient qu’on
fit grâce, et à ne donner de billets qu’aux chrétiens vraiment touchés de
repentir, «dont la pénitence approcherait d’une entière satisfaction»; la
seconde au clergé, très ferme, menaçant d’interdiction les prêtres qui
admettraient des tombés à la communion; la troisième au peuple, l'invitant à
modérer l’impatience des tombés, et à ne pas suivre dans leur rébellion ceux
qui manquaient de respect à l’évêque. Vers le même temps, des conseils
excellents arrivaient au clergé de Carthage de la part du clergé de Rome; dans
la même lettre où, mal renseigné encore, ce dernier faisait des allusions peu
bienveillantes à l'éloignement de Cyprien, il traçait aux prêtres de la
métropole africaine des règles très sages sur la conduite à suivre au sujet des
tombés, qui doivent être exhortés à la pénitence, encouragés à confesser
Jésus-Christ si une seconde épreuve leur est imposée, mais ne doivent être
reçus à la communion qu’en cas de maladie. Cette même règle fut donnée par
saint Cyprien, qui écrivit à ses prêtres d’accorder aux malades la paix promise
par les billets des martyrs. Pour les tombés qui s’étaient relevés en
confessant Jésus-Christ, et avaient été condamnés au bannissement, Cyprien les
considéra comme réhabilités, et les admit à la communion. En ce qui concernait
les autres, il jugeait qu’il fallait les laisser en suspens jusqu’à ce que la
paix eût permis de réunir une assemblée d’évêques qui déciderait, d’accord avec
le clergé et le peuple, les conditions et l’heure auxquelles il conviendrait
de les réintégrer dans la société des fidèles.
On aurait pu croire que ces décisions, empreintes de tant
de modération et de sagesse, auraient mis fin au conflit : loin de là, celui-ci
sembla devenir plus aigu. Les dissidents crièrent d’autant plus fort, qu’il
leur restait moins de raisons de crier. Lucien, au nom d’autres confesseurs,
écrivit à Cyprien une lettre dont la brièveté impérieuse touchait à l’insolence.
De tous côtés les tombés s’agitaient, s'élevaient contre les évêques, voulaient
rentrer de force et comme d’assaut dans l’Église. Malgré les conseils des
confesseurs de Rome, restés aussi respectueux de la hiérarchie que ceux de
Carthage étaient devenus indisciplinés, malgré l’intervention réitérée du
clergé romain, désormais convaincu de l’innocence et du bon droit de saint
Cyprien, malgré l’attitude excellente du plus grand nombre des prêtres de
Carthage, demeurés fidèles à leur évêque, la crise continuait. La multitude des
tombés devenait plus exigeante, à mesure que la persécution s’assoupissait, que
le péril s’éloignait, et que l’on pouvait prévoir le moment où la rentrée dans
l’Église n’offrirait plus que des avantages sans mélange aucun de dangers.
Déjà les persécuteurs découragés se relâchaient de leur
rigueur, les portes des prisons s’ouvraient, les confesseurs en sortaient en
foule. Après un an de détention, beaucoup d’entre eux furent comme grisés par
l’air de la liberté. Flattés par les prêtres rebelles, accueillis avec toute
sorte de prévenances par les tombés, étourdis des éloges qu’ils recevaient,
ils-en vinrent à se considérer comme des êtres à part, supérieurs au reste de l’humanité,
mis par la gloire du martyre au-dessus des convenances communes et de la morale
vulgaire. Des hommes qui, en prison, avaient intrépidement confessé
Jésus-Christ ne rougirent pas de s’abandonner au désordre. Les jalousies, les
divisions bruyantes se manifestèrent ouvertement parmi eux: quelques-uns
tombèrent dans l’ivrognerie, d’autres affichèrent des familiarités suspectes,
et laissèrent douter de leur vertu. Le scandale était grand: le parti des
tombés, et les prêtres qui le menaient, se réjouissaient de dérèglements qui
leur livraient plus complètement les confesseurs. Cyprien, averti comme
toujours, dut couper court à ce scandale. Sa plume infatigable écrivit à tous
les confesseurs (sans distinguer, par charité, entre les innocents et les
coupables) une lettre à la fois douce et ferme, reprenant les uns de leurs
fautes, louant l’innocence des autres, les exhortant tous à conserver, par une
exacte pureté de vie, la gloire qu’une héroïque confession leur avait acquise.
Craignant les suggestions mauvaises de la pauvreté, il annonçait vers le même
temps l’envoi de plusieurs sommes d’argent. Parmi les avertissements contenus
dans la lettre de saint Cyprien, il en est un qui mérite une attention
particulière. L’évêque blâme ceux qui, rompant leur ban, reviennent dans leur
patrie après avoir encouru une sentence d’exil non encore levée, «et s’exposent
ainsi à être punis non plus comme chrétiens, mais comme violateurs des lois».
On ne saurait trop admirer cette délicatesse extrême de l’honneur chrétien, et
ce scrupuleux respect des lois romaines chez ceux en qui les persécuteurs
s’obstinaient à voir des ennemis de l’empire.
La situation personnelle de Cyprien n’était pas identique
à celle des bannis : aucune sentence judiciaire n’avait été rendue contre lui,
et le seul acte de l'autorité qui l’eut visé était l’ordonnance de
confiscation de ses biens. Aussi pouvait-il rentrer à Carthage sans braver la
loi. Il y songeait tous les jours, et attendait avec impatience le moment où la
paix serait affermie et où la haine que lui portaient les païens paraîtrait
moins violente. Mais, quand il touchait à l’heure désirée du retour, les
troubles de l’Église s’aggravèrent: un schisme éclata. Le chef nominal fut un
laïque influent et riche, de mœurs peu recommandables, appelé Felicissimus, auquel se joignirent bientôt les cinq prêtres
qui n’avaient cessé de faire opposition à Cyprien , et parmi lesquels était le
turbulent Novat, destiné à prêcher le rigorisme à
Rome après avoir pris parti à Carthage pour la morale relâchée. Beaucoup de
tombés les suivirent, attirés par la promesse d’une prompte réconciliation. Il
était temps que Cyprien rentrât. Après un exil qui avait duré quatorze mois (de
février 250 à avril 251), il revint à Carthage. Son premier soin fut de réunir
plusieurs évêques en concile, pour régler, de concert avec le clergé et le peuple,
toutes les questions pendantes. On entendit d’abord Felicissimus, Novat et leurs adhérents: ils furent condamnés. Puis
l’assemblée termina par son jugement l’affaire des tombés. Elle décida
d’exclure de toute fonction ecclésiastique les évêques et les prêtres qui
auraient sacrifié ou seraient porteurs de certificats de sacrifice; d’accorder
la communion aux autres libellatiques s’ils avaient fait pénitence aussitôt
après leur péché; pour les laïques qui avaient sacrifié, on arrêta d’examiner
séparément chaque cas, d’après des règles déterminées, et de fixer selon les
circonstances le degré de la culpabilité, la durée de la pénitence et le délai
de la réconciliation.
Ces décrets furent envoyés au pape Corneille, qui, ayant
réuni à Rome un concile de soixante évêques, y donna son adhésion: des
assemblées tenues dans plusieurs édiles d’Italie et d’Afrique les adoptèrent
également. La question des tombés fut résolue, d’un commun accord, dans tout
l’Occident chrétien. Le schisme de Felicissimus s’éteignit misérablement au bout de quelques mois.
CHAPITRE NEUVIÈME.
LA PERSÉCUTION DE DECE EN ORIENT.
|
 |
 |
LES PERSÉCUTIONS PENDANT LA PREMIÉRE MOITIÉ DE TROISIÉME SIÉCLE (SEPTIME SÉVERE, MAXIMIN, DÈCE) |
 |
 |
 |
 |