 |
 |
HISTOIRE DU BAS-EMPIRE. |
 |
LIVRE QUARATINE CINQUIÈME
|
RAVENNE
|
Vitigès se retirait vers Ravenne avec ce que le siège de Rome, si long et si meurtrier, lui avait laissé de troupes. Au lieu de suivre la voie Flaminienne, qui était le chemin le plus droit, comme il vouloir éviter le voisinage de Narni, de Spolette et de Pérouse, où les Romains avoient des garnisons, il prit sa route par la Toscane. En passant, il jeta mille hommes dans Orviette, autant dans Clusium, quatre cents dans Tuderte. Il en envoya deux mille à Urbin, cinq cents à Césène et au mont Férétrius, qu’on nomme maintenant Saint-Léon de Monte-Feltro; et comme Auxime, aujourd’hui Osimo, était pour lors la capitale du Picénum, il choisit dans son armée quatre mille soldats des plus braves qu’il y envoya sous la conduite de ce Vandaloire qui était resté pour mort sur le champ de bataille dans le premier combat devant Rome. II prit, avec le reste de son armée, la route de Rimini, à dessein de l’assiéger. Jean, neveu de Vitalien, était dans cette place avec deux mille chevaux. Bélisaire, persuadé qu’une garnison d’infanterie serait plus en état de soutenir un long siège, fit partir Ildiger et Martin à la tête de quelques troupes, par la route Flaminienne, afin de prévenir l’arrivée des ennemis. Ils avoient ordre de retirer de Rimini Jean et ses cavaliers, et d’y faire entrer à leur place la garnison d’Ancône, composée d’Isaures et de Thraces, tous fantassins. Conon, commandant des Isaures, s’était depuis peu rendu maître d’Ancône. Bélisaire pensait que, si les Goths assiégeaient Rimini, la cavalerie rendrait plus de service hors de la place, et qu’en fatiguant l’ennemi, le harcelant sans cesse, lui enlevant ses convois, elle le forcerait à lever le siège.
 |
En approchant du fleuve Métaure, la voie Flaminienne se trouvait fermée par
un roc très-élevé, et bordée d’une rivière si rapide qu’on ne pourvoit la
traverser sans péril. Cette rivière se nomme aujourd’hui Candiano;
elle sort de l’Apennin, et se jette dans le Métaure. Au-delà du roc était un
vallon profond qui s’élargissait à son entrée. Les Romains, du temps de
Vespasien, ayant pratiqué un passage dans le roc, le fermèrent d’une porte; ils
bouchèrent de l’autre côté l’entrée du vallon, et n’y laissèrent qu’une étroite
ouverture, en sorte que ce lieu était devenu une forteresse imprenable. Elle se
nommait Petra pertusa, c’est-à-dire Roche
percée, aujourd’hui Petra lata; et le
pertuis ouvert dans le roc porte maintenant le nom de Furlo.
Le vallon était rempli de cabanes où logeaient grand nombre de Goths. Ildiger et Martin, après avoir inutilement tenté de forcer
le passage, firent grimper sur le rocher une partie de leurs gens, qui,
détachant de gros quartiers de pierres, écrasaient les habitations et les habitants.
Les Goths, effrayés, leur tendaient les bras, et demandaient miséricorde. On
leur fit quartier, à condition qu’ils passeraient au service de l’empereur. Les
deux généraux enrôlèrent dans leurs troupes ceux qui étaient en état de porter
les armes, et laissèrent les autres avec quelques soldats pour la garde de ce
poste. De là ils allèrent retirer d’Ancône la plus grande partie de la
garnison, et arrivèrent trois jours après a Rimini. Jean refusa d’obéir; quatre
cents cavaliers demeurèrent avec lui dans la ville, les autres suivirent les
deux généraux , qui, ayant laissé à Rimini les soldats d’Ancône, retournèrent
joindre Bélisaire.
A peine s’étaient-ils éloignés, que Vitigès, après avoir passé l’Apennin,
parut devant Rimini. Lés Goths commencèrent par construire une tour de bois,
portée sur quatre roues, et plus haute que les murs de la ville. Pour la faire
avancer, ils ne se servirent point de bœufs, comme ils avoient fait devant Rome
avec si peu dé succès; des soldats la poussaient au-dedans à force de bras vers
la partie la plus basse de la muraille. Au haut de la tour était un pont-levis
fort large, qui devait s’abattre lorsqu’elle serait à la portée des créneaux.
Elle fut poussée dès le premier jour jusqu’au bord du fossé, qui n’était ni
large ni profond. A l’entrée de la nuit, les Goths laissèrent seulement
quelques soldats pour la garder, et se retirèrent dans leur camp. Les habitants
tremblaient à la vue de cette redoutable machine, et s’attendaient à voir le
lendemain les ennemis au milieu de la ville. Mais le commandant ne s’effrayait
pas. Lorsque la nuit fut avancée, il sortit à la tête des Isaures avec des
bêches et d’autres instruments propres à remuer la terre, et leur ordonna de
creuser et d’élargir le fossé sans bruit, en rejetant la terre sur le bord du
côté des murs. Ils travaillèrent avec tant d’ardeur, qu’en peu de temps la
partie du mur par où l’ennemi devait l’attaquer se trouva bordée d’un fossé
large et profond. Les gardes, qui dormaient, s’étant enfin réveillés, donnèrent
l’alarme au camp; et comme les Goths accouraient pour troubler ce travail, Jean
rentra dans la place. Le jour étant venu, Vitigès, outré de colère, fit mourir
les gardes, et, s’obstinant à suivre son entreprise, il commanda de combler le
fossé, et d’y faire passer la tour. Ses ordres furent exécutés, malgré les
traits qui pleuvaient du haut des murs. Mais les fascines qu’on avait jetées à
la hâte, s’étant affaissées sous la pesanteur de la tour, elle y demeura
enfoncée, sans pouvoir avancer. D’ailleurs la terre amoncelée sur l’autre bord formait
un mur impraticable à cette machine; en sorte qu’on ne songea plus qu’à la
retirer du fossé, de crainte que les ennemis n’y missent le feu la nuit
suivante. C’était en effet le dessein du commandant, qui, pour obliger les
Goths d’abandonner leur tour, fit sur les travailleurs une furieuse sortie. On
combattit avec acharnement le reste du jour; enfin, sur le soir, les Goths
vinrent à bout d’entraîner la tour dans leur camp; mais il en coûta la vie à
leurs meilleurs soldats; ce qui les fit renoncer aux attaques, et changer le
siège en blocus. Ils se flattaient de prendre bientôt par famine une place mal
pourvue de vivres.
Pendant que Vitigès campait devant Rimini, Vraïas, son neveu, assiégeait
Milan. Cette ville, alors la plus considérable de l’Occident après Rome, par
l’étendue de son enceinte, par son opulence, et par le nombre de ses habitants,
était du domaine des Goths depuis la conquête de Théodoric. Datius, son évêque,
supportant impatiemment le joug d’une nation arienne, vint trouver Bélisaire
pendant le siège de Rome; il ne lui demandait qu’un petit nombre de soldats,
avec lesquels il promettait de chasser les Goths de Milan et de toute la
Ligurie. Bélisaire différa pour lors de le satisfaire; mais aussitôt que
Vitigès eut levé le siège, il fit partir avec Datius un corps de mille hommes,
commandés par Mundilas. Fidélis, préfet du prétoire, né à Milan, voulut être de
cette expédition, à laquelle il pouvait beaucoup aider par le crédit qu’il avait
en Ligurie. Cette petite armée s’étant embarquée à Porto, vint aborder à Gênes.
Les chaloupes, qu’on transporta sur des chariots, servirent au passage du Pô.
Sur la route de Pavie, les Romains eurent à combattre un grand corps de troupes
qui venait à leur rencontre. Pavie étant une place très-forte, servait de
magasin aux Goths établis dans ces contrées; ils y avoient déposé toutes leurs
richesses sous la garde d’une nombreuse garnison. Après un combat sanglant, les
Goths prirent la fuite, et peu s’en fallut que les vainqueurs n’entrassent dans
la ville avec les fuyards, qui eurent à peine le temps d’en fermer les portes.
Fidélis, s’étant arrêté dans une église près des murs de la ville pour y faire
sa prière tandis que les Romains se retiraient, se trouva seul assez loin de sa
troupe; son cheval s’étant abattu, quelques Goths coururent à lui et le
tuèrent. Comme il était généralement estimé, sa mort causa une sensible douleur
a Mundilas et à tous les soldats. On continua la route vers Milan, dont les
Romains s’emparèrent sans coup férir, ainsi que de toute la Ligurie. A cette
nouvelle, Vitigès fit partir Vraïas, fils de sa sœur, avec un corps de troupes
considérable. Théodebert, roi de la France austrasienne, fut prié d’envoyer du
secours. Ce prince, qui avait traité tout à la fois avec l’empereur et avec
Vitigès, crut sauver les apparences en faisant marcher, non des troupes françaises,
mais dix mille Bourguignons, qui venaient, disaient-ils, en Italie de leur
propre mouvement, et sans ordre de Théodebert, quoiqu’ils fussent ses sujets
depuis l’extinction du royaume de Bourgogne. Avec ce renfort Vraïas marcha vers
Milan, et y mit le siège. Les Romains, qui ne comptaient pas d’être sitôt
assiégés, n’avoient encore fait aucune provision de vivres. Il ne restait à
Mundilas que trois cents soldats, parce que ce général, ayant pris Bergame, Como, Novare, et plusieurs autres places, y avait distribué
des garnisons. Ainsi les habitants de Milan furent obligés de se défendre
eux-mêmes.
Bélisaire, après avoir passé deux mois à Rome pour réparer les désordres
que le siège avait causés, partit enfin pour secourir Jean, bloqué dans Rimini,
quoiqu’il n’eût pas sujet d’être content de cet officier si peu obéissant à ses
ordres. Chemin faisant, il reçut à composition Clusium et Tuderte, d’où il fit sortir les Goths, qu’il
envoya, les uns à Naples, les autres en Sicile. Il les remplaça par des
garnisons romaines. De son côté, Vitigès voulut reprendre Ancône, place
importante, parce qu’elle servait de port à la ville d’Auxime, dont elle n’est
éloignée que de quatre lieues. Il fit partir Vacis avec des troupes, et lui
ordonna d’y joindre en passant la garnison d’Auxime. La prise du château
d’Ancône, bâti sur un promontoire, entraînait celle de la ville, qui n’était
point entourée de murailles. Conon l’Isaurien, commandant de cette place, au
lieu de s’y tenir renfermé, eut l’imprudence de sortir avec sa garnison
au-devant de l’ennemi jusqu’à la distance de cinq stades. Il rangea sa petite
troupe en rond autour de la montagne sur une seule ligne, comme s’il eût formé
une enceinte de chasseurs. Dès que les Goths parurent, ses soldats, effrayés du
nombre, tournent le dos, et fuient vers le château. Les Goths les poursuivent
vivement, et les habitants, craignant de donner entrée aux ennemis, ferment les
portes et laissent leurs gens à la merci des barbares. On sauva Conon, en le
tirant sur la muraille avec des cordes. Les Goths auraient pris le château par
escalade, sans la valeur de deux gardes, l’un de Bélisaire, l’autre de
Valérien, qui, se trouvant alors par hasard dans la place, repoussèrent tous
les efforts des assaillants, et, couverts de blessures, firent quitter prise
aux ennemis avant que de mourir eux-mêmes.
Tandis que Bélisaire continuait sa marche vers Rimini, il apprit que Narsès
venait d’arriver dans le Picénum. Ce célèbre eunuque, honoré de la confiance de
l’empereur, ne s’était encore fait connaître que dans le palais, où l’essor de
son génie l’avait élevé aux premiers emplois. Chargé de conduire un secours en
Italie, il amenait cinq mille hommes sous plusieurs commandants, entre lesquels
était Justin, maître de la milice d’Illyrie. A cette petite armée s’étaient
joints deux mille Hérules, sous la conduite de trais chefs, les plus vaillants
de leur nation, Visande, Alueth et Phanothée. L’autre Narsès, frère d’Aratius, qui, peu de temps auparavant, avait amené aussi
quelques troupes à Bélisaire, alla joindre la nouvelle armée. C’était un brave
guerrier, compatriote de l’eunuque, et lié avec lui d’une étroite amitié.
Les deux armées se joignirent près de Firmum,
place maritime, à une journée d’Auxime. On tint conseil en ce lieu pour
délibérer sur le parti qu’il fallait prendre. On craignait pour Rimini. D’une
autre part, laisser derrière soi la ville d’Auxime, c’était s’engager entre
l’armée de Vitigès et une garnison nombreuse, qui pourrait les harceler sans
cesse, leur couper les vivres, et les tenir eux-mêmes comme assiégés.
D’ailleurs la plupart des officiers de Bélisaire, indignés contre Jean, qui,
par sa témérité indocile, s’était lui-même précipité dans ce danger, était
d’avis de l’abandonner à sa mauvaise fortune. Mais Narsès, ami de Jean, et qui
peut-être s’entendait dès-lors avec lui pour troubler les opérations de
Bélisaire, dont apparemment il ambitionnait la place, représenta «qu’on serait
toujours à temps d’assiéger Auxime quand on aurait délivré Rimini; que, si on laissait
prendre cette dernière place, ce serait une perte irréparable, qui influerait
sur toute la suite de la guerre, en rendant le courage aux Goths et le faisant
perdre aux Romains; que Jean était assez puni par l’extrémité où il se voyait
réduit; et que, si son imprudence méritait un autre châtiment, ce ne dévot pas
être aux dépens de leur honneur et de celui de l’empire». En ce moment on reçut
une lettre de Jean, qui mandait à Bélisaire, que, manquant de pain depuis
plusieurs jours, il ne pouvait plus résister aux habitants, résolus de se
rendre; qu’il tiendrait encore une semaine; mais que, ce terme expiré, il serait
contraint de céder à la nécessité, assez pressante pour lui servir d’excuse. A
la lecture de cette lettre, Bélisaire, naturellement généreux, ne sentit plus
que de la compassion pour cet officier. Il laissa mille hommes sous le
commandement d’Aratius, dans un poste avantageux
entre Auxime et Rimini. Il fit embarquer ses meilleures troupes, sous la
conduite d’Ildiger, avec ordre de n’aborder à Rimini
que quand l’armée de terre serait à portée de la ville. Un détachement commandé
par Martin côtoyait le rivage et suivait la flotte; il avait ordre d’allumer
grand nombre de feux lorsqu’il serait à la vue des ennemis, pour leur faire
croire que c’était toute l’armée. Pour lui, accompagné de Narsès, et suivi du
reste des troupes, il prit une route plus éloignée de la nier, et passa par Urbisaglia, nommée alors Salvia, près de Pollence, dans le Picénum. Cette ville, tellement détruite
par Alaric, qu’il n’en restait plus qu’une porte, offrit aux Romains, au milieu
de ses débris, un spectacle plus intéressant pour l’humanité que les plus
somptueux édifices.
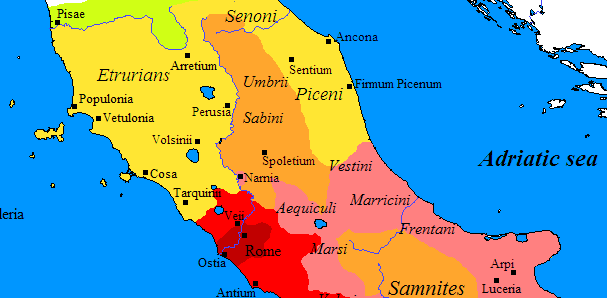 |
Depuis la destruction de Salvia, les habitants rassemblés vivaient dans des
cabanes, sur les ruines de leur patrie. Au passage de Jean dans le Picénum, ils
prirent l’épouvante; et une femme nouvellement accouchée posa son enfant à
terre, s’enfuit, et ne reparut plus. Aux cris de l’enfant, une chèvre accourut
et fit l’office de mère, l’allaitant et le défendant contre les animaux qui en approchaient.
Trois mois après, lorsque Bélisaire entra dans le Picénum, les habitants, ayant
appris que ce général, loin de faire aucun mal à ceux qui étaient de race
romaine, se déclarait leur protecteur, revinrent à leurs demeures, et furent
étonnés de retrouver cet enfant plein de vie. Les femmes s’empressaient à
l’envi de lui présenter leur sein; mais il refusait de le prendre; la chèvre,
tournant sans cesse autour de lui, écartait ces nourrices importunes, et semblait
les quereller par ses bêlements. On cessa donc de le fatiguer, et l’on se
reposa sur la chèvre du soin de son nourrisson. Procope raconte que, lorsqu’il était
sur le lieu, à la suite de Bélisaire, on lui donna ce spectacle; et que, comme
on faisait crier l’enfant, la chèvre, qui ne s’en éloignait que d’un jet de
pierre, accourut en bêlant, et le couvrit de son corps. Cette aventure fit
donner à cet enfant le nom d’Egisthe, parce qu’il fut nourri comme l’avait
été le fils de Thyeste.
Bélisaire, dont l’armée était fort inférieure en nombre à celle de Vitigès,
la conduisait par les sommets de l’Apennin, et ne doutait pas que les Goths,
découragés de tant de mauvais succès, ne prissent le parti de la retraite dès
qu’ils verraient les Romains prêts à fondre sur eux par plusieurs endroits à la
fois. Il ne se trompait pas dans sa conjecture. A une journée de Rimini, il rencontra
un détachement ennemi qui fut taillé en pièces sans avoir le temps de se reconnaître.
Ceux qui purent échapper se sauvèrent tout tremblants sur les rochers voisins,
d’où ayant considéré l’armée romaine qui s’allongeait dans les gorges étroites
de ces montagnes, et que l’épouvante grossissait encore à leurs yeux, ils
allèrent porter l’alarme dans le camp de Vitigès, en montrant leurs blessures,
et publiant que Bélisaire allait arriver en personne à la tête d’une armée
innombrable. Les Goths se rangèrent en bataille au nord de Rimini, attendant
l’ennemi de ce côté-là, et regardant sans cesse les montagnes d’où ils croyaient
à tout moment le voir descendre. A la fin du jour, ils rentrèrent dans leur
camp pour prendre du repos; mais ils passèrent la nuit dans l’inquiétude,
voyant à trois lieues, du côté de l’orient, un grand nombre de feux allumés; c’était
le corps d’armée de Martin, qui les trompait par cette apparence. Ils s’attendaient
à se voir enveloppés de toutes parts lorsque le jour serait venu. Dès qu’il
parut, un nouveau spectacle acheva de les épouvanter. La flotte cinglait à
pleines voiles vers le rivage. A cette vue, rien ne put les retenir. A peine se
donnent-ils le temps de lever leurs tentes; ce n’étaient que cris et que
tumulte. Ils abandonnent une partie de leur bagage; ils fuient en confusion,
sans écouter les ordres, sans songer à autre chose qu’à sortir du camp les
premiers et à gagner au plus tôt Ravenne. Si les assiégés avoient eu assez de
courage et de force pour les charger en ce moment, c’en était fait de l’armée
des Goths, et la guerre était finie. Ildiger, qui faisait
dans le même temps débarquer ses troupes, entra sans obstacle dans le camp
ennemi, fit prisonniers les malades qui n’avoient pu fuir, et s’empara des
bagages qu’on avait abandonnés.
Quelques heures après, Bélisaire arriva avec toute l’armée; et, voyant
devant lui les soldats de la garnison pâles et exténuées de disette, ainsi que
leur commandant, il dit à Jean, pour lui faire sentir sa faute avec douceur: «Vous
avez grande obligation à la diligence d’Ildiger, qui
a ponctuellement exécuté les ordres de son général». Jean répondit fièrement : «Je
ne dois rien à Ildiger, et tout à Narsès». Un réponse
si brusque et si peu respectueuse fit connaître à Bélisaire qu’il avait dans
Narsès un rival plus propre à traverser ses desseins qu’à les seconder. En
effet, Narsès était sans contredit un grand et puissant génie; mais il avait
fait fortune à la cour, et il est difficile de croire que, pour l’élever de la
condition d’esclave aux premières dignités du palais, ses heureux talents ne se
fussent pas aidés d’un peu d’intrigue et de manège. Ambitieux sans doute, il ne
pouvait être exempt de jalousie; et il ne voyait plus devant lui que Bélisaire.
Tous deux avoient de grandes vertus; mais celles de Narsès étaient moins
franches et plus concertées; il en aimait le brillant; au lieu que Bélisaire
n’envisageant que son devoir, laissait venir la gloire d’elle-même sans jeter
les yeux sur elle. Ce qui prouve que telles étaient les dispositions de Narsès,
c’est que ces artisans de discorde, qui n’attaquent guère les âmes
invulnérables, osèrent animer sa jalousie, et qu’il prêta l’oreille à leurs
dangereuses insinuations. Ils lui répétaient sans cesse qu’il ne convenait pas
au confident de l’empereur de marcher à la suite de Bélisaire et de ne se
mouvoir que par ses ordres: qu’il ne devait pas s’attendre que cet impérieux
général lui donnât jamais part dans le commandement; que, s’il osait lever la
tête et déclarer qu’il voulait commander en chef une partie des troupes, il entraînerait
après lui le plus grand nombre des soldats et les meilleurs officiers: que ses
gardes, les Hérules, les troupes de Justin, de Jean, d’Aratius et de Narsès, son compatriote, formaient un corps de dix mille hommes aussi
braves qu’inviolablement attachés a sa personne : que ces vaillants guerriers souhaitaient
avec ardeur que Narsès partageât avec Bélisaire l’honneur de la conquête: que
sans doute, en s’éloignant des emplois éclatons qu’il occupait à la cour, il
n’avait pas prétendu venir se perdre dans l’ombre de Bélisaire. Ils ajoutaient
que le général séparé de lui ne serait plus en état de rien entreprendre faute
de troupes ; ce qu’ils prétendaient prouver par l’énumération des garnisons
qu’il était obligé d’entretenir tant en Sicile que dans toute la longueur de
l’Italie.
Narsès, échauffé par ces discours, se trouvait comme à l’étroit dans un
rang subalterne; il affectait l’égalité. Toutes les entreprises que proposait
Bélisaire, il ne manquait jamais de prétextes pour les faire rejeter.
Bélisaire, ayant pénétré ses intentions, convoqua tous les officiers, et leur
parla en ces termes : «Braves capitaines, il me semble que vous n’avez pas de
l’état présent de la guerre l’idée que j’en ai moi-même. Je vois que vous
méprisez l’ennemi comme s’il n’était plus à craindre; et moi je suis persuadé
qu’il ne faut que cette confiance pour nous mettre en grand péril. Ce n’est ni
par lâcheté ni par faiblesse que les barbares ont fui devant nous, c’est notre
conduite qui leur en a imposé; ils ont été trompés, mais ils ne sont pas
vaincus. Prenez-y garde; la méprise sur ce point pourrait causer notre perte.
Souvent celui qui se croit vainqueur, enivré de présomption, s’endort et se précipite;
au lieu qu’un échec imprévu réveille toutes les forces de l’âme, et lui rend
cette activité qui relève les vaincus. Songez que Vitigès est à Ravenne avec
une armée encore très nombreuse; que Vraïas, maître de toute la Ligurie,
assiège Mila ; qu’il y a dans Auxime une forte garnison, et que, depuis Rimini
jusqu’à Rome, tout est plein d’ennemis qui pourraient former plusieurs armées
aussi fortes que la nôtre. Loin d’être paisibles possesseurs de l’Italie, nous
sommes enveloppés de toutes parts. Nous apprenons même que les Francs se sont
joints aux Goths dans la Ligurie; alliance formidable qui, redoublant le péril,
doit redoubler nos précautions. Je pense donc qu’il faut envoyer au secours de
Milan une partie de nos troupes, tandis que le reste attaquera Auxime. Si Dieu
favorise nos armes, ainsi que je l’espère, le succès nous guidera à d’autres
entreprises». Cette proposition de Bélisaire fut, à l’ordinaire, combattue par
Narsès: c’était, à son avis, mal employer les forces romaines que de les
occuper tout entières devant deux villes. Prenez avec vous une partie des troupes (dit-il à Bélisaire), et
conduisez-les où vous jugerez à propos. Nous irons avec le reste attaquer
l’Emilie; c’est le centre de l’empire dès Goths. En faisant trembler Ravenne,
nous vous mettrons en état de tout entreprendre, sans craindre que les ennemis
puissent être secourus. Si nous nous arrêtions avec vous devant Auxime, je craindrais
que les barbares, sortant de Ravenne , ne vinssent nous assiéger nous-mêmes, et
ne fissent périr notre armée en lui coupant le passage des vivres». Bélisaire
sentit les conséquences de ce discours. Diviser les forces romaines, c’était
les anéantir en rompant le concert qui fait le succès d’une expédition. Pour
fermer la bouche à Narsès, il produisit une lettre de l’empereur qu’il avait
jusqu’alors tenue secrète. Elle était adressée aux commandants des troupes, et
conçue en ces termes : «En envoyant en Italie Narsès, intendant de nos
finances, nous ne lui donnons pas le pouvoir de commander notre armée; nous
entendons que Bélisaire en ait seul le commandement, et qu’il emploie nos
troupes selon qu’il le jugera convenable. Nous vous ordonnons à tous de suivre
ses ordres pour le bien de notre service». Narsès prit de ces dernières paroles
un prétexte pour éluder l’ordre contenu dans la lettre, prétendant que, dans la
conjoncture présente, Bélisaire agissait contre le bien du service, et que par
conséquent on n’était pas obligé de lui obéir.
 |
Le général, sans vouloir s’engager dans une contestation peu assortie a sa
dignité, et moins encore a son caractère, envoya Pérane assiéger Orviette avec un détachement. Il marcha
lui-même vers Urbin, place importante, à une journée de Rimini. Les Goths y tenaient
une forte garnison commandée par un officier de réputation, nommé Morrhas. Narsès, Jean et les autres capitaines de leur
faction suivirent Bélisaire: mais, lorsqu’on fut arrivé devant la ville, ils se
séparèrent de lui. Bélisaire avait posé son camp à l’orient de la place, ils
allèrent camper à l’occident. Urbin était bâti sur une colline circulaire, fort
élevée, qui, sans être escarpée, ne donnait pas un accès facile à cause de la
roideur de sa pente, excepté du côté du nord. Bélisaire, espérant que les
ennemis, après la fuite de Vitigès, n’attendraient pas un assaut, leur envoya
offrir une composition favorable. Mais les Goths, sans permettre aux députés
d’entrer dans la ville, rejetèrent la proposition, et leur ordonnèrent de se
retirer sur-le-champ. Ils comptaient sur le bon état de la place, avantageusement
située et bien, fournie de munitions. Bélisaire aussitôt donna ordre de
construire une galerie pour aller à la sape, et de la faire avancer vers la
muraille par l’endroit où le terrain était plus bas et plus commode pour les
approches. Les partisans de Narsès affectaient de rire de ces préparatifs. A
les entendre, Bélisaire entreprenait l’impossible; Jean s’était déjà présenté
devant cette place, lorsqu' elle n’avait encore qu’une faible garnison, et l’avait
jugée imprenable. Ils disaient vrai en ce point; mais Jean, quelque idée qu’il
eût de son mérite, n’était pas Bélisaire. Ils ajoutaient qu’il ne convenait pas
à Narsès de perdre du temps à un siège inutile; qu’il devait bien plutôt
employer ses troupes à la conquête de l’Emilie. Narsès écouta ces conseils, et,
ayant décampé pendant la nuit malgré les instances de Bélisaire, il regagna
Rimini en diligence, suivi de ses partisans et de leurs soldats.
Au point du jour, Morrhas et la garnison, voyant
que la moitié de l’armée romaine s’était retirée, insultaient le reste par de
piquantes railleries. Cependant Bélisaire était résolu de continuer le siège.
Le hasard le servit mieux qu’il n’espérait. Il n’y avait dans Urbin qu’une
fontaine qui fournissait de l’eau à toute la ville; elle tarit en trois jours,
en sorte que les habitants se déterminèrent à se rendre. Le général romain,
n’étant pas instruit de leur résolution, s’avançait pour donner un assaut,
lorsqu’il s’aperçut que les assiégés, au lieu de se préparer à la défense, lui tendaient
les bras et demandaient à capituler. Il y consentit avec joie. Les Goths eurent
la vie sauve, et s’engagèrent à servir dans les troupes romaines. Narsès
n’apprit pas sans chagrin un succès dont il avait refusé de partager la gloire.
Pour en acquérir de son côté, il envoya Jean attaquer Célène.
Celui-ci fut vivement repoussé dans un assaut où il perdit grand nombre de
soldats, et, entre autres officiers, Phanothée,
commandant des Hérules. Rebuté de ce mauvais succès, il marcha vers Imola,
qu’il surprit; et les barbares abandonnant les places sans oser en venir aux
mains, il se rendit maître d’une partie de l’Emilie.
 |
Après la prise d’Urbin, Bélisaire ne jugea pas à proproc,
d’assiéger Auxime; la saison était trop avancée, et la place parois soit en
état de se défendre longtemps. Il mit dans Firmum, en
quartier d’hiver, un gros détachement, pour arrêter les courses de la garnison
d’Auxime, et marcha vers Orviette. Pérane, qui assiégeait cette place, apprenant des
transfuges que les vivres y manquaient, espérait qu’elle ne tarderait pas à se
rendre, si le général se présentoir devant les portes. Bélisaire, après avoir
placé son camp dans le poste le plus avantageux, fit le tour de la place pour
considérer par quel endroit il devait l’attaquer. Elle était sur une colline
isolée, dont le pied était escarpé et impraticable; le haut se terminait en
plateforme. A un jet de pierre s’élevaient tout alentour des rochers de même
hauteur; entre les rochers et la colline coulait une rivière profonde, qui ne laissait
qu’un passage étroit, où les anciens Romains avait bâti une tour; en sorte
qu’il ne restait d’entrée que par une porte, où les Goths avoient posté une
forte garde. Quoique la ville n’eût ni murailles, ni autre fortification, sa
situation seule la défendait de tout, excepté de la famine. Tant que les Goths
eurent assez de vivres pour ne pas mourir de faim, ils ne parlèrent pas de se
rendre. Lors même que leurs provisions furent épuisées, ils se soutinrent
encore quelques jours, en mangeant les peaux et les cuirs détrempés dans l’eau.
Leur commandant Albilas, renommé pour sa valeur, les repaissait
de vaines espérances. Enfin ils ne se rendirent que lorsqu’il leur restait à
peine assez de force pour capituler.
Au fléau de la guerre qui désolait l’Italie se joignit cette année une horrible famine. Comme les terres n’avaient pu être ensemencées le blé manqua tout-à-fait dans la Ligurie, l’Emilie, la Toscane, le Picénum; et la Dalmatie fut bientôt épuisée. Les peuples de l’Emilie se retirèrent dans le Picénum, où ils espéraient trouver des subsistances, à cause du voisinage delà mer. Ils y trouvèrent la même disette, et mouraient de faim avec les habitants, dont ils augmentaient la misère. Procope dit qu’il périt cinquante mille hommes en cette seule province, ce qui paraît tout-à-fait incroyable. Dans le voisinage de l’Apennin, on fit du pain de farine de gland, qui causa des maladies, dont bien des gens moururent. On ne voyait que des corps décharnés, dont la peau livide était collée sur les os; des visages hâves, desséchés, teints d’un noir de fumée, et semblables à des torches éteintes; des yeux hagards, sortant de la tête, et tels que ceux des frénétiques. Les misérables qui trouvaient quelque aliment, s’en remplissant avec avidité, mouraient encore plus tôt qu’ils ne seraient morts de la faim. Il y en eut qui se dévorèrent les uns les autres. Datius, évêque de Milan, rapportait qu’une femme attachée au service de son église avait mangé son propre enfant.
 |
Près de Rimini, deux femmes étaient restées seules de
tout un village; et, donnant à loger aux passants, elles les égorgeaient
pendant leur sommeil, et s’en nourrissaient. Elles avoient déjà tué dix-sept
hommes. Le dix-huitième s’éveilla lorsqu’elles approchaient de son lit, et,
après avoir tiré de leur bouche l’aveu de ces horreurs, il les massacra. La
campagne était couverte de morts, dont les mains étaient encore attachées aux
herbes et aux racines qu’ils n’avoient pas eu la force d’arracher. Ces cadavres
demeuraient sans sépulture, rebutés même par les oiseaux de proie, la faim
ayant déjà consumé toutes les chairs. Cassiodore, encore préfet du prétoire,
fit pour le soulagement des peuples tout ce que lui permettait l’épuisement du
trésor public. Peu de temps après, prévoyant la chute du royaume des Goths, ce
grand personnage quitta la cour, à laquelle il aurait dû renoncer après la mort
d’Amalasonte, et se retira près de Squillace sa
patrie, dans le château de Viviers, où il fonda un monastère.
Le siège de Milan continuait avec vigueur. Bélisaire avait envoyé au
secours Martin et Vliaris, à la tête d’un grand corps de troupes. Ces deux
officiers, arrivés au bord du Pô, à une journée de la ville, s’y arrêtèrent
longtemps à chercher les moyens de passer le fleuve. Mundilas, qui commandait
dans Milan, leur députa un Romain nommé Paul, qui, ayant passé le Pô à la nage,
leur représenta l’extrémité où la ville était réduite, l’importance de la
place, et le déshonneur qu’ils s’attireraient s’ils la laissaient prendre par
les Goths. On renvoya Paul, avec promesse de le suivre incessamment. De retour
à Milan, il ranima les habitants et la garnison par l’espérance d’un prompt
secours. Cependant Martin ne se pressoir pas, et, après avoir perdu plusieurs
jours, il écrivit à Bélisaire que ses troupes, effrayées du grand nombre de
Goths et de Bourguignons rassemblés autour de Milan, refusaient de passer le
fleuve; que Jean et Justin étaient actuellement en Emilie avec des troupes
considérables; qu’il avait besoin de ce renfort pour balancer les forces de
l’ennemi. Aussitôt Bélisaire dépêcha ses ordres à Jean et à Justin: ils
répondirent qu’ils n’avoient d’ordres à recevoir que de Narsès. Bélisaire, qui
avait l’âme trop grande pour sacrifier au point d’honneur le bien des affaires,
écrivit à Narsès que toutes les troupes de l’empereur ne formaient qu’un corps;
que, si les membres n’agissaient de concert, le corps entier serait bientôt
détruit; que la conquête de l’Emilie, qui n’avait point de places fortes, n’était
pour le présent de nulle importance; mais que Milan était un des boulevards de
l’Italie; qu’il était lui-même trop éloigné pour y envoyer des troupes, qui,
après un long trajet, arriveraient fatiguées, avec des chevaux recrus,
harassés, et hors d’état de servir sur-le-champ; au lieu que Jean et Justin pouvaient
en peu de temps joindre Martin et Vliaris; que ces forces réunies dissiperaient
aisément les ennemis, et feraient ensuite sans obstacle la conquête de l’Emilie.
Narsès se rendit à ces raisons, et fit partir les deux capitaines. Jean, étant
allé rassembler des barques sur la côte de Ligurie pour s’en servir au passage
du Pô, tomba malade, et l’armée de secours demeura en-deçà du fleuve.
Pendant tous ces délais, les assiégés, pressés de la famine, en étaient
réduits à manger les chiens, les rats et les animaux les moins propres à la
nourriture des hommes. Les barbares envoyèrent proposer à Mundilas la vie sauve
pour lui et pour sa garnison, s’il voulait rendre la ville. Il répondit qu’il
était prêt à accepter la condition si l’on voulait y comprendre les habitants.
Sur le refus des Goths, il exhorta la garnison à faire une sortie, pour mourir
avec honneur, si la fortune ne secondait pas leurs efforts, plutôt que de
livrer tant de Romains à la fureur des barbares. Les soldats, révoltés d’une
proposition si désespérée, envoyèrent dire aux ennemis qu’ils acceptaient leurs
offres, et ouvrirent les portes. Les Goths leur tinrent parole; mais ils les
firent prisonniers avec Mundilas, et les conduisirent à Ravenne. Les habitants,
sans distinction d’âge ni de condition, furent passés au fil de l’épée. Procope
dit qu’il en périt trois cent mille; nombre peu vraisemblable, Milan n’étant
pas alors aussi étendu qu’il l’est aujourd’hui; quoiqu’on puisse supposer que
les habitants des campagnes s’y étaient retirés. On abandonna les femmes aux
Bourguignons pour récompense de leurs services. Réparât, préfet du prétoire,
frère du pape Vigile, fut haché en pièces, et ses membres furent jetés aux
chiens. Cerventin, qui se trouva dans Milan, se sauva
en Dalmatie, et alla porter à l’empereur cette triste nouvelle. L’évêque
Datius, dont le zèle pour la religion et pour l’empire avait attiré la ruine de
sa patrie, eut aussi le bonheur de se sauver et de se retirer à Constantinople.
La ville fut saccagée et presque détruite. Les Goths reçurent à composition les
autres villes où les Romains avoient garnison, et se rendirent maîtres de toute
la Ligurie. Martin et Vliaris, couverts de honte, retournèrent joindre
Bélisaire. Mundilas, avec trois cents hommes, avait tenu plus de six mois
contre une armée nombreuse, et la ville ne fut prise qu’au commencement de
l’année 539.
Bélisaire était en marche vers le Picénum, pour y ouvrir la campagne par le
siège d’Auxime, lorsqu’il; reçut la nouvelle de la prise de Milan. Pénétré
d’une vive douleur, il refusa de voir Vliaris, dont il était déjà mécontent, à
cause de la mort de Jean l’Arménien; et, depuis ce temps-là, jamais il ne
permit à cet officier de paraître en sa présence. L’empereur, instruit de ce
désastre, prit le parti de rappeler Narsès, dont la mésintelligence avec
Bélisaire pouvait ruiner les affaires en Italie. Lorsque les Hérules virent
partir Narsès, auquel ils étaient attachés, ils ne voulurent plus servir dans
l’armée romaine, et, malgré les instances et les promesses de Bélisaire, ils
prirent la route de Ligurie. Ils y rencontrèrent Vraïas, auquel ils vendirent
leur butin, et promirent de ne plus porter les armes contre les Goths; mais ils
ne gardèrent pas longtemps leur colère. S’étant retirés en Dalmatie, Vital, qui
y commandait, vint à bout de les apaiser. Ils laissèrent auprès de lui Visande, un de leurs chefs, avec ses troupes; le reste
retourna à Constantinople sous la conduite d’Alueth et de Philémuth, successeur de Phanothée.
Vitigès, enfermé dans Ravenne, s’attendit à s’y voir bientôt assiégé. Trop faible
pour résister seul aux forces romaines songeait à s’appuyer des autres
barbares. Il ne comptoir pas sur la bonne foi de Théodebert, qui avait en même
temps traité avec les Romains et les Goths. Il s’adressa donc aux Lombards,
dont le roi, nommé Vacon, régnait glorieusement après
avoir subjugué les Suèves. Vitigès lui envoya des ambassadeurs, et lui offrait
de grandes sommes d’argent pour l’engager à venir à son secours. Vacon était allié de l’empereur, et cette tentative fut
sans succès. Dans l’extrême embarras où se trouvait le roi des Goths, il assemblait
souvent son conseil pour délibérer sur les ressources auxquelles on pourrait
avoir recours. Après beaucoup d’avis proposés et combattus tour à tour, un des
seigneurs représenta que les Romains n’avoient tourné leurs armes vers l’Occident
que depuis qu’ils n’étaient plus occupés contre les Perses; que c’était à la
faveur de cette paix qu’ils avaient détruit les Vandales, terrassé les Maures,
attaqué les Goths; que, si l’on venait à bout de faire prendre les armes au roi
de Perse, cette diversion les obligeront de laisser en repos les autres peuples
pour porter toutes leurs forces contre ce redoutable ennemi. Cette proposition
fut applaudie. On fit partir deux prêtres liguriens, auxquels on promit
récompense, s’ils réussissaient dans cette négociation. Pour se donner plus de
considération auprès de Chosroès, l’un prit la qualité d’évêque, l’autre faisait
un rôle subalterne.
Dans la disposition où se trouvait alors Chosroès, il n’était pas difficile
de l’engager à une rupture ouverte, avec l’empire. Ce prince politique, jaloux
de la puissance que les Romains acquéraient en Occident par la conquête de
l’Afrique et de l’Italie, avait déjà excité Alamondare à faire naître quelque
occasion de guerre. Deux ans auparavant, ce Sarrasin, toujours prêt à tirer
l’épée, ne trouvant pas de quoi faire subsister ses troupes dans un pays aussi
sec et stérile que l’était l’Arabie, était entré dans l’Euphratésienne à la tête de quinze mille hommes. Mais Bazas, commandant des troupes romaines,
l’avait, par son adresse et par de riches présents, engagé à se retirer. A la
sollicitation de Chosroès, il chercha querelle à Aréthas, chef des tribus
sarrasines attachées aux Romains, sous prétexte qu’Aréthas usurpait la
souveraineté sur un grand pays. C’était une lisière qui s’étendit au midi de
Palmyre, depuis la Palestine jusqu’à l’Euphrate, dans l’espace de dix journées.
On la nommait Strata, parce qu’elle était traversée
par un chemin pavé de grandes pierres. La terre, brûlée des ardeurs du soleil,
n’y produisait ni fruits, ni moissons, mais seulement quelques herbages, où
l’on envoyait paître les troupeaux. Aréthas prétendait que ce terrain appartenait
à l’empire: il le prouvait, et par la dénomination latine, et par le témoignage
des anciens du pays. Alamondare soutenait que ceux qui y faisaient paître des
troupeaux avoient toujours reconnu son domaine en lui payant le droit de
pâturage. Il appuya ses raisons de la force des armes, et battit Aréthas.
L’empereur, prévoyant les suites que pouvait avoir ce différend, envoya, pour
le terminer, le patrice Stratège, son trésorier, aussi distingué par sa
prudence que par sa noblesse; et Summus, ancien
commandant des troupes de Palestine, frère de ce Julien qui avait été
ambassadeur en Ethiopie. Ces deux députés ne s’accordaient pas mieux que les
deux princes sarrasins. Stratège conseillait à l’empereur d’abandonner un
terrain stérile et de nulle valeur plutôt que de fournir un prétexte de guerre
à l’impatience de Chosroès. Summus, au contraire, écrivait
à la cour qu’on ne pouvait sans honte laisser envahir une possession si
légitime. Il profita même des conférences qu’il avait avec Alamondare pour le
tenter par de belles promesses, et lui remit à cet effet une lettre qu’il disait
être de Justinien. Le Sarrasin n’en fit pas d’autre usage que de l’envoyer à Chosroès.
Le roi de Perse en produisait encore, qu’il prétendait lui avoir été remises
par les Huns, que l’empereur sollicitait à faire une irruption dans la Perse.
De ces lettres, vraies ou supposées, Chosroès prenait avantage pour taxer
Justinien de perfidie.
Les députés de Vitigès, arrivés en Perse sans être découverts par les
gardes de la frontière, qui dans un temps de paix ne croyaient pas avoir besoin
de beaucoup de vigilance, furent présentés à Chosroès : «Grand roi ( lui
dirent-ils ), Vitigès nous envoie pour plaider devant vous votre propre cause.
C’est lui qui vous parle par notre bouche. Ne peut-on pas dire que vous
abandonnez vos états et toute la terre à l’ambition de Justinien? Cet
usurpateur artificieux, qui se joue des traités et des serments, étend ses
prétentions sur tous les royaumes du monde. Il n’a fait la paix avec vous que
pour acquérir des forces et vous préparer une nouvelle guerre. Il nous traitait
comme ses amis, tandis qu’il subjuguait les Vandales. Devenu plus puissant, il
a tourné ses armes contre nous; il les tournera contre vous, s’il vient à bout
de nous détruire. Rompez une paix qui vous est aussi préjudiciable qu’à
nous-mêmes. Voyez dans nos désastres l’image de ceux dont les Perses sont
menacés. Ne vous flattez pas que les Romains puissent jamais devenir vos amis.
Vous pouvez désarmer leurs bras, mais vous n’étoufferez jamais dans leur cœur
cette haine mortelle, aussi ancienne que leur empire: elle éclatera toutes les
fois qu’ils se croiront en état de vous en faire sentir les effets. Nous
occupons maintenant les armes romaines; ne laissez pas échapper l’occasion. Il
vaut mieux se mettre en sûreté en prévenant l’ennemi que de s’exposer à tout
perdre en attendant les attaques». Ces raisons étaient appuyées dans le cœur de
Chosroès par la jalousie qu’il avait conçue contre Justinien. Il résolut donc
de recommencer la guerre.
La révolte des Arméniens contre l’empire le confirma dans ce dessein. Voici
ce qui se passoir alors dans ce pays. L’empereur, voulant récompenser Syméonès des services qu’il avait rendus aux Romains dans
la guerre précédente contre les Perses, le mit en possession de quelques
villages d’Arménie. Les légitimes possesseurs, voyant dépouillés, tuèrent Syméonès, et s’enfuirent en Perse. Justinien donna ces
mêmes villages à Amazaspe, neveu du mort, et joignit
à cette faveur le gouvernement de l’Arménie. Quelque temps après, Acace, très méchant
homme, mais aimé de l’empereur, accusa le gouverneur de s’entendre avec les
Perses pour leur livrer Théodosiopolis, et quelques
autres villes. L’empereur lui ayant permis de prévenir cette trahison, il tua Amazaspe, et fut revêtu de sa charge. Il ne la posséda pas
longtemps; plusieurs Arméniens, furieux de ses cruautés et de ses rapines,
l’assassinèrent, et se sauvèrent dans la forteresse de Pharange.
Sittas, qui était à Constantinople depuis la paix faite avec les Perses,
fut envoyé en Arménie. Il usa d’abord de ménagement pour tâcher d’adoucir les
rebelles, et de faire revenir dans le pays ceux qui s’étaient retirés sur les
terres de Perse. Mais, comme l’empereur, séduit par les calomnies d’Adolius, fils d’Acace, lui faisait des reproches de son
inaction, il résolut de combattre. Pour diminuer le nombre des ennemis, il
essaya d’en attirer quelques-uns au parti des Romains. Les Apétiens,
nation nombreuse et puissante, se laissèrent gagner, et lui promirent de se
ranger de son côté, pourvu qu’il s’engageât par écrit à leur conserver leurs
terres et tout ce qu’ils possédaient. Sittas leur envoya cette promesse signée
de sa main, et marcha aux ennemis avec toutes ses troupes. Le courrier s’égara,
et un détachement de l’armée romaine, qui n’était pas instruit de cette
convention, rencontra un parti d’Apétiens, et les
tailla en pièces. Sittas lui-même, ayant surpris dans une caverne un grand
nombre de leurs femmes et de leurs enfants, les fit massacrer sans les connaître.
Ces hostilités irritèrent les Apétiens, qui se
joignirent aux autres peuples de l’Arménie. Comme le pays était coupé de
montagnes et de précipices, les deux armées étaient obligées de combattre par
pelotons en plusieurs endroits à la fois. Sittas, ayant aperçu au-delà d’un
vallon une troupe de cavaliers arméniens, courut à eux à la tête d’un petit
escadron, et passa le vallon. Voyant les ennemis prendre la fuite, il s’arrêta
pour se reposer. Un cavalier hérule qui revenait de
la poursuite, courant à toute bride, rompit maladroitement la lance de Sittas;
et comme ce général avait ôté son casque pour se rafraîchir, il fut reconnu par
les ennemis, qui, le voyant si peu accompagné , revinrent sur lui. Sittas, sans
autres armes que son épée, tourna bride pour passer le vallon; et tandis qu’il
le traversait, les Arméniens le poursuivant avec ardeur, il fut atteint par Artabane l’Arsacide, qui le perça d’un coup de lance. Ainsi
mourut, dans une rencontre obscure, ce grand capitaine, dont les exploits auraient
mérité une fin plus brillante. C’était l’homme le mieux fait de son temps,
rival de Bélisaire en fait de valeur et d’habileté.
Buzès fut envoyé pour lui succéder. Arrivé près du camp des rebelles, il
leur promit le pardon, et invita les principaux à une entrevue. La plupart
refusèrent, par défiance, de l’aller trouver. Mais Jean l’Arsacide, père d’Artabane, et depuis longtemps ami de Buzès, se rendit
auprès de lui avec son gendre Bassacès, et quelques
autres seigneurs. Ils s’arrêtèrent dans le lieu marqué pour la conférence du
lendemain. Pendant la nuit, Bassacès, s’étant aperçu
que l’armée romaine se disposait à les environner, en avertit son beau-père, le
pressant de se mettre en sûreté par une prompte fuite. Comme Jean, par un excès
de confiance en l’amitié de Buzès, persistait à demeurer, Bassacès se sauva avec les autres avant que les Romains les eussent enveloppés. Jean
étant resté seul, fut tué par ordre de Buzès.
Cette perfidie fit connaître aux Arméniens qu’ils n’avoient point de grâce
à espérer. N’étant pas en état de résister seuls aux forces de l’empire, ils
implorèrent le secours de Chosroès. Bassacès, chef de
l’ambassade, lui rappela l’ancienne alliance des rois d’Arménie et des rois de
Perse. Il lui représenta «que les Romains n’avaient exécuté aucune des
conditions dont ils étaient convenus avec le dernier Arsacès,
qui leur avait cédé le royaume d’Arménie; que Justinien, qui se disait ami de Chosroès,
était en effet l’ennemi de tous les rois et de toutes les nations; que les Zannes asservis, les Lazes subjugués, la ville de Bosphore
envahie sur les Huns, l’Afrique conquise, l’Italie sur le point de l’être, étaient
autant de preuves de son ambition démesurée; qu’il était allé chercher au bout
du monde les Ethiopiens et les Homérites pour les
armer contre les Perses; que dans ses injustes projets il embrassait tout
l’univers. Qu’attendez-vous, seigneur (ajoutoitil)?
Pourquoi laissez-vous périr tant de peuples pour être vous-même dévoré le
dernier? Vous réservez-vous pour éprouver le sort des Vandales et des Maures? N’a-t-il
pas tenté de corrompre Alamondare? N’a-t-il pas sollicité les Huns à fondre sur
vos états? Et vous seul, le plus grand des rois, vous observez scrupuleusement
une paix qui ne subsiste plus. N’est-ce pas l’avoir rompue que de faire
sourdement la guerre par de perfides intrigues? Ordonnez seulement à vos
troupes invincibles de marcher; elles ne trouveront point d’ennemis. Toutes les
forces romaines sont occupées en Occident. L’empereur avait deux généraux,
Sittas et Bélisaire; nous venons de vous défaire de Sittas; Bélisaire n’est
plus au service de Justinien; las d’obéir à un maître injuste et méprisable, il
travaille à se faire lui-même une souveraineté en Italie».
J’expliquerai dans la suite ce qui donnait occasion de parler ainsi de
Bélisaire. Chosroès entendit ce discours avec plaisir; il fit assembler les
seigneurs en qui il avait le plus de confiance, pour délibérer sur les
instances de Vitigès et des Arméniens, qui se trouvaient aussi conformes que
s’ils eussent agi de concert. La guerre fut résolue pour l’année suivante. Les
Romains n’avoient encore aucune connaissance de ces mouvements.
Dans ce même temps parut une comète qui s’étendait d’orient en occident.
Elle se montra dans le signe du sagittaire, et semblait suivre le soleil, qui était
alors dans le capricorne. Elle avait la forme d’une lance. On la vit plus de
quarante jours, et le peuple ne douta pas que ce ne fût une annonce de la
guerre, à laquelle on apprit alors que se préparait Chosroès. Des deux prêtres
liguriens députés par Vitigès, l’un était mort en Perse, l’autre, y résidant,
avait envoyé l’interprète de l’ambassade pour rendre compte au roi des Goths.
Cet interprète fut arrêté près de Constantinople, par Jean, qui commandait en
Mésopotamie, et lui révéla tout le secret de la négociation. Justinien, alarmé,
chercha les moyens de conjurer l’orage. Anastase, dont le zèle avait étouffé
quatre ans auparavant à Dara la révolte de Jean Cottistis,
était pour lors à Constantinople. Comme il avait des liaisons en Perse,
Justinien le chargea d’une lettre pour Chosroès. Il représentait à ce prince
les conséquences d’une rupture; il lui mettait devant les yeux ses serments, et
la vengeance divine qui ne se laissait pas désarmer par des prétextes frivoles,
propres tout au plus à tromper les hommes. Chosroès ne répondit point à cette
lettre, et ne permit pas même à l’envoyé de sortir de Perse.
L’empereur, croyant avoir besoin de toutes ses forces contre un ennemi si
redoutable, songeait à terminer la guerre en Occident. Il renvoya les députés
de Vitigès, qu’il retenait depuis deux ans à Constantinople, et promit de
députer lui-même à Ravenne pour traiter de la paix. Bélisaire arrêta les
envoyés des Goths à leur retour en Italie, et ne les relâcha qu’après avoir
obligé Vitigès à mettre en liberté Pierre et Anastase, que Théodat avait
retenus prisonniers. Ces deux négociateurs, étant revenus à Constantinople,
furent dédommagés par l’empereur des mauvais trainements qu’ils avoient essuyés
dans une captivité de trois ans. Pierre fut revêtu de la charge de maître des
offices, et Anastase nommé préfet du prétoire d’Italie.
Pendant le cours de ces diverses négociations Bélisaire se hâtait d’achever
la conquête de l’Italie. Son dessein était d’attaquer Ravenne: mais, pour
assurer ses derrières, il fallait auparavant se rendre maître de Fésules et d’Auxime. Il envoya Cyprien et Justin faire le
siège de Fésules; et, pour empêcher Vraïas, qui était
dans Milan, de venir au secours de la place, il fit marcher vers le Pô Martin,
Jean le Sanguinaire, et un autre Jean surnommé Phagas,
c’est-à-dire, le mangeur. Ceux- ci avoient ordre de suivre Vraïas par derrière,
s’ils n’étaient pas assez forts pour lui fermer le passage. Ils s’emparèrent de Tortone, qui n’avait aucune fortification, et y
logèrent leurs troupes. Bélisaire, à la tête de douze mille hommes, alla mettre
le siège devant Auxime. Celte ville était située sur une hauteur de difficile
accès, à quatre lieues de la mer, et à trois journées et demie de Ravenne.
Vitigès, persuadé que les Romains ne feraient aucune entreprise sur Ravenne
qu’ils ne se fussent auparavant rendus maîtres d’Auxime, avait mis en garnison
dans cette ville l’élite de ses troupes. Le général romain, arrivé au pied de
la colline, donna ordre à ses soldats d’y asseoir leur camp. Pendant qu’ils dressaient
leurs tentes, les Goths, les voyant dispersés en divers pelotons, assez écartés
les uns des autres pour ne pouvoir aisément s’entresecourir,
firent sur le soir une sortie du côté de l’orient, où Bélisaire, accompagné
seulement des troupes de sa garde, travaillait à s’établir. On prit aussitôt
les armes, et on repoussa l’ennemi jusqu’au milieu de la colline. Les Goths
firent ferme en cet endroit; et comme ils tiraient sur les Romains avec
avantage, ils en tuèrent un grand nombre. La nuit sépara les combattants. Un
parti de Goths, sorti la veille pour aller chercher des vivres dans les
campagnes d’alentour, n’étant pas instruit de l’arrivée des Romains, revint
pendant cette 'nuit. A la vue des feux du camp ennemi, quelques-uns eurent
assez de hardiesse pour traverser la circonvallation qui n’était pas encore
achevée, et parvinrent heureusement dans la ville. D’autres, plus timides,
allèrent se cacher dans les bois, où ils furent découverts le lendemain et
taillés en pièces.
La force des remparts et la difficulté des approches firent perdre à
Bélisaire l’espérance de prendre la ville par assaut. Il se détermina donc à la
réduire par famine. Une prairie, voisine des murs, devenait tous les jours un
champ de bataille. Dès qu’un parti ennemi y arrivait pour faucher l’herbe, un
corps plus nombreux de Romains accourait pour le combattre , et taillait en
pièces les fourrageurs. Les Goths, toujours battus, s’avisèrent d’un artifice.
Ils détachèrent de leurs chariots les roues avec les essieux; et, lorsqu’ils
virent les Romains monter sur la colline, ils les firent rouler sur eux avec
toute la rapidité que leur donnait la roideur de la pente. Mais les Romains en
évitèrent la rencontre, et les roues arrivèrent dans la plaine sans avoir
produit d’autre effet que la risée. Les barbares eurent recours à un moyen plus
simple et plus efficace; c’était de cacher dans des chemins creux de gros détachements
de leurs meilleurs soldats, et de ne faire paraître dans la prairie qu’un petit
nombre de faucheurs. Dès qu’on était aux prises, les Goths, sortant de
l’embuscade, tombaient sur les Romains, tutoient les uns et mettaient les
autres en fuite. En vain les soldats du camp, voyant accourir les Goths, avertissaient
leurs camarades par de grands cris; l’éloignement et le bruit des armes empêchaient
de les entendre. L’ancienne discipline romaine était alors tellement altérée
par la paresse et par l’ignorance, que les trompettes avaient perdu cette
variété d’airs militaires qui distinguaient les divers commandements. Elles ne savaient
plus que sonner la charge: c’était par des cris qu’on donnait le signal de la
retraite; et, dans le tumulte d’une bataille, souvent ces cris n’étaient pas
entendus, ce qui causait une étrange confusion, et quelquefois de grandes
pertes. Procope conseilla à Bélisaire d’employer la trompette de cavalerie pour
la charge, et celle d’infanterie pour la retraite. Ces deux sons ne pouvaient
être confondus, la trompette de cavalerie étant d’un bois mince couvert de
cuir, au lieu que l’autre était d’airain, et rendait un son plus éclatant. Bélisaire
suivit ce conseil, et instruisit ses troupes de ce changement, qui sauva dans
la suite beaucoup de soldats, en les faisant retirer à propos.
Les vivres manquaient dans Auxime, et les Goths voulaient presser Vitigès
de les secourir. Mais il fallait traverser les gardes des Romains, et il ne se trouvait
personne qui osât en courir le risque. Voici le moyen qu’ils imaginèrent pour
faciliter le passage. Ayant choisi une nuit fort obscure, ils poussèrent de
grands cris d’un côté de la muraille, comme pour un événement imprévu. Les
Romains, étonnés, se figurèrent que Vitigès arrivait; et pour ne rien hasarder
dans les ténèbres, ils se tinrent dans leur camp, et portèrent leurs
principales forces du côté que partaient les cris. Les Goths firent sortir par
la porte opposée les courriers qu’ils envoyaient à Ravenne, où ils arrivèrent
au bout de trois jours. Vitigès leur promit un prompt secours; mais cette
promesse, ne fut suivie d’aucun effet. Il craignait à la fois d’être poursuivi
par Martin et par Jean, qui lui couperaient la communication de Ravenne;
d’avoir à combattre Bélisaire, et de manquer de subsistance dans le Picénum, où
il ne pourrait trouver de vivres, le pays étant ravagé; ni en faire venir
d’ailleurs, les Romains étant maîtres de la mer et du château d’Ancône. Ses
courriers, chargés de vaines espérances, furent assez heureux pour rentrer dans
Auxime, sans être aperçus des ennemis. Bélisaire, averti par ses déserteurs,
redoubla de vigilance pour ôter aux assiégés toute correspondance avec Vitigès.
Cependant Cyprien et Justin avoient formé le siège de Fésules;
mais la difficulté de l’accès rendait l’attaque impraticable. Les Goths faisaient
de fréquentes sorties, aimant mieux courir le hasard des combats que d’attendre
la famine. Les succès furent d’abord balancés. Enfin les Romains prirent la
supériorité, et tinrent l’ennemi renfermé dans la place. Les assiégés firent
savoir à Vitigès qu’ils étaient réduits à une extrême disette, et qu’ils ne pouvaient
tenir longtemps. Aussitôt Vitigès envoya ordre à Vraïas de passer le Pô,
l’assurant qu’il allait lui-même partir avec toutes ses troupes pour marcher
ensemble au secours de Fésules. Vraïas passa le
fleuve, et vint camper à trois lieues du camp de Martin; mais ni les uns ni les
autres ne se pressaient de combattre. Les Romains croyaient assez faire en
arrêtant Vraïas; et celui-ci pensait que, s’il était battu, les affaires des
Goths étaient ruinées sans ressource, parce qu’il ne serait plus en état de se
joindre à Vitigès.
Les deux armées se tenaient mutuellement en échec, et seraient peut-être longtemps
restées dans cette position, s’il ne fût survenu un troisième ennemi qu’ils n’attendaient
pas. Théodebert, allié des deux partis, mais également infidèle à tous les
deux, voyant les Goths affaiblis, forma le dessein de s’emparer lui-même de
l’Italie. Ce prince, le plus puissant des rois français, outre la France
septentrionale, possédait encore la Thuringe, une partie de la Saxe, et la
Souabe entière, habitée alors par les Allemands. Il passa les Alpes à la tête
de cent mille hommes. Il avait peu de cavalerie, et ses fantassins n’avoient
pour arme qu’une épée, un bouclier et une hache d’un fer très épais et
tranchant des deux côtés, avec un manche de bois fort court. Cette hache se nommait
francisque. Leur manière de combattre était d’approcher les ennemis, de lancer
leur francisque pour mettre en pièces les boucliers, et de charger ensuite à
grands coups d’épée. Les Goths, apprenant la marche de Théodebert, leur allié,
ne doutèrent pas qu’il ne vînt à leur secours : ils se promettaient
d’exterminer bientôt tout ce qu’il y avait de Romains en Italie. Le monarque
français n’eut garde de les détromper d’abord: il lui fallait passer le Pô; et
la garnison de Pavie pouvait lui fermer le passage. Mais, dès que les François
furent sur le pont de Pavie, ils se déclarèrent en massacrant et jetant dans le
fleuve les femmes et les enfants des Goths, que la curiosité avait attirés. Les
écrivains français ont mis cette barbarie sur le compte des Allemands, qui,
étant encore idolâtres, immolèrent, disent-ils, ces innocents à leurs
divinités, pour se les rendre favorables au commencement de leur entreprise.
Mais Procope, qui n’était pas loin de là, ne fait point cette distinction; la
nation française était encore barbare en ce temps-là; et ces peuples féroces
n’avaient pas besoin d’être animés par la superstition pour commettre des
meurtres. Ils continuèrent leur marche au-delà du Pô, vers le camp de Vraïas. A
leur approche, les Goths, ravis de joie, sortirent au-devant d’eux : mais,
lorsqu’ils virent qu’on les recevait à coups de haches , ils prirent la fuite
avec tant d’effroi, qu’ils traversèrent en foule le camp des Romains, et
coururent sans s’arrêter jusqu’à Ravenne. Les Romains, étonnés et comme
étourdis de ce désordre imprévu, ne se mirent pas en état d’arrêter ces fuyards
: étant ensuite revenus à eux-mêmes, ils s’imaginèrent que la grande armée
qu’ils apercevaient au loin était celle de Bélisaire qui venait les joindre
après avoir défait les Goths. Depuis que Vraïas était campé devant eux, ils se tenaient
renfermés dans leurs retranchements, en sorte qu’ils n’avoient eu aucune
nouvelle de ce qui s’était passé au-delà du Pô, et Théodebert marchait avec une
extrême diligence. Ils prirent donc les armes, et sortirent du camp comme pour
aller joindre Bélisaire. Ils ne reconnurent leur méprise que lorsqu’il n’était
plus possible d’éviter le combat. Leur résistance ne fut pas longue; accablés
par une si grande multitude, ils s’enfuirent en Toscane, d’où ils firent savoir
à Bélisaire leur défaite, et le danger où il était lui-même.
Cette incursion des Francs ne fut qu’un orage violent, mais passager. Le
vainqueur, au lieu démarcher droit à Ravenne, s’arrêta à faire le dégât dans la
Ligurie et dans l’Emilie. Il saccagea la ville de Gênes. Il voit trouvé
d’abondantes provisions dans les deux camps; mais elles furent bientôt
consommées. Tout le pays étant ruiné, les Francs ne trouvèrent plus pour aliments
que la chair des bœufs dont les pâturages étaient remplis, ni pour boisson que
les eaux du Pô; ce qui leur causa de mortelles dysenteries; et les bœufs leur
ayant manqué à la fin, la disette acheva de détruire leur armée. Le tiers des
soldats était déjà mort de faim et de maladie, lorsque Théodebert reçut une
lettre de Bélisaire qui, pour ne pas irriter la fierté de ce jeune prince, lui reprochait
avec ménagement d’avoir oublié les serments par lesquels il s’était lié avec
les Romains; il lui faisait entendre que l’empereur n’était pas tellement dénué
de forces, qu’il ne pût encore repousser une insulte, et il l’exhortait à ne
pas exposer ses possessions légitimes pour mériter le titre d’usurpateur. Cette
lettre fit sans doute moins d’impression sur l’esprit fougueux du jeune
monarque que la disette et la crainte d’une révolte de troupes. Elles murmuraient
hautement de ce qu’on les laissait mourir de faim dans une contrée déserte, où
la terre n’était plus couverte que de cendres et de cadavres. Théodebert prit
donc le parti de repasser les Alpes aussi promptement qu’il était venu.
Après la retraite des Francs, Martin et Jean rallièrent leurs troupes, et
retournèrent dans leur premier poste. Les Goths, renfermés dans Auxime, n’étant
pas instruits de l’irruption des Francs, attendaient tous les jours avec
impatience le secours promis par Vitigès. Enfin ils résolurent de lui envoyer
encore un courrier pour réitérer leurs instances. Mais la vigilance de
Bélisaire leur avait fermé tous les passages. Ils aperçurent un soldat de
l’armée romaine qui était de garde dans un poste, pour empêcher les habitants
de venir faucher l’herbe. Comme il était seul, quelques habitants se
hasardèrent à s’approcher de lui, et lui promirent avec serment une somme
considérable, s’il voulait rendre un service aux assiégés. Le soldat, nommé Burcence, Besse de nation, accepta leurs offres, se chargea
d’une lettre pour Vitigès, et tint parole. Vitigès lui en remit une autre, par
laquelle il s’excusait sur l’incursion des Francs; il promettait de nouveau de
se rendre au plus tôt à Auxime, et exhortait les soldats de la garnison à
répondre aux espérances de toute la nation, dont le salut dépendait de leur courage.
Il récompensa libéralement le courrier, qui, étant revenu au camp des Romains,
apporta pour cause d’absence que, s’étant trouvé malade, il était resté dans une
église voisine pour obtenir de Dieu sa guérison, selon une dévotion ordinaire
en ce temps-là. Le lendemain , étant retourné à son poste, il remit la lettre
de Vitigès. Le retardement du secours lui fit faire un second voyage. On mandait
au roi qu’on ne pouvait plus tenir que cinq jours. De nouvelles promesses
inspirèrent encore à la garnison de nouvelles espérances. Bélisaire, instruit
de l’extrémité où la ville était réduite, s’étonnait qu’elle résistât si
longtemps; il voulut savoir la cause d’une constance si opiniâtre; il donna
ordre de saisir quelqu’un des habitants et de le lui amener. Valérien se
chargea de l’exécution: il y employa un Esclavon agile et robuste qu’il avait
dans ses troupes. C’était un stratagème ordinaire aux Esclavons, qui habitaient
au bord du Danube, de se tapir comme des serpents, tantôt sous une roche,
tantôt entre des buissons ou des herbages, et de s’élancer de là tout à coup
sur un ennemi qu’ils emportaient dans leur camp. Celui-ci employa la même ruse,
et réussit. Le soldat goth, qu’il transporta dans la tente de Valérien,
découvrit la perfidie de Burcence. Ce malheureux fut
convaincu par son propre aveu, et Bélisaire en abandonna le châtiment à ses
camarades, qui le brûlèrent vif à la vue de la ville.
Bélisaire entreprit de vaincre par la soif une opiniâtreté qui résistait
aux horreurs de la famine. Il n’y avait dans Auxime qu’un seul puits, qui ne pouvait
fournir aux besoins des habitants. Mais, hors des murs, à la distance d’un jet
de pierre, coulait sur la pente de la colline un petit ruisseau dont l’eau se
rendait dans un réservoir couvert d’une maçonnerie. Bélisaire fit avancer
toutes ses troupes, comme s’il eût voulu donner un assaut général; et lorsqu’il
vit tout le contour des murs garni de soldats et d’habitants préparés à la
défense, il détacha cinq travailleurs qui, chargés des instruments propres à démolir
un édifice, marchèrent vers le réservoir à l’abri de plusieurs boucliers. Une
décharge de pierres et de traits ne put les empêcher d’arriver. Pendant qu’ils
s’efforçaient de détruire la fontaine, les Goths, qui se voyaient perdus, si on
leur ôtait cette ressource, sortirent sur les travailleurs. Les Romains
accoururent pour les défendre, et le combat devint furieux. L’avantage du lieu favorisait
les Goths; les Romains, en butte à leurs traits, tombaient en grand nombre, et
rien ne les retenait dans un poste si périlleux que la présence du général,
qui, s’exposant lui-même, les animait de ses paroles et de ses regards. Peu
s’en fallut qu’il n’y perdît la vie. Une flèche allait le percer sans qu’il
l’aperçût venir, lorsqu’un de ses gardes, nommé Unigat,
opposa son bras, et reçut le coup dont il demeura estropié. Le combat dura
depuis le lever du soleil jusqu’à midi avec un acharnement extrême. Sept
Arméniens des troupes de Narsès et d’Aratius, s’y
distinguèrent par leur agilité et leur hardiesse. Enfin les Goths se
retirèrent, et les travailleurs revinrent joindre l’armée sans avoir pu,
pendant un si long temps, détacher, malgré tous leurs efforts, une seule pierre
de l’édifice, tant les anciens sa voient donner de solidité à leurs ouvrages.
Bélisaire, n’ayant pu détruire la fontaine, en corrompit les eaux en y faisant
jeter de la chaux, des cadavres et des herbes venimeuses. Il ne restait plus
aux habitants que l’eau de leur puits, qu’on leur distribuent par mesure. Mais ils
se soutenaient encore par l’espérance du secours. Bélisaire, de son côté,
renonçant aux attaques, n’attendait le succès que de sa vigilance à garder tous
les passages.
La garnison de Fésules, réduite aux abois, avait
déjà capitulé. Cyprien et Justin, après avoir laissé quelques troupes dans
cette place, vinrent joindre l’armée devant Auxime, amenant avec eux les
principaux prisonniers. Bélisaire fit approcher ceux-ci des murailles pour les
donner en spectacle aux assiégés, qu’il exhortait en même temps à se rendre. La
famine, encore plus pressante que ses paroles, acheva de vaincre l’opiniâtreté
des habitants. Mais ils demandaient la liberté de se retirer à Ravenne avec
tout ce qui leur appartenait. Bélisaire balançait d’envoyer à Vitigès tant de
braves guerriers, et de fortifier par un si puissant secours une ville qu’il
allait attaquer. Les soldats lui faisaient instance pour ne pas accorder aux
assiégés la permission d’emporter leurs richesses; ils lui montraient leurs
blessures, ils s’écriaient que les dépouilles des barbares leur étaient dues;
que c’était le prix de leur sang et la légitime récompense de leurs travaux. D’une
autre part, il se hâtait de partir pour prévenir la jonction des François avec
Vitigès ; car on disait qu’ils étaient déjà en marche pour se rendre à Ravenne.
Enfin les Romains, pressés par la conjoncture, et les Goths par la famine,
convinrent que les assiégés conserveraient la moitié de leurs effets. Le
partage étant fait, les Romains prirent possession d’Auxime, après six mois de
siège, et les Goths furent enrôlés dans l’armée de Bélisaire.
Il semblait que, pour terminer la guerre, il ne restait plus qu’à prendre
Ravenne, où Vitigès se tenait enfermé. Bélisaire résolut de l’assiéger. Il fit
prendre les devants à Magnus, avec ordre de marcher le long du Pô pour arrêter
les convois qui descendaient par le fleuve. Vital, arrivé depuis peu de
Dalmatie, en faisait autant sur l’autre bord. Tout réussissait à Bélisaire, et
l’on eût dit que le fleuve même s’entendait avec lui. Les Goths avoient chargé
de blé en Ligurie quantité de bateaux qu’ils conduisaient à Ravenne. Les eaux
du Pô, ayant baissé tout à coup, donnèrent aux Romains le temps d’arriver et de
se saisir du convoi. Incontinent après, le fleuve grossit et reprit son cours
ordinaire. La perte de ce blé incommoda beaucoup Ravenne, qui commençait à manquer
de vivres, les Romains étant maîtres du golfe Adriatique.
Les rois francs, qui n’avoient pas perdu l’envie d’étendre leur puissance
au-delà des Alpes, apprenant le danger où se trouvait Vitigès, crurent
l’occasion favorable pour le déterminera céder une partie de ses états, dans
l’espérance de sauver le reste. Ils envoyèrent à Ravenne offrir du secours au
roi des Goths, à condition de partager avec lui la souveraineté de l’Italie.
Bélisaire, instruit de leur démarche, députa de son côté pour engager Vitigès à
entrer en négociations avec l’empereur. Le chef de l’ambassade était ce même
Théodose, intendant de Bélisaire , et amant d’Antonine, que j’ai déjà fait connaître.
Les députés francs eurent audience les premiers. Sans parler des hostilités
récentes de Théodebert, ils firent valoir le vif intérêt que leurs maîtres prenaient
à la conservation du royaume des Goths. Déjà cinq cent mille hommes avoient, disaient-ils,
passé les Alpes, et marchaient la hache à la main pour tailler en pièces
l’armée romaine à la première rencontre. Si les Goths se joignaient aux
François, plus de ressource pour les Romains. Si au contraire les Goths s’unissaient
avec les Romains, les Francs avaient des forces de reste pour écraser les uns
et les autres.
«N’oubliez pas, ajoutaient-ils, que les Romains portent dans le cœur une
haine irréconciliable contre toutes les autres nations. Nous, nous unirons avec
vous pour conserver l’Italie, et nous y établirons de concert la forme du
gouvernement qui vous semblera la meilleure; c’est à vous de choisir si vous
aimez mieux périr avec les Romains ou régner avec nous».
Les envoyés de Bélisaire prirent ensuite la parole:
«Quand il serait vrai ( dirent-ils ) que les Francs vinssent en aussi grand
nombre qu’ils l’annoncent pour vous intimider, la guerre présente ne vous a que
trop «appris que le nombre cède à la valeur; et s’il était besoin de multiplier
les soldats , la France , armée tout entière , en fournirait elle autant que
l’empire, dont elle n’égale pas la dixième partie. Nous sommes, à les entendre,
les ennemis naturels de toutes les nations étrangères; et comment les Francs
ont-ils traité les Thuringiens, les Bourguignons? Comment viennent-ils de vous
traiter vous-mêmes? Je leur demanderons volontiers quel dieu ils prendront à
témoin de leur fidélité à garder les serments. N’avaient-ils pas juré une
alliance avec vous lorsqu’ils ont égorgé vos femmes et vos enfants sur le pont
de Pavie; lorsqu’ils ont taillé en pièces vos troupes qui leur tendaient les
bras comme à leurs amis; lorsque, par un ravage et un massacre général, ils
vous ont confondus avec nous, dont ils étaient aussi les alliés? Cette nation
n’en connaît point; elle oublie les traités dès qu’elle les a jurés, ou elle ne
s’en souvient que pour perdre plus sûrement ceux qu’elle a mis hors de défense
par une paix simulée. Aujourd’hui même n’ont-ils pas oublié l’alliance faite
avec vous, et confirmée par des serments dont la force subsiste encore? Ils
vous en demandent une nouvelle , et veulent vous la faire acheter par la perte
de vos possessions. Fuyez ces amis perfides: ennemis découverts, ils seront
moins dangereux. Il vous sera plus facile de les repousser en vous joignant à
nous que de sauver de leur avidité insatiable ce que vous vous serez réservé
dans le partage qu’ils vous proposent».
Vitigès, après avoir longtemps délibéré avec les principaux seigneurs de la
nation, se détermina enfin à traiter avec l’empereur. On porta de part et
d’autre diverses propositions d’accommodement. Pendant le cours de cette
négociation, Bélisaire ne se relâcha point de sa vigilance à garder les
passages. Il donna ordre à Vital de se rendre maître des places de la Vénétie,
et à Ildiger de passer le Pô pour resserrer Ravenne
de plus en plus. Sur ce qu’il apprit qu’il y restait encore de grands amas de
blé, il gagna par argent un des habitants, qui mit le feu aux magasins. On
soupçonna Matasonte, femme de Vitigès, d’avoir
favorisé cette trahison; d’autres crurent que l’incendie avait été causé par le
feu du ciel. Ces deux opinions différentes inquiétaient également Vitigès: il
en concluait qu’il n’y avait pour lui aucune assurance, et qu’il avait pour
ennemi ou sa propre femme, ou Dieu même.
Les Goths avoient grand nombre de châteaux dans les Alpes cottiennes, qui
font aujourd’hui partie du Piémont. Le général romain, informé qu’ils songeaient
à se rendre, y envoya Thomas, un de ses officiers, pour les recevoir à
composition. En effet, dès que celui-ci fut sur les lieux, Sisigis,
qui avait le commandement supérieur sur les garnisons du pays, se rendit à lui,
et engagea les autres commandants à suivre son exemple. Vraïas marchait alors
au secours de Ravenne, à la tête de quatre mille hommes, qu’il avait tirés de
ces châteaux. Ses soldats, apprenant ce qui se passait derrière eux, et
craignant pour leurs familles, le forcèrent de rebrousser chemin. Il retourna
donc sur ses pas, et assiégea Thomas et Sisigis. Jean
et Martin, qui n’étaient pas éloignés, accoururent au secours et prirent
d’emblée plusieurs châteaux, dont ils firent les habitants prisonniers. C’étaient
pour la plupart les femmes et les enfants des soldats de Vraïas, qui, pour les
tirer d’esclavage abandonnèrent leur général, et passèrent du côté des Romains.
Vraïas, hors d’état de rien entreprendre, se retira en Ligurie.
Il apprit bientôt qu’il était inutile de songer à secourir Ravenne.
Justinien, résolu de rappeler ses troupes d’Occident pour les opposer à Chosroès,
avait envoyé à Vitigès deux sénateurs, Domenic et Maximin, chargés de conclure
la paix à ces conditions : que Vitigès conserverait, avec le titre de roi et la
moitié de ses trésors, tout le pays au-delà du Pô, et qu’il abandonnerait à
l’empereur le reste de ses richesses et de l’Italie. Il ne traitait si
favorablement le roi des Goths que parce qu’il ignorait l’extrémité où ce
prince était réduit. Les Goths, voyant qu’on ne leur demandait que ce qu’ils
avoient déjà perdu, et qu’ils étaient à la veille de perdre tout le reste, étaient
assez disposés à accepter ces propositions; mais Bélisaire vit avec un extrême
déplaisir qu’on lui ravissait l’honneur d’achever une victoire qu’il avait
entre les mains, et de conduire Vitigès prisonnier à Constantinople. Comme les
Goths, comptant sur sa parole plus que sur celle de l’empereur, exigeaient
qu’il signât ce traité, il refusa de le faire, apportant pour raison qu’il n’en
avait point reçu l’ordre: ce qui leur inspira tant de défiance, que toute
négociation fut rompue. Ce grand capitaine, quoique d’une vertu irréprochable,
avait auprès de lui des officiers malintentionnés qui ne cherchaient qu’à
censurer sa conduite : les principaux étaient Bessas, Narsès, et son frère Aratius, Jean le Sanguinaire, qui s’était rendu au camp
depuis la retraite de Vraïas, et Athanase, préfet du prétoire, arrivé depuis
peu de Constantinople. Cette cabale faisait courir le bruit que Bélisaire s’opposait
à la paix, parce qu’il tramait sourdement quelque entreprise contre les
intérêts de l’empereur. Le général, averti de ces propos calomnieux, résolut de
consentir au traité. Mais, comme il prévoyait que ces mêmes personnes qui le forçaient
aujourd’hui de signer une paix si peu avantageuse, en égard aux conjonctures, seraient
dans la suite les premières à l’accuser de n’en avoir pas détourné l’empereur,
en l’instruisant de l’état où se trouvaient les ennemis, il prit une sage
précaution. Ayant fait assembler tous les officiers de l’armée en présence des
deux députés de l’empereur :
«Vous savez (leur dit-il) quelles sont les conditions écoutées avec joie
par Vitigès. Si vous les trouvez honorables, que chacun de vous le témoigne
hautement : s’il en est quelqu’un parmi vous qui ne croie pas impossible de
réduire l’Italie entière et de détruire absolument la puissance des Goths,
qu’il dise hardiment ce qu’il pense. J’attends de votre bouche ce que je dois
décider sur nos véritables intérêts, afin que vous ne m’imputiez pas un jour
les suites du parti que vous aurez pris vous-mêmes. Il serait absurde de se
taire, quand on est encore maître de choisir, pour attendre à se plaindre quand
le mal serait devenu irréparable»
Après qu’il eut parlé, tous déclarèrent que la paix était nécessaire, et
qu’ils étaient hors d’état de pousser plus loin leurs entreprises contre les
ennemis. Bélisaire exigea qu’ils lui donnassent leur avis par écrit, afin
qu’ils ne pussent le désavouer dans la suite.
Le bonheur du général romain, ou plutôt la haute réputation qu’il s’était
acquise chez les ennemis mêmes, rendit inutiles tous ces préliminaires, et
conduisit l’événement au point que Bélisaire avait désiré. Les Goths, quoique
rebutés des malheurs attachés à la personne de Vitigès, balançaient encore de
se rendre à l’empereur, par la crainte d’être traînés hors de l’Italie et
transportés à Constantinople. Les principaux d’entre eux, s’étant consultés,
résolurent unanimement d’offrir la couronne à Bélisaire. Ils le firent
secrètement solliciter de prendre le titre de roi, et lui promirent de le reconnaître
et de le soutenir de tout leur pouvoir. Mais l’usurpation et la perfidie étaient
trop éloignées de ce grand homme; il portait gravé profondément dans le cœur le
serment de fidélité qu’il avait prêté à Justinien. Cependant, pour tourner
cette bienveillance des Goths à l’avantage de son maître, il feignit d’être
flatté de la proposition. Vitigès, n’osant contredire le vœu de la nation, se
fit assez de violence pour approuver un choix qui le déshonorait, et pour
joindre même ses instances à celles des seigneurs, assurant le général romain
qu’il serait le premier à lui rendre hommage. Alors Bélisaire, ayant de nouveau
assemblé ses officiers, leur demanda s’ils ne convenaient pas que ce serait un
exploit grand et mémorable de faire prisonniers tous les Goths avec Vitigès,
sans coup férir, et de rendre à l’empire l’Italie entière. Ils s’écrièrent que
rien ne pouvait arriver de plus heureux, et le prièrent d’exécuter ce noble
dessein, s’il était en son pouvoir d’y réussir. Bélisaire fait dire aussitôt à
Vitigès et aux seigneurs qu’il est prêt à écouter leurs propositions. Ceux-ci,
déjà pressés par la disette qui se faisait sentir de plus en plus, envoient de
nouveaux députés pour traiter avec Bélisaire, et tirer de lui une promesse
qu’il ne permettra de faire aucun mal à personne de la nation, et qu’il se
déclarera roi des Goths et de l’Italie. Ils dévoient ensuite l’amener à Ravenne
avec son armée. Bélisaire s’engagea par serment à la première de ces deux
conditions: quant à la seconde, il répondit qu’il ne voulait rien faire sur cet
article qu’en présence de Vitigès et des seigneurs.
Les députés, persuadés qu’il n’était pas besoin de le presser d’accepter
une couronne, crurent leur commission remplie, et le prièrent de venir avec eux
à Ravenne. Cette négociation s’était traitée dans le plus grand secret; et
Bélisaire, pour ne trouver aucun obstacle à l’exécution de la parole qu’il avait
donnée de ménager les Goths comme ses amis et ses sujets, éloigna les officiers
qu’il savait peu disposés à lui obéir. Il les envoya avec leurs troupes en
divers cantons de l’Emilie, sous prétexte qu’il ne pouvait plus les faire
subsister dans son camp. Pour amener avec lui dans Ravenne l’abondance et la
joie, il fit partir sa flotte chargée de vivres, et lui donna ordre de se
rendre au port de cette ville. Ensuite, accompagné des députés, il se mit en
marche avec son armée. Son entrée fut plutôt celle d’un roi qui reviendrait
dans sa capitale après une longue absence que celle d’un vainqueur dans une
ville conquise. Il avait donné à ses troupes les ordres les plus exprès de ne
point tirer l’épée, et de traiter les habitants comme leurs frères. Les Goths,
tant de fois témoins de la valeur des soldats de Bélisaire, les considéraient
avec une sorte d’admiration; mais les femmes, qui, sur le rapport des vaincus,
s’étaient toujours figuré les Romains comme des hommes de grande taille, et
invincibles par leur multitude, les voyant au contraire beaucoup plus petits et
en moindre nombre que les Goths, insultaient à leurs maris, et les taxaient de l’âcheté.
On s’assura de la personne de Vitigès; mais on le traita avec honneur. Les
Goths qui avoient leurs établissements en-deçà du Pô eurent la liberté de s’y
retirer. Il en sortit beaucoup de Ravenne; en sorte qu’on n’avait plus rien à
craindre de leur part, ni hors de la ville, le pays étant couvert de garnisons
romaines; ni dans la ville, les Romains s’y trouvant en aussi grand nombre que
les Goths. Bélisaire se saisit ensuite des richesses du palais, qu’il réservait
à l’empereur. Fidèle à sa parole, il n’ôta rien aux particuliers, et ne permit
de leur faire aucun tort. Les garnisons des places fortes, ayant appris que
Ravenne et Vitigès étaient au pouvoir des Romains, envoyèrent assurer Bélisaire
de leur obéissance. Trévise et les autres villes de la Vénétie se rendirent.
Jean et Martin avoient déjà conquis toute l’Emilie; il ne restait aux Goths que Césène, dont Bélisaire s’empara dans le même temps
qu’il entra dans Ravenne. Tous les commandants de ces places vinrent, sur sa
parole, se rendre auprès de lui. Ildibad fut le seul qui témoigna de la
défiance. C’était un officier de grande considération, qui commandait dans
Vérone. Il était neveu de Theudis, roi des Visigoths.
Comme ses enfants étaient entre les mains de Bélisaire, qui les avait trouvés
dans Ravenne, il fit assurer le général romain de sa soumission; mais il ne
jugea pas à propos de sortir de Vérone. Ainsi se termina la cinquième année de
la guerre des Goths. Pour ne pas interrompre ce qui regarde Vitigès, je
rapporterai ici ce qui se passa en Italie jusqu’au retour de Bélisaire à
Constantinople, quoique ces événements appartiennent aux premiers mois de
l’année suivante.
Les instances que les Goths faisaient à Bélisaire d’accepter la couronne ne
pouvaient être si sécrétés qu’elles ne parvinssent à la connaissance des
envieux que ce grand homme avait autour de lui. Ils en écrivirent à l’empereur,
comme d’une intrigue criminelle. Une pareille calomnie avait déjà trouvé entrée
dans l’esprit de l’empereur après la conquête de l’Afrique. Il rappela
Bélisaire, sous prétexte de l’employer contre les Perses. II lui donna dès lors
le titre de commandant des armées d’Orient. Buzès fut chargé de la conduite des
troupes jusqu’au retour de Bélisaire. Bessas, Jean le Sanguinaire, et les
autres généraux, eurent ordre de rester en Italie, et Constantin de passer de
la Dalmatie à Ravenne. Les Goths, qui désiraient ardemment d’avoir Bélisaire
pour roi, ne furent point d’abord alarmés de cette nouvelle. Ils ne pouvaient
se persuader que ce général voulût préférer à l’honneur d’un diadème celui
d’une fidélité stérile. Mais, lorsqu’ils virent qu’il se préparait à partir,
les principaux d’entre eux se rendirent à Pavie, et offrirent à Vraïas de le reconnaître
pour roi.
«Je loue votre dessein (leur répondit Vraïas); il vous faut un roi capable
de continuer la guerre, si vous avez assez de cœur pour ne pas vivre esclaves
des Romains; mais Vraïas n’est pas celui que vous devez choisir. Je suis neveu
de Vitigès; je serais méprisé des ennemis, comme héritier de ses malheurs, et
détesté de mes compatriotes, comme usurpateur de sa couronne. Choisissez
Ildibad: vous connaissez sa valeur, il est neveu du roi des Visigoths, dont les
forces peuvent relever nos espérances et arrêter notre chute.»
Cet avis fut approuvé de tous. On va chercher Ildibad à Vérone, et on le
proclame roi à Pavie; mais Bélisaire régnait en effet sur les cœurs. A peine
Ildibad fut-il revêtu de la pourpre, qu’il proposa de
la quitter, et conseilla de faire de nouvelles démarches auprès de Bélisaire.
On envoya donc à Ravenne des députés qui mirent en œuvre les motifs qu’ils croyaient
les plus pressants. Ils accusaient le général romain d’avoir manqué à sa
parole.« Vous êtes, lui disaient-ils, le défenseur de Justinien, et vous voulez
en être l'esclave! honteuse modestie qui préféré la servitude a la royauté!
Celui qui a vaincu les Goths est-il donc incapable de les gouverner? Ildibad
est notre roi; mais il vous reconnaît pour le sien. Il est prêt à vous rendre
hommage et à mettre sa couronne à vos pieds».
Bélisaire, qui savait faire de grandes choses sans appareil, parce qu’il
les faisait sans effort, repartit en deux mots: «Je suis sujet de Justinien, et
ne l’oublierai jamais».
Peu de jours après il partit pour Constantinople, accompagné de quatre de
ses plus braves et plus fidèles lieutenants, Ildiger,
Valérien, Martin et Hérodien. Il y transportait Vitigès et Matasonte avec leurs enfants, les trésors des rois goths, plusieurs des principaux
seigneurs, et les fils d’Ildibad. L’empereur les vit avec joie, et les traita
avec honneur. Vitigès fut revêtu des titres de comte et de patrice. On lui
assigna des terres vers les frontières de la Perse; il mourut deux ans après.
Sa veuve épousa Germain, comme nous le verrons dans la suite. Justinien fit
étaler dans son palais les trésors des Goths; mais il n’en permit la vue qu’aux
sénateurs; sans y admettre le peuple. Sa vanité fut alors retenue par une
timide politique. Il craignait de donner trop d’éclat à Bélisaire; et ce fut
pour cette raison qu’il ne lui permit pas d’entrer en triomphe, comme au retour
de la conquête d’Afrique. Mais la jalousie du prince relevait le général; et
l’admiration des peuples lui rendait avec usure ce que son maître enviait à sa
gloire. On ne parlait que de Bélisaire, qui, par deux conquêtes au-dessus de
toute espérance, effaçait la renommée des plus fameux capitaines de l’ancienne
Rome: c’était lui qui avait détrôné et conduit à Constantinople les successeurs
de Genséric et de Théodoric, les deux plus grands rois des barbares; c’était
lui qui avait arraché aux Vandales et aux Goths les dépouilles des Romains, et
rendu à l’empire, dans l’espace de six années, la moitié de la terre et de la
mer. Bélisaire ne pouvait sortir de sa maison sans attirer une foule de peuple
qui ne se lassait pas de le considérer. Escorté de cette multitude et suivi
d’une troupe de Goths, de Maures et de Vandales, qui tenaient à honneur d’être
ses prisonniers, tous les pas qu’il faisait dans Constantinople semblaient être
la marche d’un triomphe. Sa bonne mine, la noblesse de ses traits, sa taille
avantageuse, le faisaient distinguer; tandis que lui-même, accessible, familier
avec tous ceux qui l’abordaient, il aimait à se confondre avec eux et à se
dérober à l’admiration publique.
Tout était héroïque dans Bélisaire, et sa valeur ne lui acquérait pas plus
d’estime que sa bonté, son humanité, sa générosité, ne lui conciliaient d’amour
de la part et des soldats et des peuples, et même des ennemis. C’était le père
de ses soldats. Non content de les faire guérir de leurs blessures, il les en consolait
par ses largesses. Aucune action de bravoure ne demeurait sans récompense. La
perte d’un cheval, d’une arme, était aussitôt réparée par le général. Et ce n’était
point par le pillage qu’il fournissait à ces libéralités; rien ne rassurait
plus les laboureurs que la présence de Bélisaire. Nous sommes leurs gardes, disait-il;
une armée est faite pour protéger les campagnes, et non pour les ravager.
Jamais la marche de ses troupes n’y causa de dommage; il prenait grand soin
d’épargner les moissons, et ne permettait pas de cueillir les fruits. Loin de
surcharger les paysans de contributions, son voisinage les enrichissait; il faisait
acheter leurs denrées ce qu’elles valaient. Il était lui-même un exemple de
justice, de modération, de continence. Aussi chaste que le premier des Scipions, jamais il n’aima d’autre femme que la sienne,
quoique Antonine ne se piquât nullement de fidélité. De tant de belles
prisonnières qui tombèrent entre ses mains, il n’en voulut jamais voir aucune,
loin de mettre leur vertu à l’épreuve. Une lumière aussi sûre que rapide l’éclairait
dans toutes les affaires, et lui montrait toujours le meilleur parti dans les conjonctures
les plus équivoques. Hardi avec sagesse, il savait user à propos de célérité et
de lenteur. Ferme et plein de confiance dans les revers, il ne se défiait que
de la prospérité; c’était alors qu’il s’observait davantage, de peur de
s’abandonner aux excès d’une joie indiscrète. Jamais personne ne vit Bélisaire
échauffé par le vin. Toujours suivi de la victoire en Afrique et en Italie, il
parut encore plus grand lorsqu’il fut de retour à Constantinople. Ses titres,
ses richesses, le nombreux cortège de ses gardes, l’auraient rendu redoutable,
si sa vertu n’eût mis un frein à son pouvoir. Tout obéissait à ses ordres; mais
il obéissait lui-même aux lois de la religion et de l’état. L’empereur fut
heureux d’avoir en lui un sujet fidèle: si Bélisaire eût entrepris d’usurper
l’empire, il aurait peut-être trouvé dans Justinien moins de résistance que
dans Gélimer et Vitigès.
Pendant que Bélisaire achevait la conquête de l’Italie, l’Illyrie et la
Grèce étaient ravagées par les barbares; et les Maures disputaient aux Romains
la possession de lâ Numidie. Calluc, qui commandait
en Illyrie, défit d’abord les Gépides, et fut ensuite défait et tué dans une
grande bataille, dont on ne fait aucun détail. Une incursion des Huns fut
encore plus funeste à l’empire. Tout fut mis à feu et à sang depuis le golfe
Adriatique jusqu’aux environs de Constantinople. Ils prirent trente-deux
châteaux en Illyrie. L’ancienne ville de Potidée, nommée Cassandrie, depuis que
Cassandre, roi de Macédoine, l’a voit rebâtie, fermait l’entrée de la presqu’île
de Pallène. Les Huns, qui, jusqu’alors se contentaient de courir les campagnes
sans s’arrêter à l’attaque des villes, la prirent d’assaut, pénétrèrent dans la
presqu’île, et, sans rencontrer de résistance, retournèrent dans leur pays
avec un riche butin et cent vingt mille prisonniers. L’attrait du pillage leur
fit encore passer le Danube. Ayant forcé la muraille qui couvrait la Chersonèse
de Thrace, ils égorgèrent ou traînèrent en esclavage tous les habitants.
Quelques détachements de ces barbares passèrent l’Hellespont, et allèrent
piller les côtes de l’Asie. Ils revinrent une troisième fois, ravagèrent l’Illyrie
et la Thessalie, et s’avancèrent jusqu’aux Thermopyles, dont le passage était
fermé d’un château et d’une muraille défendue par des paysans armés qui les
repoussèrent. Mais, ayant découvert un chemin entre les montagnes, ils
entrèrent dans l’Achaïe, et ne l’abandonnèrent qu’a près avoir désolé tout le
pays jusqu’à l’isthme de Corinthe.
Ce fut alors que , pour arrêter ces courses, Justinien borda de châteaux la
rive du Danube, depuis la Pannonie jusqu’à son embouchure. Toutes les villes
anciennes le long du fleuve sortirent de leurs ruines. La Dardanie,
la Macédoine, la Thessalie, l’Epire, virent s’élever de toutes parts un si
grand nombre de forteresses, que, si les tours et les murailles faisaient
seules la sûreté d’un pays, ces provinces auraient été hors d’insulte pour
plusieurs siècles. Il fortifia de nouveau lé pas des Thermopyles, et y plaça
une garnison de deux mille hommes. Auparavant ce défilé n’était gardé que par
les paysans, qui prenaient tumultuairement les armes à la nouvelle d’une
incursion de barbares. L’empereur fit murer tous les chemins qui traversaient
les montagnes voisines; ils étaient en grand nombre et assez larges pour le
passage d’un chariot. Aussi Procope s’étonne-t-il que l’armée de Xerxès, qui
fut arrêtée en ce lieu pendant plusieurs jours, n’eût découvert qu’un sentier
fort étroit: mais ces lieux avoient pu changer de face depuis le temps de
Xerxès. Un autre défilé conduisait aux Thermopyles, entre Héraclée et Myropolis; Justinien en boucha l’entrée par une épaisse
muraille, et releva les fortifications de ces deux villes. Il pourvut à la
sûreté de l’Achaïe, en cas que les barbares vinssent à forcer le passage. Les tremblements
de terre, la longueur du temps, la négligence, avaient presque ruiné Corinthe,
Athènes, Platée et les places de la Béotie: elles furent mises en état de
défense. La réparation des villes du Péloponnèse aurait demandé beaucoup de
temps et de dépense; l’empereur se contenta de fermer l’isthme par un bouleard flanqué d’un grand nombre de tours, et défendu
par une forte garnison. Procope nomme près de quatre cents villes ou châteaux
bâtis ou rétablis dans l’Illyrie et la Grèce, et près de deux cents dans la
seule province de Thrace. La longue muraille bâtie par Anastase, et qui,
s’étendant du Pont-Euxin à la Propontide, servait de clôture aux environs de
Constantinople, jusqu’à douze ou treize lieues de la ville, tombait en ruine;
en sorte que les maisons de plaisance, remplies de meubles précieux et de tous
les ornements du luxe et de l’opulence, étaient exposées an pillage des
barbares. L’empereur répara les brèches; il releva les murs de Sélymbrie, renfermée dans cette vaste enceinte. Rhédeste était un port commode et d’une entrée facile sur
la Propontide; comme c’était une place ouverte, la crainte des barbares en avait
écarté les marchands. Elle fut fortifiée, et devint une retraite assurée pour
les navigateurs. Le mur qui fermait la Chersonèse fut refait beaucoup plus haut
et plus fort qu’il n’était auparavant. On le borda d’un fossé large et profond;
une nombreuse garnison fut chargée de la défense. Les villes de cette
presqu’île furent mises en état de résister à de nouvelles incursions. Toutes
les places de la cote de Thrace sur la mer Egée, celles de la province d’Hémus et de Rhodope, détruites en partie, soit par les
années, soit par les incursions des Huns et des Esclavons, furent réparées et
fortifiées. Il aurait été bien plus sûr de rendre l’empire redoutable aux
barbares en remettant en vigueur l’ancienne discipline; mais Justinien ne connaissait
de grandeur que celle de la dépense; il ignorait que la force d’un état réside
dans le cœur de ses habitants plus que dans les remparts, et qu’en un temps de
décadence, ce sont les sentiments et les mœurs qu’il faut rétablir plutôt que
les forteresses et les murailles, toujours trop faibles lorsqu’elles ne sont
pas défendues par l’amour du prince et de la patrie.
L’Afrique se reposait sous le gouvernement doux et équitable de Germain,
lorsque Justinien rappela ce prince pour y renvoyer Salomon avec de nouvelles
troupes, commandées par Rufin et Léonce frères, et par Jean, fils de Sisinniole. Salomon, arrivé à Carthage, trouvant la faction
de Stozas entièrement détruite, s’occupa de ce qui regardait le bon ordre et la
sûreté de la conquête. Il maintint, la discipline dans les troupes, qu’il
compléta par des recrues. Il éloigna ceux qui lui étaient suspects, envoyant
les uns à Constantinople, les autres en Italie, où Bélisaire les retenait. Il
bannit de l’Afrique ce qui restait de Vandales, et n’y laissa aucune de leurs
femmes. Il environna de murailles toutes les villes, et assura encore plus la
tranquillité du pays par sa vigilance à faire observer les lois. L’Afrique oubliait
ses malheurs passés, et voyait renaître la fertilité et l’opulence.
Trois ans auparavant, Salomon avait inutilement tenté de s’emparer du mont Aurase, dont Yabdas était demeuré lé maître. Il entreprit
une seconde fois d’en déloger les Maures, et fit prendre les devants à
Gontharis, un de ses gardes, à la tête d’un grand corps de troupes. Celui-ci,
étant arrivé sur les bords du fleuve Abigas, campa
près de Gaba, ville autrefois célèbre, mais alors déserte. Ce guerrier, plus
brave que prudent, hasarda une bataille, et fut défait. Il était assiégé dans
son camp, lorsque Salomon vint camper à trois lieues de distance. Dès qu'il
apprit le danger où était Gontharis, il fit marcher à son secours une partie de
ses troupes, avec ordre d’attaquer les ennemis et de donner la main à
Gontharis. Mais l’entreprise se trouva impossible. L’Abigas, sortànt du mont Aurase, se divisait
en une infinité de canaux, pratiqués par les Numides pour l’arrosement de leurs
terres; en sorte qu’ils étaient les maîtres des eaux de ce fleuve, dont ils ouvraient
ou fermaient les canaux à leur volonté. Les Maures, ayant inondé tous les
environs de leur camp, en avoient rendu l’accès impraticable. Sur cette nouvelle,
Salomon accourut avec toutes ses troupes: les barbares, malgré l’avantage de
leur position, ne l’attendirent pas; ils se retirèrent au pied du mont Aurase. Le générai romain les y poursuivit, et les défit
dans un sanglant combat. Les uns s’enfuirent dans la Mauritanie; les autres, au
nombre de vingt mille, se renfermèrent avec Yabdas dans une forteresse nommée Zerbule, que ce prince avait depuis peu bâtie sur la pente
de la montagne. Salomon fil le dégât autour de Tamugade;
et, après avoir réduit en cendres les fruits et les moissons, il marcha pour
attaquer Zerbule; Yabdas, craignant d’être affamé
dans ce poste, y avait laissé garnison, et s’était retiré sur le haut de la
montagne, en un lieu nommé Tumar, au milieu
des rochers et des précipices. Salomon, après avoir attaqué Zerbule pendant trois jours, résolut d’abandonner cette entreprise, qui traînait en
longueur, et d’aller chercher Yabdas. Il se persuadait qu’après avoir forcé ce
prince dans sa retraite, il viendrait aisément à bout de réduire la forteresse.
Pendant qu’il se préparait à lever le siège, la garnison, qui avait perdu tous
ses officiers, tués à coups de flèches sur les murailles, profita de
l’obscurité de la nuit pour s’évader à l’insu des Romains. Au point du jour,
ceux-ci, se mettant en marche, furent surpris de ne voir paraître personne sur
les murs. Ils envoyèrent faire le tour de la place: on trouva une des portes
ouverte, et le fort abandonné. Après l’avoir pillé, ils y laissèrent garnison,
et marchèrent vers le sommet de la montagne. .
Lorsqu’ils furent à la vue de Tumar, où Yabdas se
tenait campé dans un lieu inaccessible, ils prirent poste entre les rochers, et
y passèrent plusieurs jours sans pouvoir monter à l’ennemi ni l’attirer au
combat. Ce qui les incommodait davantage, était la difficulté de faire parvenir
des vivres jusqu’à leur camp, et surtout le manque d’eau. Salomon gardait
lui-même celle qu’on avait apportée , et n’en distribuait qu’un verre par jour
à chaque soldat. Tout retentissait de murmures contre le général: Il les avait,
disaient-ils, conduits au-dessus des nuées pour les faire périr de soif, aussi
desséchés que ces rochers arides, qui ne leur offraient que la sépulture.
Salomon, quoiqu’il tâchât de soutenir leur courage, était dans un extrême
embarras, lorsqu’une heureuse témérité lui procura le succès qu’il ne pouvait
attendre de la prudence. Un bas-officier, nommé Gézon,
soit par défi, soit par désespoir, entreprit de monter seul à l’ennemi. Il était
suivi à quelque distance de plusieurs de ses camarades, qui admiraient sa
hardiesse. Trois Maures qui gardaient ce poste coururent à lui, mais
séparément, le sentier étant trop étroit pour les laisser marcher de front. Il
les tua l’on après l’autre. Ceux qui le suivaient, encouragés par ce succès,
s’élancent vers l’ennemi. A ce spectacle, toute l’armée, sans attendre le
commandement, sans garder aucun ordre, accourt avec de grands cris; ils
s’animent, ils s’aident les uns les autres, ils gravissent sur ces rochers. Les
deux frères Rufin et Léonce, arrivés les premiers, portent partout l’épouvante
et la mort. Les Maures fuient et roulent dans les précipices. Yabdas, quoique
blessé à la cuisse d’un coup de javelot, fut assez heureux pour se sauver: il
gagna la Mauritanie. Les Romains, pour ôter aux Maures la retraite du mont Aurase, y bâtirent plusieurs forts, où ils mirent garnison.
Entre les précipices de cette montagne s’élevait une roche escarpée, qu’on appelait
la roche de Géminien. On y avait autrefois
bâti une tour, fort petite à la vérité, mais qui, par son assiette, devenait un
refuge assuré. Yabdas y avait enfermé ses femmes et ses trésors sous la garde
d’un vieil officier dont la fidélité lui était connue. Les Romains, en visitant
tous les détours de la montagne, découvrirent un sentier qui les conduisit au
pied de cette tour. Un d’entre eux, par bravade, se hasarda d’y monter, et
servit d’abord de risée aux femmes qui se montraient au haut de la tour. Le
vieux commandant, le regardant entre les créneaux, l’invitait par raillerie à
redoubler ses efforts. Le soldat, piqué de ces insultes, fit tant des mains et
des pieds, qu’il approcha d’assez près pour s’élancer aux créneaux, et pour
abattre la tête au commandant d’un coup de sabre. Ses camarades, animés par son
exemple, se soulèvent mutuellement, et atteignent le haut de la tour. Ils
enlèvent les femmes et l’argent, dont le général fit usage pour rebâtir les
murs de plusieurs villes. Les Maures ayant abandonné la Numidie, Salomon entra
dans la première Mauritanie, dont Stèfe était
capitale, et la rendît tributaire. Il ne restait plus aux Maures que la seconde
Mauritanie. Mastigas, roi de la nation, la possédait
tout entière, à l’exception de Césarée, dont Bélisaire s’était emparé. Pendant
les quatre années qui suivirent cette expédition, Salomon laissa jouir les
Africains des douceurs de la paix; et tandis que le feu de la guerre désolait
l’Asie et l’Italie, l’Afrique était devenue, par la modération de ce sage
gouverneur, la contrée la plus heureuse de l’empire.
 |
HISTOIRE DU BAS-EMPIRE. |
 |

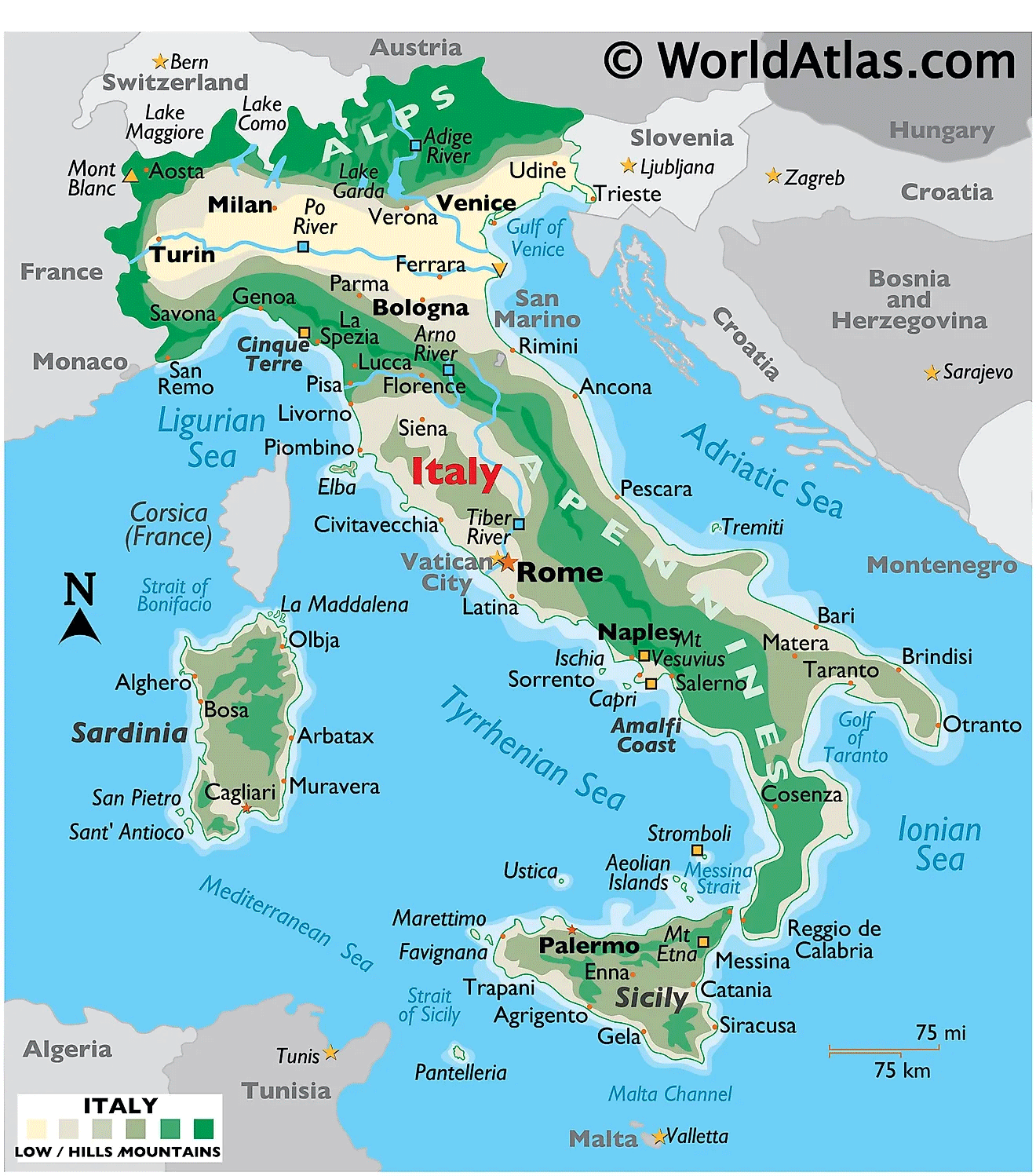
 |
 |
 |