cristoraul.org " El Vencedor Ediciones" |
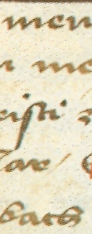 |
HISTOIRE DE LA LIGUE FORMÉE CONTRE CHARLES LE TÉMÉRAIRE.
DEUXIEME PARTIE.
SIÉGE DE NEUS. — GUERRE DE SUNDGAU — CONQUÊTE DE LA
LORRAINE PAR CHARLES LE TÉMÉRAIRE.
CHAPITRE PREMIER.
Exposé des projets du duc de Bourgogne
Charles le Téméraire n'a été mis en scène jusqu'à présent
que lorsque cela a été nécessaire pour la parfaite intelligence de mon récit. A
l’avenir il y paraîtra plus souvent. Ses précédents démêlés avec Louis XI ne
rentraient point dans le cadre du tableau que je veux présenter à mes lecteurs.
Mon but n’est point de me faire l’historien du prince bourguignon : je cherche
simplement à faire connaître les faits de la ligue sous les coups de laquelle
Charles devait finalement succomber.
Etienne de Hagenbach, frère du landvogt,
avait eu connaissance de la fin tragique de Pierre, en voyant arriver au castel
paternel le cercueil renfermant ses restes. Il partit aussitôt pour Luxembourg,
où se trouvait le duc Charles, afin de lui rendre compte des événements
d’Alsace.
Ce prince, en apprenant la perte de ses nouveaux domaines
et l’exécution de son lieutenant favori, fut saisi d’un accès de rage tel, que
même ses serviteurs les plus intimes ne se souvenaient pas de lui en avoir vu
de semblable. Il commença par se jeter sur le porteur de ces funestes
nouvelles, et le frappa avec fureur en l’entraînant à sa suite autour de
l’appartement et en lui adressant successivement les questions les plus
incohérentes. Puis, s’en prenant à tout ce qui était à sa portée et brisant ses
meubles, il jura, au milieu dés imprécations les plus effroyables, qu’il
tirerait une éclatante Vengeance de cet attentat. Son exaspération frénétique
dura plusieurs jours. Tout ce qu’on fit pendant ces premiers moments pour
essayer de le calmer ne servit qu’à l’irriter davantage.
Or, le comte Henri de Würtemberg était alors dans les
environs de Luxembourg. Après avoir passé plusieurs années à la cour de
Bourgogne, il en avait été rappelé par son père, le duc Ulric. Ce dernier étant
au nombre des signataires du traité de Constance, Charles ordonna qu’on employât
la ruse ou la force pour s’emparer de la personne de Henri; il espérait devenir
maître de Montbéliard, grâce à cette capture, et se ménager ainsi l’entrée de
l’Alsace. Le duc de Bourgogne, on le voit, était astucieux et perfide, comme
plusieurs des princes de son temps; mais il se faisait illusion à lui-même et
se croyait le plus franc et le plus loyal des hommes, parce qu’il en était le
plus violent et le plus emporté.
Dès que la nouvelle de l’arrestation de Henri parvint aux
Bâlois et aux autres confédérés, ils se hâtèrent de mettre une forte garnison à
Montbéliard, et d’en augmenter l’artillerie. — Bientôt après, un messager de
Charles arriva en cette ville. Le duc exigeait qu’on lui en fit sur-le-champ la
remise, et déclarait qu’en cas de refus, il ferait décapiter le comte. Mais le
sire de Stein, capitaine de la citadelle, répondit à cette menace dans les
termes suivants : « Le duc de Bourgogne s’est emparé de mon seigneur le comte
Henri de Würtemberg, qui ne l’avait offensé en rien; cependant, quand bien même
ledit duc de Bourgogne ferait mettre à mort mondit seigneur de Würtemberg, il se chargerait la conscience d’un crime inutile et
odieux, car je ne rendrai ni la ville, ni le château confiés à ma garde, ce
serait manquer à mon devoir . Il est d’autres comtes de Würtemberg à qui je
dois obéir, je ne céderai que par leurs ordres, et si mon refus coûte la vie au
jeune comte, sa famille saura le venger; je défendrai donc le poste envers et
contre tous. » Toutefois, Charles ne persista point dans son horrible projet,
et se borna à retenir Henri dans les prisons de Luxembourg.
Cependant, les confédérés jugèrent, d’après ces
démonstrations, que le danger était imminent, et ils s’empressèrent de garnir
de troupes les passages par lesquels le duc de Bourgogne aurait pu arriver en
Alsace.
Heureusement pour cette province, d’autres soins
l’empêchaient alors d’y agir personnellement. Charles était encore absorbé par
ses grands projets contre l’Allemagne, d’une part, et la France de l’autre.
Car, avec son imprévoyance accoutumée, il n’hésitait pas à s’engager à la fois,
pour ainsi dire, dans plusieurs affaires dont une seule eût suffi pour occuper
son temps et ses ressources.
Quant à la France, il venait de conclure (1474) avec son
beau-frère, Édouard d’Angleterre, un traité qui renouvelait les anciennes
alliances, et par lequel le roi s’engageait à envahir les états de Louis XI, à
la tête de 10,000 hommes, avant le mois de juillet de l’année suivante. Il
devait, avec l’aide du duc de Bourgogne, faire la conquête du royaume, et
donner à ce dernier, pour prix de son assistance, le duché de Bar, les comtés
de Champagne, de Nevers, Rhétel, Eu et Guise, la
baronnie de Donzey et les villes dé la Somme, sans
exiger d’hommage pour ces seigneuries ni pour celles que le duc possédait déjà.
Le roi d’Aragon, le duc de Bretagne, le connétable de Saint-Pol,
la duchesse de Savoie et le duc de Milan étaient d’accord avec eux. — En même
temps, pour détourner les soupçons de Louis XI, Charles le Téméraire avait fait
avec lui une trêve d’une année (1er mars 1474).
Passons à l’Allemagne. Robert de Bavière, archevêque de
Cologne, ayant été en rupture ouverte avec son chapitre et les Etats du pays,
avait été mis au ban de l’Empire en 1469, et Hermann, frère du landgrave de
Hesse, s’était vu chargé de l’administration de l’archevêché. Robert, abandonné
par tout le monde, sauf son frère l’électeur palatin, venait de se décider à
implorer l’assistance du duc de Bourgogne et à le choisir pour avoué et
défenseur, afin d’être remis en possession de son diocèse. Charles, entraîné
par son caractère impétueux, accepta et envoya à Cologne l’ordre d’obéir; mais
on déchira sa sommation, et les armes de Bourgogne furent jetées dans la boue.
Le duc saisit avec empressement ce prétexte pour porter ses armes sur l’Empire.
Outre le plaisir de se venger de l’insulte reçue à Trêves, il espérait se
ménager quelques chances favorables, et il pensait en avoir fini de ce côté
avant qu’il fût temps d’agir contre la France.
Il entra sur-le-champ en campagne, et au mois de juillet
1474, il mit le siège devant Nuitz, ou Neuss, ville
forte située sur l’Erft, à une demi-lieue de son
embouchure dans le Rhin. Le landgrave Hermann y était enfermé avec 1800 hommes
d’armes et quelques seigneurs allemands.
Charles le Téméraire avait fait rapidement des
préparatifs immenses pour cette expédition; son artillerie était formidable :
elle consistait en trois cent cinquante pièces de divers calibres, parmi
lesquelles cent quinze serpentines. Aucun prince ne pouvait réunir ses troupes
aussi promptement que lui, elles étaient l’objet de tous ses soins, et il avait
fait à ce sujet plusieurs règlements très détaillés. Outre ses soldats
réguliers et ses vassaux, il tenait à gages bon nombre d’hommes qui vivaient
dans leurs foyers, mais qu’il passait en revue une fois par mois, et qui,
moyennant une faible paye, étaient toujours prêts à le suivre.
L’armée du duc de Bourgogne comptait plusieurs milliers
de lances garnies, ayant chacune six hommes, dont trois archers à cheval, un crânequinier, un couleuvrier et
un piquier, et en outre les trois archers pouvaient avoir leurs coutilliers et leurs pages. Deux conducteurs et deux
pionniers bardés de fer accompagnaient chacun des chariots de guerre et de
munitions. Charles avait aussi à sa solde un grand nombre de mercenaires
anglais et plusieurs capitaines étrangers. Parmi ces derniers, on remarquait
deux condottieri italiens, le comte de Campo Basso et
le seigneur Galeotto, qui, anciens serviteurs de la
maison de Lorraine, avaient recruté une forte troupe d’aventuriers lombards
pour leur nouveau maître.
CHAPITRE II
De te qui advint en Alsace et dans le Sundgau après
l’exécution de Pierre de Hagenbach.
Cependant, malgré le siège de Neuss, le duc de Bourgogne
n’avait pas renoncé à ses projets de vengeance contre Sigismond et l’Alsace,
et, afin d’être bien servi de ce côté, il en avait confié le soin à Étienne de
Hagenbach, frère de Pierre, au comte de Blamont et aux deux frères de Hassenbourg. Ces chevaliers rassemblèrent 6000 hommes non
loin de Brondrault, et le Sundgau étant dégarni de
troupes, ils y firent des incursions et s’y conduisirent en véritables
vandales. Leur première apparition eut lieu le 17 août. Elle fut marquée par le
pillage de quatre bourgs. Ils reparurent bientôt après, ravagèrent trente
villages, entre Delle et Porentrui, massacrèrent un
grand nombre de paysans, détruisirent les églises, répandirent à terre le saint
Sacrement, enlevèrent des femmes et des enfants, qu’ils emportèrent, attachés
par les jambes, la tète en bas, aux pommeaux de leurs selles, et emmenèrent
plus de 200 têtes de gros bétail. On voyait parmi eux de ces Wallons qui, au
rapport de Kœnigshofen, vivaient plutôt comme des
animaux immondes que comme des hommes, et commettaient de telles atrocités,
qu'un chrétien n'oserait se permettre de les raconter.
Ces incursions se renouvelèrent encore à diverses
reprises. Les Bourguignons arrivaient ordinairement de nuit et aux lieux où on
s’attendait le moins à les voir paraître. Les gens de la campagne, livrés au
sommeil, étaient réveillés par le pillage et le meurtre; bientôt le pays fut
sillonné de larges espaces où on ne rencontrait plus ni êtres humains, ni
champs cultivés, où, en un mot, les débris fumants des chaumières et des églises
indiquaient seuls encore que ces landes désertes avaient été peu de temps
auparavant riches et peuplées. Parfois les Bourguignons se donnaient la
jouissance infernale de mettre le feu à un village et de l’entourer de manière
à ce que les paysans n’en pussent sortir et fussent brûlés dans leurs propres
demeures. La terreur répandue dans la contrée était telle, qu’on vit les
habitants de bourgs entiers abandonner leurs maisons et leurs terres pour
chercher un refuge dans des lieux plus éloignés.
Les Bâlois se hâtèrent alors de secourir l’archiduc. Ils
mirent en garnison à Delle deux cents hommes, qui furent, peu de temps après,
relevés par trois cents autres. Au seul bruit de leur approche, les
Bourguignons se retirèrent, tandis que quatre cents paysans, du taillage de
Ferrette, commandés par leur seigneur, Christophe de Richberg,
entrèrent dans la haute Bourgogne, résolus de mettre Blamont au pillage. Mais
le comte de Blamont les surprit avec six cents chevaux et les dissipa après en
avoir tué quatre-vingt-neuf et fait une centaine de prisonniers.
Les autres confédérés envoyèrent également des renforts
en plusieurs lieux du Sundgau, mais ils consistaient en fantassins, et la
pluie, qui tombait par torrents, avait endommagé leurs munitions de guerre. Les
troupes de Charles, au contraire étant bien montées, leur échappaient toujours,
et quoiqu’elles eussent des provisions de toute espèce en grande abondance,
elles évitaient le combat.
Tel était l’état des choses lorsque Louis XI proposa à
Sigismond et aux différents alliés de ce prince d’envoyer leurs représentants à
Lucerne ; l’automne était déjà fort avancé. Nous devons remarquer ici que,
malgré le traité conclu à Constance, le duc de Bourgogne comptait encore des
amis en Suisse, et que la duchesse de Savoie se donnait beaucoup de mouvement
pour empêcher la rupture définitive entre les montagnards et Charles le
Téméraire. Cependant, le roi réussit à vaincre l’opposition de quelques-unes
des ligues, et la réunion projetée eut lieu. Alors Louis ne négligea ni
dépenses ni soins d'aucune espèce pour pousser les confédérés à prendre une
décision prompte et énergique. Il espérait, comme il le disait à ses
conseillers intimes, que le duc de Bourgogne,— qu’il appelait la bête
féroce,—irait se briser le crâne contre les Allemands.
Toutes choses s’arrangèrent au gré des désirs du roi de
France, grâce à l’adresse de maître Gratien Favre, président du parlement de
Toulouse, du sire Louis de Saint-Priest, et de maître Mohet,
bailli de Montferrand en Auvergne, ses ambassadeurs; grâce aussi à l’activité
de Nicolas de Diesbach et à l’horreur qu’inspirait
généralement la conduite des Bourguignons dans le Sundgau.
L’assemblée se sépara après avoir décidé que l’on
entrerait en campagne au prochain jour de saint Simon et saint Jude. Les
Suisses envoyèrent sans plus tarder leur lettre de défi au comte de Blamont, et
le héraut impérial, Gaspard Harter, porta à Charles
celle de l’archiduc et de ses alliés du Rhin. Le héraut, arrivé à Neuss,
remplit son message. Les chroniqueurs rapportent que le duc de Bourgogne,
étouffé par la colère, ne lui répondit que par les mots à peine articulés de «
Berne, Berne! »
Les confédérés se réunirent à Héricourt, entre
Montbéliard et Béfort, au nombre de 20,000, au jour
désigné. Les Suisses formaient à peu près la moitié de cette armée, dont les
membres portaient, en signe d’union, une grande croix blanche. Le contingent de
Strasbourg était de2000 fantassins et 250 chevaux; un train d’artillerie considérable
accompagnait ce corps, et il fallait dix-huit étalons vigoureux pour mettre en
mouvement la pièce principale, qu’on nommait der strauss (le bouquet). Le sieur Jean de Berenfels commandait
les Strasbourgeois, auxquels vinrent encore se joindre les forces de leur
évêque, Robert de Bavière
Les alliés entouraient depuis quinze jours le fort
d’Héricourt, et le siège était peu avancé. — Vers la saint Martin, le comte de
Blamont, espérant les surprendre et les tailler en pièces, s’approcha de leur
camp à la tête de 5000 hommes et de 7000 Lombard1 que le comte de Romont venait
de recruter en Italie pour Charles le Téméraire. Ces deux corps formidables
marchaient en silence, et leurs chefs se croyaient déjà sûrs du succès de leur
ruse. Mais quelques-uns des gens de Strasbourg étaient sortis du camp pour
chercher des fourrages; voyant venir à petite distance une troupe nombreuse,
ils ne surent d’abord qu’en penser, et l’un d’entre eux, nommé Von Hage, homme courageux et déterminé, résolut d’avancer, afin
de savoir si c’étaient des amis ou des ennemis. Il arriva ainsi à portée
d’arbalète des Bourguignons; — une flèche, dirigée contre lui, perça son bras
de part en part; cependant il ne tomba point de cheval, et revint à bride
abattue auprès des siens, en criant : « L'ennemi arrive, il veut nous
surprendre. »
A ces mots, proférés d’une voix de Stentor et qui
retentissent bientôt dans le camp des confédérés, chacun court à ses armes. Un
instant après, les alliés marchent à la rencontre des comtes de Blamont et de Romont,
la mêlée commence. Les Zurichois, sous la conduite de Félix Relier, les gens de
Berne, de Lucerne, de Soleure et de Bienne, sous celle de l’avoyer Scharnachthal; les Strasbourgeois, ayant Berenfels à leur tête, se précipitent sur l’ennemi avec une
irrésistible impétuosité et poussent de grands cris pour s’exciter mutuellement
au combat; le désordre se met aussitôt dans l'infanterie bourguignonne, malgré
une position favorable; les longues piques des Suisses empêchent la cavalerie
d’approcher. Les deux comtes ne s'étaient point attendus à une bataille en
règle, leurs troupes se débandent; les hommes d’armes autrichiens et les nobles
de la Souabe s’élancent à leur poursuite; ils en assomment 2000, en brûlent
encore 300 dans deux villages voisins où ils s’étaient réfugiés; et, s’il faut
en croire les chroniqueurs, cette journée ne coûte aux alliés que quelques
blessés et trois morts.
La déroute des Bourguignons avait été complète, et les
confédérés recueillirent un riche butin. Ils s’étaient emparés, entre autres
choses, de deux pierriers et d’un grand chariot chargé de provisions destinées
au fort d’Héricourt. Ce qu’on ne put emporter fut brûlé sur place.
La nouvelle de la défaite des deux comtes étant parvenue
dans l’intérieur de la ville assiégée, Etienne de Hagenbach et l’un des frères
de Hassenbourg, qui la défendaient avec 400 hommes,
demandèrent à capituler. Ils en sortirent le 16 novembre 1474; l’archiduc Sigismond
en prit possession le même jour et y laissa une garnison de 200 cavaliers et
200 fantassins. Après la dispersion de l’armée ennemie, les alliés se
séparèrent pour rentrer dans leurs foyers respectifs. Les Strasbourgeois
arrivèrent chez eux dans la soirée de la fête de sainte Catherine. On les reçut
avec de grands honneurs; ils se rendirent aussitôt à la cathédrale pour
remercier Dieu de la victoire et consacrer à Notre-Dame cinq drapeaux conquis
sur les Lombards.
Les Bâlois ramenèrent dans leur ville soixante
prisonniers, parmi lesquels se trouvaient dix-huit de ces Wallons qui avaient
commis les plus grandes atrocités dans le Sundgau. On les condamna à être
brûlés vifs. La sentence reçut son exécution le 18 décembre, et l’on y procéda
avec beaucoup de solennité. Les magistrats urbains, en grand costume, à cheval
, accompagnés des geôliers et d’un grand nombre d’officiers subalternes,
portant tous les marques distinctives de leurs fonctions, allèrent, au son
lugubre d’une cloche particulière, chercher les criminels à la prison. Ils
furent conduits processionnellement à la place de l’Hôtel—de—Ville; là ils
s’assirent sur des sellettes, et lecture de leur jugement leur fut faite du
haut du balcon de l’hôtel, en présence d’une foule d’assistants. Ensuite on les
mena avec les mêmes cérémonies à une esplanade ouverte, sur laquelle s’élevait
un immense bûcher. Les Wallons y ayant été précipités, le bourreau y mit le
feu. Pendant ce temps la cloche continuait à tinter. Elle formait en quelque
sorte l’accompagnement de chants funèbres qui se prolongèrent jusqu’au moment
où la flamme s’abaissant, fit voir aux spectateurs qu’il ne restait plus rien
des dix-huit condamnés.
Cependant les Bourguignons s’étaient de nouveau réunis
sous les ordres du comte de Blamont, et recommençaient leurs ravages dans le
Sundgau, aux environs mêmes du fort d’Héricourt. Leur défaite avait en quelque
sorte aiguillonné leur haine, ils pillaient et massacraient avec les plus
effroyables raffinements de barbarie.
Les alliés renforcèrent la garnison de Montbéliard, et
après avoir tenu des conférences à Colmar, ils se disposèrent à rentrer en
campagne. Louis XI, dont les ambassadeurs avaient encore assisté à ces
réunions, obtint de chacun des confédérés la promesse formelle de ne point
traiter séparément avec le duc de Bourgogne.
Le roi poursuivait alors ces négociations avec d’autant
plus de chaleur, qu’enfin il n’ignorait plus les projets de Charles et
d’Edouard d’Angleterre.
Plein de vigilance, il comptait éviter la guerre par la
politique, en divisant ses ennemis et en leur suscitant de graves embarras. Les
confédérés ne tardèrent pas à se rendre maîtres de plusieurs forts et villes
appartenant aux Bourguignons, et obligèrent ainsi ces derniers à mettre
momentanément un terme à leurs incursions.
CHAPITRE III.
De 11 grande armée impériale qui se réunit auprès de Neuss.
Pendant ce temps, le siège de Neuss continuait. Le duc de
Bourgogne ne quittait pas la place et rassemblait autour d’elle toutes ses
forces.
Les habitants commençaient à manquer de vivres et
faisaient de grands feux sur les clochers de leurs églises, pour avertir de
leur détresse une armée allemande campée sur la rive droite du Rhin, sous le
commandement de Guillaume d’Arenberg, mais qui ne pouvait venir à leur aide. —
Les bourgeois de Cologne, craignant pour eux-mêmes, demandèrent du secours aux
princes de l’Empire et aux villes du Rhin, et résolurent d’envoyer aussi une députation
à Augsbourg, où se trouvait encore l’empereur. Leurs ambassadeurs devaient supplier
Frédéric de leur prêter assistance, et lui représenter que s’il refusait
d’obtempérer à leur demande, leur ville et celle de Neuss seraient ravagées de
fond en comble par le duc de Bourgogne. Ce seigneur faisait des efforts
désespérés, parce qu’il voulait à tout prix en finir sur les bords du Rhin,
avant l’époque fixée avec le roi d’Angleterre pour attaquer la France.
Frédéric, prince avare, doué d’une grande perspicacité
lorsqu’il s’agissait de s’assurer quelque avantage pécuniaire, et en qui la
passion de l’or, si indigne d’un roi, faisait taire même la voix de l’honneur
et le soin de sa réputation,— Frédéric, disons-nous, jugea de suite qu’il
pourrait profiter du besoin qu’on avait de son intervention dans l’affaire de
Neuss. Il répondit donc aux députés : qu’ayant vécu aux dépens de la ville
d’Augsbourg et étant hors d’étal de solder ses comptes, il lui était impossible
d’en sortir, à moins qu’on ne voulût acquitter sa dette. Il fallut céder; les
différents Etats de l’Empire payèrent pour lui 30,000 florins, lui firent un
don de 1000 florins d’or, et s’engagèrent à le défrayer jusqu’à son arrivée à
Cologne.
Louis XI, qui voulait le décider à agir, promit aussi de
lui faire passer, sous les ordres des sires de Craon et de Sallazar,
un renfort de 20,000 hommes dès qu’il serait devant Neuss.
L’empereur fit partir enfin ses lettres de convocation
pour les princes, Etats et villes d’Allemagne, et leur enjoignit de réunir
leurs contingents; quant au duc de Bourgogne, il fut déclaré ennemi du
saint-empire; Frédéric et les princes lui adressèrent leurs Absags-Briefe,
rédigés dans la forme voulue.
Ceci se passait en octobre. Au mois de novembre,
l’empereur arriva à Andernah, entre Coblentz et Cologne. — Beaucoup de seigneurs allemands
l’accompagnaient. L’armée impériale se montait déjà à près de 60,000
combattants, bien qu’elle fût loin d’être au complet. Mais cette armée, au lieu
d’agir, s’arrêta à grande distance de Neuss, et Frédéric se borna à envoyer
quelques renforts à Guillaume d’Arenberg.
Heureusement les pluies d’automne avaient beaucoup
endommagé les ouvrages des Bourguignons et obligèrent Charles à changer quelques-unes
de ses dispositions. Les gens de Cologne en profitèrent pour ravitailler Neuss.
L’hiver s’écoula de la sorte, l’empereur restant immobile
à Andernach, et le duc continuant le siège, malgré les démarches du légat du
pape et du roi de Danemark. Ce dernier revenait de Rome, et s’était rendu à Düsseldorf,
à la sollicitation de Frédéric, pour servir de médiateur entre les parties
belligérantes. Rien ne pouvait briser l’orgueil de Charles ni le décider à
céder. Il proposa cependant au roi Louis XI de prolonger pour six mois la trêve
convenue entre eux : son offre fut acceptée.
Le roi profitait des loisirs que lui laissait
l’obstination du duc pour mettre ordre aux affaires intérieures de son royaume
et traiter avec plusieurs princes sur l’appui desquels Charles avait compté. Il
n’oubliait pas non plus ses engagements avec les Suisses, auxquels il faisait
payer exactement les sommes qu’il leur avait promises.
Enfin, cependant, vers les fêtes de Pâques de l’année
1475, six mois après l’envoi des lettres de convocation, les princes et villes
qui n’avaient point encore réuni leurs contingents mirent leurs troupes en
mouvement. Strasbourg fit partir par terre 100 lances bien équipées, le mardi
de la semaine sainte, sous la conduite du chevalier Philippe de Müllenheim. Les cavaliers étaient vêtus de costumes blancs
et rouges que leur donnait la ville; un train d’artillerie assez considérable
les suivait.
Cinq cents fantassins, portant des uniformes aux mêmes
couleurs , s’embarquèrent sur le Rhin, dans huit grands bateaux, le lundi
suivant.
Plusieurs volontaires s’étaient joints à eux. On comptait
parmi ces derniers les gentilshommes les plus distingués du pays, tels que plusieurs
sires de Müllenheim, de Zorn, de Kaggeneck,
de Bock, etc.
Quatorze barques, chargées de tentes, de munitions de
guerre et de vivres de toute espèce pour les hommes et les chevaux, suivaient
les huit premières.
Les commandants et porte-enseignes de la troupe étaient
l’ammeistre Lienhard, Conrad Hungerstein, et Hans Hauszen L’évêque Robert ajouta 100 lances au contingent de
la ville, et en confia la direction au comte Frédéric de Bitsche et au sire Walter de Thann.
Les troupes des autres cités d’Alsace se mirent en
mouvement en même temps que celles de Strasbourg; aucune d’elles ne manqua à
l’appel: Bâle envoya 250 cavaliers, commandés par le chevalier Velt de Neusteins.
Les Strasbourgeois, étant arrivés au camp impérial,
furent admis immédiatement à défiler devant l’empereur. Frédéric se plaça sur
un balcon avec un grand nombre de princes et de seigneurs du plus haut lignage,
et donna des éloges extrêmes à la tenue de ce corps.
Les 500 fantassins et l’artillerie parurent les premiers,
ensuite vinrent les cavaliers de la ville et ceux de l'évêque. Philippe de Müllenhein fermait le cortège et portait le magnifique
étendard de Strasbourg, riche en dorures et en peintures. On y voyait, d’un
côté, l’inscription : A solo Christo Victoria; — de l’autre, la légende
; Venite ad puerurn Christum omîtes qui onerati estis, tracée autour des images de l’enfant Jésus
et de la sainte Vierge, patronne de la ville. Les bras étendus, la mère du
Sauveur semblait donner sa bénédiction à ceux qui marchaient sous cette
bannière vénérée.
De nouvelles troupes grossissaient journellement l’armée
impériale; enfin elle se monta à 80,000 hommes.
Quelques rixes, survenues entre les corps de Bâle et de
Nuremberg d’abord, puis entre ceux de Strasbourg et de Münster, retardèrent,
pendant quelque temps encore, le départ pour Neuss. Cette dernière querelle,
dans laquelle Nuremberg, Augsbourg, Francfort et le Rheingau s’étaient déclarés
pour Strasbourg, Lubeck et Aix-la-Chapelle pour Munster, coûta la vie à plus de
60 hommes. On eut beaucoup de peine à calmer le tumulte, et le Strasbourgeois
qui en avait été le premier auteur fut publiquement décapité. Enfin, l’armée
s’ébranla le mardi avant la Fête-Dieu ( 1475). L’on décida, dans ces
circonstances, en faveur de Strasbourg, une difficulté agitée depuis longtemps,
Cette ville prétendait au privilège de porter l’étendard impérial, par
conséquent de tenir le premier rang et de voir marcher sa bannière à côté de
celle de l’Empire. Nuremberg, Cologne, Augsbourg, Francfort et Ulm lui contestaient
ce droit. Cologne s’était rendue justice à elle-même en s’emparant du drapeau;
mais elle fut forcée de le restituer à Strasbourg, et Philippe de Müllenheim eut l’honneur de le porter le premier jour. Les
autres villes ne jouirent de cet avantage que dans les journées suivantes.
Quant au droit d’avoir sa propre bannière près de l’aigle impériale, Strasbourg
y fut maintenue, et primait en ceci toutes les cités d’Allemagne.
On arriva, vers dix heures du matin, à un demi-mille de Neuss, et aussitôt une escarmouche s’engagea
entre les corps avancés des deux partis. La perte des Bourguignons fut beaucoup
plus considérable que celle des alliés.
Plusieurs autres petits combats eurent lieu les jours
suivants.
C’était à de semblables luttes que se bornaient les
exploits des deux puissantes armées qui maintenant étaient en présence.
Evidemment Frédéric avait plus envie de traiter que de se battre, et à chaque instant
il envoyait le cardinal Forli, légat du pape Sixte IV, au camp du duc de
Bourgogne, pour essayer de ramener ce prince à dès dispositions plus
pacifiques. Mais Charles restait sourd à toutes les propositions; oubliant que
ses Etats étaient dégarnis et menacés, il ne voulait en aucune façon renoncer
au projet de s’emparer de Neuss.
Tout cependant aurait dû le porter à accueillir
favorablement les ouvertures de l’empereur, car Edouard d’Angleterre avait
achevé ses préparatifs et était prêt à descendre en France. Lord Scales, beau-frère du roi, vint même à Neuss afin d’engager
le duc à en lever le siège. Charles, qui, dans son obstination, paraissait un
être privé de jugement, ne tint aucun compte des représentations de
l’ambassadeur anglais; il croyait son honneur attaché à la prise de cette place
qu’il entourait depuis onze mois et à laquelle il avait livré inutilement
cinquante assauts. Son armée était lassée, fatiguée, et à la suite des immenses
travaux qu’il lui avait fait exécuter, son camp ressemblait à une ville où l’on
trouvait des jeux de boule et de paume, des boutiques et des cabarets. Le duc
avait fait jeter même un pont sur un bras du Rhin, mais sa construction avait
coûté la vie à un grand nombre de Bourguignons, et il fut ruiné par les Allemands,
sans avoir été d’aucune utilité.
Enfin, un événement auquel Charles aurait dû s’attendre
depuis longtemps, mais qui n’en était pas moins imprévu pour lui, opéra ce que
n’avaient pu faire ni la raison ni l’intérêt. Le jeune duc René de Lorraine lui
déclara la guerre.
CHAPITRE IV.
Des choses qui advinrent en Lorraine pendant le siège de
Neuss, el comment le duc René déclara la guerre au duc Charles.
Nous sommes obligés de faire maintenant un pas rétrograde
et de rendre compte de ce qui s’était passé récemment en Lorraine.
Malheureusement pour le duc de Bourgogne, ses troupes, en traversant la
province, n’avaient nullement respecté les conditions du traité conclu avec René.
Loin de payer comptant les vivres, elles pillaient comme si elles se fussent
trouvées en pays conquis. » Le soldat avoit vescu partout si licencieusement » disent les auteurs
lorrains « et s’était rendu si outrageux par ses continuelles pilleries, rançonnements
et violences, qu’il n’avait été que bien peu diffèrent de l’ennemi tout ouvert
et déclaré. » Les habitants des campagnes s’étaient avisés alors de réfugier
leurs meubles et leurs provisions dans les églises. Les Bourguignons en
brisèrent les portes, enlevèrent ce qui y était déposé, et accablèrent de coups
et des plus mauvais traitements ceux qui voulaient s’opposer à leur insolence.
Les Lorrains, peu endurants par nature, témoignaient fort haut l’aversion que
leur inspiraient les étrangers, et se rendaient en foule à Nancy, afin de
porter plainte au bon duc René. Ce prince avait réclamé l’exécution des
conventions, mais inutilement; les soldats de Charles n’en continuèrent pas
moins leurs exactions et n’étaient point réprimés par leurs chefs. Le duc de
Bourgogne lui-même, auquel on s’était adressé, n’avait tenu aucun compte des
doléances de son jeune allié; il s’était contenté de dire : « Que tels dommages
n’étoilent si grands qu’on se le figurait. »—Puis, à la satisfaction qui
en fut demandée : « N’étaient premièrement que remises, réponses pleines de
mépris et enfin paroles d’un refus absolu, tellement qu’il apparaissait assez
que rien ne le retenait de pis faire, sinon les empêchements et les difficulté
de la guerre en laquelle il se trouvait avec les Allemands. »
Louis XI, toujours admirablement instruit des événements,
avait jugé l’occasion favorable pour amener la rupture du traité conclu entre
les deux ducs. Le seigneur delà Trêmouille, sire de Craon,
et Thierry de Lénoncourt, bailli de Vitry, furent envoyés
à Nancy, afin de reprendre des négociations précédemment entamées par
l’entremise de Charles et Achille de Beauveau, du
capitaine de la Charité et de Jean de Paris, conseillers du roi. Louis XI les
chargeait de dire à René, qu’en considération de sa grande jeunesse, il lui
pardonnait les arrangements faits avec Charles de Bourgogne, mais à condition
qu’il les romprait immédiatement et qu’il renouvellerait l’alliance avec la
France, alliance sur laquelle reposaient d’ailleurs la sûreté et l’existence
même du duché de Lorraine.
René, indigné des mauvais procédés des Bourguignons,
avait accueilli avec joie les propositions de Louis XI. Il s’était empressé de
prêter, pour lui et sa mère, entre les mains des deux derniers ambassadeurs, le
serment de servir le roi contre tous ses ennemis.
Louis XI, à son tour, déclarait avoir reçu le duc René et
la comtesse Yolande au nombre de ses amis, vu leur renonciation à l’alliance
forcée qu’ils avaient conclue avec son sujet rebelle Charles de Bourgogne. Il
promettait de les défendre contre qui que ce fût, de les maintenir en
possession de leurs domaines, et de ne conclure ni paix ni trêve sans les y
comprendre.
Sur ces entrefaites, l’empereur, fatigué de l’inutilité
de ses démarches auprès de Charles le Téméraire, avait envoyé le sieur de
Montreuil et plusieurs gentilshommes de Strasbourg, Bâle et Schelestadt au duc de Lorraine, pour lui enjoindre d’interdire dorénavant le passage de ses
Etats aux gens de Bourgogne.
René avait consenti. Frédéric s’engagea, de son côté, à
ne pas traiter séparément avec Charles, et à protéger la Lorraine,
conjointement avec le roi de France, contre toutes attaques.
Plusieurs autres conditions furent encore stipulées:
l’empereur promit de porter les villes de Metz, Toul et Verdun à se déclarer
pour René, et de lui faire restituer diverses places situées dans les pays du
duc Charles.
Sous la teneur du même traité, Adolphe, archevêque de
Mayence, Jean, archevêque de Trêves, et Albert, margrave de Brandebourg, électeurs
du saint-empire, agréèrent et consentirent que le duc de Lorraine entrât ainsi
dans leur alliance, aux termes arrêtés entre l’empereur et lui. Le tout fut
fait dans le camp impérial de Zuntz, le 17 mai 1475.
Cependant, René avait lieu de craindre que l’évêque de
Toul, ami du duc de Bourgogne, ne pût se dispenser de prendre parti pour ce
prince. Il pria donc le pape Sixte IV d’envoyer en Lorraine son légat,
Alexandre de Forli, pour demander au prélat de demeurer neutre. Le légat parla
à l’évêque et aux chanoines, et René, étant venu à Toul et les ayant vus les
uns après les autres, se rendit à l’Hôtel-de-Ville et engagea les magistrats et
les bourgeois à ne donner aucun secours à son ennemi. L’évêque, le chapitre et
le corps de ville promirent au duc tout ce qu’il voulut, et il se retira fort
content à Nancy, après avoir reçu les présents ordinaires en vin, bœufs,
moutons, foin et avoine.
Le légat persuada de plus à l’évêque de se retirer dans
son abbaye de Luxeu, pour ôter tout soupçon au duc René,
et le pape même lui écrivit qu’il ferait très prudemment de demeurer tranquille
dans ce monastère. Antoine obéit, après avoir donné des ordres pour fortifier
Liverdun et Mézières.
Toutefois, les Bourguignons étaient encore en possession
de leurs quatre places d’armes, et continuaient à rançonner le pays; de jour en
jour, les réclamations des gens de la campagne devenaient plus nombreuses et
plus pressantes.
René, voulant mettre un terme à ces exactions, consulta
son conseil, et se rendit en France, à Notre-Dame de Liesse, où se trouvait
alors Louis XI. Le roi l’engagea à défier Charles, et lui donna une promesse
écrite de l’assister de toute sa puissance.
Le duc suivit cet avis. Aussitôt après son retour à
Nancy, le 9 mai 1475, il « dépêcha vers Charles un héraut, avec charge de lui
dénoncer la guerre de sa part, et en signe de ce, lui gager le gantelet
ensanglanté, comme lors en étroit la coutume.»
Le messager, serviteur du sire de Craon, et nommé le
More, connaissant par ouï dire les fureurs du duc de Bourgogne, lui remit la lettre,
jeta le gantelet, et se sauva de toute la vitesse de son cheval, craignant que
Charles n’ordonnât qu’on le noyât dans le Rhin. Mais le duc le fit rattraper,
et au lieu de le maltraiter, il lui remit un de ses plus riches vêtements, avec
12 florins d’or, en lui disant d’un ton très enjoué :
« Voilà pour les bonnes nouvelles que tu m’apportes,
mais dis à ton maître qu’on lui donne de perfides conseils, car nous allons
mettre fin à cette guerre, et nous serons bientôt en Lorraine. »
Cette réponse ayant été portée à René, il comprit que la
lutte était prochaine et s’en retourna vers Louis XI. Le roi mit à ses ordres
400 lances sous le commandement du sire de Craon, et s’écria : « Mon beau
cousin, si le Bourguignon vient en Lorraine, nous y irons en personne. »
René donna tous ses soins à bien traiter les Français, et
se prépara à entrer en campagne. Son armée étant réunie, l’on se mit en marche.
Pierrefort et Fauquelmont furent enlevés en peu de
jours.
Les troupes stationnèrent ensuite dans le pays messin, et
le sire de Craon s’empara de Danviltiers, situé entre
Verdun et Montmédy.
Tel était l’état des choses, lorsque René reçut une
longue lettre de Charles le Téméraire. Ce prince essayait encore de lui faire
des remontrances, de lui prouver que ses motifs pour se déclarer son ennemi
étaient frivoles, et qu’il ne pouvait, sans violer son serment et son honneur,
sans devenir parjure, en un mot, « se liguer contre lui avec qui que ce soit, fùt-ce avec l’empereur et le roi de France. »
Cette épître, écrite, selon l’auteur lorrain, avec toutes
les aigreurs et animosités qui « se peuvent imaginer » finissait par les menaces
suivantes :
« Nous vous sommons, par ces présentes, et cette fois
pour toutes, de garder et observer vos serments, foi et promesse, ainsi que
tous les articles du traité, de cesser entièrement de faire par vous-même, et
par aucun de vos vassaux ou sujets, guerre, mort et dommage contre nous ou
contre nos pays et sujets, pour le service de l’empereur, du roi de France ou
d’autres quelconques. Et si avec eux ou avec l’un d’eux vous avez fait quelque
traité contre nous, nous vous sommons de le révoquer comme nul. Nous vous
sommons aussi de permettre à nos gens, serviteurs et sujets, le passage par
votre pays, et nous vous avertissons que si vous faites contrairement à la paix,
nous procéderons contre vous ainsi qu’il appartient contre les violateurs de
leur foi, serment et parole. Et, de plus, nous tâcherons, moyennant l’aide de
Dieu, notre créateur, de vous donner à connaître la différence qu’il y a de
notre amitié et bienveillance avec notre inimitié et hostilité, que vous
préviendrez, j’espère, par votre repentance. »
Charles envoya aussi aux seigneurs lorrains un manifeste
pour porter à leur connaissance le défi de René, qu'il pensait, disait-il, lui
avoir été adressé sans leur participation. Il leur enjoignait de refuser au duc
leur assistance, les menaçant, au cas contraire, de les traiter avec autant de
rigueur que René lui-même.
Toutefois, la lettre de son ennemi n’intimida point le
jeune prince. Il avait commencé les hostilités, croyant pouvoir compter sur les
promesses de Louis XI, et ne doutant point que le roi ne parût bientôt à la
tète d’une puissante armée; il ne voulut donc plus reculer.
CHAPITRE V.
Comment le duc de Bourgogne leva le siège de Neuss.
Retournons à Neuss. Nous venons de rendre compte des
événements qui obligeaient le duc de Bourgogne à modifier ses projets. Il
aspirait maintenant à avoir les mains libres, afin de se porter en Lorraine
avec toutes ses forces, et il commença dès lors à prêter une oreille plus
favorable aux propositions de Frédéric
En conséquence, on dressa deux pavillons à petite
distance des camps, et le cardinal de Forli, légat de Sixte IV, le margrave de
Brandebourg, et le duc Albert de Saxe, s’y réunirent aux députés bourguignons
pour entamer la négociation.
On ne tarda pas à conclure un armistice, et les deux
parties belligérantes se visitèrent dans leurs camps respectifs.
Cependant, il y avait division parmi les princes et
seigneurs présents à l’armée impériale. Les uns faisaient les vœux les plus
ardents pour la paix, les autres, au contraire, désiraient la continuation de
la guerre. Au nombre de ces derniers, on remarquait surtout les ambassadeurs du
roi de France : c’étaient Jean Tiercelin, sieur de Brosses, et maitre Jean de
Paris, conseiller au parlement. Ils répétaient à tout propos à Frédéric que,
fort comme on l’était, il fallait en profiter pour écraser le duc de Bourgogne;
ils promettaient aussi pour l’avenir l’appui de leur maître, appui qui
jusqu’alors avait manqué aux confédérés; car Louis XI, bien qu’il en eût été
sommé à diverses reprises, n’avait point encore envoyé les 20,000 hommes qu’il
s’était engagé à fournir.
Mais l’empereur lui-même était trop disposé à la paix pour
que les discours des envoyés français pussent faire grande impression sur lui.
De puissantes considérations lui inspiraient des intentions favorables au duc.
— Frédéric n’avait point renoncé au projet de mariage entre son fils Maximilien
et Marie, héritière de Bourgogne, princesse déjà si souvent recherchée, et, si
souvent aussi, promise par son père; de plus, l’empereur craignait de se
brouiller avec le légat du pape et les électeurs, qui comprenaient que la
présente guerre coûtait beaucoup a l’Empire, sans devoir jamais lui rien
rapporter; enfin aussi Frédéric, il faut le dire, comptait fort peu sur les
belles promesses et les protestations de Louis XI.
Le sieur de Brosses et Jean de Paris s’empressèrent
d’informer leur maître de la disposition des esprits à Neuss, et Louis vit
qu’il fallait agir enfin, pour ne point perdre l’occasion d’anéantir la
puissance de celui qu’il regardait comme son plus mortel ennemi. Libre du côté
du midi, par la prise de Perpignan, qu’il avait enlevé le 10 mars aux
Aragonais, il pénétra en Picardie; mais, malgré la promptitude do ses succès
dans cette province, les intentions de l’empereur restèrent les mêmes.
Les ambassadeurs du roi résolurent de tenter un dernier
effort auprès de Frédéric. Ils lui représentèrent que Charles, étant dans toute
la vigueur de l’âge, et marié depuis peu d’années à une jeune princesse,
pourrait bien avoir encore des héritiers mâles, et qu’en outre il était fort à
présumer que Mlle. de Bourgogne, maladive, toute enflée et sujette à de graves
infirmités, comme la plupart des princesses de sa maison, n’aurait jamais
d’enfants. Ils n’avaient aucune preuve à fournir à l’appui de ce qu’ils
avançaient, mais ils répétaient la leçon que leur avait faite leur maître. Ils
promirent aussi à l’empereur, au nom de Louis XI, la plus riche part des
dépouilles de Charles le Téméraire. Toutefois, malgré son médiocre génie,
Frédéric était très-rusé, au dire de la Chronique de Strasbourg, « et fort au
fait des pratiques de la diplomatie française » ; il répondit simplement
aux envoyés du roi, en leur racontant en public l’apologue des chasseurs qui
vendaient la peau de l’ours avant d’avoir tué la bête. Les sieurs de Brosses et
Jean de Paris n’en tirèrent plus une parole après qu’il leur eut rappelé cette
fable, et furent congédiés de la sorte.
L’armistice durait encore. L’ammeistre Lienhard,
commandant des troupes strasbourgeoises, voulut en profiter. Il se dirigea vers
le camp bourguignon, suivi d’un bon nombre d’hommes d’armes, et témoigna le
désir de le visiter Charles le Téméraire, en ayant été informé, exigea qu’on
montrât toutes choses dans les plus grands détails à l’ammeistre et à ses
compagnons. Les uns croient qu’il donna simplement cet ordre, parce qu’il se
plaisait à éblouir les étrangers en étalant sa magnificence à leurs yeux;
d’autres pensent, avec plus de raison, qu’ayant l’intention de porter tôt ou
tard la guerre en Alsace, il se flattait d’inspirer aux Strasbourgeois une salutaire
terreur, en se faisant voir à eux dans tout l’appareil de sa puissance.
Quoi qu’il en soit, on les mena d’abord dans les bastions
où était la formidable artillerie bourguignonne, consistant en 350 pièces de
différents calibres, toutes prêtes à faire feu.
Après cela, ils furent conduits dans les tentes du duc,
qu’ornaient de riches tapisseries. Ils virent en premier lieu celle où se
trouvaient les principaux capitaines du prince, portant des armures ciselées,
les plus somptueuses possible; puis ils passèrent au pavillon occupé par
Charles lui-même. Ce prince dînait au moment où ils y entrèrent. Il portait un
habit gris de lin, d’une extrême simplicité; sa tête était couverte d’un large
béret tiré fort avant sur le front, et de dessous lequel ses grands yeux noirs
« lançaient de farouches regards ». Assis seul à sa table, on avait servi
devant lui différents mets dans de grands plats d’argent. A sa droite, étaient
trois médecins et plusieurs de ses vieux conseillers; à sa gauche, s’élevait un
grand guéridon d’argent, en forme de vaisseau, porté sur un pied de même métal,
et couvert avec profusion de vaisselle d’or. Près de la porte, on remarquait
une quantité de coupes, dans lesquelles on offrait à boire à ceux qui se
présentaient. Le duc lui-même ne se désaltérait qu'avec de l’eau rougie d’un
peu de vin de Beaune, contenue dans quelques carafes de vermeil. En un mot, ajoute notre historien, « les
choses du monde les plus rares et les plus précieuses semblaient avoir été
rassemblées en ce lieu. »
Les Strasbourgeois, que l’appareil de la puissance de
Charles n’avait point effrayés, furent très-émerveillés du luxe qui régnait à
sa cour et à sa table. Jamais ils n’avaient rien vu de semblable, quoiqu’ils
eussent eu occasion d’assister aux repas de plusieurs grands seigneurs et de
pénétrer, à diverses reprises, dans les demeures de l’empereur et de l'archiduc
Sigismond. Mais chez ces princes, les habitudes domestiques étaient simples et
les mets peu recherchés.
Cependant, en sortant du camp, l’ammeistre Lienhard,
homme d’un sens droit et juste, se tourna vers ses compagnons et s’écria : «
Tout ce que nous venons de voir est fort beau, sans doute; malgré cela, le sort
de ce duc puissant ne me semble pas digne d’envie, car on assure qu’il n’a pas
un ami fidèle, et que ses serviteurs les plus intelligents l’ont quitté et se
sont rendus à la cour du roi de France, afin d’échapper à la sévérité et aux
fureurs de leur maître, fureurs qui ne sont jamais adoucies ni par la
libéralité, ni par les propos affectueux. »
Aussitôt que l’armistice eut expiré, et bien que les
négociations continuassent, Charles le Téméraire tenta un dernier effort. Le 24
mai, l’armée impériale avait fait un mouvement afin de se rapprocher de Neuss.
Le duc laissa derrière lui une partie de ses forces pour garder le siège,
rangea les autres en bataille, et traversa à gué la petite rivière d’Erft, qui le séparait de l’ennemi. Il attaqua d’abord la
gauche des Impériaux, auxquels son artillerie fit beaucoup de mal, et que la
cavalerie lombarde, conduite par Campo Basso et Galeotto, força à regagner le camp en désordre. Les
Allemands firent successivement trois vigoureuses sorties et furent toujours
repoussés. Alors le duc de Saxe déploya l’étendard de l’Empire, et l’on se
disposait à résister à une quatrième attaque; mais la nuit arrivait, et
Charles, content d’avoir sauvé sa réputation et sa gloire, se retira dans ses
quartiers.
Toutefois, cette bataille inspira à Frédéric un désir de
plus en plus vif d’en finir, et comme le duc était également pressé, les
négociations avancèrent avec beaucoup de rapidité, à partir de ce moment. On
tenait tous les jours des conférences, et en même temps, les deux armées, animées
par la haine réciproque la plus violente, se livraient à chaque instant de
petits combats partiels. Les troupes se massacraient entre elles, tandis que
leurs chefs traitaient de la paix. Dans le camp bourguignon, on faisait déjà de
grands préparatifs de départ, avant même que les conventions ne fussent
signées, et Charles, après avoir assiégé la ville durant plus de onze mois,
s’en éloignait au moment où elle était réduite à toute extrémité et incapable
de tenir huit jours encore.
Frédéric, qui avait cité aux envoyés de Louis XI la fable
de la peau de l’ours, eût pu se rappeler aussi le mot du poète : car cette
guerre, pour laquelle on avait réuni toutes les forces de l’Allemagne, se
termina par une trêve de neuf mois. Charles donna encore à l’empereur l’espoir
du mariage prochain du prince Maximilien avec Mlle. Marie; on remit l’affaire
de Cologne au jugement du pape, et la ville de Neuss fut placée en dépôt entre
les mains du légat.
Le caractère du duc de Bourgogne et le puéril orgueil qui
le dominait ne se démentirent point jusqu’au bout. Il ne voulut pas quitter
Neuss le premier. Frédéric, se moquant de cette vanité ridicule, partit avant
lui.
Le duc donna encore un grand festin d’apparat au légat et
aux principaux seigneurs allemands, et les traita en fines épices. Enfin; le 27
juin, il s’éloigna de la misérable bicoque devant laquelle il venait de perdre
près d’une année.
Frédéric, ne songeant qu’à ses propres intérêts, avait
oublié complètement René de Lorraine dans le traité, malgré les engagements
pris récemment vis-à-vis de lui; et de même, il n’avait fait aucune stipulation
en faveur des membres de la ligue de dix ans. Charles persistait à vouloir en
tirer une éclatante vengeance, et l’empereur n’insista guère sur ce point, qui
personnellement le touchait peu.
Toutefois, les alliés ne s’effrayèrent point de l’abandon
dans lequel on les laissait, et, voyant qu’on ne songeait pas à eux dans les
conférences de Neuss, ils se réunirent à Bâle durant la semaine de la Pentecôte
Louis XI et René se firent représenter à cette assemblée. Le premier s’engagea
à opérer une diversion dans les Pays-Bas, tandis que les confédérés attaqueraient
Charles en Bourgogne; le second accéda formellement à la ligue de dix ans.
CHAPITRE VI.
De ce qui se passa dais le Sundgau. — Comment le duc de
Bourgogne mécontenta sou beau-frère Édouard d'Angleterre, et comment Louis XI
abandonna René de Lorraine.
La guerre avait été reprise dans le Sundgau pendant les
derniers mois de l’expédition de Neuss. Le comte de Blamont avait fait, du côté
de Montbéliard, une nouvelle irruption dans le pays. Les Bourguignons ne
s’étaient retirés qu’aprés avoir incendié quarante
villages et commis toutes les atrocités qui marquaient habituellement leur
passage.
Cependant, les alliés étaient rentrés en campagne pour
venger ces nouveaux désastres, et avaient vigoureusement riposté, sous le commandement
du comte Ostwald de Thierstein. Ils remportèrent
plusieurs avantages et se rendirent maîtres de divers forts en peu de temps. On
divisa le butin en trois portions égales. La première revint à Sigismond, la
deuxième aux Suisses, la troisième à Strasbourg et Bâle. Le contingent de la
première de ces deux villes se montait alors à 1800 hommes, tant cavaliers que
fantassins, et 12 pièces d’artillerie, parmi lesquelles on remarquait, outre le
Strauss, un pierrier immense.
Les alliés, forts de 16,000 hommes, investirent Blamont. Ostwald
de Thierstein, proche parent du comte, refusa de
prendre le commandement de cette expédition, et se fit remplacer par Hermann d’Eptingen. On serra de très-près la citadelle et la ville;
le Strauss y causa beaucoup de dommage. Lors du premier assaut, les
Strasbourgeois attaquèrent, d’un côté les Bâlois, et les gens de Sigismond de
l’autre; mais les assiégés leur jetèrent, du haut de leurs murs, une si grande
quantité de ferraille, dé ruches à miel et de vieille poterie, qu’ils furent
obligés de se retirer. 7000 Bourguignons arrivèrent sur ces entrefaites, avec
le projet de délivrer la place; mais en même temps aussi les confédérés
reçurent un renfort de 5000 hommes. La garnison consentit donc à capituler. On
lui laissa la vie sauve, et les alliés entrèrent dans le fort. Ils y trouvèrent
beaucoup de munitions de guerre, entre autres huit tonnes de poudre, et une
masse considérable de provisions de bouche. Le château lui-même était digne de
servir à la résidence d’un prince, et renfermait dans son enceinte plusieurs
sources d’une eau excellente
Après s’être rendus maîtres de Blamont, les confédérés,
voulant s’assurer les passages du Jura, prirent encore Grandson et Orbe.
Tel était l’état des choses dans les pays de la
confédération, lorsque Charles le Téméraire levait le siège de Neuss. Il
voulait, disait-il, «se dépêcher d’en finir avec tout le monde, notamment avec
les Lorrains, pour tomber sus aux paysans. » C’est ainsi qu’il appelait les
Suisses et les Alsaciens. « Ils n’ont pas su encore ce que c’est que combattre,
ajoutait-il, mais nous allons le leur apprendre. » Les alliés, à qui on répéta
ces orgueilleuses paroles, n’en furent point émus. « C’est plutôt le duc Charles,
dirent-ils, qui ne connaît pas la guerre ; il n’a jamais eu affaire personnellement
avec des hommes; au reste, il ne s’agit pas de grands mots ; mais on verra qui
parlera le plus haut à la fin. »
D’un autre côté, l’armée de Louis XI avait continué à
dévaster la Picardie et l’Artois. Le roi avait réuni également des forces en
Normandie, pour protéger ce pays contre les Anglais, qui n’étaient point
arrivés encore, quoique l’époque fixée pour leur débarquement fût déjà passée. Il
avait mis aussi Paris sous les armes, garni Dieppe et Eu, et garanti
l’organisation, la solde et les privilèges des francs-archers.
Enfin, cependant, le 5 juillet 1475, l’armée d’Edouard
traversa la mer, sur 500 bateaux plats de Hollande et de Zélande, mis à sa
disposition par Charles de Bourgogne. Ce passage dura plusieurs jours, et Louis
ne fit aucune tentative pour s’y opposer. Le roi d’Angleterre avait à sa suite,
outre l’élite de sa noblesse, formant un redoutable corps de 1500 hommes
d’armes, 14000 archers à cheval, et de plus une troupe de 3000 hommes commandée
par le sire de Duras et lord Dudley, et destinée à se rendre en Bretagne;
enfin, un grand nombre de fantassins et d’ouvriers chargés de dresser les
pavillons et de servir l’artillerie.
Edouard IV, au moment de son embarquement à Douvres,
avait envoyé son héraut normand Jarretière à Louis XI, pour le sommer de
lui rendre son royaume de France, et protester qu’en cas de refus, il ne
pourrait attribuer qu’à lui-même les maux qui en résulteraient. Le roi était en
nombreuse compagnie au moment où la lettre de défi lui fut remise. Il la lut
sans que l’expression de son visage pût faire deviner aux assistants le contenu
de l’épître, et ayant pris Jarretière à part dans un cabinet voisin, il
se mit à deviser familièrement avec lui. Après lui avoir représenté qu’il
n’avait aucun sujet de haine ou de mécontentement personnel contre son frère
d’Angleterre, il ajouta : que la saison était trop avancée pour commencer la
guerre, et que les Anglais, au lieu de trouver en son cousin Charles l’allié
sur lequel ils comptaient, auraient en lui un homme «revenant du siège de
Neuss, pauvre et déconfit en toutes choses. » Enfin il donna au héraut 300 écus
d’or et lui en promit encore 4000 s’il parvenait à opérer un accommodement
entre lui et Edouard. Il lui fit remettre aussi une superbe pièce de 30 aunes
de velours cramoisi, par Philippe de Commines, sire d’Argentan.
Jarretière, sensible aux libéralités de Louis XI, qui
avait toujours le talent d’être généreux à propos, avoua à ce prince que le roi
d’Angleterre lui-même ne paraissait pas avoir grand goût pour la guerre. Il
promit de lui parler et d’engager les lords Howard et Stanley, très en crédit
auprès d’Edouard, à s’entremettre en cette affaire .
En effet, les Anglais avaient sujet d’être mécontents.
Ils s’étaient attendus à ce que le duc de Bourgogne, fidèle à sa parole, les
recevrait à la tête d’une belle armée, après avoir fatigué déjà les troupes de
Louis XI par une campagne de quelques mois. Loin de là, Edouard, en débarquant
à Calais, ne trouvait pas même son allié.
La duchesse de Bourgogne vint la première au rendez-vous.
Charles le Téméraire y arriva le 14 juillet après avoir passé à Bruges (12 juillet)
pour demander des subsides aux Flamands. Il était seul; il avait laissé ses
troupes derrière lui, afin qu’elles pussent se reposer, et comptait les
rejoindre pour exécuter ses desseins contre la Lorraine. Il proposait alors un
nouvel arrangement au roi d’Angleterre. Au lieu de faire la guerre ensemble,
conformément à leur première convention, il voulait qu’ils la fissent
séparément; qu’Edouard entrât en France du côté de Soissons, tandis qu’il irait
lui-même châtier les Lorrains, les Suisses et les Alsaciens, et qu’enfin on se réunit
à Reims, où le roi se ferait sacrer. Il promettait aussi l’assistance du
connétable de Saint-Pol, qui, disait-il, leur
remettrait Saint-Quentin et les autres places fortes du nord de la France.
Ces projets ne plaisaient guères aux Anglais. Le duc,
voulant essayer de calmer leur mécontentement, crut ne pouvoir se dispenser
d’accompagner au moins son beau-frère en Artois et en Picardie.
Toutefois, durant ce voyage même, Charles témoigna à
Edouard la défiance la plus injurieuse; il pénétrait seul dans les villes pour
y passer les nuits, et laissait camper ses alliés dans les bourgades voisines.
L’on arriva ainsi en vue de Saint-Quentin. Les Anglais en approchaient sans
nulle précaution, comme d’une cité amie dont les portes leur seraient ouvertes.
Mais le connétable de Saint-Pol, qui trompait tout le
monde à la fois et n’avait d’autre but que d’embrouiller de plus en plus les
affaires pour se soustraire aux vengeances de Louis XI et de Charles, le
connétable de Saint-Pol, disons-nous, ne les y laissa
point entrer et leur fit tirer sus. Alors leur colère éclata. Edouard reprocha
aigrement au duc de Bourgogne la témérité de sa conduite; cependant ce dernier
refusa de renoncer à aucun de ses plans, et partit, sur ces entrefaites, pour
demander de l’argent et des hommes aux États de Hainaut, et marcher ensuite
contre la Lorraine.
Louis XI ne manqua pas de profiter du fatal aveuglement
de son rival. Il entama aussitôt une négociation et rencontra peu d’obstacles.
Châties le Téméraire avait trop vivement offensé les Anglais pour qu’ils
pussent lui pardonner. Grâce à une promesse de mariage futur entre le petit
dauphin et l’une des filles dit roi d’Angleterre, grâce aussi aux
appointements, à l’argent comptant, à la précieuse vaisselle et aux bijoux que
Louis distribua aux conseillers d’Edouard, il conclut avec ce prince, moyennant
50,000 écus de pension viagère, une trêve qui devait expirer le 29 août 1482, à
l’heure du coucher du soleil.
L’acte fut signé à Amiens; les deux monarques eurent une
entrevue à Pecquigny, sur la Somme, et le roi
d’Angleterre s’en retourna dans ses États avec ses troupes.
Le duc de Bourgogne perdit ainsi le plus redoutable de
ses alliés. Il en eut un violent accès de colère et maltraita fort en paroles
son royal beau-frère; mais, plein de confiance en sa propre puissance, il ne
conçut d’ailleurs aucune inquiétude.
Au commencement de septembre, il rassembla ses forces
près de Montmédy, où était établi son quartier général.
Il avait convoqué 40,000 hommes et une grande partie de
l’artillerie dont nous avons parlé, et qu’on regardait avec raison comme une
des plus belles de l’Europe. Charles, en passant en revue cette armée
admirablement équipée, rêvait une suite de brillantes conquêtes qui, dans sa
pensée, finirait nécessairement un jour par celle de la France.
Le duc ordonna au comte de Luxembourg et à Campo-Basso, le condottiere italien, de commencer la guerre.
Ces deux généraux, étant entrés en Lorraine, y prirent
plusieurs châteaux; la nouvelle en fut portée à René, qui s’était déjà jeté sur
le pays de Luxembourg et y avait forcé Pierrefort, Montfaucon et quelques
autres places, et qui alors se disposa à marcher contre l’ennemi. Mais à sa
grande surprise, le sire de Craon refusa de le suivre, sous prétexte qu’il
n’avait pas l’ordre de combattre les Bourguignons. Peu de jours après, il
partit même inopinément pour reconduire en France les troupes qu’il avait
amenées au secours du duc de Lorraine.
La cause de ce changement soudain dans la conduite de
Louis XI était connue seulement de quelques confidents intimes. Le roi se trouvait
encore sous l’impression de terreur que lui avaient causée la venue des Anglais
et leur alliance avec Charles le Téméraire. Désirant éviter la guerre à tout
prix, il résolut d’avoir, avec le duc de Bourgogne, au moins une trêve de
quelques années. Il comptait à la vérité lui susciter secrètement, en toute
occasion, des ennemis et des embarras, le bien enferrer avec les Allemands et
les Suisses; mais il voulait s’abstenir de paraître lui-même en scène, et ne
donner ouvertement aucun sujet de mécontentement à*son beau cousin. Sa
vengeance, pour se faire attendre, n’en serait que plus sûre, et suivant
l’expression de notre chroniqueur alsacien : « Il reculait pour mieux sauter ».
Il fit donc indirectement des propositions à Charles, et celui-ci, qui, peu de
temps auparavant, avait follement refusé d’être compris dans le traité
d’Amiens, accepta cette fois avec empressement, afin d’éviter que les troupes
françaises stationnées dans la Champagne n’entravassent ses progrès en
Lorraine. Une trêve de neuf années fut signée, le 13 septembre, au château de Soleuvre, entre Luxembourg et Montmédy. L’une des
conditions de ce traité était : que le duc livrerait à Louis, le connétable de
France, Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol,
coupable de haute trahison, et père du comte de Luxembourg, l’un des principaux
capitaines de l’armée bourguignonne. Le connétable, qui depuis longtemps
trompait à la fois le roi et le duc, s’était réfugié à Mons en Hainaut, et rappelait
à Charles leur ancienne amitié et les services qu’il lui avait rendus
autrefois, en le suppliant de ne point le livrer au roi de France, son parent
et son plus mortel ennemi. Louis XI s’engageait, si on lui remettait le comte
de Saint-Pol, à abandonner au duc de Bourgogne les
villes de Ham et de Saint-Quentin, et les places de la Somme qui appartenaient
au connétable. Charles ayant consenti, le sire de Craon reçut son ordre de
départ. C’était donc au moment où René allait subir les conséquences du défi
envoyé à Neuss, à l’instigation du roi de France, que ce monarque astucieux et
perfide abandonnait sou jeune allié.
CHAPITRE VII.
Comment le duc de Bourgogne fit la conquêt de la
Lorraine.
Le duc de Lorraine ne perdit point courage. Il ne croyait
pas encore à la déloyauté de Louis XI et pensait que des secours ne tarderaient
pointa lui arriver. En attendant, il concentra sa petite armée à Pont-à-Mousson,
afin d’aviser
aux meilleurs moyens de défendre le pays. Il y fut rejoint par un corps de 6000 hommes, suivi d’un train d’artillerie assez
considérable. Ce renfort lui était envoyé par les villes d’Alsace, qui, voyant
le danger de leur allié, sc montraient fidèles au traité conclu avec lui.
Messire Adam Sporn commandait pour Strasbourg, Jean
de Housse pour Colmar, Antoine de Falkenstein pour Schelestadt, Bernard de Honstein pour Bâle, et Walther de Thann pour Thann. Un bon nombre de braves capitaines,
tant lorrains que gascons, vinrent aussi se réunir au duc René : c’étaient Colinet de la Croix, le grand Michaud, le grand Bertrand,
Menai et Gratien de Guerre, le petit Jennois, Jennois de Bidos, Roquelaure, Fortune, et d’autres encore.
L’on résolut alors de mettre garnison seulement dans les
places principales du pays, et d’employer les munitions des petites pour
approvisionner Nancy, Pont-à-Mousson et Epinal. Celle-ci avait été reprise aux
Bourguignons peu de temps auparavant. Le commandement de la première de ces
trois villes fut confié au bâtard de Calabre il y entra avec 4000 hommes. Celui
d’Epinal échut au bâtard de Vaudémont, et comme l’on estimait que le fort de
Briey, au nord du Barrois, serait le premier assiégé par le duc Charles, on y
laissa 80 Suisses et Alsaciens, sous le commandement de Gérard d’Avillers,
auquel s’adjoignirent volontairement plusieurs gentilshommes du pays, non à
l’intention de la garder contre une telle force , mais bien afin de gagner
toujours du temps et de tailler quelque besogne à l’ennemi. René, ayant fait
ces dispositions, déclara que son intention était de se rendre sur-le-champ en
France, afin de rappeler au roi ses promesses et de lui présenter la lettre
qu’il avait signée en l’engageant à défier Charles le Téméraire.
Plusieurs des seigneurs présents exprimèrent leurs doutes
sur le succès de ce voyage. Mais le jeune prince leur répondit, plein dé
confiance et d’espoir : « N’ayez là-dessus ni doute ni souci, il
tiendra sa parole comme un bon roi » ; et ayant recommandé les siens à
Dieu, il monta à cheval pour aller trouver son ancien allié.
Tandis que les garnisons lorraines travaillaient à
augmenter les moyens de défense des places confiées à leur garde, le duc de
Bourgogne avançait.
Ainsi qu’on l’avait prévu, il ouvrit la campagne par le
siège de Briey. Son artillerie commença à en battre les murailles. Malheureusement,
Gérard d’Avilliers, ayant eu la main enlevée d’un
coup de serpentine, ne put plus se défendre, et rendit le fort à discrétion. Le
duc condamna les habitants à lui payer 12,000 florins, gracia les gentilshommes,
et fit pendre en environs d’icelui les 80 Suisses et Allemands. « Un cas,
ajoute encore notre auteur lorrain, advint alors plein d’étonnement et d’admiration.
Ce fut qu’un soldat bourguignon, s’étant mis en devoir, avec plusieurs
blasphèmes exécrables, de rompre la porte d’une chapelle de saint Antoine qui
est hors de ladite ville de Briey, se sentit à l’instant épris d’une ardeur qui
l’embrasa tellement par tout le corps que la mort s’ensuivit sur-le-champ.»
Charles, ayant enlevé l’une après l’autre les citadelles
du Barrois, qui étaient dégarnies de troupes, arriva, le 25 septembre, à
Pont-à-Mousson et y entra après quelques jours de siège. Il partit de là pour
Nancy, et fut rejoint en route par 600 Italiens, que Frédéric, prince de Tarante, lui amenait de Naples. On leur fit grand accueil.
La marche des Bourguignons vers la capitale du pays fut
en quelque sorte triomphale. Ils s’emparèrent, sans rencontrer de résistance
nulle part, des villes par lesquelles ils passaient. Le 30 septembre, ils
traversèrent le village d’Essey, et tandis qu’ils défilaient en vue de Nancy,
les gardes des tours et des portes firent feu sur eux de leurs plus gros
canons. Charles poussa plus loin et établit son camp sur les hauteurs de
Saffay1, en face du bourg Saint-Nicolas.
Cependant René était arrivé auprès de Louis XI, l’avait
suivi jusqu'à Dieppe et le pressait, avec les plus vives instances, d’être
fidèle à ses serments. Le roi, qui ne jugeait pas encore le moment venu
d’abandonner ouvertement son allié, renouvela ses promesses. Mais il feignit de
ne pouvoir croire que le duc de Bourgogne fût en Lorraine, et affirma que, pour
le moment, il lui était impossible de donner plus de 800 lances, commandées par
l’amiral de France. Le duc reprit le chemin de ses Etats avec ce faible secours.
Dès son arrivée, il put apprécier le fond qu’il fallait
faire sur les assurances de Louis; « car, comme il fut un jour question de
donner sus aux Bourguignons et avec beaucoup d’avantage les Français furent
tenus dans l'inaction par leur chef, qui, peu après , en mit même la meilleure
partie dans la ville de Bar, dont il devait, disait-il, augmenter la garnison ».
La surprise douloureuse que cette conduite fit éprouver à
René augmenta encore quelques jours plus tard; un messager, arrivé de la part
du roi, apporta à tous les Français qui n'étaient pas dans le Barrais l’ordre
de s'y retirer immédiatement.
Le duc se vit donc abandonné pour la seconde fois, et
sans pouvoir en deviner la cause, alors que le danger devenait de plus en plus
pressant. Après s’être retiré momentanément à Joinville, il se décida à partir
avec les Français pour rappeler encore à Louis la parole donnée. Mais, durant
le voyage déjà, le manque absolu d’égards de ceux en la compagnie desquels il
se trouvait, put lui faire pressentir l’accueil qu’il recevrait.
Cependant, les capitaines lorrains n’étaient pas restés
fidèles à leur premier plan, et avaient disséminé leurs forces dans une foule
de petits postes secondaires. Il n’y avait donc plus moyen d’organiser sur un
seul point une défense vigoureuse. Charles, après avoir pris Charmes, Dompaire
et Bruyères, qu’il saccagea et pilla avec la dernière rigueur, détacha une
partie de son armée, et lui ordonna de s’emparer de différentes forteresses
situées sur les deux rives de la Moselle, tandis qu’il investirait lui-même les
cités les plus considérables du pays. Il arriva le 40 octobre devant Epinal,
après une suite de succès non interrompus.
La garnison de cette ville se composait de 700 Allemands
et de troupes gasconnes. Les bourgeois d’Epinal, très dévoués au bon duc René,
s’armèrent eux-mêmes de piques, firent une sortie, et se jetèrent avec une si
inconcevable furie sur la cavalerie bourguignonne, que Charles ne put
s’empêcher de s'écrier: « Vainement je me flattais de voir tomber les
villes en ma présence ». Il se décida alors à commencer un siège en règle, mais
ses travaux, à tout instant détruits par les assiégés, avançaient fort
lentement.
Cependant la population d’Epinal, ayant appris sur ces
entrefaites qu’il n’y avait plus de secours à attendre de la France, vit bien
que tôt on tard il faudrait se rendre, et que, par conséquent, il était inutile
d’irriter le duc de Bourgogne par une longue résistance. Le 19 octobre, l’un
des premiers magistrats du lieu monta sur la muraille pour offrir au prince de
capituler, à condition toutefois qu’Epinal serait maintenue en ses franchises,
privilèges et libertés des temps passés, et que les étrangers en sortiraient,
vie et bagues sauves, sans qu’il leur fût fait aucun dommage.
Charles, qui désirait beaucoup obtenir par arrangement
cette importante cité, accepta ces propositions et prit possession solennelle
de la place dès le jour même.
« Il y fit son entrée en armes, avec le plus de magnificence
et d’apparat dont il se put adviser, enflé qu’il étroit
d’aise de cette prise plus que de toutes les autres ». Il portait un riche manteau
brodé d’or, sa tête était couverte d’une toque ornée de pierreries; des joueurs
d’instruments, vêtus de soie blanche et montés sur de fort beaux chevaux, le
précédaient. Aux côtés du duc paraissaient le prince de Tarente et les ambassadeurs
de France, d’Aragon, de Naples, de Milan et de Venise, qui ne l’avaient pas
quitté depuis la conclusion du traité de Neuss. Puis venaient les seigneurs de
la cour, et l’armée divisée en compagnies marchant bannières déployées.
Charles, enchanté d’avoir fait une si belle conquête, parla avec beaucoup de
bonté à la bourgeoisie, s’engageant « à la garder en son état, à la défendre de
toute sa puissance, à lui être gracieux seigneur, et à ne lui demander d’autre ôtage que le serment déloyauté et de fidélité ». Ce
serment lui fut prêté. Cependant, ajoute le chroniqueur lorrain, le duc
vit bien que les « hommes d’Epinal étoilent Bourguignons par force et Lorrains
par affection; aussi il laissa une nombreuse garnison dans leur cité, pour la
défendre contre les Français et les Allemands ».
Charles ne rencontra plus aucune résistance pendant le
reste de la campagne. Beaucoup de villes se rendirent à lui; il y en eut qui
envoyèrent même des députés au-devant du prince pour faire acte de soumission,
et bientôt le duché fut conquis, à l’exception de Sirey, Bitsche,
Sarrebourg et Nancy.
Les Bourguignons reparurent aux environs de la capitale
de la Lorraine dans la matinée du 25 octobre 1475. L’avant-garde, commandée par
le comte de Campo-Basso, annonça leur arrivée du côté
de la Madeleine. « Ils y surprirent le troupeau de bestes rouges , dit notre historien, et le comte le fit aussitôt conduire à Rozières, où ses gens étoilent en garnison ». L’armée
s’arrêta dans la plaine autour de Nancy, et se mit à travailler aux
retranchements. De toutes parts on dressa des pavillons. Celui du duc,
infiniment plus vaste que les autres, était garni de soie et de broderies d’or,
et décoré, à son entrée, d’une grande croix de Saint-André. Charles avait pris
son quartier dans le faubourg de Saint-Thiébaut; ses généraux se logèrent à
celui de Saint-Nicolas et à Saint-Jean de Vieilaitre,
commanderie de Malte, au couchant de la ville’.
Le duc de Bourgogne mit une ardeur extrême à faire
pousser les travaux du siège; à tout instant il venait diriger les ouvriers,
qui poursuivaient leur besogne nuit et jour, sans presque prendre de repos, et
faisaient de tels progrès, en dépit des escarmouches des assiégés, qu’en moins
de huit jours Nancy était complètement entourée.
Charles commença alors à battre vivement la place, les
Nancéiens lui ripostèrent de leur mieux.
Ils avaient leur principale artillerie sur une grosse
tour, du haut de laquelle ils faisaient un affreux ravage dans le quartier de
la commanderie de Saint-Jean, où était la plus forte batterie des assiégeants.
Les Bourguignons braquèrent contre cette tour un énorme pierrier et réussirent
à faire une grande brèche à l’étage supérieur de l’édifice.
L’un des capitaines de la garnison y monta, et ayant vu
le pierrier et les artilleurs qui l’affûtaient, il redescendit, et dit à Jacob,
maître canonnier allemand, adroit et assuré de ses coups: « Charges ta
pièce, vises de ce côté; prends ta mèche; je remonte, et quand ils viendront
affûter, je crierai : Feu! et par saint Georges, je crois que bien nous besognerons
». Tout se passa, en effet, comme le capitaine l’avait prévu : au signal
convenu, le pierrier bourguignon était culbuté, et ceux qui le servaient
gisaient à côté, morts ou blessés.
Les chroniqueurs racontent aussi que, pendant
l’intervalle des feux, un gentilhomme, nommé Nicolas des Grands-Moulins, avait
coutume de paraître à une fenêtre pour narguer les troupes de Charles, en leur
chantant de grivoises chansons, avec accompagnement de cliquettes. Les
assiégeants l’excitaient à se montrer, en lui criant : « Hé! beau
chanteur, viens nous dire une chansonnette ». Grands-Moulins se hâtait
d’obéir, et aussitôt les archers de diriger une grêle de traits contre la
fenêtre; cependant, jamais le gai chanteur n’était atteint, et maître Jacob
disait avec un imperturbable sang-froid : «Flèches pour saint Sébastien, elles
ne font pas de mal »
Cependant, Nancy avait été approvisionnée fort à la hâte,
et l’on commençait à y souffrir une terrible disette. Les assiégeants au
contraire avaient en grande abondance des vivres de toute espèce. La ville
était serrée de trop près pour que la garnison pût faire des sorties et se ravitailler
au dehors; les Bourguignons la regardaient déjà comme prise, et tous les soirs
ils criaient aux Nancéiens d’un ton goguenard : « Par les cinq plaies de Dieu,
demain vous serez à nous et tous pendus. » Les défenseurs de la place
répondaient à ces bravades, en lançant dans le camp ennemi des pierres énormes
armées de gros crampons de fer, qui y occasionnaient un ravage affreux, et
faisaient dans leurs drapeaux des trous à passer un bœuf.
Charles le Téméraire éprouvait une impatience et une
irritation excessives de cette résistance à laquelle il avait été fort loin de
s’attendre ; il craignait les maladies pour son armée car, « la saison étroit
lors pluvieuse ». Depuis longtemps aussi l’époque à laquelle il devait livrer à
Louis XI le comte de Saint-Pol, connétable de France,
était passée. Le roi réclamait auprès du duc l’exécution de ses promesses; le
menaçant, en cas de refus, de mettre ses troupes en campagne, d’arrêter ses
progrès en Lorraine et d’empêcher la prise de Nancy. Charles avait déjà cherché
plusieurs fois à gagner des répits, car il pensait qu’une fois maître de la
ville, il pourrait garder le comte. Il redoutait la honte dont il se couvrirait
en abandonnant un ancien ami muni d’un sauf-conduit signé de sa main, à celui
même qui avait juré sa perte. Cependant le duc, occupé depuis trois semaines du
siège de la place, pressé et menacé de plus en plus, se décida enfin, et
chargea secrètement de celte triste mission les sires Hugonnet et d’Humbercourt. Charles donna à ces deux seigneurs les instructions les plus
précises. Ils devaient conduire le prisonnier à Pèronne et le remettre aux gens du roi le 24 novembre, à moins qu'ils ne reçussent la
nouvelle de la prise de Nancy, auquel cas ils auraient à retourner sur leurs
pas. Cet ordre fut suivi à la lettre : le 24, Saint-Pol passa aux mains de l’amiral de France, des sires de Saint-Pierre et du
Bouchage, et de maître Cerisais.
Son procès fut entamé et mené très-vite, le connétable
fut décapite en place de Grève, le 19 décembre suivant.
Charles ayant eu l’infamie de livrer celui qui s’était
réfugié chez lui au moment du danger, pensa n’avoir plus rien à craindre de
Louis XI. II se décida donc à laisser son armée dans l'inaction et à attendre
patiemment que la disette forçât les assiégés à se rendre. Mais une seule
journée eût changé la destinée du malheureux connétable. Le 25 novembre, le
gouverneur de Nancy reçut, par un transfuge qui réussit à pénétrer dans la
ville, une lettre de René, lequel lui mandait que, «n’ayant rien pu obtenir du
roi de France, il l’engageait à ne s’opiniâtrer à plus longue résistance et à
rendre la place au duc de Bourgogne ».
Dès le lendemain, le bâtard de Calabre envoya à Charles
le Téméraire un projet de capitulation. Il offrait de lui remettre les clefs de
Nancy, à condition qu’elle serait maintenue dans ses anciens privilèges, que
les habitants et la garnison auraient la vie et les biens saufs, et que les
étrangers pourraient sortir avec tout ce qui leur appartenait. Cette
proposition comblait les vœux de Charles, il l’accepta sans hésiter.
Le 27, les Allemands, les Français, les Gascons et les
gens des villages voisins, formant un corps de 4000 hommes environ, évacuèrent
la ville avec armes et bagages. Charles et les seigneurs de sa suite les
voyaient défiler et ne pouvaient se lasser d’admirer leur bonne tenue et leur
air martial.
Le 30 novembre, jour de la saint André, patron de la
Bourgogne, le prince fit son entrée par la porte de Notre-Dame, dite alors de
la Craffe. Charles, pour témoigner sa joie, avait voulu prendre possession
de Nancy avec toute la pompe possible, et présider lui-même à l’arrangement du
cortège triomphal.
On voyait paraître d’abord six trompettes habillés
d’étoffe de soie blanche et bleue, et portant à leurs instruments des fanons
sur lesquels étaient brodées les armoiries de Bourgogne; puis défilaient ces
mêmes hérauts qui avaient déjà joué un rôle lors de l’arrivée de Charles à
Trêves. Ils précédaient 400 hommes d’armes magnifiquement équipés et bardés de
fer. Venait ensuite le grand écuyer, tenant en main l’épée d’honneur nue et la
pointe en l’air. Ce seigneur marchait immédiatement en avant du duc de
Bourgogne, qu’entourait une grande foule de gentilshommes. On remarquait, au
milieu d’eux, le prince de Tarente, Antoine de Bourgogne, le duc de Clèves, le
sieur de Bièvre, les comtes de Nassau, de Simays, de Campo-Basso et de Marie . Charles était coiffé d’une toque
d’écarlate, « qu’on ne lui avoi vu porter qu’ès plus grandes et signalées
assemblées esquelles il s’était trouvé; elle était
garnie d’une croix de Saint-André, et enrichie, en ses quatre bouts, de quatre
pierres précieuses, savoir : un diamant, un rubis, un saphir et une escarboucle
, qui étaient de prix inestimable; et tout le reste de son train et
équipage se voyait en tel arrois, qu’il n’était en rien diffèrent de celui d’un
bien grand t monarque ».
Il avait laissé entr’ouvert son manteau de drap d’or
parsemé de perles et de pierreries, afin qu’on pût voir son armure richement
ciselée. La housse de son cheval, de drap d’or également, traînait jusqu’à
terre, et sur la tête du coursier flottait un immense panache de plumes d’une
éblouissante blancheur. Les nobles de sa suite, armés de pied en cap, portaient
aussi des manteaux en superbes étoffes, enrichis de broderies ou de perles; ils
avaient au col de grosses chaînes d’or, et le poitrail de leurs chevaux était
garni de clochettes en vermeil qui résonnaient à mesure que le cortège
s’avançait.
Après le duc et ses entours, paraissait un corps de douze
pages, qui, par l’élégance de leur tenue et de leurs costumes, l’emportaient
sur tout ce qui les précédait. C’étaient les plus beaux jeunes gens de la cour
de Bourgogne, vêtus uniformément de drap d’or. « Mais chacun d’eux était couvert
d’un armet différent de son compagnon; l’un avait un heaume, l’autre un capuset, l’autre une salade, l’autre un chapeau de Montauban,
etc. ; et tous portaient autour de la tète un cercle, d’argent doré, orné de
quantité de pierreries ».
Les selles de ces pages étaient de vermeil et rehaussées
d’une infinité de pierres précieuses.
Les baillifs du Hainaut et du
Brabant et le margrave de Rœthelin fermaient la
marche, tous vêtus et montés à qui mieux mieux.
Le duc mit pied à terre à l’église cathédrale, en
laquelle il entra après avoir abandonné aux chanoines d’icelle sa monture,
qui fut depuis vendue 100 florins d’or.
Le prince ayant assisté à une grand’ messe chantée par
les prélats de sa suite, prêta, entre les mains du prévôt de Saint-George, le serment accoutumé, « l'accompagnant,
suivant notre historien, de beaucoup d’autres grandes promesses, afin de tant
mieux captiver la bonne grâce et la bienveillance de ses nouveaux sujets,
et s’engageant à leur être juste et bon seigneur en toutes choses ». Les nobles
furent indignés de ce que le prévôt eût reçu le serment de Charles, comme s’il eût été souverain de naissance et de droit. « Quant à ses belles assurances, dit Thiriat dans ses
mémoires, ils ne firent aucun semblant de les ouïr, et il paraissait, à leur
silence, qu’avoient perdu par mort tout sentiment, tant furent froidement
reçues les cajoleries et festoiements que leur fit le prince ».
Charles se rendit au palais dans le même ordre
qu’auparavant, et au son des trompettes. Les salles en avaient été décorées
avec beaucoup de soin, et un grand repas y attendait les vainqueurs.
Cependant, au milieu de ce mouvement, Charles pouvait
voir que les Lorrains regrettaient le duc René. Nulle part de joyeuses acclamations
n’avaient accueilli son passage dans les rues; il n’avait rencontré sur son
chemin que de tristes visages. Il était affligé de cette disposition des
esprits; il éprouvait alors le sincère désir de se faire aimer et de rester à
jamais en possession des Etats qu’il venait de conquérir et qui unissaient ses
domaines de Flandres et de Bourgogne. Tout aussi maintenant semblait lui
présager un avenir prospère. Il était en paix avec ses voisins, il ne redoutait
plus Louis XI, et le 27 novembre, au moment même où Nancy se rendait à lui, il
concluait un nouveau traité d’alliance avec l’empereur; quant aux membres de la
confédération de dix ans, enfin, il les regardait comme de faibles ennemis
qu’il écraserait facilement avant la fin de l’hiver. Il mit donc tous ses soins
à satis faire les Lorrains pendant les jours qui suivirent son entrée. Il
ordonna même que les portes du palais restassent constamment ouvertes, afin que
l’on pût venir lui parler à volonté.
Le 48 décembre, le duc convoqua les trois Etats du pays à
Nancy, pour le 27 du même mois.
On dressa à cet effet, dans la salle principale du
palais, un pavillon de soie sons lequel était placé le trône ducal, et on y
abattit deux cheminées afin d’avoir plus
de place. Les seigneurs, les ecclésiastiques et les députés des villes s’étant
réunis au jour désigné, Charles parut accompagné de son frère Antoine, bâtard
de Bourgogne, du prince de Tarente, du duc de Clèves et des sieurs de Marie et
de Bièvre, avec lesquels il avait diné.
Le duc, s’étant placé sur son siège, salua courtoisement
l’assemblée et prit la parole avec une douceur et une affabilité qu’on ne lui
avait jamais vues auparavant.
Il chercha d'abord à démontrer aux assistants qu'il était
infiniment plus avantageux pour eux d’être placés sous sa domination que sous
celle de leurs anciens maîtres, parce qu’il avait le pouvoir et la volonté de
les défendre contre leurs voisins ; puis il promit aux Etats de faire du duché
de Lorraine le centre de ses vastes domaines, de choisir Nancy pour sa capitale
et sa résidence habituelle, et de la rendre la plus belle ville du monde, sans
qu’il en coûtât rien à ses nouveaux sujets. Le duc annonça aussi qu’il
laisserait M. de Bièvre aux Lorrains pour les gouverner en son absence; enfin
il termina son discours en déclarant aux Etats qu’en retour de sa sollicitude
paternelle, il comptait sur leur obéissance, leur amour et leur reconnaissance.
Ces belles paroles ne firent cependant pas grand effet,
dit Bournon, « encore que mons de Bièvre et Mons la Marche, capitaine ès-gardes du susdit duc, firent crier
en payant, vive le duc de Bourgogne et Lorraine ! »
Toutefois, chacun était satisfait de ce que Charles eût
désigné pour le remplacer en son absence ce même sieur de Bièvre (Jean de Rubempré)
que son caractère droit et juste avait fait aimer généralement. Il était de la
famille de Croy et parent de René, mais très-dévoué
au prince bourguignon, qu'il servait avec une fidélité à toute épreuve, bien
que souvent il déplorât ses extravagances et lui fit à ce sujet des
remontrances inutiles.
M. de Bièvre choisit quelques seigneurs du pays pour lui
servir de conseil, comme Gaspard de Raville, Michel de Brandebourg, André d’Arancourt, Jean de Toulon et plusieurs autres.
Charles le Téméraire, ayant l’esprit rempli des grandes
entreprises qu’il méditait, créa encore plusieurs capitaines et leur ordonna de
tenir leurs troupes prêtes pour la fin de janvier 1476.
Il continua d’ailleurs, pendant le peu de temps qu’il
passa encore à Nancy, à prendre le masque d’un duc de Lorraine, et à se montrer
doux, humain et bienfaisant envers tous. — Il poussa si loin la mansuétude,
qu’il fit même un accueil favorable aux envoyés de Metz. Il avait cependant,
nous le savons, de graves motifs de rancune contre cette cité. Espérant
l’adoucir par la soumission, elle lui députa les Srs André de Rineck et Philippe Dex,
pour lui remettre une magnifique coupe d’or remplie d’anciennes monnaies du
même métal et 500 florins du Rhin. Charles reçut ces présents avec affabilité,
employa les monnaies pour en faire une longue chaîne, et se servit de la coupe
en plusieurs occasions.
CHAPITRE VIII.
De la querelle des ligues suisses avec le conte de
Romont, et comment la ville de Strasbourg se mit en état de résister au duc de
Bourgogne.
Il nous faut faire encore un pas rétrograde pour jeter un
coup d’œil sur les événements qui s’étaient passés en Suisse pendant le siège
de Nancy, et qui inspiraient à Charles un si vif désir de porter au plus tôt la
guerre dans le pays des ligues.
Les Suisses, les Bernois en particulier, étaient vivement
irrités depuis quelque temps par les vexations continuelles que leur faisaient
éprouver plusieurs des partisans du duc de Bourgogne, et surtout la duchesse de
Savoie et le comte de Romont. La duchesse, sœur de Louis XI, espérait, en
soutenant Charles le Téméraire, marier un jour Philibert de Savoie, son fils, à
Mlle Marie. Le comte Jacques de Romont était oncle de Philibert, et possesseur
de vastes domaines sur le lac de Genève. La duchesse et le comte avisaient
constamment aux moyens d’augmenter les forces de Charles, et avaient encore
recruté pour lui un bon nombre d’hommes en Lombardie. Les bandes lombardes
traversaient le mont Cenis et le Saint-Bernard pour aller rejoindre l’armée
ducale, et se conduisaient en Suisse comme en pays ennemi s’emparant de tout ce
qui était à leur convenance, accablant les habitants de vexations et de mauvais
traitements. Les ligues portaient leurs plaintes au comte de Romont, qui les
écoutait à peine. Ses propres gens poussaient l’insolence jusqu’à s’associer
aux Lombards pour piller et rançonner les marchands dont ils parvenaient à
s’emparer. Enfin le comte lui-même fit arrêter à Lausanne deux chariots
appartenant à des hommes de Nuremberg, et, trois jours après, huit bourgeois de
Fribourg et de Berne furent assassinés dans le pays de Vaud. Ces dernières violences
mirent les Suisses en mouvement. Lecomte de Romont, comprenant enfin qu’il
avait été trop loin, se rendit à Berne et promit à cette ville une entière
satisfaction. Mais dès qu’il fut de retour dans sa comté, on sut que le duc de
Bourgogne venait de le nommer son maréchal, et qu’il n'attendait que le moment
favorable pour prendre l’offensive. Dès lors on se détermina à le prévenir. Les
Bernois et les Fribourgeois envoyèrent des messagers dans toutes les ligues,
pour les engager à s’armer et défièrent le comte le 14 octobre 1475.
Chacun était prêt. Sans tarder davantage, les Suisses
pénétrèrent dans les domaines du seigneur de Romont, qui n’avait pas compté sur
une attaque aussi prompte et aussi vigoureuse. Avant qu’il eût eu le temps de
se mettre en défense, Moral, Cudrefin, Estavayer, Moudon, Yverdun, Romont et Grancourt étaient pris, et au bout de trois semaines il
avait perdu tous ses Etats Les Suisses massacraient ce qui essayait de leur
résister et ne faisaient quartier à aucun Italien. Après avoir ravagé le pays
de Neufchâtel et de Morat, ils entrèrent dans celui de Vaud; Lausanne se
racheta pour 2000 florins, les paroisses de La Vaux pour 5000. Jacques de
Romont essaya de réunir une armée à Morges, mais elle fut repoussée et obligée
de se retirer en Bourgogne; les Suisses pillèrent la ville. Genève aussi se
racheta moyennant 26,000 florins.
Après cette série de succès, les ligues consentirent à la
conclusion d’un armistice, qui devait durer jusqu’au commencement de l’année
1476.
Telles étaient les nouvelles apportées à Charles le
Téméraire pendant le siège de Nancy et qui lui avaient inspiré un ressentiment
si profond. Aussi, quoique son armée eût grand besoin de repos, il fit
sur-le-champ de nouveaux prêparatifs de guerre,
contre l’avis de ses plus fidèles serviteurs, et ordonna à ses hommes d’armes
de se trouver à Toul, dans la meilleure tenue possible, au commencement de
janvier. Chacun s’émerveillait de ce qu’ayant achevé si facilement la conquête
de la Lorraine, il voulût rentrer en campagne au cœur de l’hiver. Mais sa
résolution était inébranlable. Il disait à tout venant « que la peau de l’ours
de Berne l’empêcherait d’avoir froid »; qu’il en finirait en une fois avec les
Suisses et les Alsaciens, et que, pour ce qui était de la ville de Strasbourg,
il saurait bien s’en rendre maître par force, si elle ne consentait à livrer à
lui de plein gré.
Ces dernières paroles, répétées déjà à plusieurs reprises
par Charles, avaient été redites à Strasbourg, et les bourgeois comprirent
qu’il était nécessaire de mettre sur-le-champ leur ville en état de résister au
duc de Bourgogne, car sa puissance était grande et il avait une armée de plus
de 30,000 hommes. En conséquence, les magistrats et le sénat se réunirent pour
délibérer sur ce que l’on ferait dans ces circonstances critiques.
On voyait alors autour de Strasbourg, et fort près de ses
murailles, une quantité de couvents et d’autres bâtiments, dont un ennemi
pouvait facilement s’emparer. Or, une fois en possession de ces postes, il
devenait aisé do tirer dans la ville et de la contraindre à se rendre.
Beaucoup de membres de l’assemblée demandaient la
démolition de ces édifices; mais il en était qui possédaient des maisons hors
de l’enceinte des murs, d’autres qui avaient des créances sur leurs
propriétaires, d’autres encore dont les parents ou les enfants étaient dans les
couvents. Tous ceux-ci s’opposèrent aux mesures extrêmes, et l’assemblée se
sépara sans rien décider.
Le jour suivant, l'on convint que les principaux
sénateurs, auxquels on adjoindrait quelques gens de guerre expérimentés ,
examineraient impartialement l’état des choses et feraient leur rapport à la
commune. Ces hommes, ayant fidèlement rempli leur mission, déclarèrent aux
magistrats qu’à moins de détruire les bâtiments extérieurs, la place était hors
d’état de soutenir un siège.
Les chefs de la république prévoyaient que, malgré cela,
le grand conseil ne prendrait encore aucune détermination, parce que la voix de
l’intérêt personnel faisait taire celle de l’intérêt général; ils résolurent
donc de réunir le corps des échevins, et de lui remettre la solution de cette
grave affaire
Les échevins demandèrent alors qu’on choisît parmi les constoffler huit hommes probes et loyaux, et qu’on les
investit d’un pouvoir dictatorial, en leur reconnaissant le droit de faire raser
et abattre tous les édifices qui pourraient compromettre la sûreté de la ville.
Ces hommes veilleraient également à l’approvisionnement de la place, tant en
munitions de guerre qu’en vivres. Les conseils, échevins et meistres les assisteraient
dans l’exercice de leurs fonctions, et feraient exécuter leurs ordres quels
qu’ils fussent. Quiconque y mettrait opposition serait puni en son corps et en
ses biens. Enfin, chaque citoyen, sans acception de rang ou de fortune, leur
prêterait serment de fidélité et d’obéissance.
L’élection des huit nouveaux magistrats eut lieu le lundi
avant la fête de sainte Galle; c’étaient les sieurs Ch. Frédéric de Bock, dit Sturmfeder, Pierre Schott, Hans de Bersch,
Hans Ehrle, Bernard Wurmsser,
Nicolas Renner, François Hag et Lienhard.
Aussitôt après cette élection, on vit régner à Strasbourg
une activité extraordinaire. Les huit constoffler portèrent dans l’exercice de leur pouvoir une vigueur et une présence d’esprit
admirables, et furent dès lors merveilleusement secondés par la bourgeoisie. La
ville rappelait en ce moment ces énergiques républiques de l’antiquité qui
sacrifiaient tout aux besoins de la patrie lorsqu’un grand danger la menaçait.
Le premier acte des nouveaux élus fut d’examiner encore
une fois les alentours immédiats de la cité et de s’assurer ainsi de
l’exactitude du premier rapport fait au sénat. L’ayant trouvé en tous points
conforme à la vérité, ils entamèrent avec les moines et les nonnes une négociation
relative à l’abandon de leurs couvents respectifs. Ils leur présentèrent en
même temps un décret du pape autorisant la destruction des monastères qui
gênaient la défense de Strasbourg.
La démolition fut commencée sur-le-champ et achevée à la
Chandeleur en 1476. On abattit ainsi, hors de Strasbourg, cinq beaux couvents,
deux églises, et six cent quatre-vingts maisons ou granges;
Les religieux des deux sexes furent conduits processionnellement
dans l’intérieur de la Villé, où on leur procura d’autres établissements. — Il y avait aussi dans Strasbourg même des maisons qui
obstruaient l’abord
des murailles d’enceinte.
On les renversa. En tout, le nombre des édifices détruits, grands et petits, se monta à treize cents. On eut soin encore de couper les arbres
auprès des
murs, de sorte que le terrain autour de la place était nivelé et entièrement découvert.
Des retenues d’eau furent faites au quartier appelé Finckwiller, on munit la cité d’un très-large fossé, et on
flanqua son enceinte de fortes tours.
Les constoffler ne négligèrent
pas non plus les approvisionnements. L’artillerie était en bon état, et l’on
fit de grands achats d’armes à feu; d’après les ordres des dictateurs, chaque
bourgeois aisé se fournit de tout ce qu’il fallait à son entretien et à celui
de sa famille pour deux années, et l’on déposa dans les greniers et celliers
publics des provisions de grains et de vin, de légumes secs et de viande salée
suffisantes à la consommation de huit à neuf ans.
Les magistrats avaient eu soin aussi d’écrire aux villes
riveraines du Rhin et aux cités de la Souabe. Dans leur lettre, qui, avant la
révolution de 1789, était déposée aux archives de Strasbourg, on remarquait la
phrase suivante : « Si, ce dont. Dieu veuille nous garder, le duc Charles
de Bourgogne vient nous assiéger, nous vous prions de venir à notre aide, vous
promettant, en ce cas, bonne solde exactement payée ».
Toutefois, Strasbourg n’eut que faire de l’assistance de
ces villes, car les événements se succédèrent avec trop de rapidité pour
laisser à Charles le Téméraire le loisir de songer à l’exécution de ses
menaces.
Ce prince faisait de son côté de grands préparatifs, et
ne doutait plus qu’il ne fût au moment de parvenir à l’accomplissement de ses
désirs les plus chimériques. Tout contribuait d’ailleurs à entretenir
l’illusion de son orgueil. Le vieux roi René d’Anjou promettait de lui léguer
la Provence; le duc comptait sur une amitié à toute épreuve de la part de la
duchesse de Savoie et de Galéas de Milan, et regardait la conquête de la Suisse
comme la chose du monde la plus aisée. A la vérité, les bons conseils ne lui
manquaient pas. Plusieurs de ses intimes lui prédisaient, de la part des
ligues, une résistance désespérée, et lui rappelaient les désastres de la
maison d’Autriche dans les Alpes. Mais il repoussait ces sages avis, les
croyant dictés par la pusillanimité. Louis XI lui-même, qui craignait pour les
Suisses et pour la France l’union intime de Charles avec la Savoie et le Milanais,
engageait de bonne foi le duc de Bourgogne à laisser les ligues en paix, et lui
proposait à ce sujet une entrevue à Auxerre. Charles ferma l’oreille à ces
ouvertures, dans lesquelles il ne voyait qu’une nouvelle perfidie.
Cependant l’armistice conclu avec le comte de Romont
était expiré, et les Suisses, après avoir tenu une assemblée à Zurich,
députèrent quelques-uns des leurs à Nancy pour faire des propositions de paix à
Charles. Ces envoyés devaient lui représenter qu’il n’avait pas grand’chose à gagner avec les habitants d’un pays pauvre et
sauvage, et qu’il trouvait plus d’argent dans les éperons de ses chevaliers que
dans toutes leurs montagnes. Ils étaient chargés même de lui offrir secrètement
de restituer ce qu’ils avaient pris au comte, et de renoncer à l'alliance avec
la France.
Le duc de Bourgogne rejeta ces propositions avec la
dernière arrogance. Depuis longtemps il ne tenait compte ni de roi, ni
d’empereur, et les Suisses et leurs amis lui paraissaient trop peu redoutables
pour qu’il eût à tenir registre de leurs doléances et de leurs griefs.
Les envoyés quittèrent donc Nancy. Bientôt après les
membres de la confédération de dix ans se réunirent à Bâle pour convenir de
leurs faits. Les deux villes de Strasbourg et Bâle retirèrent alors les 40,000
florins que chacune d’elle avait déposés pour acquitter la dette de Sigismond,
en s’engageant toutefois à les avancer de nouveau si Charles le Téméraire
revenait à des idées pacifiques, « et de telle sorte il advint que ce prince ne
garda point les terres engagées et ne reçut pas un seul ducat de la somme
prêtée au comte de Tyrol ».
|
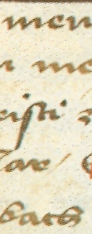 |
 |
 |
 |