cristoraul.org " El Vencedor Ediciones" |
BILIOTHÈQUE FRANÇAISE |
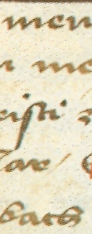 |
HISTOIRE DE LA LIGUE FORMÉE CONTRE CHARLES LE TÉMÉRAIRE1433-1477.
PAR
LE BARON MARIE-THÉODORE DE BUSSIERRE
AVANT-PROPOS.
La
manière dont une partie de l’Alsace fut engagée à Charles le Téméraire par
Sigismond d’Autriche, comte du Tyrol et cousin de l’empereur Frédéric III,
l’administration du landvogt bourguignon, la
confédération et les guerres qui en ont été les conséquences, forment un des
épisodes les plus caractéristiques de l’histoire du XV siècle. Le simple
récit des faits tel qu’il nous est livré par des chroniques contemporaines ou à
peu près contemporaines, donne la solution d’une foule de problèmes historiques
importants. Il nous fait connaître toutes les classes de la société d’alors,
les mœurs et les habitudes des nobles et des bourgeois, des princes et des
peuples. C’est d’ailleurs un drame complet, dans lequel l’action marche
incessamment, dont l’intérêt va toujours croissant, et qui se termine par une
des catastrophes les plus terribles et les plus méritées dont le souvenir nous
ait été conservé. L’ouvrage de tout un siècle est détruit en quelques heures à
la bataille de Nancy ; la maison de Bourgogne, redoutable rivale du royaume de
France aux prises avec la féodalité, est anéantie dans cette journée; la
maison de Lorraine y trouve son salut, celle d’Autriche sa puissance.
L’intervention divine se manifeste à chaque page dans cette histoire : le
Superbe est humilié, son pouvoir est brisé, la justice et le bon droit
finissent par triompher.
Le récit
de vengeances cruelles, de représailles sanglantes, exercées par les deux partis,
afflige sans doute souvent l’âme du lecteur; mais au milieu de ces tristes
scènes, trop fréquentes dans les annales du moyen âge, on est au moins consolé
par les manifestations énergiques d’une foi vivante et profonde, qui se
reproduisent à chaque instant. De nos jours, hélas! bien des gens qui ont
honnêtement vécu, suivant le monde, refusent de mourir en chrétiens. —A
quelques siècles en arrière, au contraire, nous voyons le scélérat lui-même
essayant dans ses derniers moments de reconquérir le ciel par la force de son
repentir.—La première partie de notre histoire en présentera un remarquable
exemple.
Nous
avions commencé à parcourir les anciennes chroniques de Lorraine et d’Alsace,
sans avoir la pensée de publier le résultat de notre travail. Mais, à la
lecture de ces vieilles pages si naïvement écrites, notre amour-propre national
s’est éveillé. Il nous a semblé que la plupart des historiens modernes
n’avaient pas apprécié à leur juste valeur le rôle que les cités d’Alsace ont
joué dans les désastres de Charles le Téméraire. Strasbourg, principalement,
s’est distinguée dans les guerres de ce prince avec les Suisses et les
Lorrains, par ses sacrifices, par le courage de ses troupes, par. la rapidité
avec laquelle se succédaient ses renforts. Nous avons voulu que justice fût
rendue à notre ville natale, et nous avons écrit ce qu’on va lire.
PREMIÈRE
PARTIE.
PIERRE
DE HAGENBACH.
CHAPITRE
PREMIER.
Comment
Sigismond, comte du Tyrol, engagea une partie de ses domaines à Charles le
Téméraire.
L’origine des démêlés de Charles le Téméraire avec les villes alsaciennes et les Suisses remonte au traité conclu entre ce prince et le comte Sigismond du Tyrol. Depuis
longtemps les communes suisses et la maison d’Autriche étaient en lutte
ouverte. Ces querelles incessantes se terminaient toujours à l’avantage des
communes. Sigismond, prince doué d’un esprit pacifique et d’un caractère conciliant, se voyait poussé à la guerre malgré ses dispositions personnelles. Les nobles
des pays environnants, ennemis jurés des Suisses, l’y excitaient, et ses
domaines, situés le long du Rhin, étaient ravagés à chaque instant.
Il eût
vainement attendu des secours de la part de son cousin, l’empereur Frédéric,
assez pauvre prince, qui cherchait à concentrer ses forces pour se mettre à
l’abri des invasions des Turcs, et qui, dominé d’ailleurs par le désir d’amasser
de grands trésors, n’avait guère le loisir de s’occuper des intérêts des
membres de sa famille. Sigismond ne pouvait non plus espérer l’assistance de la
France; car Charles VII, et après lui son fils Louis XI, s’étaient solennellement
engagés à ne donner aucune aide à quiconque voudrait tenter quelque entreprise
contre les cantons de la vieille ligue.
La
noblesse d’Alsace et de Souabo venait, à l’époque à
laquelle commence notre histoire, de se faire une nouvelle querelle avec les
Suisses, en rançonnant le bourgmestre de Schaffouse,
et en insultant la ville de Mulhouse, alliée des Cantons. Sigismond avait été
obligé de s’en mêler, et malgré l’orgueilleuse présomption avec laquelle les
gentilshommes parlaient des gardeurs de vaches des Alpes, cette fois
encore les Suisses avaient eu le dessus. Ils s’étaient empressés d’envoyer des
troupes au secours de Mulhouse, et avaient dévasté le midi de l’Alsace et la
rive droite du Rhin. Us allaient même se rendre maîtres de la petite ville de AValdshut, lorsque Sigismond, hors d’état de la défendre,
proposa de leur payer dix mille florins pour couvrir les frais de la guerre. Il
s’était inutilement adressé à Frédéric le Victorieux , évêque palatin, à
Rupert, évêque de Strasbourg, et à Jean de Venningen,
évêque de Bâle. Les ligues acceptèrent l’offre du comte du Tyrol.
Toutefois,
ce traité humiliant ne rendait pas sa situation meilleure : son trésor était
épuisé, il lui devenait aussi impossible de payer les dix mille florins que de
continuer à lutter avec ses redoutables voisins; et la seule ressource qui lui
restât était d’engager en tout ou en partie ses domaines d’Alsace pour se
procurer de l’argent.
Voulant
sortir d’embarras, il songea à s’adresser au duc de Bourgogne, l’un des
princes les plus riches et les plus puissants de la chrétienté. Cependant,
Sigismond hésitait; «car, disent les historiens du temps, il savait que ce
seigneur orgueilleux aspirait uniquement à étendre ses Etats, et que son
amitié était à peu près aussi redoutable que son inimitié.» — Malheureusement,
il ne pouvait espérer qu’un autre consentit à prendre, en nantissement d’une créance,
une contrée dont la possession était une cause de discorde perpétuelle.
D’ailleurs, les conseillers les plus intimes de l’archiduc le poussaient à
traiter avec Charles de Bourgogne. Ils lui représentaient que de cette manière
les pays qu’arrose, le Rhin seraient préservés des invasions des Suisses sans
qu’il fût obligé d’intervenir; que le duc lui paierait une forte somme, grâce
à laquelle il vivrait à Innsbruck tranquillement et d’une façon conforme à son
rang; qu’enfin, et quoi qu’on en dît, ce prince plein de loyauté et de
franchise ne manquerait pas de rendre la province engagée aussitôt qu’on le
rembourserait; que peut-être même il marierait sa fille unique à l’archiduc
Maximilien, et que, grâce à cette alliance, la maison d’Autriche pourrait bien
recouvrer un jour ses anciens et vastes domaines de Suisse.
Ces
discours, souvent répétés, et qui s’accordaient avec l’intérêt du moment,
mirent un terme aux incertitudes de Sigismond. Il se décida à envoyer à Charles
plusieurs seigneurs de confiance pour lui demander de lui avancer la somme de
80,000 fl. d’or, et lui proposer, en gage de cette créance , le comté de
Ferrette, le landgraviat d’Alsace, le Brisgaw et le Sundgaw .
Or, le
duc de Bourgogne avait à sa cour, en qualité de maître d’hôtel, un gentilhomme
alsacien nommé Pierre de Hagenhach, auquel il témoignait
beaucoup de confiance et d’amitié. Pierre était peu digne de cette faveur, et
ne la devait qu’à un courage bouillant et brutal, et à l’adresse avec laquelle
il savait flatter l’orgueil démesuré et souvent puéril de Charles. Il était du
reste violent, cruel, et d’une licence de mœurs effrénée; en présence du
prince, il se montrait obséquieux , humble de propos et de manières, et
jamais, malgré la familiarité avec laquelle le traitait le duc, il n’oubliait
la distance qui les séparait. Hagenbach, né dans le Sundgau,
y était devenu l’objet de la haine générale par son arrogance, sa dureté envers
ses inférieurs, et ses constantes querelles avec ses égaux. Cet homme devant
jouer un grand rôle dans notre histoire, il n’est pas hors de propos de
rappeler les circonstances à la suite desquelles il arriva à la cour de
Bourgogne.
Il était
sorti un jour de son castel avec une suite assez nombreuse pour faire visite à Marquart de Baldeck, honorable
gentilhomme fort aimé dans le pays. La comtesse Barbe de Tengen,
belle-sœur de Marquart, se trouvait alors chez lui.
La grâce et la beauté de cette jeune personne firent impression sur le cœur
sensuel de Pierre, en même temps qu’une riche dot tentait son avarice. Il la
demanda aussitôt en mariage, mais Barbe repoussa ses vœux. Hagenbach, irrité de
ce refus, dissimula son ressentiment et resta quelques jours encore à Baldeck, faisant, ainsi que ses gens, grande chère aux
dépens du châtelain. Ayant mûri son projet pendant cet intervalle, il proposa
une partie de chasse à son hôte. Marquart était loin
de soupçonner une perfidie, mais dès qu’il fut hors de ses terres, Pierre se
jeta sur lui, le garrotta avec l’assistance de ses serviteurs, et sc rendit de
toute la vitesse de ses chevaux dans les Etats bourguignons.
Le sire
de Baldeck dut payer une énorme rançon, et depuis
lors Hagenbach, craignant de se montrer en Alsace, resta dans un pays où les
aventuriers hardis et qui méprisaient le danger, étaient toujours les bienvenus.
Les
envoyés de l’archiduc étant arrivés à Arras, —où se trouvait alors Charles le
Téméraire avec l’individu que nous venons de faire connaître à nos lecteurs, —
cherchèrent à disposer favorablement le prince bourguignon par toutes sortes de
flatteries, et en lui représentant que sans doute la Providence le destinait à humilier
l’orgueilleuse seigneurie de Berne et à venger la noblesse des affronts que
lui avaient fait endurer les paysans des Alpes. — Toutefois, il n’était nul besoin
d’exciter la cupidité du duc par de semblables discours. Charles était dévoré
d’ambition; son désir le plus ardent était de lier et de coordonner, de
manière à en faire un tout homogène, les diverses provinces de ses États. Il
comprenait que l’unité leur manquait et aspirait à leur assurer de meilleures
frontières; la proposition qu’on lui faisait comblait donc ses vœux.
Sigismond
ne tarda point à se rendre lui-même à la cour de Bourgogne, afin de régler
définitivement les conditions du traité ; il y séjourna quelque temps, l’on
signa la convention le 9 mai 1469 à Saint-Omer. Il fut stipulé que le comte du
Tyrol livrerait au duc, outre les domaines proposés, les quatre villes
forestières de Waldshut Straubingen, Lauffenburg et
Rheinfelden; que les 80,000 florins d’or lui seraient soldés immédiatement,
soit à Bâle, soit à Besançon; que le remboursement de cette dette aurait lieu
également dans une de ces deux villes, au choix du débiteur, et qu’aussitôt
il serait remis en possession de ses États; qu’enfin le duc de Bourgogne ne
pourrait modifier en rien la forme du gouvernement des pays engagés, qu’il
respecterait leurs droits, leurs franchises et leurs privilèges, et leur
donnerait pour landvogt ou gouverneur un seigneur
alsacien.
L’archiduc
avait exigé ces dernières clauses et Charles n’y avait mis aucune opposition,
comprenant bien qu’elles étaient absolument illusoires et que leur exécution
dépendrait de sa seule volonté aussitôt après la prise de possession.
Les
parties contractantes s'étant séparées, Sigismond d’Autriche toucha les 80,000
florins d’or, et Rodolphe, comte de Roethelin, vint
au mois de juin 1469 faire prêter serment aux nouveaux sujets de Charles le
Téméraire et s’emparer du pays au nom de ce prince.
CHAPITRE II.
Comment
Pierre de Hagenbach fui nommé landvogt des domaines
engagés el comment il les gouverna.
Une
alarme générale s’était répandue en Alsace aussitôt après la conclusion du
traité do Saint-Omer. Malgré les conditions stipulées par Sigismond en faveur
des habitants de ses domaines, ils pressentaient ce qu’ils auraient à souffrir
sous leur nouveau maître. La preuve récente qu’avait donnée le duc de
Bourgogne de la violence de ses fureurs, en punissant la révolte des Liégeois
par le meurtre, le pillage et l’incendie, justifiait toutes les craintes.
Cependant,
Pierre de Hagenbach avait appris que le landvogt de
la province devait être Alsacien. Son ambition s’était aussitôt réveillée. Il profitait
de ses rapports fréquents et familiers avec son seigneur, pour lui insinuer
adroitement que, plus que tout autre, il était apte à le servir dans une
contrée qu’il connaissait de longue main. Je suis, lui disait-il, ce qu’il faut
pour rester fidèle au traité, sans avoir à en craindre les inconvénients,
Alsacien par la naissance, Bourguignon par le cœur et le dévouement.» Charles
écoutait ces propos d’une oreille favorable. Il espérait s’emparer peu à peu
de l’Alsace entière et la joindre à la Bourgogne, tout comme il aspirait à
réunir la Gueldre à ses Etats de Flandre. iL voyait dans cette acquisition un
moyen de se rendre grand en Allemagne, et déjà alors il songeait à y étendre
assez sa puissance pour être élu empereur à la mort de Frédéric d’Autriche. iL
comprenait aussi qu’occupé en d’autres lieux, il lui fallait dans ses nouvelles
possessions un lieutenant qui les connût, qui fût entièrement dans ses intérêts
et prêt à tout pour le servir.
Le
chevalier de Hagenbach parvint donc à ses fins et obtint le poste de landvogt qu’il désirait avec tant d’ardeur.
L’office
de landvogt donnait des attributions à la fois
civiles et militaires, et une sorte de pouvoir dictatorial qui rendait les
abus très-faciles. Il n’était pas aisé d’en appeler au souverain dans un temps
où les communications étaient encore lentes et rares.
Fier de
sa nouvelle dignité, Pierre quitta son maître à Saint-Omer, au commencement de
l’année 1470; quinze cents cavaliers bien armés et quatre mille fantassins
vallons l’accompagnaient. Il pénétra en Alsace avec cette suite et traversa le
pays pour s’y faire reconnaître en qualité de représentant du duc de Bourgogne.
La première impression produite par l’arrivée du chevalier de Hagenbach fut
celle de la crainte. On n’avait pas perdu dans la province le souvenir de ses méfaits.
Il ne chercha d’ailleurs pas à dissimuler ses intentions. Dès qu’il eut mis le
pied dans le landgravial, le peuple se vit accablé de
traitements infâmes.
Les
orgies les plus dégoûtantes marquèrent partout le passage du landvogt. «Je ne crains ni Dieu, ni le monde, avait-il coutume de dire,
je fais ce qui me plaît, j’appartiens au diable et j’agis en conséquence.»
Pierre,
pendant celle première tournée dans les domaines confiés à son administration,
s’arrêtait dans les villes et les villages el enlevait aux bourgeois leurs
femmes ou leurs filles; un bourreau était à ses côtés et menaçait de mort les
époux ou les parents qui cherchaient à s’opposer à ses violences. Ce despote
subalterne, voulant dominer par la terreur et comptant sur l’impunité et sur la
faveur de son maître, ne respectait pas même les couvents de nonnes; il
brisait les portes des monastères, pénétrait dans l’intérieur des cloîtres,
pillait les églises, vidait les caves; puis, quand il s’était gorgé de vin avec
les compagnons de ses débauches, le meurtre, l’incendie et les excès les plus
dégoûtants couronnaient ces profanations abominables. Les chroniques d’Alsace
contiennent les détails d’une quantité de scènes dont l’horreur dépasse tout ce
qu’on peut imaginer. On nous pardonnera de ne point les raconter; notre plume
se refuse à les transcrire.
La suite
des actions de Hagenbach répondit à cet épouvantable début. Les familles les
plus distinguées de la contrée ne furent pas plus respectées par lui que
celles des dernières classes du peuple. Les officiers du landvogt participaient habituellement à ses hideux plaisirs; voulant les établir dans la
province, afin de la tenir plus complètement sous sa dépendance, il
contraignait les nobles et les bourgeois riches à donner leurs filles en
mariage à ceux sur lesquels il se flattait d’avoir le plus d’empire.
Hagenbach
se livrait encore à des crimes d’un autre genre. Loin de tenir compte des
stipulations du traité conclu entre Charles et Sigismond, il viola
successivement les droits et privilèges du pays. Il interdit la chasse aux
gentilshommes, força, dans les villes, les magistrats à adopter des mesures
injustes et iniques; toute opposition de leur part devenait le prétexte de
nouvelles violences. Habituellement aussi Pierre séquestrait à son profit les
propriétés qui étaient à sa convenance, en obligeant les possesseurs à
recevoir les sommes minimes pour lesquelles le souverain du pays avait engagé
les domaines cent ou deux cents ans auparavant. Enfin il en vint à exiger que
les cités et les forts du pays, même ceux non compris dans la convention,
reconnussent son autorité. Les peuples, excédés de ces iniquités, commencèrent à
murmurer. Leurs plaintes étant parvenues à la connaissance de Hagenbach, le
plus irascible et le plus cruel des hommes, provoquèrent des traitements plus
durs encore.
Le lanvodgt, dans le délire de son insolence, osa enjoindre
même aux bourgeois de Bâle et de Strasbourg de se soumettre à lui. Sa lettre à
Strasbourg surtout se distinguait par un ton d’excessive arrogance. Elle
ordonnait aux citoyens de cette ville de déposer sur-le-champ leurs magistrats
urbains et leur défendait d’élire un ammeistre. «Nous viendrons nous-même vous en
imposer un, disait Hagenbach en finissant, et celui-là ne sera ni boucher,
ni boulanger, ni marchand de rubans; vous aurez l’honneur d’avoir pour chef le
plus noble des princes, le duc de Bourgogne lui-même».
Beaucoup
de Strabourgeois avaient des biens dans la campagne,
il s’en empara, déclarant qu’il ne souffrirait plus que les manants eussent ni
domaines ni troupes armées. Il confisqua de même les terres de la ville; la
vallée de Willè en relevait, elle dut se soumettre à
lui, puis vers la fin de l’automne, il assiégea et prit le château d’Ortenberg, que le sieur de Müllenheim défendait pour Strasbourg. Hagenbach, enorgueilli par ce succès, proclama alors
qu’il comptait gouverner les lieux nouvellement acquis d’après son bon plaisir,
sans s’inquiéter de droits anciens. «Je prétends, disait-il, être respecté et obéi à
l’égal du pape et de l’empereur, car j’en réunis toutes les prérogatives en ma
personne.» Le chevalier en vint bientôt jusqu'à violer audacieusement les
privilèges des évêques de Strasbourg et de Bâle et des seigneurs immédiats des
bords du Rhin et de l’Alsace. Ces nobles personnages craignirent enfin qu’on ne
voulût les rendre sujets du duc de Bourgogne, tandis que jusqu’alors ils
avaient relevé directement de l’Empire. Pour la première fois depuis
l’affranchissement des communes, on vit cesser les discordes entre les seigneurs
et les villes, et un intérêt bien entendu les porta à se réunir.
Le landvogt avait offensé aussi les Suisses, alliés fidèles et
constants de la maison de Bourgogne. Peu après son arrivée en Alsace, il
s’était emparé, au nom de son maître, de la seigneurie de Schenkelberg dépendante des Bernois. Charles le Téméraire leur avait, à la vérité, rendu ce
domaine. Mais de nouveaux sujets d’irritation se présentèrent bientôt.
Hagenbach soutint le seigneur de Howdorf, aventurier
attaché au service de Bourgogne, qui avait arrêté à Brisach une troupe de marchands suisses au moment où ils se rendaient à la foire de
Francfort. Ces honnêtes bourgeois furent très-mal menés, enfermés dans le
château de Schutteren, et obligés de souscrire une
rançon de 40,000 écus. Toutefois, les gens de Strasbourg, informés de cet acte
de violence, s’armèrent à la hâte, enlevèrent le fort d’assaut, le rasèrent,
rendirent la liberté aux marchands, et déclarèrent nul le billet qu'on leur
avait extorqué; ce fait peut être considéré comme le point de départ de l’alliance
entre la ligue helvétique et les villes d’Alsace.
CHAPITRE III.
Comment
le jeune comte Réné de Vaudémont devint duc de
Lorraine.
Pierre de
Hagenbach gouvernait les domaines engagés depuis tantôt trois ans, et le duc de
Bourgogne ne s’était point encore enquis le moins du monde de ce qui se
passait en Alsace. D’autres soins l’absorbaient. Charles, avons-nous dit, aspirait
à fonder un immense Etat et à augmenter ses domaines de manière à devenir le
prince le plus puissant de l’Europe. Les chroniqueurs racontent que le duc
avait montré dès son enfance une prédilection particulière pour Alexandre, Annibal
et César, dont il lisait sans cesse l’histoire. Leur courage et leurs
prodigieux exploits étaient les exemples qu’il se proposait d’imiter. De bonne
heure, il avait commencé à s’exercer au métier des armes, afin d’être compté au
nombre des guerriers célèbres par leurs prouesses. Bientôt aussi il eut la
réputation du chevalier de l’Europe le plus intrépide dans les dangers et le
plus vaillant au combat. Personne ne se montrait infatigable et dur à lui-même
comme Charles le Téméraire, et, suivant Commines, il était toujours le premier
levé et le dernier couché de son armée. Cependant ce prince, vigoureux de
corps, bouillant et emporté, était plutôt encore brave soldat que grand
capitaine; adonné à peu près uniquement à la guerre et aux études militaires,
il devint dur, cruel, entêté, et son âme resta étrangère aux sensations douces
et aux qualités aimables qui seules rendent un souverain cher à ses sujets.
Tandis
que Hagenbach tyrannisait l’Alsace sans contrôle, le duc de Bourgogne était
tout occupé de ses démêlés et de ses guerres avec Louis XI. Il avait réussi à armer
contre le roi plusieurs puissants seigneurs de France, et en 1471, Nicolas, duc
de Calabre et de Lorraine, s’était joint à lui. Charles, suivant son habitude,
lorsqu’il voulait s’attacher un prince, avait promis à Nicolas l’héritage de
Bourgogne, avec la main de mademoiselle Marie, sa fille unique. «Il savait
d’ailleurs, disent les chroniqueurs, que ce prince
était bien aimé en France, et il pensait que beaucoup d’autres seraient
entraînés par l’exemple dudit duc». Nicolas seconda son allié en
diverses expéditions, et le duc de Bourgogne profita de la circonstance pour
gagner par ses libéralités et ses promesses quelques-uns des premiers
gentilshommes lorrains. Les deux princes se jurèrent encore une inviolable
amitié avant de se quitter.
Le duc de
Lorraine était à peine de retour à Nancy, qu’il fut pris d’une maladie
violente, à la suite de laquelle il expira au commencement du mois d’août, en
l’année 1473. Il était âgé de vingt-six ans. Son mal fut si prompt et si douloureux,
que personne n’hésita à accuser Louis XI d’avoir enlevé par le poison à Charles
de Bourgogne un de ses plus fidèles alliés.
Nicolas
était le dernier descendant mâle du roi Réné. Yolande
d’Anjou, sœur de son père et veuve de Ferry II, comte de Vaudémont, de la
branche cadette de Lorraine, se trouvait alors héritière du duché. Mais elle
avait cédé ses droits à son fils Réné, dès le 2 août 1473,
par acte authentique daté de Vézelise et dressé en présence des sieurs Jean
Bâtard d’Harcourt, Jean de Ligneville, Thomas Pfaffenhoven et Philippe de Gondrecourt,
se réservant néanmoins, sa vie durant, les rentes et revenus du duché et des
villes et places dépendantes. Dame Yolande vivait très-retirée dans la baronnie
de Joinville, avec ses filles et ce même fils, âgé alors de vingt-deux ans.
Or, il
advint, peu de jours après la mort du duc Nicolas, qu’une troupe nombreuse de
cavaliers magnifiquement équipés se présenta au castel de la veuve de
Vaudémont. En tête du cortège marchait Jeau de Wisse, bailli d’Allemagne. Après avoir salué Yolande avec
respect, il lui dit : «Ma très-chère dame, les seigneurs du conseil de
Lorraine se recommandent par moi à vous et à monsieur votre beau fils. Ils vous
avertissent que votre beau neveu, le duc Nicolas, de ce monde est trépassé, et
ils ont avisé que le duché vous appartient, à cause de votre grand-père le duc
Charles, que Dieu absolve ; c’est pourquoi, madame, préparez-vous avec votre beau
fils, venez droit à Nancy, et de tout le conseil, de toute la seigneurie et du
commun aussi, comme dame et princesse vous serez reçue.»
La dame
de Vaudémont, très-affligée de la mort de son neveu, remercia les seigneurs présents,
et promit d’être à Nancy dès le 45 août. Elle fit, en effet, les préparatifs
nécessaires, et partit au jour désigné avec ses enfants et sa suite. Le clergé,
les seigneurs et la bourgeoisie vinrent à sa rencontre, en costume de
cérémonie, et l’attendirent auprès du village de Ludres. Yolande, y étant
arrivée, fut reçue par de joyeuses acclamations. «Noël, Noël! criait-on de
tous côtés, très-honorée dame et notre princesse, mille fois soyez la bienvenue,
et notre seigneur, votre beau-fils aussi». Yolande, prenant alors la parole,
dit à haute voix, de manière à être entendue de tous les assistants: «Je vous
rends grâce de l’honneur que vous me voulez, mes chers sieurs ; vous savez que
je suis veuve, je suis en la tutelle de mon fils, je vous prie donc qu’il vous
plaise de le recevoir pour votre duc. Un seigneur jeune et de bon entendement
est plus vertueux qu’une femme en affaires de gouvernement».
Personne
ne s’opposa à la proposition de la duchesse; l’extérieur de René plaisait à
chacun et inspirait de l’affection à première vue. Son expression était à la
fois spirituelle, douce et gracieuse. Ses manières ouvertes et bienveillantes fessaient
ressortir encore davantage la beauté remarquable de ses traits. On savait
aussi qu’il était juste et modéré, et malgré sa grande jeunesse, ses vertus le
faisaient déjà chérir de tout le pays.
Le
gouverneur de Nancy, présentant alors à Rénè les
clefs de la ville, s’écria : «que Dieu vous donne la grâce de gouverner ce
duché à votre salutation, à votre honneur, au profit de vous et de tous, mon
très-redouté seigneur.»
«Messieurs
ne vous souciez, répondit aussitôt le jeune duc, avec l’aide et plaisir de
Dieu, j’ai l’espoir de tellement
gouverner, que de tous me ferai aimer».
Le
cortège se mit ensuite en marche précédé du clergé; au moment où Réné entrait dans la ville par la porte Saint-Nicolas, les
cloches des églises commencèrent leur carillon, tandis que les enfants et les
bourgeois le saluaient à son passage du cri répété de : Noël, Noël !
Le prince
descendit de cheval à la porte de la basilique de Saint-Georges et se rendit au
grand autel, où on lui présenta les reliques du saint
enfermées dans une châsse d’argent. Jacques de Haraucourt, prévôt de l’église,
lui adressa, suivant l’ancien usage observé à l’avènement des ducs de Lorraine,
les mots suivants : « Mon trés-redouté et souverain
seigneur, vous plaît-il de faire le serment et devoir que vos prédécesseurs ont
accoutumé de faire à leur réception en ce duché de Lorraine et à leur première
entrée en cette ville de Nancy?—Oui vraiment,» dit Réné,
en posant les mains sur les reliques. «Ainsi donc, mon très-redouté et
souverain seigneur, ajouta le prévôt,
vous jurez et promettez loyalement et avec parole de prince que vous garderez,
maintiendrez et entretiendrez les trois Etats de votre duché, à savoir : les
nobles, gens d’église, bourgeois et peuple, en leurs anciennes libertés et
franchises qu’ils ont eues de vos prédécesseurs, et de ce donnerez vos lettres-patentes,
ainsi que tous vos devanciers ont fait? — Oui vraiment, répliqua encore Réné. — La grand’messe ayant été alors chantée, le duc se
rendit à son palais où il fut fêté pendant quatre jours; mais durant ce temps,
il chercha à prendre connaissance des affaires et maintint dans leurs charges
la plupart de ceux qui en avait possédé. Une joie universelle était répandue
dans le pays, jamais règne ne s’était annoncé sous de plus heureux auspices.
Rêne s’en
alla passer quelques jours à Joinville, puis il revint à Nancy. Bientôt après
on vit arriver dans cette capitale Marrazin, conseiller,
et Jean de Paris, chambellan de Louis XI. Ce prince astucieux voulait prévenir
le duc de Bourgogne et se faire un ami du duc de Lorraine. Réné consentit à traiter avec les envoyés français, et chargea Charles et Achille de Beauveau et Nicolas Merlin de Bar de rédiger les articles
d’une alliance qui fut signée à Neufchâteau, le 27 août.
Pendant
que ces événements se passaient en Lorraine, le duc de Bourgogne se rapprochait
insensiblement de la frontière septentrionale du pays, à la tête de 25,000
hommes et de 400 chariots de guerre. Les Messins, craignant que cette
formidable expédition ne fût dirigée contre eux, furent saisis d’une terreur
extrême, et le conseil de la ville se décida, le 2 septembre, à députer a ers Charles le Téméraire les sieurs Régnault le Gournay, êchevin, Wary Roucel et Michel le Gournay,
chevaliers de Metz.
Le duc
fit son entrée à Luxembourg le G du même mois. Les envoyés messins y étaient
depuis trois jours déjà. Ils s’adressèrent d’abord au conseiller d’Imbrecourt, seigneur très en crédit auprès de Charles, lui
recommandèrent les intérêts de leur ville, et lui firent présent de douze
belles coupes d’argent, de la valeur de deux cents florins. D’Imbrecourt leur promit une audience du prince pour le jour
suivant. Cependant, le 7 septembre allait finir, et personne encore ne les
avait appelés. Ils auguraient fort mal de ce silence, lorsqu’à l’entrée de la
nuit ils virent accourir Olivier de la Marche, chambellan et capitaine de la
garde, qui s’engagea à les mener chez le duc le lendemain matin. Les députés
assistèrent en effet, le 8, au lever de Charles le Téméraire. Michel le
Gournay, s’étant agenouillé devant lui, prit la parole au nom de ses
compagnons, rappela au duc que ses ancêtres, d’illustre mémoire, avaient
toujours entretenu des rapports de bon voisinage avec la cité de Metz, et le
supplia d’imiter leur exemple. Ensuite il le pria de vouloir bien accepter
cent mesures d’un vin de Moselle excellent, que lui envoyait la magistrature
urbaine.
Charles
reçut gracieusement ce présent, et répondit à Michel le Gournay d'un air fort
courtois, protestant que, loin d’avoir formé aucun projet contre ses amis de
Metz, il était décidé à les défendre en toute occasion contre leurs ennemis.
Il invita même les envoyés à dîner le jour suivant à sa table, et chargea son
grand maître d’hôtel, Guillaume de Bitsche, de veiller
à ce qu’ils fussent traités avec égard et à ce qu’on leur servît d’excellents
repas.
Michel le
Gournay et ses compagnons s’étaient à peine retirés dans leur demeure, qu’ils
virent arriver trois joueurs de luth et autant de trompettes, chargés par le
duc de Bourgogne de leur faire de la musique pendant le dîner. Le prince leur
envoyait également quatre grands flacons d’argent contenant du vin de Beaune;
l’ordre fut donné de leur en servir de semblable tant qu’ils seraient à
Luxembourg. Le soir encore ils assistèrent à une fête magnifique célébrée à la
cour, et le 10 ils repartirent pour Metz, enchantés de l’accueil de Charles et
de ses belles promesses.
Le duc de
Bourgogne lui-même ne tarda pas à quitter Luxembourg et à s’avancer vers Nancy.
Il allait à Dijon, afin d’y déposer le corps de son père, Philippe le Bon,
décédé au mois de juin 4467. Réné sortit de sa
capitale pour recevoir Charles avec honneur. Les deux princes se rencontrèrent
entre Bouxières-aux-Dames et Champigneules. Après
s’être embrassés, ils firent ensemble leur entrée à Nancy. René offrit à son
hôte de le loger dans son palais; mais le duc de Bourgogne refusa et prit ses
quartiers dans la maison du receveur Vautrin Malois. Il
demeura deux jours à Nancy, et Réné n’oublia rien
pour le régaler et lui donner des marques de sa considération.
Quant au
corps du duc Philippe, Réné le fit mener à Bayon, de
là il fut conduit au monastère des chartreux à Dijon, où il devait être
enseveli. Les deux princes se séparèrent très-bons amis en apparence. Réné n’avait aucune défiance de l’amitié de Charles, mais
celui-ci méditait déjà de se rendre maître de la Lorraine, qu’il trouvait à sa
convenance. Il pensait que l'inexpérience de Réné lui
en fournirait une occasion favorable. Il fit donc avancer de plus en plus ses
troupes sur les frontiêres de Lorraine, de Bourgogne
et de Luxembourg, dans la vue, disait-il, que l’on ne fit aucune entreprise
contre le jeune duc, à son nouvel avènement à la couronne. René
objecta que personne ne le menaçait et qu’il était en paix avec ses voisins,
mais Charles ne tint aucun compte de ses remontrances.
Louis XI
avait suivi ces mouvements; il fit stationner, de son côté, des troupes en Champagne,
et leur enjoignit de rester en observation dans les environs de Bar. Ainsi, la
Lorraine semblait destinée à devenir prochainement la pomme de discorde des
deux rivaux, et chacun d’eux était prêt à entrer en lice au moindre mouvement
de la partie adverse., etc..
CHAPITRE IVComment
l’empereur Frédéric fut régalé à Strasbourg eT à Metz.
Retournons
maintenant en Alsace. An moment où René prenait possession de ses États; l’empereur
Frédéric arrivait à Strasbourg, après avoir passé deux mois aux eaux de Baden,
auprès de sa scieur, l’épouse du margrave Charles.
Il fit
son entrée dans la ville pendant la journée du lundi après l’Assomption. 900
cavaliers l’accompagnaient. Les seigneurs les plus distingués de sa suite
étaient : Le prince Maximilien son fils, les archevêques et évêques de
Mayence, Besançon, Eichstett, Augsbourg, Spyre et Bâle, les ducs Albert et Louis de Bavière, Calixte
Othman, frère du sultan Mahomet Louis, duc de Bavière des Deux-Ponts, le
margrave Charles de Bade, le comte Eberhard de Wurtemberg, les comtes de Vernembourg et de Katzenellenbogen,
les seigneurs Jacques Lichtenberg, Schoffart de Linange, Schmassmann de Rappolstein, le comte Hugues de Montfort, deux comtes de Tubingeu et une quantité de cavaliers de moindre rang.
La
réception de l’empereur à Strasbourg fut la plus pompeuse possible. L’évêque
Robert, suivi de son clergé, vint à sa rencontre jusqu’à la porte dite des
Bouchers. On avait jonché de fleurs et de verdure les rues par où le cortège
devait passer, et les habitants des maisons voisines avaient orné leurs façades
de belles tapisseries et de toiles de diverses couleurs. Frédéric fut conduit
en cérémonie à l’hôtel des seigneurs de Lichtenberg, préparé pour lui servir
de demeure. Il y admit aussitôt en sa présence la députation chargée par la
ville de lui remettre de riches présents, ainsi qu’aux personnes de sa suite.
Les dons
offerts à Frédéric consistaient : en un bassin de vermeil du prix de 400
florins et contenant la somme de 1000 florins d’or; en 20 tonneaux de vin, 200
sacs d’avoine, 100 poissons et six bœufs. Le prince Maximilien reçut un bassin
d’argent du prix de 200 florins et 600 florins d’or, 6 tonneaux de vin, 60 sacs
d’avoine et 20 moutons. Les présents destinés aux autres étaient proportionnés
à leur rang; personne ne fut oublié; on remit même 42 florins aux joueurs de
trompette de la suite de Frédéric. Ce prince parut ravi de l'offrande des Strasbourgeois
, et, voulant alors donner une marque de faveur particulière à son hôte, le
sieur Jacques de Lichtenberg, il lui conféra, en présence de tous les
assistants, le titre et les prérogatives de comte du saint-empire.
Cependant
les Strasbourgeois s’efforçaient, disent les chroniques, de procurer à
l’empereur tous les divertissements possibles! « Ihm alle Kurzweil zu machen,» en le faisant
assister à des fêtes, à des joùtes sur terre et sur
la rivière d’Ill qui traverse leurs murs; en déployant, en un mot, toute la
magnificence usitée en pareille occasion. Frédéric, charmé de la manière dont
on le traitait, jugea assez favorablement des dispositions de la ville pour en
exiger le serment de fidélité; mais les chefs de la république le lui
refusèrent, se fondant sur les anciens privilèges de Strasbourg et sur sa
qualité de cité libre et impériale.
«Nous
nous sommes librement attachés à l’empereur et à l’Empire, répondirent-ils;
nous avons contribué volontairement aux dépenses de leurs entreprises et toujours
soutenu leurs droits au péril de nos vies. Toujours on s’en est fié à notre
bonne volonté et à notre bonne foi. Nos ancêtres n’ont jamais prêté de serment
de fidélité, nous ne pouvons, sans nous déshonorer, passer sur les règles que
leur exemple nous a prescrites. S. M. I. a en main les
lettres de ses prédécesseurs; si elle ordonne qu’on les consulte, on trouvera
quelle est la liberté de la ville de Strasbourg, nous ne pouvons, nous ne
devons pas y porter atteinte.»
Il fallut
en demeurer là. Frédéric, déçu dans son espoir, demanda alors qu’au moins on
lui fit une avance de 4000 florins. Les magistrats, après quelque hésitation, consentirent
à lui en remettre 3000. «Ils n’ignoraient point que jamais cet argent ne leur
serait remboursé; car l’empereur, fort prévenant lorsqu’il demandait , était un
seigneur très-peu gracieux quand il s’agissait de rendre ou de donner. Dans les
villes où il passait, il avait coutume d’emprunter des sommes trop faibles pour
qu’on pût exiger de gages de la créance, bien « décidé qu’il était à ne point
acquitter ces petites dettes»
Frédéric
partit de Strasbourg le vendredi avant la saint Adolphe, pour visiter Fribourg
en Brisgau et Bâle. On le reçut dans cette dernière
cité avec une méfiance extrême. La milice urbaine prit les armes, et un corps
de 800 Suisses vint renforcer la garnison. L’empereur feignit de ne point
remarquer ces dispositions malveillantes, et se montra fort courtois en ses
manières et en ses propos.
Ce prince
annonça alors que son projet était de se rendre à Metz et de traverser la
contrée engagée à Charles de Bourgogne par l’archiduc Sigismond. Hagenbach
résolut aussitôt de l’accompagner en sa qualité de landvogt de ces domaines, et s’empressa d’aller à Bâle à la tête de quatre-vingts
cavaliers bien équipés, et vêtus uniformément de gris et de noir.
Les
derniers succès du duc de Bourgogne avaient encore donné une nouvelle impulsion
à l’insolence du chevalier. Se voyant, d’ailleurs, fort bien reçu par
l’empereur, il ne mit plus de bornes à l’extravagance de ses discours; il
traitait les Alsaciens de vils coquins, qu’on écraserait sans peine, et les
Suisses d’audacieux, qu’il fallait réduire pour écorcher l’ours de Berne et
s’en faire des fourrures.
Ces
propos, répétés dans la province, engagèrent Strasbourg, Bâle, Colmar, Schelestadt et un grand nombre d’autres villes, à conclure
ensemble une union défensive; les nobles de la contrée prirent aussi part à
l’alliance.
Hagenbach,
ayant chargé un de ses lieutenants do gouverner en son absence, suivit Frédéric
de Bâle à Ensisheim, à Colmar, Schelestadt, Oberehnheim et Saverne. De là, l’empereur se dirigea vers
Metz, et, suivant sa coutume, il préleva de petits emprunts dans les
différents lieux où il s’arrêtait.
Frédéric
fit son entrée à Metz le 18 janvier; les bourgeois, ne voulant pas se montrer
moins empressés que ceux de Strasbourg, lui donnèrent chaque jour une fêle
nouvelle. Une semaine s’écoula ainsi au milieu des plaisirs.
Sur ces
entrefaites, on vit arriver une ambassade, composée des sires Jean de Marie, Englbert, comte de Nassau; Hugonnet,
chancelier de Bourgogne; et David, évêque d’Utrecht. Elle venait demander à S.
M. I. l’entrée de Metz pour Charles le Téméraire, avec 10,000 chevaux, afin que
les deux princes pussent avoir une conférence. Pierre de Hagenbach, qui,
aussitôt après l’arrivée de l’empereur à Metz, avait rejoint son maître à
Luxembourg, s’était réuni aux ambassadeurs.
Frédéric
leur répondit qu’il ne lui appartenait pas d’accorder ou de refuser une demande
de cette nature, et les engagea à s’adresser aux magistrats de la cité. Le
grand conseil s’assembla; après une assez longue délibération, il déclara aux
envoyés : «Qu’on serait charmé de recevoir monseigneur de Bourgogne et 500
chevaux tout au plus, s’il lui était agréable de venir avec ce nombre de
cavaliers; mais qu’on ne pouvait loger
10,000 hommes, ayant déjà sur les bras 4800 personnes formant la suite de l’empereur,
500 soudoyeurs aux gages de la république, et les
gens d’alentour, qui, craignaient une guerre avec la Lorraine, et avaient réfugié
leurs biens et leurs bestiaux dans la ville. »
Les ambassadeurs,
irrités de ce refus, demandèrent alors qu’on accueillit leur maître avec 1000
hommes, ou qu’au moins on lui donnât une des portes de Metz, afin qu’il pût y
entrer et en sortir à volonté. Mais le grand conseil opposa un refus
péremptoire à cette absurde prétention.
Dans la
crainte de quelque surprise, les magistrats avaient même fait barricader les
petites rues, car ils ne se tenaient pas fort assurés non plus de la bonne
volonté de l’empereur, et ils avaient caché 4000 hommes dans les granges et
dans les greniers. Ils avaient, outre cela, 16,000 hommes des villages aux
environs de la ville, et ordonnèrent aux bourgeois de se tenir sur leurs gardes
tout le temps que Frédéric serait dans leurs murs, et de s’assembler au premier
coup de cloche, pour frapper sur l’ennemi, quel qu’il fût.
Les
Bourguignons partirent donc fort mécontents; mais avant de quitter la ville,
ils témoignèrent leur ressentiment en adressant des injures et des paroles
grossières aux gens de Metz et aux gardes des portes. Hagenbach surtout,
habitué depuis plusieurs années à faire sa volonté sans contrôle, traitait les
passants de vilains, de chiens, de coquinaille et de
pourceaux.
La colère
de Charles éclata en cette occasion; il proféra de terribles menaces contre
Metz, assurant que «les habitants feraient bien de lui en ouvrir les portes,
parce qu’il tenait leurs clefs en sa main»; et en disant ces mots, il désignait
du geste son armée et son artillerie.
Cependant,
la fureur du duc de Bourgogne s’exhala en vaines paroles. Les bourgeois de la
ville, espérant le calmer, lui envoyèrent une magnifique coupe d’or pleine de
florins, 50 bœufs, 200 montons, beaucoup de blé, 200 chariots chargés de vin du
Rhin et de la Moselle, et un tonneau de malvoisie. Ces présents radoucirent
singulièrement l’humeur de Charles. En effet, il en avait besoin, car il était
embarrassé de se procurer assez de vivres pour les seigneurs et gentilshommes
de sa suite. Les fournitures des villes de ses États n’y pouvaient suffire, non
plus que les grandes battues qui se faisaient dans le pays de Luxembourg afin
de réunir le gibier.
Le duc de
Bourgogne alla alors accomplir un pèlerinage à Aix-la-Chapelle, après avoir
fait demander à l’empereur de lui accorder à Trêves l’entrevue qui avait manqué
à Metz, et qu’il désirait obtenir pour traiter diverses affaires de haute
importance.
CHAPITRE V,
Comment
l'empereur et le duc de Bourgogne eurent une entrevue à Trêve, et comment le
duc donna un grand repas à l'empereur.
Frédéric
III, ayant consenti à la requête du prince bourguignon , s’était rendu
incognito à Trêves, le 29 septembre 1473. Le duc vint le lendemain. —
L’empereur, lorsqu’il apprit l’arrivée de Charles, ressortit de la ville, afin
d’y faire son entrée solennelle en même temps que lui.
Frédéric
était enveloppé d’un long manteau de drap d’or enrichi de perles. Les princes
d’Allemagne, qui avaient été avec lui à Strasbourg et à Metz, chevauchaient
autour de sa personne. A ses côtés marchait le prince Maximilien, dont la bonne
mine et la beauté attiraient les yeux de ha multitude. Il portait une robe de
pourpre brodée d’argent. Après lui venait le prince Calixte Othman, qui
relevait les grâces de Maximilien par son visage austère et rébarbatif, par son
habit traînant à la turque, et par ses cheveux hérissés attachés en forme de
nœud au haut de la tête. Il avait passé à sa ceinture un cimeterre persan.
Cependant
la suite de Charles le Téméraire l’emportait de beaucoup encore sur celle de
l’empereur. Le duc parut en présence du chef de l’empire avec un éclat qui
devait nécessairement blesser Frédéric, prince ombrageux et très-enclin à la
jalousie.
Une
troupe de hérauts d’armes, vêtus chacun d’une cotte brodée aux armoiries de
l’une des provinces appartenant à leur maître, précédait le duc. Charles était
bardé de fer delà tête aux pieds, mais par-dessus son armure il avait jeté un
manteau enrichi de diamants, et de la valeur de plus de 100,000 ducats. Vue
foule immense de chevaliers, magnifiquement équipés, et sur les vêtements
desquels on voyait briller l’or et les pierreries, l’accompagnait et déployait
à son exemple le faste le plus extraordinaire . La moitié de son armée lui
servait en outre d’escorte et occupait les villages à deux lieues à la ronde.
Les personnes qui marchaient auprès de Charles étaient : Louis de Bourbon, évêque
de Liège; David, bâtard de Bourgogne, évêque d’Utrecht; le duc Jean de Clèves,
Antoine le Grand, bâtard de Bourgogne; les comtes de Nassau et de Marie, et Guy
d’Imbrecourt.
Lorsque
les deux cortèges se rencontrèrent, le duc descendit de sa monture, et, suivant
l’usage, il ploya un genou pour saluer Frédéric. — L’empereur avait également
mis pied à terre; il releva le duc et l’embrassa, puis ils remontèrent à
cheval et se dirigèrent vers la ville. Jean de Bade, archevêque de Trêves, et son
frère, le margrave Christophe, les attendaient auprès de la porte avec 600
hommes vêtus d’écarlate. Une foule immense, accourue pour assister à ce beau spectacle,
encombrait les rues. Les deux princes les traversèrent au petit pas de leurs
destriers, causant avec toutes les apparences de la bienveillance et de
l’intimité. Ayant ensuite fait ensemble leurs prières à la cathédrale, ils se
séparèrent. L’empereur se logea à l’archevêché, et le duc au couvent de
Saint-Maximin, situé hors de l’enceinte de la cité.
Ce fut
dans ce cloître que l’on commença à traiter d’affaires dès le lendemain, mais
seulement pour la forme et avec beaucoup de pompe. L’archevêque de Mayence
ouvrit la conférence, en prononçant, au nom de l’empereur, un discours en
latin. Après avoir accordé de grands éloges au duc de Bourgogne, il exprima le
désir de lui voir conclure une paix durable avec la France, afin qu’on put se
réunir pour arrêter les progrès des Turcs. Charles chargea de sa réponse
Guillaume Hugonnet, son chancelier. Ce seigneur parla
également en langue latine, rappela la longue histoire des démêlés de la
Bourgogne avec la France, insista beaucoup sur les crimes de Louis XI et sur
l’ingratitude dont il avait fait preuve après avoir été reçu par le duc
Philippe à l’époque où il ne pouvait plus se montrer à la cour Ju feu roi son
père. Le chancelier termina en affirmant que, sans les entreprises perfides de
Louis, qu’il qualifia de traître, d’ingrat, d’empoisonneur, son maître
n’hésiterait pas à marcher contre les infidèles et à venger d’une manière terrible
les désastres qu’avait essuyés la chrétienté.
Toutefois,
ainsi que nous venons de le dire, Charles le Téméraire ne voulait pas
s’expliquer en public sur les véritables motifs qui l’avaient porté à demander
une entrevue à l’empereur. Cette conférence était simplement une cérémonie
d’apparat; le duc se proposait d’en venir à ses fins plus adroitement et dans
l’intimité du tête-à- tête.
Le séjour
de l’empereur et du prince bourguignon à Trêves fut marqué par des festins,
des joûtes et des fêtes de toute espèce.
Les
historiens contemporains nous ont transmis, entre autres, les détails d’un
célèbre repas donné à Frédéric par le duc, repas à l’occasion duquel on déploya
un luxe dont les détails semblent avoir été empruntés aux récits des conteurs
orientaux.
« Charles
le Téméraire, dit notre chroniqueur, avait invité l’empereur à venir dîner
chez lui le jeudi 7 octobre. Il y avait convié également le prince Maximilien
et les prélats et seigneurs de la suite de S. M. impériale. Frédéric, ayant
accepté, se rendit à cheval à la demeure du duc de Bourgogne; les autres
invités l’accompagnaient. Il était neuf heures du matin.
«L’empereur,
vêtu d’un habit brun brodé d’or, portait au col une croix du même métal et d’un
travail exquis. Six seigneurs, armés de toutes pièces comme pour un tournois,
marchaient devant lui; on voyait aussi à ses côtés deux chevaliers des pays
méridionaux, qui avaient les bras nus et tenaient de larges boucliers. Lorsque
le cortèges arrêta auprès de Saint-Maximin, Charles vint à sa rencontre. Il
était entièrement habillé de drap l’or et couvert d’une quantité innombrable
de perles et de pierres de grand prix. Cependant l’éclat de son costume
faisait ressortir encore davantage ce que sa physionomie avait de rude et de
sévère. Ses grands yeux noirs, son regard fier et hardi, ne pouvaient faire
oublier l'air peu distingué que donnaient à sa personne une taille carrée, des
épaules fort larges, des membres excessivement robustes et des jambes
légèrement arquées par la grande habitude de l’équitation.
«Le duc
de Bourgogne chercha en cette occasion à corriger ce que la richesse de ses
vêtements pouvait avoir de mortifiant pour les autres, par une conduite
Respectueuse et pleine d’obligeance envers Frédéric. S. M. étant descendue de
cheval, les deux princes entrèrent dans l’église avec leurs suites respectives.
«On avait
suspendu dans la nef de riches tapisseries flamandes sur lesquelles se voyaient
représentés les traits les plus remarquables de l’Ancien Testament et même de
l’histoire profane, tels que la prise de Troie, l’expédition de la Toison d’or
et les conquêtes d’Alexandre le Grand. Le chœur était entièrement tendu en drap
d’or, en velours et en étoffes de soie, et le duc avait pris le trésor de sa
propre chapelle pour servir à la décoration du maître-autel.
«Vingt-quatre
statues d’argent, hautes d’un pied et demi, paraient cet autel; on y voyait en
outre quatre estrades, couvertes également de drap d’or; elles portaient les
objets suivants :
«Sur la
première, on admirait les douze apôtres, hauts d’un pied et demi et en
vermeil.
«Sur la
deuxième, étaient deux statues d’or massif.
«Sur la
troisième, il y avait trois statues et dix croix en vermeil, et six autres
croix en or, ayant pour supports des tableaux de même métal, merveilleusement ciselés
en relief et ornés d’une profusion de pierres précieuses.
«Sur la
quatrième, on voyait six grandes croix en vermeil et deux en or, incrustées de
perles de saphirs et d’émeraudes, deux flambeaux en or, deux en vermeil et deux
en argent, six statues d’anges hautes d’une aune, dont deux en or, enrichies de
pierreries, deux en vermeil et deux en argent; une châsse d’or, ornée d’une
quantité de diamants, de rubis et de topazes, et renfermant des reliques de
saint Paul ermite et de saint Antoine; — un tabernacle d’or, décoré, sur
toutes ses faces, de diamants, de perles et de petits tableaux ciselés dans le
métal avec un art infini; — une cassette d’or d’un travail tellement exquis,
que le regard ne pouvait s’en détacher, et dans laquelle se trouvait un
morceau de bois Je la vraie croix, enchâssé dans un diamant long da deux
doigts , et de la valeur de 200,000 écus d’or; — un clou de la croix renfermé
dans un lis en diamant, et une quantité de reliques et d’autres objets
précieux, dont il serait trop long de donner le détail.
«On avait
préparé aussi dans l’église deux oratoires somptueux en forme de pavillons;
l’un pour l’empereur, l’autre pour le duc de Bourgogne; ce dernier n’assista
pas à la messe, parce qu’il était occupé à donner ses ordres pour l’arrangement
du repas. Aussitôt après le saint sacrifice, les musiciens de Charles
chantèrent des hymnés avec accompagnement de divers
instruments; puis le duc vint prendre Frédéric et le conduisit dans la salle
où l’on devait manger. Elle était arrangée aussi richement que l’église, et
tendue en étoffes dans lesquelles le mélange de l’or et de la soie produisait
des dessins variés à l’infini. Au-dessus de la place destinée à l’empereur, on
avait établi un grand dais d’or, dont l’intérieur était formé par trois
peintures les plus belles et les plus parfaites du monde.
«Trois
tables étaient disposées l’une à la suite de l’autre, dans le sens de la
longueur de l’appartement. Devant chaque couvert se trouvait une coupe d’or et
un grand flacon de vermeil contenant du vin; en outre, un grand nombre de
coupes étaient préparées, afin qu’on pût y présenter aux convives les vins
exquis de divers pays, qui devaient leur être servis pendant le repas.
« Cette
salle ouvrait sur une seconde pièce, dans laquelle on avait élevé un immense
dressoir, auquel on montait par neuf marches arrangées en forme d’amphithéâtre
et qui atteignait le plafond. Le dressoir était couvert d’une vaisselle somptueuse.
On y voyait :
« 33
grands vases d’or et d’argent.
« 7 0
flacons de diverses grandeurs et des mêmes métaux.
« 100
patères et croix d’or ornées de perles et de pierreries.
« 40
douzaines de grandes coupes d’argent.
« 6 nefs
de grande dimension, ciselées avec perfection, et dont 4 en argent et 2 en or
massif.
« 12
bassins en argent avec leurs aiguières.
« 6
grandes carafes d’argent, contenant chacune 24 bouteilles (12 maas) de vin.
« 6
cornes de narval, montées en or et hautes de 3 aunes.
« 12
tonneaux en vermeil, contenant chacun 2 mesures (2 ohmen)
de vin fin; et enfin 3000 pièces d’argenterie pour le service de la table, bien
que Charles eût emporté dans ce voyage le tiers à peine de la vaisselle
magnifique qu’avait fait faire son père, le feu duc Philippe.
«
Cependant, l’empereur fut ébloui d’un étalage aussi extraordinaire et en
conçut un secret dépit. Les assistants observaient qu’il avait peine à
conserver les dehors de la politesse et à répondre d’une manière convenable aux
prévenances de son hôte. Il savait d’ailleurs que les seigneurs bourguignons ne
manquaient pas de rire tous les jours à ses dépens et à ceux des personnes de
sa suite, et qu’ils répétaient fort souvent qu’on avait tort de loger dans de
beaux appartements des Allemands sales et grossiers. Il sentait aussi que, par
le luxe de sa cour, le duc de Bourgogne jouait en réalité le rôle d’empereur,
et qu’à ses côtés il avait presque l’air d’un humble vassal.
« Pour
faire plus d’honneur à Frédéric, on avait placé son siège sur une estrade, de
sorte qu’il embrassait d’un coup d’œil les trois tables. Il occupait seul le
haut bout de la sienne; les archevêques de Mayence et de Trêves et les
évêques de Liège et d’Utrecht se mirent à sa droite; Charles de Bourgogne, le
prince Maximilien, les ducs Etienne de Bavière, Albert de Munich et Louis de Veldentz, prirent place à sa gauche.
Tout le monde étant assis,
on entendit une fanfare bruyante, la porte de la 6alle s’ouvrit, et alors
entrèrent dix joueurs de trompettes, quatre de flûtes et deux de grosse caisse;
puis parurent douze hérauts d’armes et douze comtes. Ces personnages étaient
vêtus de velours ou de drap d’or et précédaient l’entrée du premier service,
qui était de treize plats par table. Les services suivants furent : l’un de
dix-sept plats, l’autre de dix, et on les présenta avec le même cérémonial. Le
duc de Bourgogne avait fait réunir à cette occasion les mets les plus rares et
les plus exquis, et les productions des pays les plus lointains.
« Le
troisième service ayant été enlevé, on porta le dessert dans trente bassins et
dans des coupes et des patères d’or ciselés et ornés d’une infinité de pierres
précieuses Ces bassins contenaient des conserves, des gâteaux légers et des
confitures de diverses espèces.
« Le
pain, le linge de table et tout ce qui est nécessaire à un repas, étaient
renfermés dans d’immenses paniers artistement tressés en lames d’argent fin.
« Pour
donner une idée des richesses de la cour de Bourgogne, il ne faut point oublier
de dire aussi que les personnes venues à la suite des hôtes de Charles le
Téméraire furent traitées avec une recherche presque égale dans un appartement
séparé; et cependant ce festin somptueux était loin d’égaler en magnificence
ceux que le duc avait donnés, quelques années auparavant, à l’occasion de son
mariage avec M Marguerite d’Yorck.
«Après le
repas, on retourna à l’église pour les vêpres. La soirée étant alors arrivée,
l’empereur se prépara à regagner sa demeure. Le duc, jaloux de se montrer
courtois en toutes choses, voulut accompagner S. M. Il jeta sur ses vêtements
un manteau de velours fourré de martre, et monta son superbe cheval noir aux
harnachements duquel pendaient une multitude de sonnettes d’or. Six cents
gentilshommes de sa maison accompagnèrent également Frédéric à la lueur d’une
infinité de flambeaux.
« L’on
peut juger, d’après les détails que nous venons de donner, de la niasse de
butin que firent les Suisses et leurs alliés après la défaite de Charles le
Téméraire.»
CHAPITRE VI.Comment le duc de Bourgogne voulut se faire couronner en qualité de roi, et comment l’empereur trompa le duc.
Cependant,
malgré les fêtes et les divertissements, le duc de Bourgogne ne négligeait
point les affaires sérieuses.
Réné de Lorraine avait renouvelé
plusieurs fois ses instances afin qu’on éloignât les Bourguignons concentrés
sur les frontières de ses Etats. Charles le Téméraire, pressé de la sorte, fit
répondre au jeune duc qu’il retirerait ses troupes après avoir reçu des
assurances positives de son attachement, et avoir conclu avec lui une ligue
offensive et défensive semblable à celle à laquelle le feu duc Nicolas s’était
engagé jadis. René s’en défendit en alléguant son alliance avec Louis XI ; mais
Charles ne se rebuta pas; enfin, vaincu par ses instances et ses promesses, le
duc de Lorraine, qui d’ailleurs n’était pas en état de résister, signa un
traité dont les conditions étaient : «Que les gens de Bourgogne auraient un
passage libre sur les terres de Lorraine pour aller dans la comté de Ferrette,
en payant leurs dépens, et que Réné ferait ouverture
à Charles de quatre de ses places d’armes.»
Du côté
de l’empereur, tout aussi semblait se disposer de manière à favoriser les
desseins secrets de Charles le Téméraire. Frédéric était parvenu à dominer la
mauvaise humeur que lui avait d’abord inspiré le luxe de ce prince. Il avait
intérêt à le ménager, désirant marier son fils Maximilien avec la princesse
Marie, héritière de Bourgogne. Peu de jours après le repas dont il a été
question ci-dessus, il renouvela les propositions faites précédemment déjà à ce
sujet; elles furent accueillies avec un feint empressement. Le duc permit même
au prince et à la princesse de s’écrire; mais, quoique le premier eût dix-huit
ans, et que Marie en comptât quinze, qu’ainsi rien ne s’opposât à
l’accomplissement immédiat de l’alliance, il imaginait mille prétextes pour la
retarder encore. Le fait est qu’au moyen de ce leurre il espérait obtenir de
Frédéric le titre de roi, objet de son ambition, avant la conclusion du
mariage, et qu’alors il comptait éluder sa promesse. L’idée d’un gendre lui causait
une horreur insurmontable, et il avait coutume de dire à ses intimes: «Plutôt
me faire moine que de marier ma fille!»
En effet,
l’empereur ne tarda pas à connaître le but des prévenances et des flatteries de
Charles le Téméraire. Ce prince lui fit part de ses prétentions; elles étaient
exorbitantes; non-seulement il voulait le titre de roi de Bourgogne et l'office
de vicaire du saint-empire, mais il réclamait encore plusieurs augmentations de
territoire, entre autres les quatre évêchés de Liège, Utrecht, Tournay et
Cambrai, et le duché de Lorraine comme fief relevant de sa couronne.
Frédéric
eut la faiblesse de consentir. Les deux princes fixèrent le jour du
couronnement et désignèrent l’évêque de Metz, George de Bade, pour donner
l’onction au successeur des anciens rois de Bourgogne. Déjà pour préluder à
cette pompe, une superbe cérémonie avait eu lieu le 4 novembre. Charles, après
avoir reçu solennellement de l’empereur l’investiture du duché de Gueldre,
qu’il venait d’enlever à son légitime possesseur, lui avait prêté foi et
hommage pour ses seigneuries relevant de l’Empire.
Le duc,
heureux lorsqu’il pouvait étaler ses trésors et éblouir les princes et les
peuples par l’éclat de son faste, résolut de déployer en cette occasion une
magnificence jusqu’alors inusitée. Il fit préparer les insignes de la royauté,
la couronne, le sceptre, le manteau et la bannière, et tendre de tapisseries
l’église Saint-Maximin où il devait être sacré1 Dans le chœur on
voyait deux trônes exactement semblables et couverts d’étoffes brochées en or :
seulement celui destiné à Frédéric était placé un peu au-dessus du second;
des sièges somptueux disposés dans la nef devaient servir aux princes et aux
seigneurs des deux cours. Les ornements de la chapelle ducale étaient disposés
sur les autels, et des estrades tendues en soie faisaient le tour complet de la
grande place.
La
plupart des seigneurs présents à Trêves ignoraient le but de ces préparatifs;
mais Louis XI, aux investigations duquel rien ne pouvait échapper, en fut
informé sur-le-champ. Il s’empressa d’écrire à l’empereur pour lui faire des
représentations et lui démontrer que Charles, une fois roi, ne manquerait pas
de chercher à agrandir son royaume aux dépens des Etats voisins, peut-être même
de devenir son compétiteur. Il l’engageait aussi à ne pas trop se laisser
éblouir par des propositions de mariage , «parce que le duc était accoutumé à
promettre sa fille à tout le monde, sans jamais la donner à personne. »
Frédéric
se trouvait dans un grand embarras : il sentait la justesse des observations du
roi de France, mais il avait donné sa parole, et il redoutait de faire un
affront sanglant à Charles le Téméraire, qui ne pardonnait jamais, et dont les
vengeances étaient terribles.
L’on
était à la veille du jour arrêté pour le couronnement, et l’empereur flottait
encore irrésolu. Alors il advint que Jean, archevêque de Trêves, apprit la
cause de tout ce mouvement ; comme on le savait très-ennemi de monseigneur de Bourgogne,
on la lui avait cachée avec soin, et il avait cru qu’il s’agissait simplement
d’une fête ou d’une cérémonie semblable à celles qui depuis quelques semaines
se succédaient sans interruption dans la ville. Le prélat se rendit en hâte
auprès de Frédéric, et, l’ayant trouvé seul, il lui dit avec hardiesse : «
Sire, est-il vrai que vous consentez à donner la couronne à Charles de
Bourgogne, pour être roi des pays que j’ai ouï nommer? » Puis, continuant à
parler avec beaucoup de chaleur et d’énergie, il lui rappella que, devant le rang suprême à une élection , il n’avait point le droit de
disposer de la sorte des fiefs de l’Empire; que, de plus, il ne pouvait, sans
la plus criante injustice, déférer à un autre les biens qui étaient échus au
duc Réné en légitime héritage enfin, il lui peignit
vivement les dangers résultant de cette nouvelle royauté, et l’engagea à retirer
une parole qu’il n’avait pu donner en honneur et conscience.
Frédéric,
pressé de la sorte, consentit à tout, mais en priant l’archevêque de trouver un
moyen de le sortir d’embarras. «Rien n’est plus aisé, reprit Jean, ne dites mot
à qui que ce soit: à minuit nous aurons une barque, nous partirons et vous
serez délivré de tout souci. Il ne sera pas couronné, à l’Empire tort ne ferez,
et envers tous quitte serez. »
En effet,
à l’heure indiquée, l’empereur, l’archevêque et le prince Maximilien
descendaient la Moselle et s’acheminaient vers Cologne. De là, Frédéric se
rendit à Francfort, puis il parcourut les villes de la Souabe, et arriva enfin
à Augsbourg, où on lui fit très-grand accueil, et où il demeura longtemps.
Ce fut au
moment fixé pour la cérémonie, et lorsque Charles, déjà couvert de ses
vêtements royaux et de ses pierreries les plus précieuses, se disposait à se
rendre à l’église, qu’on vint lui annoncer le départ de l’empereur.
Cette
fuite, qui renversait les projets du duc, lui causa un de ces accès de violente
fureur auxquels il était sujet et qu’il ne savait maîtriser en aucune façon.
Il se répandit aussitôt en imprécations épouvantables et en serments de
vengeance contre Frédéric et l’archevêque de Trêves, son conseiller : Saint
Georges! s’écriait-il en serrant les poings et en grinçant des dents : m'ont—
il ainsi abusé, mais par saint Georges, je m'en vengerai'. Puis il voua à
plusieurs reprises le prince et le prélat aux cent mille diables de l’enfer.
Lorsque
Charles était dans cette disposition d’esprit, il s’enfermait dans ses
appartements, brisait ses meubles à coups de pied, renversait ce qui se
rencontrait sur son passage, se jetait habillé sur son lit, refusait de changer
de vêtements, de se faire raser, et souvent même de manger et de boire.
Semblable à un homme ivre ou possédé, il accablait d’indignes traitements ses
serviteurs les plus dévoués, de sorte que les gens dont les conseils ou les
lumières eussent pu lui être les plus utiles, ne l’approchaient qu’en tremblant,
ou même s’éloignaient de lui, dégoûtés qu’ils étaient de vivre auprès d’un maître
aussi despote et aussi inaccessible aux bons avis.
CHAPITRE VII.
Comment
le duc de Bourgogne alla visiter les domaines que lui avait engagés Sigismond,
comte de Tirol.
Hagenbach
avait été constamment aux côtés de Charles pendant le séjour de Trêves, et la
faveur dont il jouissait avait atteint son apogée. Le chevalier se tint
prudemment à l’écart pendant les premiers moments d’exaspération de son maître.
Quand il jugea le duc un peu plus calme, il essaya de le distraire de ses
sombres pensées, en lui représentant que rien ne l'empêcherait de poursuivre en
temps opportun ses desseins sur l'Allemagne, en y revenant de vive force, sans recourir
à l’empereur, qui l’avait si indignement trahi.
Les
discours du landvogt firent impression sur son
seigneur. Le duc, capricieux et passionné, passant facilement d’une idée à une
autre, et ne voulant plus rester à Trêves, où il craignait d’être l’objet de
la risée publique après sa mésaventure, déclara qu’il irait visiter ses nouveaux
domaines d’Alsace, et ordonna qu’on fit les préparatifs de départ avec toute la
célérité possible.
Il se mit
en route le 25 novembre 1473, et se dirigea vers la Lorraine par le val de
Metz. Ne pouvant s’emparer pour le moment des Etats du duc René, car il n’avait
aucun prétexte pour l’attaquer, il voulait au moins avoir une entrevue avec
lui et essayer de le placer sous sa complète dépendance. Il avait déjà renoué,
dans ce but, de secrètes intelligences avec le vieux roi de Provence.
Les
Bourguignons avaient compté faire grande chère dans le pays messin, fertile en
provisions de toute espèce et où l’on récolte de fort bon vin; mais, à leur
grande surprise, ils trouvèrent les maisons, les caves et les greniers vides.
Les gens de la campagne s’étaient hâtés de retirer leurs denrées dans la
ville; celle-ci était elle-même sur le pied de siège, on avait doublé l’artillerie
des remparts et les gardes des portes et des murailles.
Charles,
marchant à la tête de ses nobles, feignit de ne point apercevoir ces
dispositions hostiles, il tourna Metz. Le 26, il s’arrêta à Thionville, où
les ambassadeurs de Home, de Hongrie, de Pologne, de Venise, de Naples,
d’Angleterre, de Danemark, de Bretagne, de Cologne, de Ferrare et du comte
Palatin vinrent le trouver. Il partit de Thionville le 15 décembre, passa la
nuit à Sainte-Marie-aux-Bois, de là à Chambley, puis
au château de Pierrefort; le 15 décembre il arriva à Frouart.
Le duc de Lorraine l’y rencontra, les deux princes se témoignèrent de l’amitié,
et se rendirent ensemble à Nancy, où leur entrée fut saluée d’une triple
décharge d’artillerie.
Réné ordonna que le duc de Bourgogne
fût traité avec toute sorte de respect, et le quitta peu pendant les trois
journées qu’il passa dans sa capitale. Charles cherchait à lui prouver que, vu sa
grande jeunesse, il avait besoin d’un puissant protecteur. Il l’exhorta à lui être
inviolablement fidèle, et lui rappela la convention récemment conclue,
d’après laquelle on devait livrer aux Bourguignons diverses places d’armes de
la Lorraine. «Rênes ’y était engagé, dit un auteur cité déjà plusieurs fois, en
se voyant le couteau sur la gorge, et ses confédérés le regarder les bras
ployés, sans lui donner aucune espérance de secours ; lors, il avait choisi ce
que la nécessité, qui est un violent maître d’escolle,
lui enseignait, que fut de recevoir la loi de celui a qui le pressoir de plus
près, qui toit le duc de Bourgogne».
Toutefois, Réné soumit encore une fois cette affaire à son
conseil. Celui-ci était divisé en deux partis. L’un, le parti de la Lorraine
française, avait servi sous le duc de Bourgogne contre Louis XI, pendant les
derniers règnes, et se montrait fort disposé à entrer dans les vues de Charles
; le second, au contraire, composé des seigneurs de la Lorraine allemande,
éprouvait pour les Bourguignons une insurmontable antipathie. Le premier
l’emporta ; il fut décidé que Réné renoncerait à
l’alliance du roi, qui s’était déjà montré traître à l’égard du feu duc
Nicolas. Charles obtint, comme places d’armes, Epinal, Darney, Neufchâteau et Preny. L’on renouvela également la stipulation qui
reconnaissait aux gens de Bourgogne le droit de passage par la Lorraine, quantes fois que bon leur semblerait» en
se conduisant en amis, et en payant comptant toutes les provisions. De son
côté, Charles le Téméraire promit à Réné et aux
seigneurs lorrains alliance et protection contre quiconque les attaquerait.
Le duc de
Bourgogne confia le gouvernement des quatre places au Rheingrave,
à M. de Brandebourg, au sieur de Varembon et au
Bâtard de Calabre.
Réné de Lorraine accompagna, le 19
décembre, son allié jusqu’à Saint-Nicolas du Port, et Charles, ayant pris congé
de lui, continua sa route vers l’Alsace.
La
nouvelle de sa prochaine arrivée se répandit promptement dans cette province
et y causa une si grande terreur, que de tous côtés les populations des
campagnes prenaient la fuite. L’évêque de Strasbourg et les cités
resserrèrent leur alliance. Plusieurs d’entre elles, notamment Bâle,
réunirent de fortes garnisons afin d’être en état de résister au duc, s’il
avait dessein de les attaquer.
Charles
le Téméraire traversa les Vosges avec 5000 cavaliers et entra en Alsace par le
val de Willé, deux jours avant les fêtes de Noël. Hagenbach
le précédait, à la tête de 1000 cavaliers et 2000 fantassins vallons. Il avait
fait halte auprès de Colmar, afin d’annoncer aux magistrats de cette ville la
visite du prince pour le 24 décembre, et de leur ordonner de le recevoir avec
le respect et les honneurs dus à son rang. Mais les bourgeois, loin de tenir
compte de cette orgueilleuse injonction, déclarèrent péremptoirement que si
le duc prétendait franchir l’enceinte de leurs murs avec plus de deux cents
cavaliers, ils lui fermeraient leurs portes. On connaissait à Colmar la façon
dont Pierre gouvernait les pays confiés à son administration, on ne voulait pas
risquer de se livrer à lui et de se trouver un jour soumis à sa tyrannie. Il
recueillait ainsi les fruits de cet odieux despotisme qui avait fait exécrer le
nom bourguignon dans la contrée entière.
Tandis
que Hagenbach négociait avec les Colmariens, Charles se disposait à passer la
nuit à Chatenois, bourg situé au pied des Vosges, non loin de Schélestadt. Les habitants du lieu, se défiant de lui,
s’étaient retranchés dans un cimetière protégé par une forte enceinte de
murailles. Les Bourguignons voulurent aussitôt entrer dans cet asile et se
préparaient à user de violence; la scène commençait à devenir tumultueuse,
lorsque l’un des gens de Chatenois ajusta un soldat qui l’apostrophait en l’injuriant,
et l’étendit roide mort sur la place. Le désordre fut alors porté à son comble;
les troupes de Charles menaçaient de mettre immédiatement le feu aux quatre
coins du bourg, si on ne leur livrait le coupable. Les paysans hésitaient, mais
cet homme énergique et courageux, ne voulant pas que d’autres portassent la
peine de son action, vint lui-même se livrer à ses bourreaux. Les Bourguignons
décidèrent qu’il serait publiquement exécuté à Colmar, afin de donner un
exemple salutaire au pays; et quelques heures après cet épisode, ils se remirent
en marche. Pendant la route, une querelle s’éleva parmi les gardiens du
prisonnier; celui-ci en profita pour prendre la fuite et regagner son village,
sans qu’on lui eût fait aucun mal.
Cependant,
Charles le Téméraire était arrivé auprès de Colmar. Mais les bourgeois virent,
du haut des murs, que la troupe du prince était fort nombreuse, et que 1500
hommes d’armes venaient encore du côté de Guémar. Ils s’empressèrent alors de
fermer leurs portes, ainsi qu’ils l’avaient annoncé à Pierre de Hagenbach, et
enjoignirent fièrement au duc de passer outre. On ne pouvait songer
dans le moment à tirer vengeance de cet affront. Charles se décida en conséquence
à suivre le comte Jean de Lupffen, qui l’engageait à
pousser jusqu’à son château, bâti sur une hauteur, à une ou deux lieues de la
ville. Le corps d’armée bourguignon prit ses quartiers dans les villages
voisins, de façon à pouvoir être réuni au premier signal.
Le
lendemain 25 décembre, Charles repartit de grand matin pour Brisach.
Il y fut reçu pompeusement, mais avec beaucoup d’inquiétude. On dissémina ses
hommes d’armes dans les bourgades des environs, et suivant leur usage, ils y
commirent toutes sortes d’excès, enlevant les vivres et les bestiaux aux
paysans, cherchant à séduire leurs femmes et leurs filles, ne payant rien de
ce qu’ils prenaient; en un mot, ajoute la chronique de Strasbourg, «on eût dit
des troupes ennemies auxquelles on aurait permis le pillage de la contrée.»
Le 28
décembre, le duc réunit la bourgeoisie de Brisach sur
la place du marché et se fit prêter par elle le serment de fidélité pur et simple,
sans réserve ; et tant était grande la terreur qu’il inspirait, qu’on ne
songea pas à lui résister ou à réclamer. Dans cette môme journée, il vit
arriver les évêques de Bâle et de Spire, les envoyés du comte palatin et du
margrave de Bade; ces seigneurs recommandèrent le pays et ses habitants à sa bienveillance.
Charles, qui précisément se trouvait dans un de ses rares accès de mansuétude,
accueillit leur pétition d’une manière assez gracieuse, et leur demanda à son
tour de vivre avec lui en bons voisins. Ils lui firent à cet égard les plus
belles promesses du monde.
La
population de Brisach profita du séjour du prince
bourguignon pour hasarder quelques plaintes très-timides touchant la sévérité de l’administration de Hagenbach: toutefois, cet homme était l’objet d’une
telle crainte, et on le voyait si avant dans la faveur de son maître, que
personne n’osa dévoiler à Charles les horreurs commises par son lieutenant. Ce
fut un nouveau malheur pour le pays. Le duc, s’il avait su toute la vérité, eût
sans doute puni ou remplacé le landvogt; au lieu de
cela, il se borna à lui adresser quelques stériles recommandations, et celui-ci
se promit intérieurement de tirer une éclatante vengeance des plaintes des
bourgeois aussitôt qu’il n’aurait plus les mains liées par la présence de son
seigneur.
Charles
le Téméraire quitta Brisach le dernier jour de décembre
de l’année 1473, et se dirigea vers Ensisheim. Il y passa en revue les hommes
d’armes des différentes villes qui lui avaient été engagées par Sigismond. Ils
étaient au nombre de plusieurs mille et parfaitement équipés. Le duc se montra
enchanté de leur bonne tenue, et Hagenbach lui affirma que cette troupe
pourrait être quadruplée au besoin
Charles,
ayant traversé encore une fois le Rhin, se rendit à Thann, où il reçut les ambassadeurs
d’Aragon, de Bretagne et de Venise, les envoyés de plusieurs princes allemands,
et le nonce du pape. Deux anciens avoyers de Berne, Petermann
de Werber et Nicolas de Scharnachthal,
se présentèrent aussi au nom des Suisses, lui parlèrent à genoux, bien qu’ils
ne fussent pas ses sujets, et lui demandèrent justice et réparation des
injures que la ligue avait reçues du sieur d’Howdorf et du landvogt Hagenbach. «Je pars, fut la seule réponse de Charles; si vous
avez à me parler, suivez-moi à Dijon.»
En effet,
il ordonna qu’on se disposât à se mettre en route dès le surlendemain matin, et
déclara que son intention était de retourner dans sa capitale à la tête de
toutes les troupes présentes Mais, à la prière d’Hagenbacb,
il lui laissa huit cents Picards; le landvogt les
avait demandés soi-disant pour protéger le pays, mais en réalité il désirait
les conserver, afin de s’en servir dans l’exécution de ses détestables projets.
Le duc de
Bourgogne s’éloigna de l’Alsace le 3 janvier de l’année 1474 , et reprit à
marches forcées le chemin de ses Etats. Son départ répandit dans la province
une joie proportionnée à l’effroi qu’y avait occasionné sa présence. L’on
avait craint de lui voir former quelque entreprise contre Strasbourg, Colmar et Schélestadt, et si ses affaires lui en eussent laissé
le temps, il n’y eût pas manqué, car la possession de ces villes importantes
le tentait infiniment. «Mais, ajoute notre chroniqueur, Dieu, dans sa
puissance et sa miséricorde, détourna ce malheur de notre patrie; et les forts
et villes du pays purent rendre de nouveau une partie de leurs garnisons aux
travaux de l’agriculture. »
CHAPITRE
VIII.
Comment
une ligue formidable se forma contre le duc de Bourgogne, et comment Sigismond
rentra en possession des domaines engagés.
Cependant,
l’absence du prince bourguignon devint l’occasion de nouvelles calamités pour
les domaines que lui avait engagés Sigismond d’Autriche. —Hagenbach ne tarda
pas à revenir aux errements de son administration précédente. Il semblait même
qu’il voulût se dédommager d’une contrainte de quelques jours par un redoublement
de violence et d’iniquité, et en s’abandonnant sans aucune réserve à toutes
ses infâmes passions, à toute sa brutalité, «do wart herr Peler von Hagenbach noch zorniger und tett dem land und den Lüten noch viel mer ze leide,» dit
l’historien d’Alsace. Les exactions recommencèrent; on accabla les habitants
du pays des plus mauvais traitements, le landvogt ne
tenait compte ni du rang, ni des droits de personne.
Les
premières journées après le départ de Charles se passèrent en réjouissances à
l’occasion du mariage de Pierre.
Il épousa
celle même comtesse Barbe de Tengen qui, quelques
années auparavant, avait fait impression sur lui au castel de Marquart de Baldeck. Maintenant
il la forçait à lui accorder sa main, plutôt pour se venger de ses précédents
refus, que par un sentiment d’amour et de constance. Or, la terreur inspirée
par le landvogt était telle, que cette fois sa
demande avait été accueillie comme un ordre auquel il fallait obéir sans
hésitation ni résistance.
Pierre
marié, resta aussi dissolu de mœurs qu’auparavant, il continuait à enlever des
femmes et des filles de familles respectables, pour leur faire violence ; ses
officiers et même ses soldats imitaient ses exemples.
Bientôt
après, le landvogt s’empara de divers pâturages
appartenant aux nobles et aux communes, et, selon son ancien usage, il
confisqua à son profit plusieurs propriétés qui tentaient sa cupidité. Il
renouvela également ses menaces contre Strasbourg et les autres villes; enfin
il ordonna qu’on lui payât un rappen (petite
pièce de monnaie) pour chaque mesure de vin qui se consommerait dans le pays.
Cet impôt lui rapporta des sommes immenses .
Les
villes et les campagnes voulurent essayer encore une fois de ramener le chevalier
à de meilleurs sentiments. Elles députèrent à Brisach quatre honorables bourgeois chargés de lui faire des représentations et de lui
demander avec fermeté de les laisser en jouissance de leurs droits anciens, et
d’avoir égard au traité conclu entre son maitre et l’archiduc. Hagenbach reçut
ces envoyés; pendant les premiers moments, il écouta l’exposé de leurs griefs
avec une apparente patience; mais, son naturel féroce reprenant bientôt le
dessus, il les accabla d’injures, en s’agitant comme un furieux sur son siège;
puis, sans leur donner le temps de répondre, il fit signe au bourreau, qui au
moment même les décapita en sa présence.
Après
cette affreuse exécution, le landvogt sembla ne plus
agir que sous l’inspiration de Satan. Il résolut de désarmer les cités, et de
supprimer les corps de métiers. En même temps il accabla les paysans de
corvées et en fit périr tous les jours un grand nombre ; ses exécrables Wallons,
excités par lui, opprimaient et pillaient le pauvre peuple; enfin, ajoute la
chronique d’où ces détails sont tirés, le vieux fleuve Rhin lui-même avait
terreur de lui; et de tous côtés des prières s'élevaient vers le ciel pour
que Dieu prit pitié de l’humanité et délivrât la terre d’un pareil monstre. Les
cités d’Alsace renouvelèrent leur alliance défensive, et les pays engagés
envoyèrent un messager à Innsbruck, vers leur souverain naturel, l’archiduc
Sigismond, afin d'implorer son assistance1.
Ce prince
s’empressa d’écrire à Hagenbach, et lui enjoignit de respecter les droits, les
biens et la vie de ses sujets. Cette lettre enflamma encore davantage
l’impitoyable landvogt, et Sigismond comprit enfin
qu’il était urgent d’agir avec énergie, pour soustraire ses domaines à un joug
aussi intolérable.
Le roi
Louis XI avait suivi avec la plus grande attention les événements d’Alsace,
afin de saisir le moment d’opérer un rapprochement entre la maison d’Autriche et
la Suisse. Le duc de Bourgogne avait, à la vérité, des amis à Berne et dans
d’autres villes de la ligue. Ils étaient dirigés par Adrien de Bubenberg. Mais Louis avait su s’y former également un
parti composé des plus riches bourgeois et des familles nouvelles : à sa tête
se trouvait Nicolas de Diesbach.
Depuis
plusieurs années déjà (1469), le roi avait conclu avec les Suisses un traité
d’alliance, signé, d’un côté, par les envoyés de Berne, qui représentaient
aussi Lucerne, Uri, Schwitz, Underwalden, Zug et Glaris; de l’autre, par les envoyés français, Louis
de Joinville et Jean Breçonnet. Il y était dit : «Au
cas où Mgr le roi voudrait faire la guerre au duc de Bourgogne ou le duc de
Bourgogne au roi, Nous et les seigneurs de la ligue de la haute Allemagne, nos confédérés très-chers, ne devons, ni par nous,
ni par les nôtres, porter, prêter, ni accorder aucun secours, faveur, ou
conseil audit duc de Bourgogne. Pareillement, si Mgr de Bourgogne voulait faire
la guerre contre nos confédérés les seigneurs de la ligue, ou nous à lui, le
roi ne devrait prêter, porter, ni accorder secours, faveur ou conseil au duc de Bourgogne ».
Cette
convention n’avait cause aucune inquiétude à Charles le Téméraire, qui
comptait sur ses partisans de Berne. Il avait continué d’ailleurs à vivre
encore avec les ligues en rapport de bon voisinage. Mais, grâce à la conduite
insensée de Hagenbach, le moment approchait où son maitre devait ressentir les
effets de l’inimitié des Suisses. Tandis que le duc repoussait rudement les ambassadeurs
helvétiques à Thann, le roi concluait avec Nicolas de Diesbach un nouveau pacte, par lequel la France et la ligue s’engageaient à se soutenir
réciproquement dans leurs guerres, et en particulier contre la Bourgogne. Louis
promettait en outre que, sa vie durant, il ferait payer annuellement à Lyon, à
ses nouveaux alliés, en témoignage de sa charité envers eux, la somme de 20,000
francs; que de plus il donnerait quatre florins et demi du Rhin par mois à
chaque soldat suisse qu’il prendrait à son service; «qu’enfin si les ligues
venaient à être en lutte avec le duc de Bourgogne, et si lui, roi de France,
était empêché de leur envoyer s des renforts, il leur payerait, à Lyon également,
20,000 florins du Rhin par quartier, «pendant le temps de la guerre». Tel fut
le premier traité de subsides entre la France et la Suisse
Cependant
ceci était simplement le prélude de l’alliance formidable que le roi avait
dessein de former contre le duc de Bourgogne, et dans laquelle il comptait
faire entrer Sigismond et les villes libres d’Alsace et des bords du Rhin. Hagenbach,
par son despotisme, rendait nécessaire l’union intime de ceux que Louis XI
voulait rapprocher; il secondait donc merveilleusement les plans de ce
monarque fin et astucieux, et devint ainsi la cause immédiate de la ruine de
Charles le Téméraire.
Louis fit
faire, pour la troisième fois, des propositions aux Suisses et en même temps
aux cités alsaciennes et à l’archiduc. L’on convint d’une réunion à Constance
(le 25 mars 1474), afin d’établir les bases d’un accord.
Sigismond
et les évêques Robert de Strasbourg et Jean de Bâle y parurent en personne, les
cantons suisses et les villes de Strasbourg, Bâle, Colmar, Schelestadt,
Haguenau, Keysersberg, Mülhouse,
Munster, Turckheim et Rosheim y députèrent des représentants. Un grand nombre
de gentilshommes se réunirent aussi à cette diète; Louis XI y envoya Josselin
de Sillinen, administrateur du diocèse de Grenoble,
et Jean, comte d’Ebersteim, deux de ses négociateurs
les plus habiles. L’on s’entendit promptement; il s’agissait de faire face à
un danger commun, les anciennes rivalités, les querelles entre les nobles et
les communes semblaient oubliées.
Chacun
comprit qu’avant toute autre chose, il était nécessaire de cimenter une paix
solide et durable entre Sigismond et les ligues. Il fut donc décidé que
l’Argovie, objet du litige, resterait à perpétuité aux Suisses; ceux-ci, de
leur côté, s’engagèrent à restituer à l’archiduc les documents, titres et
papiers non relatifs à l’Argovie, et qu'ils avaient pris dans les divers forts
dont ils «'étaient successivement rendus maîtres. Il y eut à la vérité une
difficulté : les ligues exigeaient le passage par quatre ville de la comté de
Ferrette, quand il leur plairait. Mais ce différend, soumis à l’arbitrage de
Louis XI, fut promptement apaisé. Le roi décida en faveur des Suisses.
Cependant,
Charles le Téméraire se trouvait alors en Bourgogne, et avait été instruit
enfin de ce que Louis tramait contre lui. Toutefois il ne croyait pas à
beaucoup près les choses aussi avancées, et il se borna à prier son parent,
Jean de Savoie, comte de Romont, de remplir les fonctions de médiateur. Ce seigneur,
très-dévoué aux intérêts du duc, envoya sans tarder Henri de Collombier et Jean Allard en Suisse. Les deux ambassadeurs
se rendirent successivement dans les villes et communes du pays, traitant tout
le monde avec beaucoup d’égards , et représentant à chacun qu’on avait toujours
été en rapports de bon voisinage avec la maison de Bourgogne, et qu’il serait
fort mal avisé de se brouiller avec elle pour se lier à celle d’Autriche, la
plus ancienne et la plus redoutable ennemie des ligues. Collombier et Allard furent reçus partout d’une manière très-honorable, et au moment même
où se tenaient les conférences de Constance, ils ne rencontrèrent nulle part de
dispositions ouvertement hostiles contre Charles. Ce prince resta donc dans
une trompeuse sécurité, et quitta Dijon pour retourner dans son duché de
Luxembourg, et combiner avec l’Angleterre la perte de Louis XI. Il laissait
ainsi derrière lui des causes de ruine imminente, et tandis qu’il rêvait à
l’accomplissement de ses immenses projets, les négociations entamées par
l’influence du monarque français étaient couronnées du plus heureux succès.
L’on en
vint bientôt à la question la plus importante, à celle de l’expulsion des
Bourguignons de l’Alsace. Les députés des villes de ce pays rendirent à
l’assemblée un compte exact des crimes de Hagenbach, et démontrèrent que le
but de Charles était d’étendre son autorité sur la province entière. Ils
ajoutèrent qu’évidemment le duc, maître déjà d’une partie du cours du Rhin, du
nord de la France, jusqu’aux bords de la Somme, sûr de son alliance avec
l’Anglais et le Breton, se flattait maintenant encore d’unir la Méditerranée à
la mer d’Allemagne, en héritant du vieux roi Réné, la
Provence et le royaume d’Arles, et en ajoutant aux deux Bourgognes et à la
comté de Ferrette la Lorraine et la Suisse.
Ces
considérations étaient fondées et justes : il était urgent de se liguer contre
l’ambition de Charles le Téméraire. Enfin, les membres présents conclurent, en
leurs noms et en ceux de leurs mandataires, une alliance offensive et défensive
dont la durée devrait être de dix ans.
Cependant,
Sigismond d’Autriche ne possédait pas les 80,000 florins nécessaires pour
dégager ses domaines. Strasbourg et Bâle lui proposèrent de les lui avancer
pour un temps indéterminé, sous la garantie du roi de France. Cette offre
ayant été acceptée, l’on se sépara. Chacun retourna chez soi, afin de se
préparer à la guerre
L’archiduc
partit de Constance, à la tête de 300 cavaliers, et se dirigea vers Bâle. Partout,
à son passage, les populations suisses l’accueillirent avec la plus franche
cordialité, le souvenir de cent cinquante années de haines et de guerres
sanglantes était éteint. Sigismond, arrivant à Bâle, apprit que la somme de
80,000 florins s’y trouvait déjà disponible et déposée à la Monnaie.
Il s’empressa alors d’envoyer deux hérauts au duc de Bourgogne pour l’en
informer et lui déclarer que, la dette étant acquittée, on eût à le remettre en
possession de ses terres, conformément aux clauses du traité
conclu en 1469
Jamais
peut-être Charles le Téméraire n’avait eu d’accès d’emportement aussi violent
que celui avec lequel il accueillit la lettre de l’archiduc. Si dans ce moment
d’autres affaires n’eussent exigé sa présence, il se fût mis en route
sur-le-champ pour ravager l’Alsace entière. II ordonna qu’on emprisonnât les
hérauts et les retint assez longtemps captifs, sans cependant leur faire aucun
mal.
L’écrit
par lequel il répondit à Sigismond était de la plus excessive arrogance. II
rappelait que le landgraviat lui avait été engagé à une époque où l’archiduc,
abandonné par tout le monde, ne savait comment arrêter le mauvais vouloir des
Suisses. «Mais, ajoutait-il, nous avons dépensé quatre fois la somme que nous vous
avons avancée pour nous procurer du repos à nous-mème et aux autres; nous ne voulons pas avoir fait ces sacrifices en pure perte.
Des ennemis nous ont été suscités, qu’on les mette hors d’état de nous nuire,
qu’ensuite la « dette nous soit payée à Besançon et non pas à Bâle. Et si l’on
refuse d’accéder à ces conditions, disait-il en finissant, nous en tirerons
vengeance sur votre propre personne»
Le duc de
Bourgogne eut soin aussi d’expédier un messager à Hagenbach, pour lui
recommander de se maintenir dans les domaines d’Alsace, jusqu’à ce qu’il y vint
lui-même. Pierre avait résolu, au moment où il avait été informé des négociations
de Constance, et sans attendre les ordres de son maître, de mettre de fortes
garnisons dans les villes de la province. Il commença par garnir Thann de
troupes. De là il retourna à Brisach, à la tête des
Lombards; y étant arrivé pendant l’office du vendredi-saint, il entra dans
l’église avec sa suite et força le prêtre à recommencer le service pour lui.
Cependant,
l’archiduc venait de conférer le titre de landvogt au
chevalier Hermann d’Eptingen, et ce seigneur avait
quitté Bâle avec 200 lances pour entrer en fonctions. L’on accourut en foule
au-devant du nouveau gouverneur. Les habitants d’Ensisheim reconnurent les
premiers son autorité. Le seul Antoine de Münstrohl,
lieutenant de Hagenbach, chercha à conserver la ville au duc de Bourgogne en se
retirant dans la citadelle, mais les bourgeois le forcèrent à capituler et
chassèrent la garnison.
Ces événements
ayant été rapportés à Hagenbach, il partit en hâte avec un corps de cavalerie
pour faire rentrer Ensisheim sous son joug. La ville lui ferma ses portes, et,
en dépit de ses menaces, de ses imprécations et de ses serments de la plus
éclatante vengeance, il fut obligé de s’éloigner.
Pierre,
ivre de fureur, revint à Brisach, et fit ses
dispositions pour livrer un assaut à Ensisheim dans la matinée du jour du
Pâques, à l’heure où il pensait que la population, réunie dans les églises, ne
songerait guère à la défense de ses murs. Il voulait, disait-il, aller lui
donner la bénédiction pascale. Il ordonna donc à 500 hommes déterminés de se
préparer, de se munir d’échelles et de tous les objets nécessaires pour entrer
de vive force dans une place de guerre. Toutefois, son projet avorta. Les gens
d’Ensisheim auxquels la garde des murs avait été confiée, ayant aperçu la
cohorte ennemie, sonnèrent l’alarme; aussitôt on se précipita en foule hors des
églises pour courir aux armes. Hagenbach commanda l’assaut de la citadelle;
mais, ayant été repoussé avec une perte assez considérable, il se retira.
CHAPITRE IX.
Comment Pierre de Hagenbach fut puni de ses crimes et
cousent il se repentit avant de mourir.
Les habitants de Brisach ignoraient ce qui venait de se
passer à Ensisheim, et Pierre fit faire une garde très-sévère, afin que la
nouvelle ne pût leur en arriver. Il avait reçu quelques renforts, ses troupes
se montaient alors à 800 Wallons, 200 Allemands et autant de cavaliers. Son
irascibilité était parvenue au dernier degré d’exaspération, à la suite de
l’échec qu’il avait essuyé. Dans la soirée de ce même dimanche de Pâques, il convoqua ses officiers, afin de
tenir avec eux un conseil secret. Il leur représenta qu'il était urgent de
conserver au moins à tout prix la possession de Brisach au duc de Bourgogne. La
ville était bien approvisionnée, Hagenbach résolut de la débarrasser des
bouches inutiles et d’en fermer les portes. Il déclara donc à ses subordonnés
que, le lendemain matin, il ferait sortir tous les habitants des deux sexes,
sous prétexte de les obliger à creuser un fossé autour des remparts, qu’il ne
les laisserait plus rentrer, et qu’ensuite on assommerait ceux restés dans
l’intérieur de la cité. Il comptait sur les . Wallons et les Allemands pour
exécuter ces ordres épouvantable .
Et en effet, à l'issue du conseil, un roulement de
tambour rassembla la bourgeoisie sur la place principale delà ville, et on lui
annonça que, sous peine de la bastonnade, les gens de Brisach, hommes et
femmes, eussent à se rendre devant les portes, le jour suivant, à l'heure du
lever du soleil, pour travailler à augmenter les moyens de défense de la place.
Or, Frédéric Vœgelein,
commandant 200 Allemands, était indigné depuis longtemps des orgies et des cruautés
du landvogt. C’était un homme courageux et
entreprenant, quoique de petite taille. Ce brave soldat logeait dans la maison
d’un honnête artisan, lequel avait femme et enfants. La famille de son hôte lui
avait toujours témoigné de l’amitié, et il en avait même reçu différents petits
services.
Vœgelein,
après avoir assisté à la conférence réunie chez Hagenbach, retourna à son logis
et s’assit, sombre et soucieux, à la table du bourgeois; les enfants s’étant
approchés familièrement de lui, suivant leur habitude, il fut saisi d’un
sentiment de grande pitié à la vue de ces petits malheureux destinés à être
assassinés ou orphelins le jour suivant. Bientôt il eut arrêté un plan pour
prévenir la boucherie ordonnée par le landvogt. Ayant
fait part des desseins de Pierre à ses hôtes, qui l’écoutaient pâles et immobiles
de terreur, il leur enjoignit d’en avertir incontinent les habitants de
Brisach. « Quant à moi, ajouta-t-il, je monterai chez le sire de Hagenbachet lui demanderai notre solde; il se mettra en
colère, je le quitterai, et aussitôt que vous entendrez le roulement du
tambour, hâtez-vous d’accourir bien armés sur la place du marché. Le chevalier
y viendra, je vous en réponds, et nous l’aurons en notre puissance. « Il nous
faut contenir cette bête féroce, prête à tremper ses mains dans votre sang ».
Vœgelein,
après avoir parlé de la sorte, alla rejoindre en secret ses 200 Allemands : «
Le landvogt, leur dit-il, ne veut point nous payer notre
dû, et son projet est de nous expulser de la ville; c’est pourquoi j’irai
demain, au lever du soleil, lui demander encore de l’argent, et s’il persiste
dans ses refus, je battrai le tambour sur la grand’place;
alors réunissez-vous incontinent, équipés en guerre, et ayez soin d’exécuter
les ordres que je vous donnerai ».
On ne pensa guère à dormir cette nuit-là à Brisach.
Pierre était levé dès les premières lueurs de l’aurore, et le capitaine, étant
entré chez lui, s’écria hardiment : « Sire landvogt,
mes hommes d’armes ne me laissent aucun repos, il y a longtemps que nous ne
recevons plus de solde; tout ce que nous avions est consommé, nous manquons
d’argent » . Hagenbach lui tourna le dos d’un air de mépris, et répondit avec
sa trivialité habituelle : « Ich geb dir ein dreck uffd’nasen » .
Puis il le menaça de le faire jeter dans le Rhin, une pierre au cou, s’il revenait
à la charge. Vœgelein ne lui donna pas le temps de
prononcer un mot de plus : il courut aussitôt à la place et frappa à tour de
bras sur la caisse de sa troupe. Le chevalier, lorsqu’il entendit ce bruit, se
précipita sur les pas du chef allemand pour le poignarder de sa main, mais, en
même temps que lui, arrivèrent les soldats et les bourgeois armés de pied en
cap. Les femmes même venaient de tous côtés, portant des pioches, des fourches
et des broches, la foule, sans attendre les ordres de Vœgelein,
se rua sur Hagenbach, qui chercha son salut dans la fuite et se réfugia dans la
première maison venue. On l’y poursuivit, il fut pris. Il resta alors enfermé
pendant deux jours, et sous bonne garde, dans la demeure du bourgmestre. Le
troisième jour, on lui riva des fers aux pieds et aux mains; le quatrième, il
fut emprisonné dans une tour bâtie au bord du Rhin.
Personne, dans cette échauffourée, n’avait défendu
Hagenbach. Ses abominables Wallons, s'étaient sauvés de Brisach au moment de
son arrestation, oubliant même leurs effets, dans leur retraite précipitée.
Lorsque Pierre eut été garrotté, ils revinrent sur leurs pas et se présentèrent
aux bourgeois avec une contenance dont l’humilité égalait leur arrogance
passée, demandant qu’on voulût bien leur permettre d’emporter ce qui leur
appartenait, et de se retirer ensuite en paix. Ils protestèrent aussi que
toujours ils avaient eu regret de la conduite du chevalier, et qu’ils n’avaient
pas commis la moitié des cruautés qu’il leur ordonnait habituellement
d’exécuter. Ces assurances n’étaient point conformes à la vérité, et les gens
de Brisach avaient sans doute bien des vengeances à exercer : mais, contents de
l’arrestation du principal criminel, ils se montrèrent généreux et accordèrent
aux Wallons l’autorisation réclamée. Vœgelein resta
avec sa troupe et prit du service chez l’archiduc.
Tandis que ces choses se passaient à Brisach, les
Strasbourgeois attaquaient et enlevaient aux Bourguignons, dans la journée du
lundi de Pâques, le château d’Ortenberg et la vallée
de Willé. En même temps aussi, Hermann d’Eptingen continuait à reprendre possession des pays
engagés, au nom de l’archiduc. Partout on l’accueillait comme un libérateur.
Antoine de Münstrohl, possesseur du château de Thann
, et qui déjà s’était opposé à la reddition du fort d’Ensisheim, ferma seul ses
portes au nouveau landvogt, mais peu après il rentra
également dans le devoir.
Sigismond suivit de près son lieutenant. Il se rendit
d’abord à Ensisheim; et, le 30 avril, il arriva à Brisach aux acclamations de
tout le peuple. Le 4 mai suivant, l’archiduc ordonna qu’on fît subir la torture
à Hagenbach, et ce scélérat, incapable de résister aux tourments de la
question, avoua ses innombrables forfaits aux lieux même qui, pendant près de
trois ans, en avaient été le théâtre habituel
Le prince chargea Eptingen de
poursuivre le procès de son prédécesseur. Pierre fut mis en jugement le 9 mai.
Le tribunal, présidé par Thomas Schulz, schultheiss (bailli) d’Ensisheim, était composé de vingt-sept juges choisis parmi les
hommes les plus instruits et les plus probes du pays. On en fît venir deux de
Strasbourg, deux de Bâle, autant de Colmar, Schelestadt, Kentzingen, Fribourg, Neubourg, Soleure et Berne, et
on leur adjoignit huit bourgeois notables de Brisach, parce que cette ville
avait été principalement souillée par les excès de l’ancien landvogt.
Plusieurs milliers d’individus affluèrent de la contrée environnante, afin
d’assister aux débats. Quatre cents personnes accompagnaient , dans trois
grands bateaux, les deux seuls juges bâlois.
Lorsque Hagenbach comparut, Eptingen,
laissant de côté la grande masse des crimes du prévenu, se borna à faire porter
contre lui quatre chefs d’accusation, par Pierre Iselin,
qui remplissait les fonctions d’accusateur public, pensant que cela suffirait
pour le faire condamner, à savoir :
1° D’avoir fait mettre à mort quatre honnêtes bourgeois
de Thann, sans jugement-préalable;
2° De s’être solennellement engagé, en arrivant à
Brisach, à n’y introduire aucune innovation, et à laisser ladite ville en
jouissance de ses anciens privilèges, et d’avoir été infidèle à ses promesses,
en destituant et remplaçant le conseil et les corporations, et en établissant
les impôts les plus onéreux;
3° D’avoir manqué à son serment de ne laisser entrer dans
la ville aucune troupe étrangère, d’y avoir admis des Français et des Picards,
qu’il avait logés dans les maisons des bourgeois, et auxquels il avait ordonné
de tuer, dans une même journée, tous les habitants de la place ;
4° Enfin, d’avoir fait violence à une foule de jeunes
filles, de femmes mariées et même de religieuses, à Brisach et dans les
villages et couvents des environs.
Pierre de Hagenbach répondit à ces quatre chefs
d’accusation, par l’organe de son fürsprecher (avocat) Jean Irmay.
Le fürsprecher affirma
qu’en condamnant à mort les quatre bourgeois de Thann, son client s’était borné
à obéir à son seigneur le duc de Bourgogne, lequel lui avait enjoint de faire
exécuter les rebelles sans autre forme de procès, et, ajouta-t-il, ces quatre
hommes étaient dans ce cas.
Quant au second chef, il avoua qu’en effet Hagenbach
avait juré aux gens de Brisach de respecter leurs droits; mais il prétendit que
ce serment avait été invalidé par celui prêté postérieurement an duc de
Bourgogne par les bourgeois eux-mêmes.
Passant au troisième chef, Irmay assura que le duc avait enjoint à l’accusé d’introduire les Wallons à Brisach;
qu'ainsi, il ne pouvait être considéré comme coupable pour avoir exécuté les
ordres de son maître.
Et quant à l’accusation relative aux femmes, dit-il
enfin, il n’est point vrai que Pierre de Hagenbach leur ait fait violence, car
il les a toujours généreusement payées.
L’accusateur public ayant repris la parole, le fürsprecher lui répondit encore, puis on entendit
les témoins; cela dura depuis 7 heures du matin jusqu’à 7 heures du soir.
Enfin, les juges prononcèrent leur arrêt: l’ex-landvogt fut condamné à être exécuté publiquement et séance
tenante.
Les hommes chargés de la garde de Pierre le conduisirent
alors en présence du héraut d'armes, Gaspard Harter ,
qui avait assisté aux débats, et ce dernier dit par trois fois : « Quel est
celui que vous m’amenez?» On lui répondit: «C’est le chevalier de Hagenbach; »
et trois fois il répliqua :« Cela n’est point vrai, il n’y a pas ici de
chevalier, il n’y a qu’un lâche et un menteur; qu’on brise ses armes et qu’on
attache son écu à la queue d’un cheval, afin qu’il soit traîné dans la
poussière. »
Puis, s’adressant au condamné, il lui parla dans les
termes suivants : « Pierre de Hagenbach, j’ai regret que tu aies tramé (gewebet) une aussi criminelle vie; ta conduite n’a
pas été celle d’un chevalier. Ton devoir était de maintenir la justice et
le bon droit de tous, de protéger la veuve et l’orphelin, l’honneur des femmes
et des filles, de respecter le clergé, de t’opposer aux abus delà force. Non-seulement
tu t’es rendu coupable des forfaits qui sont opposés à ces devoirs, mais encore
tu as ordonné à d’autres de les commettre. Ainsi donc, puisque tu as agi
contre l’honneur et ton serment de chevalier, tes juges sévères ont décidé
qu’on t’enlèverait les insignes de ton grade pour les jeter sur le fumier, et je te proclame un indigne
chevalier de saint Georges, au nom duquel saint tu as reçu l’ordre de
chevalerie.»
Hermann d’Eptingen, prenant à
son tour la parole en sa qualité de landvogt, dit,
avec lenteur et solennité : « Hagenbach, je vais t’arracher les insignes de
chevalerie que tu portes encore, mais que tu es déclaré indigne de porter, à savoir
; ton collier, ta chaîne, ton anneau, tort poignard et tes éperons. »
Puis, les lui ayant ôtés, il lui en frappa la bouche, et,
se tournant du côté des assistants, il prononça encore les mots suivants : «
Chers chevaliers et sieurs ici présents, d’après vos ordres j’ai arraché ses
insignes à Pierre Hagenbach et lui ai infligé un châtiment public; que cette
leçon vous serve d'exemple, et vous engage à vous a conduire toujours comme il
convient à des chevaliers , noblement, en respectant la justice, le droit et
l’honneur. »
Alors le chef du tribunal se leva de son siège, lut la
sentence à Pierre et le livra immédiatement au bourreau. Hagenbach demanda
qu’on le décapitât sans lui infliger de longues tortures. Cette faveur dernière
lui ayant été accordée, deux vieux prêtres s’approchèrent de lui pour
l’exhorter au repentir et à ne point mourir dans l’impénitence finale, afin que
son âme ne périt point avec son corps.
L’on conduisit le condamné devant la porte dite des
Tonneliers, et comme la nuit était fort obscure, une grande foule
l’accompagnait, portant des torches et des flambeaux. Hermann d'Eptingen et les juges se rendirent à cheval à la place de
l’exécution. Hagenbach marchait à la suite du cortège, entre les deux prêtres.
Dans ce terrible moment, il montra de la fermeté, de la piété et un profond et
véritable repentir de ses crimes passés. Il pria les assistants d’implorer pour
lui la miséricorde divine et de demander à l’archiduc Sigismond d’approuver et
de faire exécuter son testament. Il léguait à l’église de Brisach, seize
chevaux, son trésor et une chaîne d’or de la valeur de cent dix florins, en
expiation de ses forfaits. Arrivé au lieu de l’exécution, Pierre s’agenouilla
dévotement au milieu de l’assemblée pour demander pardon à Dieu et aux hommes;
il reconnut à haute voix que son châtiment n’était pas proportionné à
l’énormité de ses crimes. « Je le
subis sans regret, ajouta-t-il, mais j’éprouve une peine bien vive en pensant
au sang innocent qui coulera encore pour moi, car sans doute le duc Charles voudra
venger ma mort. »
Après avoir prononcé ces paroles, que l’on pouvait
regarder comme prophétiques, Hagenbach rappela l’un des prêtres. Ayant fait sa
confession générale avec une grande contrition et reçu l’absolution, il joignit
les mains et tendit courageusement son cou à l’exécuteur de Colmar, qui passait
pour le plus habile du pays. Un vigoureux coup de glaive sépara la tête du
tronc, et elle roula sur un tas de son, préparé à cet effet. La foule, touchée
du repentir et de la résignation de Pierre, assista en silence à cette
tragédie, et, malgré les cruautés dont il s’était rendu coupable envers la
plupart des assistants, chacun au fond du cœur lui pardonnait. Sa mort soldait
ses crimes, et personne n’eût osé accabler encore d’une malédiction celui qui
allait paraître devant son Juge suprême, celui qu’un ministre du Très-Haut
venait d’absoudre. « Dieu lui soit en aide et à nous tous », ajoute le
pieux Kœnigshofen, en terminant le récit de son
procès et de son exécution.
Le corps de Hagenbach fut déposé dans une chapelle. Le
lendemain on transporta ses restes au castel de sa famille, pour les ensevelir
à côté de ceux de ses ancêtres. Comme il avait fait un legs considérable à
l’église de Brisach, les magistrats de la ville firent sculpter en bois son
buste, afin qu’on l’exposât à côté du maître-autel aux jours des grandes fêtes,
el que le peuple n’oubliât pas de prier pour le repos de l’âme du malheureux
Pierre. Une pièce de la chaîne d’or de Hagenbach décorait le cou de ce buste,
et sur la tête on voyait le béret de velours que le chevalier portait le jour
de son supplice; autour du béret était un large cercle d’or massif, couvert de
perles et de belles pierreries.
Barbe de Tengen, veuve de
Hagenbach, épousa, peu de temps après sa mort, le comte Ulric d’Ortingen, et plus tard, en troisièmes noces, Henri, comte
des Deux-Ponts.
DEUXIEME PARTIE.
SIÉGE DE NEUS. — GUERRE DE SUNDGAU — CONQUÊTE DE LA
LORRAINE PAR CHARLES LE TÉMÉRAIRE.
----------------------------
----------------------------------------------- --------------------------------------------------------- Louis XI et Charles Le Temeraire------------------------------ Histoire de Charles le Téméraire duc de Bourgogne------------------------------------ Charles le Téméraire et la ligue de ConstanceCharles le Temeraire et Rene de Lorraine
Histoire de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne
Histoire des ducs de Bourgogne
|
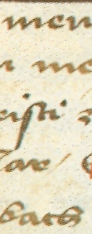 |
 |
 |
 |