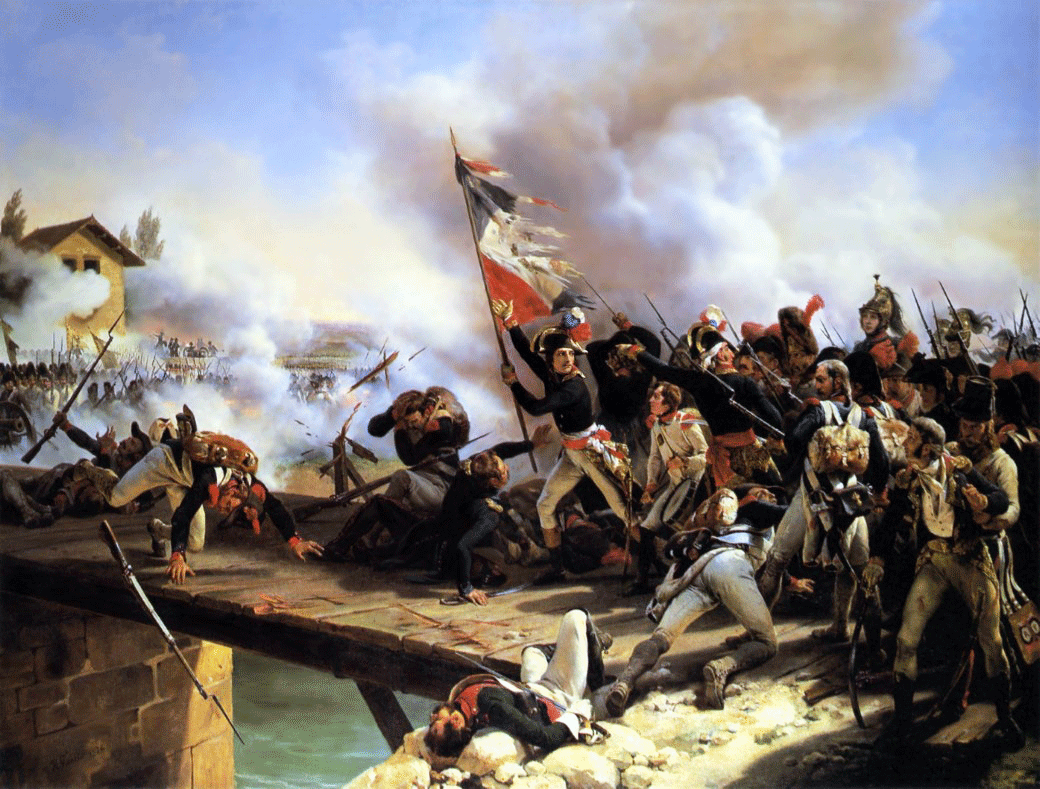HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. |
SITUATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE DE LA FRANCE APRÈS LA RETRAITE DES ARMÉES D'ALLEMAGNE AU COMMENCEMENT DE L'AN V.— COMBINAISONS DE PITT; OUVERTURE D'UNE NÉGOCIATION AVEC LE DIRECTOIRE; ARRIVÉE DE LORD MALMESBURY A PARIS.— PAIX AVEC NAPLES ET AVEC GÊNES; NÉGOCIATIONS INFRUCTUEUSES AVEC LE PAPE; DÉCHÉANCE DU DUC DE MODÈNE; FONDATION DE LA RÉPUBLIQUE CISPADANE.— MISSION DE CLARKE A VIENNE.— NOUVEAUX EFFORTS DE L'AUTRICHE EN ITALIE; ARRIVÉE D'ALVINZY; EXTRÊMES DANGERS DE L'ARMÉE FRANÇAISE; BATAILLE D'ARCOLE.
L'issue que venait d'avoir la campagne d'Allemagne était fâcheuse pour la république. Ses ennemis, qui s'obstinaient à nier ses victoires, ou à lui prédire de cruels retours de fortune, voyaient leurs pronostics réalisés, et ils en triomphaient ouvertement. Ces rapides conquêtes en Allemagne, disaient-ils, n'avaient donc aucune solidité. Le Danube et le génie d'un jeune prince y avaient bientôt mis un terme. Sans doute la téméraire armée d'Italie, qui semblait si fortement établie sur l'Adige, en serait arrachée à son tour, et rejetée sur les Alpes, comme les armées d'Allemagne sur le Rhin. Il est vrai, les conquêtes du général Bonaparte semblaient reposer sur une basé un peu plus solide. Il ne s'était pas borné à pousser Colli et Beaulieu devant lui; il les avait détruits: il ne s'était pas borné à repousser la nouvelle armée de Wurmser; il l'avait d'abord désorganisée à Castiglione, et anéantie enfin sur la Brenta. Il y avait donc un peu plus d'espoir de rester en Italie que de rester en Allemagne; mais on se plaisait à répandre des bruits alarmans. Des forces nombreuses arrivaient, disait-on, de la Pologne et de la Turquie pour se porter vers les Alpes, les armées impériales du Rhin pourraient faire maintenant de nouveaux détachemens, et, avec tout son génie, le général Bonaparte, ayant toujours de nouveaux ennemis à combattre, trouverait enfin le terme de ses succès, ne fût-ce que dans l'épuisement de son armée. Il était naturel que, dans l'état des choses, on formât de pareilles conjectures, car les imaginations, après avoir exagéré les succès, devaient aussi exagérer les revers.
Les armées d'Allemagne s'étaient retirées sans de grandes pertes, et tenaient la ligne du Rhin. Il n'y avait en cela rien de trop malheureux; mais l'armée d'Italie se trouvait sans appui, et c'était un inconvénient grave. De plus, nos deux principales armées, rentrées sur le territoire français, allaient être à la charge de nos finances, qui étaient toujours dans un état déplorable: et c'était là le plus grand mal. Les mandats, ayant cessé d'avoir cours forcé de monnaie, étaient tombés entièrement; d'ailleurs ils étaient dépensés, et il n'en restait presque plus à la disposition du gouvernement. Ils se trouvaient à Paris, dans les mains de quelques spéculateurs, qui les vendaient aux acquéreurs de biens nationaux. L'arriéré des créances de l'état était toujours considérable, mais ne rentrait pas; les impôts, l'emprunt forcé, se percevaient lentement; les biens nationaux soumissionnés n'étaient payés qu'en partie; les paiemens qui restaient à faire n'étaient pas encore exigibles d'après la loi; et les soumissions qui se faisaient encore n'étaient pas assez nombreuses pour alimenter le trésor. Du reste, on vivait de ces soumissions, ainsi que des denrées provenant de l'emprunt, et des promesses de paiement faites par les ministres. On venait de faire le budget pour l'an V, divisé en dépenses ordinaires et en dépenses extraordinaires. Les dépenses ordinaires montaient à 450 millions; les autres à 550. La contribution foncière, les douanes, le timbre et tous les produits annuels, devaient assurer la dépense ordinaire. Les 550 millions de l'extraordinaire étaient suffisamment couverts par l'arriéré des impôts de l'an IV et de l'emprunt forcé, et par les paiements qui restaient à faire sur les biens vendus. On avait en outre la ressource des biens que la république possédait encore; mais il fallait réaliser tout cela, et c'était toujours la même difficulté. Les fournisseurs non payés refusaient de continuer leurs avances, et tous les services manquaient à la fois. Les fonctionnaires publics, les rentiers n'étaient pas payés, et mouraient de faim.
Ainsi l'isolement de l'armée d'Italie, et nos finances, pouvaient donner de grandes espérances à nos ennemis. Du projet de quadruple alliance, formé par le directoire, entre la France, l'Espagne, la Porte et Venise, il n'était résulté encore que l'alliance avec l'Espagne. Celle-ci, entraînée par nos offres et notre brillante fortune au milieu de l'été, s'était décidée, comme on l'a vu, à renouveler avec la république le pacte de famille, et elle venait de faire sa déclaration de guerre à la Grande-Bretagne. Venise, malgré les instances de l'Espagne et les invitations de la Porte, malgré les victoires de Bonaparte en Italie, avait refusé de s'unir à la république. On lui avait vainement représenté que la Russie en voulait à ses colonies de la Grèce, et l'Autriche à ses provinces d'Illyrie; que son union avec la France et la Porte, qui n'avaient rien à lui envier, la garantirait de ces deux ambitions ennemies; que les victoires réitérées des Français sur l'Adige devaient la rassurer contre un retour des armées autrichiennes et contre la vengeance de l'empereur; que le concours de ses forces et de sa marine rendrait ce retour encore plus impossible; que la neutralité au contraire ne lui ferait aucun ami, la laisserait sans protecteur, et l'exposerait peut-être à servir de moyens d'accommodement entre les puissances belligérantes. Venise, pleine de haine contre les Français, faisant des armemens évidemment destinés contre eux, puisqu'elle consultait le ministère autrichien sur le choix d'un général, refusa pour la seconde fois l'alliance qu'on lui proposait. Elle voyait bien le danger de l'ambition autrichienne; mais le danger des principes français était le plus pressant, le plus grand à ses yeux, et elle répondit qu'elle persistait dans la neutralité désarmée, ce qui était faux, car elle armait de tous côtés. La Porte, ébranlée par le refus de Venise, par les suggestions de Vienne et de l'Angleterre, n'avait point accédé au projet d'alliance. Il ne restait donc que la France et l'Espagne, dont l'union pouvait contribuer à faire perdre la Méditerranée aux Anglais, mais pouvait aussi compromettre les colonies espagnoles. Pitt, en effet, songeait à les faire insurger contre la métropole, et il avait déjà noué des intrigues dans le Mexique. Les négociations avec Gênes n'étaient point terminées; car il s'agissait de convenir avec elle à la fois d'une somme d'argent, de l'expulsion de quelques familles, et du rappel de quelques autres. Elles ne l'étaient pas davantage avec Naples, parce que le directoire aurait voulu une contribution, et que la reine de Naples, qui traitait avec désespoir, refusait d'y consentir. La paix avec Rome n'était pas faite, à cause d'un article exigé par le directoire; il voulait que le Saint-Siége révoquât tous les brefs rendus contre la France depuis le commencement de la révolution, ce qui blessait cruellement l'orgueil du vieux pontife. Il convoqua un concile de cardinaux, qui décidèrent que la révocation ne pouvait pas avoir lieu. Les négociations furent rompues. Elles recommencèrent à Florence; un congrès s'ouvrit. Les envoyés du pape ayant répété que les brefs rendus ne pouvaient pas être révoqués, les commissaires français ayant répondu de leur côté que la révocation était la condition sine quâ non, on se sépara après quelques minutes. L'espoir d'un secours du roi de Naples et de l'Angleterre soutenait le pontife dans ses refus. Il venait d'envoyer le cardinal Albani à Vienne, pour implorer le secours de l'Autriche, et se concerter avec elle dans sa résistance.
Tels étaient les rapports de la France avec l'Europe. Ses ennemis, de leur côté, étaient fort épuisés. L'Autriche se sentait rassurée, il est vrai, par la retraite de nos armées qui avaient passé jusqu'au Danube; mais elle était fort inquiète pour l'Italie, et faisait de nouveaux préparatifs pour la recouvrer. L'Angleterre était réduite à une situation fort triste: son établissement en Corse était précaire, et elle se voyait exposée à perdre bientôt cette île. On voulait lui fermer tous les ports d'Italie, et il suffisait d'une nouvelle victoire du général Bonaparte pour décider son entière expulsion de cette contrée. La guerre avec l'Espagne allait lui interdire la Méditerranée, et menacer le Portugal. Tout le littoral de l'Océan lui était fermé jusqu'au Texel. L'expédition que Hoche préparait en Bretagne l'effrayait pour l'Irlande; ses finances étaient en péril, sa banque était ébranlée, et le peuple voulait la paix; l'opposition était devenue plus forte par les élections nouvelles. C'étaient là des raisons assez pressantes de songer à la paix, et de profiter des derniers revers de la France pour la lui faire accepter. Mais la famille royale et l'aristocratie avaient une grande répugnance à traiter avec la France, parce que c'était à leurs yeux traiter avec la révolution. Pitt, beaucoup moins attaché aux principes aristocratiques, et uniquement préoccupé des intérêts de la puissance anglaise, aurait bien voulu la paix, mais à une condition, indispensable pour lui et inadmissible pour la république, la restitution des Pays-Bas à l'Autriche. Pitt, comme nous l'avons déjà remarqué, était tout Anglais par l'orgueil, l'ambition et les préjugés. Le plus grand crime de la révolution était moins à ses yeux l'enfantement d'une république colossale, que la réunion des Pays-Bas à la France.
Les Pays-Bas étaient en effet une acquisition importante pour notre patrie. Cette acquisition lui procurait d'abord la possession des provinces les plus fertiles et les plus riches du continent, et surtout des provinces manufacturières; elle lui donnait l'embouchure des fleuves les plus importans au commerce du Nord, l'Escaut, la Meuse et le Rhin; une augmentation considérable de côtes, et par conséquent de marine; des ports d'une haute importance, celui d'Anvers surtout; enfin un prolongement de notre frontière maritime, dans la partie la plus dangereuse pour la frontière anglaise, vis-à-vis les rivages sans défense d'Essex, de Suffolk, de Norfolk, d'Yorkshire. Outre cette acquisition positive, les Pays-Bas avaient pour nous un autre avantage: la Hollande tombait sous l'influence immédiate de la France, dès qu'elle n'en était plus séparée par des provinces autrichiennes. Alors la ligne française s'étendait, non pas seulement jusqu'à Anvers, mais jusqu'au Texel, et les rivages de l'Angleterre étaient enveloppés par une ceinture de rivages ennemis. Si à cela on ajoute un pacte de famille avec l'Espagne, alors puissante et bien organisée, on comprendra que Pitt eût des inquiétudes pour la puissance maritime de l'Angleterre. Il est de principe, en effet, pour tout Anglais bien nourri de ses idées nationales, que l'Angleterre doit dominer à Naples, à Lisbonne, à Amsterdam, pour avoir pied sur le continent, et pour rompre la longue ligne des côtes qui lui pourraient être opposées. Ce principe était aussi enraciné en 1796, que celui qui faisait considérer tout dommage causé à la France comme un bien fait à l'Angleterre. En conséquence, Pitt, pour procurer un moment de répit à ses finances, aurait bien consenti à une paix passagère, mais à condition que les Pays-Bas seraient restitués à l'Autriche. Il songea donc à ouvrir une négociation sur cette base. Il ne pouvait guère espérer que la France admît une pareille condition, car les Pays-Bas étaient l'acquisition principale de la révolution, et la constitution ne permettait même pas au directoire de traiter de leur aliénation. Mais Pitt connaissait peu le continent; il croyait sincèrement la France ruinée, et il était de bonne foi quand il venait, tous les ans, annoncer l'épuisement et la chute de notre république. Il pensait que si jamais la France avait été disposée à la paix, c'était dans le moment actuel, soit à cause de la chute des mandats, soit à cause de la retraite des armées d'Allemagne. Du reste, soit qu'il crût la condition admissible ou non, il avait une raison majeure d'ouvrir une négociation; c'était la nécessité de satisfaire l'opinion publique, qui demandait hautement la pais. Pour obtenir en effet la levée de soixante mille hommes de milice, et de quinze mille marins, il lui fallait prouver, par une démarche éclatante, qu'il avait fait son possible pour traiter. Il avait encore un autre motif non moins important; en prenant l'initiative, et en ouvrant à Paris une négociation solennelle, il avait l'avantage d'y ramener la discussion de tous les intérêts européens, et d'empêcher l'ouverture d'une négociation particulière avec l'Autriche. Cette dernière puissance en effet tenait beaucoup moins à recouvrer les Pays-Bas, que l'Angleterre ne tenait à les lui rendre. Les Pays-Bas étaient pour elle une province lointaine, qui était détachée du centre de son empire, exposée à de continuelles invasions de la France, et profondément imbue des idées révolutionnaires; une province que plusieurs fois elle avait songé à échanger contre d'autres possessions en Allemagne ou en Italie, et qu'elle n'avait gardée que parce que la Prusse s'était toujours opposée à son agrandissement en Allemagne, et qu'il ne s'était pas présenté de combinaisons qui permissent son agrandissement en Italie. Pitt pensait qu'une négociation solennelle, ouverte à Paris pour le compte de tous les alliés, empêcherait les combinaisons particulières, et préviendrait tout arrangement relatif aux Pays-Bas. Il voulait enfin avoir un agent en France, qui pût la juger de près, et avoir des renseignemens certains sur l'expédition qui se préparait à Brest. Telles étaient les raisons qui, même sans l'espoir d'obtenir la paix, décidaient Pitt à faire une démarche auprès du directoire. Il ne se borna pas, comme l'année précédente, à une communication insignifiante de Wickam à Barthélémy; il fit demander des passe-ports pour un envoyé revêtu des pouvoirs de la Grande-Bretagne. Cette éclatante démarche du plus implacable ennemi de notre république, avait quelque chose de glorieux pour elle. L'aristocratie anglaise était ainsi réduite à demander la paix à la république régicide. Les passe-ports furent aussitôt accordés. Pitt fit choix de lord Malmesbury, autrefois sir Harris, et fils de l'auteur d'Hermès. Ce personnage n'était pas connu pour ami des républiques; il avait contribué à l'oppression de la Hollande en 1787. Il arriva à Paris avec une nombreuse suite, le 2 brumaire (23 octobre 1796).
Le directoire se fit représenter par le ministre Delacroix. Les deux négociateurs se virent à l'hôtel des Affaires-Étrangères, le 3 brumaire an V (24 octobre 1796). Le ministre de France exhiba ses pouvoirs. Lord Malmesbury s'annonça comme envoyé de la Grande-Bretagne et de ses allies, afin de traiter de la paix générale. Il exhiba ensuite ses pouvoirs, qui n'étaient signés que par l'Angleterre. Le ministre français lui demanda alors s'il avait mission des alliés de la Grande-Bretagne, pour traiter en leur nom. Lord Malmesbury répondit qu'aussitôt la négociation ouverte, et le principe sur lequel elle pouvait être basée admis, le roi de la Grande-Bretagne était assuré d'obtenir le concours et les pouvoirs de ses alliés. Le lord remit ensuite à Delacroix une note de sa cour, dans laquelle il annonçait le principe sur lequel devait être basée la négociation. Ce principe était celui des compensations de conquêtes entre les puissances. L'Angleterre avait fait, disait cette note, des conquêtes dans les colonies: la France en avait fait sur le continent aux alliés de l'Angleterre; il y avait donc matière à restitutions de part et d'autre. Mais il fallait convenir d'abord du principe des compensations, avant de s'expliquer sur les objets qui seraient compensés. On voit que le cabinet anglais évitait de s'expliquer positivement sur la restitution des Pays-Bas, et énonçait un principe général pour ne pas faire rompre la négociation dès son ouverture. Le ministre Delacroix répondit qu'il allait en référer au directoire.
Le directoire ne pouvait pas abandonner les Pays-Bas; ce n'était pas dans ses pouvoirs, et l'aurait-il pu, il ne le devait pas. La France avait envers ces provinces des engagements d'honneur, et ne pouvait pas les exposer aux vengeances de l'Autriche en les lui restituant. D'ailleurs, elle avait droit à des indemnités pour la guerre inique qu'on lui faisait depuis si long-temps; elle avait droit à des compensations pour les agrandissemens de l'Autriche, la Prusse et la Russie en Pologne, par les suites d'un attentat; elle devait enfin tendre toujours à se donner sa limite naturelle, et, par toutes ces raisons, elle devait ne jamais se départir des Pays-Bas, et maintenir les dispositions de la constitution. Le directoire, bien résolu à remplir son devoir à cet égard, pouvait rompre sur-le-champ une négociation dont le but évident était de nous proposer l'abandon des Pays-Bas et de prévenir un arrangement avec l'Autriche; mais il aurait ainsi donné lieu de dire qu'il ne voulait pas la paix, il aurait rempli l'une des principales intentions de Pitt, et lui aurait fourni d'excellentes raisons pour demander au peuple anglais de nouveaux sacrifices. Il répondit le lendemain même. La France, dit-il, avait déjà traité isolément avec la plupart des puissances de la coalition, sans qu'elles invoquassent le concours de tous les alliés; rendre la négociation générale, c'était la rendre interminable, c'était donner lieu de croire que la négociation actuelle n'était pas plus sincère que l'ouverture faite l'année précédente par l'intermédiaire du ministre Wickam. Du reste, le ministre anglais n'avait pas de pouvoir des alliés, au nom desquels il parlait. Enfin, le principe des compensations était énoncé d'une manière trop générale et trop vague, pour qu'on pût l'admettre ou le rejeter. L'application de ce principe dépendait toujours de la nature des conquêtes, et de la force qui restait aux puissances belligérantes pour les conserver. Ainsi, ajoutait le directoire, le gouvernement français pourrait se dispenser de répondre; mais pour prouver son désir de la paix, il déclare qu'il sera prêt à écouter toutes les propositions, dès que le lord Malmesbury sera muni des pouvoirs de toutes les puissances, au nom desquelles il prétend traiter.
Le directoire qui, dans cette négociation, n'avait rien à cacher, et qui pouvait agir avec la plus grande franchise, résolut de rendre la négociation publique, et de faire imprimer dans les journaux les notes du ministre anglais et les réponses du ministre français. Il fit imprimer en effet sur-le-champ le mémoire de lord Malmesbury, et la réponse qu'il y avait faite. Cette manière d'agir était de nature à déconcerter un peu la politique tortueuse du cabinet anglais; mais elle ne dérogeait nullement aux convenances, en dérogeant aux usages. Lord Malmesbury répondit qu'il allait en référer à son gouvernement. C'était un singulier plénipotentiaire que celui qui n'avait que des pouvoirs aussi insuffisans, et qui, à chaque difficulté, était obligé d'en référer à sa cour. Le directoire aurait pu voir là un leurre, et l'intention de traîner en longueur pour se donner l'air de négocier; il aurait pu surtout ne pas voir avec plaisir le séjour d'un étranger dont les intrigues pouvaient être dangereuses, et qui venait pour découvrir le secret de nos armemens; il ne manifesta néanmoins aucun mécontentement; il permit à lord Malmesbury d'attendre les réponses de sa cour, et, en attendant, d'observer Paris, les partis, leur force et celle du gouvernement. Le directoire n'avait du reste qu'à y gagner.
Pendant ce temps notre situation devenait périlleuse en Italie, malgré les récens triomphes de Roveredo, de Bassano et de Saint-George. L'Autriche redoublait d'efforts pour recouvrer la Lombardie. Grâces aux garanties données par Catherine à l'empereur pour la conservation des Gallicies, les troupes qui étaient en Pologne avaient été transportées vers les Alpes. Grâces encore à l'espérance de conserver la paix avec la Porte, les frontières de la Turquie avaient été dégarnies, et toutes les réserves de la monarchie autrichienne dirigées vers l'Italie. Une population nombreuse et dévouée fournissait en outre de puissans moyens de recrutement. L'administration autrichienne déployait un zèle et une activité extraordinaires pour enrôler de nouveaux soldats, les encadrer dans les vieilles troupes, les armer et les équiper. Une belle armée se préparait ainsi dans le Frioul, avec les débris de Wurmser, avec les troupes venues de Pologne et de Turquie, avec les détachemens du Rhin, et les recrues. Le maréchal Alvinzy était chargé d'en prendre le commandement. On espérait que cette troisième armée serait plus heureuse que les deux précédentes, et qu'elle finirait par arracher l'Italie à son jeune conquérant.
Dans cet intervalle, Bonaparte ne cessait de demander des secours, et de conseiller des négociations avec les puissances italiennes qui étaient sur ses derrières. Il pressait le directoire de traiter avec Naples, de renouer les négociations avec Rome, de conclure avec Gênes, et de négocier une alliance offensive et défensive avec le roi de Piémont, pour lui procurer des secours en Italie, si on ne pouvait pas lui en envoyer de France. Il voulait qu'on lui permît de proclamer l'indépendance de la Lombardie, et celle des états du duc de Modène, pour se faire des partisans et des auxiliaires fortement attachés à sa cause. Ses vues étaient justes, et la détresse de son armée légitimait ses vives instances. La rupture des négociations avec le pape avait fait rétrograder une seconde fois la contribution imposée par l'armistice de Bologne. Il n'y avait eu qu'un paiement d'exécuté. Les contributions frappées sur Parme, Modène, Milan, étaient épuisées, soit par les dépenses de l'armée, soit par les envois faits au gouvernement. Venise fournissait bien des vivres; mais le prêt était arriéré. Les valeurs à prendre sur le commerce étranger à Livourne étaient encore en contestation. Au milieu des plus riches pays de la terre, l'armée commençait à éprouver des privations. Mais son plus grand malheur était le vide de ses rangs, éclaircis par le canon autrichien. Ce n'était pas sans de grandes pertes qu'elle avait détruit tant d'ennemis. On l'avait renforcée de neuf à dix mille hommes depuis l'ouverture de la campagne, ce qui avait porté à cinquante mille à peu près le nombre des Français entrés en Italie; mais elle en avait tout au plus trente et quelques mille dans le moment; le feu et les maladies l'avaient réduite à ce petit nombre. Une douzaine de bataillons de la Vendée venaient d'arriver, mais singulièrement diminués par les désertions; les autres détachemens promis n'arrivaient pas. Le général Willot, qui commandait dans le Midi, et qui était chargé de diriger sur les Alpes plusieurs régimens, les retenait pour apaiser les troubles que sa maladresse et son mauvais esprit provoquaient dans les provinces de son commandement. Kellermann ne pouvait guère dégarnir sa ligne, car il devait toujours être prêt à contenir Lyon et les environs, où les compagnies de Jésus commettaient des assassinats. Bonaparte demandait la quatre-vingt-troisième et la quarantième brigade, formant à peu près six mille hommes de bonnes troupes, et répondait de tout si elles arrivaient à temps.
Il se plaignait qu'on ne l'eût pas chargé de négocier avec Rome, parce qu'il aurait attendu, pour signifier l'ultimatum, le paiement de la contribution. «Tant que votre général, disait-il, ne sera pas le centre de tout en Italie, tout ira mal. Il serait facile de m'accuser d'ambition; mais je n'ai que trop d'honneur; je suis malade, je puis à peine me tenir à cheval, il ne me reste que du courage, ce qui est insuffisant pour le poste que j'occupe. On nous compte, ajoutait-il; le prestige de nos forces disparaît. Des troupes, ou l'Italie est perdue!»
Le directoire, sentant la nécessité de priver Rome de l'appui de Naples, et d'assurer les derrières de Bonaparte, conclut enfin son traité avec la cour des Deux-Siciles. Il se désista de toute demande particulière, et de son côté, cette cour, que nos dernières victoires sur la Brenta avaient intimidée, qui voyait l'Espagne faire cause commune avec la France, et qui craignait de voir les Anglais chassés de la Méditerranée, accéda au traité. La paix fut signée le 19 vendémiaire (10 octobre). Il fut convenu que le roi de Naples retirerait toute espèce de secours aux ennemis de la France, et qu'il fermerait ses ports aux vaisseaux armés des puissances belligérantes. Le directoire conclut ensuite son traité avec Gênes. Une circonstance particulière en hâta la conclusion: Nelson enleva un vaisseau français à la vue des batteries génoises; cette violation de la neutralité compromit singulièrement la république de Gênes; le parti français qui était chez elle se montra plus hardi, le parti de la coalition plus timide; il fut arrêté qu'on s'allierait à la France. Les ports de Gênes furent fermés aux Anglais. Deux millions nous furent payés en indemnité pour la frégate la Modeste, et deux autres millions fournis en prêt. Les familles feudataires ne furent pas exilées, mais tous les partisans de la France expulsés du territoire et du sénat furent rappelés et réintégrés. Le Piémont fut de nouveau sollicité de conclure une alliance offensive et défensive. Le roi actuel venait de mourir; son jeune successeur Charles-Emmanuel montrait d'assez bonnes dispositions pour la France, mais il ne se contentait pas des avantages qu'elle lui offrait pour prix de son alliance. Le directoire lui offrait de garantir ses états, que rien ne lui garantissait dans cette conflagration générale, et au milieu de toutes les républiques qui se préparaient. Mais le nouveau roi, comme le précédent, voulait qu'on lui donnât la Lombardie, ce que le directoire ne pouvait pas promettre, ayant à se ménager des équivalens pour traiter avec l'Autriche. Le directoire permit ensuite à Bonaparte de renouer les négociations avec Rome, et lui donna ses pleins pouvoirs à cet égard.
Rome avait envoyé le cardinal Albani à Vienne; elle avait compté sur Naples, et dans son emportement elle avait offensé la légation espagnole. Naples lui manquant, l'Espagne lui manifestant son mécontentement, elle était dans l'alarme, et le moment était convenable pour renouer avec elle. Bonaparte voulait d'abord son argent; ensuite, quoiqu'il ne craignît pas sa puissance temporelle, il redoutait son influence morale sur les peuples. Les deux partis italiens, enfantés par la révolution française, et développés par la présence de nos armées, s'exaspéraient chaque jour davantage. Si Milan, Modène, Reggio, Bologne, Ferrare, étaient le siége du parti patriote, Rome était celui du parti monacal et aristocrate. Elle pouvait exciter les fureurs fanatiques, et nous nuire beaucoup, dans un moment surtout où la question n'était pas résolue avec les armées autrichiennes. Bonaparte pensa qu'il fallait temporiser encore. Esprit libre et indépendant, il méprisait tous les fanatismes qui restreignent l'intelligence humaine; mais, homme d'exécution, il redoutait les puissances qui échappent à la force, et il aimait mieux éluder que de lutter avec elles. D'ailleurs, quoique élevé en France, il était né au milieu de la superstition italienne; il ne partageait pas ce dégoût de la religion catholique, si profond et si commun chez nous à la suite du dix-huitième siècle; et il n'avait pas, pour traiter avec le Saint-Siége, la même répugnance qu'on avait à Paris. Il songea donc à gagner du temps, pour s'éviter une marche rétrograde sur la péninsule, pour s'épargner des prédications fanatiques, et, s'il était possible, pour regagner les 16 millions ramenés à Rome. Il chargea le ministre Cacault de désavouer les exigences du directoire en matière de foi, et de n'insister que sur les conditions purement matérielles. Il choisit le cardinal Mattei, qu'il avait enfermé dans un couvent, pour l'envoyer à Rome; il le délivra, et le chargea d'aller parler au pape. «La cour de Rome, lui écrivit-il, veut la guerre, elle l'aura; mais avant, je dois à ma nation et à l'humanité de faire un dernier effort pour ramener le pape à la raison. Vous connaissez, monsieur le cardinal, les forces de l'armée que je commande: pour détruire la puissance temporelle du pape, il ne me faudrait que le vouloir. Allez à Rome, voyez le Saint-Père, éclairez-le sur ses vrais intérêts; arrachez-le aux intrigans qui l'environnent, qui veulent sa perte et celle de la cour de Rome. Le gouvernement français permet que j'écoute encore des paroles de paix. Tout peut s'arranger. La guerre, si cruelle pour les peuples, a des résultats terribles pour les vaincus. Évitez de grands malheurs au pape. Vous savez combien je désire finir par la paix une lutte que la guerre terminerait pour moi sans gloire comme sans péril.»
Pendait qu'il employait ces moyens pour tromper, disait-il, le vieux renard, et se garantir des fureurs du fanatisme, il songeait à exciter l'esprit de liberté dans la Haute-Italie, afin d'opposer le patriotisme à la superstition. Toute la Haute-Italie était fort exaltée: le Milanais, arraché à l'Autriche, les provinces de Modène et de Reggio, impatientes du joug que faisait peser sur elles leur vieux duc absent, les légations de Bologne et Ferrare, soustraites au pape, demandaient à grands cris leur indépendance, et leur organisation en républiques. Bonaparte ne pouvait pas déclarer l'indépendance de la Lombardie, car la victoire n'avait pas encore assez positivement décidé de son sort; mais il lui donnait toujours des espérances et des encouragemens. Quant aux provinces de Modène et de Reggio, elles touchaient immédiatement les derrières de son armée, et confinaient avec Mantoue. Il avait à se plaindre de la régence, qui avait fait passer des vivres à la garnison; il avait recommandé au directoire de ne pas donner la paix au duc de Modène, et de s'en tenir à l'armistice, afin de pouvoir le punir au besoin. Les circonstances devenant chaque jour plus difficiles; il se décida, sans en prévenir le directoire, à un coup de vigueur. Il était constant que la régence venait récemment encore de se mettre en faute, et de manquer à l'armistice en fournissant des vivres à Wurmser, et en donnant asile à un de ses détachemens: sur-le-champ il déclara l'armistice violé, et en vertu du droit de conquête, il chassa la régence, déclara le duc de Modène déchu, et les provinces de Reggio et de Modène libres. L'enthousiasme des Reggiens et des Modénois fut extraordinaire. Bonaparte organisa un gouvernement municipal pour administrer provisoirement le pays, en attendant qu'il fût constitué. Bologne et Ferrare s'étaient déjà constituées en république, et commençaient à lever des troupes. Bonaparte voulait réunir ces deux légations aux états du duc de Modène, pour en faire une seule république, qui, située tout entière en-deçà du Pô, s'appellerait République cispadane. Il pensait que si, à la paix, on était obligé de rendre la Lombardie à l'Autriche, on pourrait éviter de rendre, au duc de Modène et au pape, le Modénois et les légations, qu'on pourrait ériger ainsi une république, fille et amie de la république française, qui serait au-delà des Alpes le foyer des principes français, l'asile des patriotes compromis, et d'où la liberté pourrait s'étendre un jour sur toute l'Italie. Il ne croyait pas que l'affranchissement de l'Italie pût se faire d'un seul coup; il croyait le gouvernement français trop épuisé pour l'opérer maintenant, et il pensait qu'il fallait au moins déposer les germes de la liberté dans cette première campagne. Pour cela il fallait réunir Bologne et Ferrare à Modène et Reggio. L'esprit de localité s'y opposait, mais il espérait vaincre cette opposition par son influence toute puissante. Il se rendit dans ces villes, y fut reçu avec enthousiasme, et les décida à envoyer à Modène cent députés de toutes les parties de leur territoire, pour y former une assemblée nationale, qui serait chargée de constituer la république cispadane. Cette réunion eut lieu le 25 vendémiaire (16 octobre) à Modène. Elle se composait d'avocats, de propriétaires, de commerçans. Contenue par la présence de Bonaparte, dirigée par ses conseils, elle montra la plus grande sagesse. Elle vota la réunion en une seule république des deux légations et du duché de Modène; elle abolit la féodalité, et décréta l'égalité civile; elle nomma un commissaire chargé d'organiser une légion de quatre mille hommes, et arrêta la formation d'une seconde assemblée, qui devait se réunir le 5 nivôse (25 décembre), pour délibérer une constitution. Les Reggiens montrèrent le plus grand dévouement. Un détachement autrichien étant sorti de Mantoue, ils coururent aux armes, l'entourèrent, le firent prisonnier, et l'amenèrent à Bonaparte. Deux Reggiens furent tués dans l'action, et furent les premiers martyrs de l'indépendance italienne.
La Lombardie était jalouse et alarmée des faveurs accordées à la Cispadane, et crut y voir pour elle un sinistre présage. Elle se dit que puisque les Français constituaient les légations et le duché sans la constituer elle-même, ils avaient le projet de la rendre à l'Autriche. Bonaparte rassura de nouveau les Lombards, leur fit sentir les difficultés de sa position, et leur répéta qu'il fallait gagner l'indépendance en le secondant dans cette terrible lutte. Ils décidèrent de porter à douze mille hommes les deux légions italienne et polonaise, dont ils avaient déjà commencé l'organisation.
Bonaparte s'était ménagé ainsi autour de lui des gouvernemens amis, qui allaient faire tous leurs efforts pour l'appuyer. Leurs troupes sans doute ne pouvaient pas grand'chose; mais elles étaient capables de faire la police du pays conquis, et de cette manière elles rendaient disponibles les détachemens qu'il y employait. Elles pouvaient, appuyées de quelques centaines de Français, résister à une première tentative du pape, s'il avait la folie d'en faire une. Bonaparte s'efforça en même temps de rassurer le duc de Parme, dont les états confinaient à la nouvelle république; son amitié pouvait être utile, et sa parenté avec l'Espagne commandait des ménagemens. Il lui laissa entrevoir la possibilité de gagner quelques villes, au milieu de ces démembremens de territoires. Il usait ainsi de toutes les ressources de la politique, pour suppléer aux forces que son gouvernement ne pouvait pas lui fournir; et, en cela, il faisait son devoir envers la France et l'Italie, et le faisait avec toute l'habileté d'un vieux diplomate.
La Corse venait d'être affranchie par ses soins. Il avait réuni les principaux réfugiés à Livourne, leur avait donné des armes et des officiers, et les avait jetés hardiment dans l'île pour seconder la rébellion des habitans contre les Anglais. L'expédition réussit; sa patrie était délivrée du joug anglais, et la Méditerranée allait bientôt l'être. On pouvait espérer qu'à l'avenir les escadres espagnoles, réunies aux escadres françaises, fermeraient le détroit de Gibraltar aux flottes de l'Angleterre, et domineraient dans toute la Méditerranée.
Il avait donc employé le temps écoulé depuis les événemens de la Brenta à améliorer sa position en Italie; mais s'il avait un peu moins à craindre les princes de cette contrée, le danger du côté de l'Autriche ne faisait que s'accroître, et ses forces pour y parer étaient toujours aussi insuffisantes. La quatre-vingt-troisième demi-brigade et la quarantième étaient toujours retenues dans le Midi. Il avait douze mille hommes dans le Tyrol sous Vaubois, rangés en avant de Trente sur le bord du Lavis; seize ou dix-sept mille à peu près sous Masséna et Augereau, sur la Brenta et l'Adige; huit ou neuf mille enfin devant Mantoue; ce qui portait son armée à trente-six ou trente-huit mille hommes environ. Davidovich, qui était resté dans le Tyrol après le désastre de Wurmser, avec quelques mille hommes, en avait maintenant dix-huit mille. Alvinzy s'avançait du Frioul sur la Piave avec environ quarante mille. Bonaparte était donc fort compromis; car, pour résister à soixante mille hommes, il n'en avait que trente-six mille, fatigués par une triple campagne, et diminués tous les jours par les fièvres qu'ils gagnaient dans les rizières de la Lombardie. Il l'écrivait avec chagrin au directoire, et lui disait qu'il allait perdre l'Italie.
Le directoire, voyant le péril de Bonaparte, et ne pouvant pas arriver assez tôt à son secours, songea à suspendre sur-le-champ les hostilités par le moyen d'une négociation. Malmesbury était à Paris, comme on vient de le voir. Il attendait la réponse de son gouvernement aux communications du directoire, qui avait exigé qu'il eût des pouvoirs de toutes les puissances, et qu'il s'exprimât plus clairement sur le principe des compensations de conquêtes. Le ministère anglais, après dix-neuf jours, venait enfin de répondre le 24 brumaire (14 novembre) que les prétentions de la France étaient inusitées, qu'il était permis à un allié de demander à traiter au nom de ses alliés, avant d'avoir leur autorisation en forme; que l'Angleterre était assurée de l'obtenir, mais qu'auparavant il fallait que la France s'expliquât nettement sur le principe des compensations, principe qui était la seule base sur laquelle la négociation pût s'ouvrir. Le cabinet anglais ajoutait que la réponse du directoire était pleine d'insinuations peu décentes sur les intentions de sa majesté britannique, qu'il était au-dessous d'elle d'y répondre, et qu'elle voulait ne pas s'y arrêter, pour ne pas entraver la négociation. Lejour même, le directoire, qui voulait être prompt et catégorique, répondit à lord Malmesbury qu'il admettait le principe des compensations, mais qu'il eût à désigner sur-le-champ les objets sur lesquels porterait ce principe.
Le directoire pouvait faire cette réponse sans se trop engager, puisqu'en refusant de céder la Belgique et le Luxembourg, il avait à sa disposition la Lombardie et plusieurs autres petits territoires. Du reste, cette négociation était évidemment illusoire; le directoire ne pouvait rien en attendre, et il résolut de déjouer les finesses de l'Angleterre, en envoyant directement un négociateur à Vienne, chargé de conclure un arrangement particulier avec l'empereur. La première proposition que le négociateur devait faire était celle d'un armistice en Allemagne et en Italie, qui durerait six mois au moins. Le Rhin et l'Adige sépareraient les armées des deux puissances. Les siéges de Kelh et de Mantoue seraient suspendus. On ferait entrer chaque jour dans Mantoue les vivres nécessaires pour remplacer la consommation journalière, de manière à replacer les deux partis dans leur état actuel à la fin de l'armistice. La France gagnait ainsi la conservation de Kehl, et l'Autriche celle de Mantoue. Une négociation devait s'ouvrir immédiatement pour traiter de la paix. Les conditions offertes par la France étaient les suivantes: l'Autriche cédait la Belgique et le Luxembourg à la France; la France restituait la Lombardie à l'Autriche, et le Palatinat à l'Empire; elle renonçait ainsi, sur ce dernier point, à la ligne du Rhin; elle consentait en outre, pour dédommager l'Autriche de la perte des Pays-Bas, à la sécularisation de plusieurs évêchés de l'Empire. L'empereur ne devait nullement se mêler des affaires de la France avec le pape, et devait prêter son entremise en Allemagne pour procurer des indemnités au stathouder. C'était une condition indispensable pour assurer le repos de la Hollande, et pour satisfaire le roi de Prusse, dont la soeur était épouse du stathouder. Ces conditions étaient fort modérées, et prouvaient le désir qu'avait le directoire de faire cesser les horreurs de la guerre, et ses inquiétudes pour l'armée d'Italie.
Le directoire choisit pour porter ces propositions le général Clarke, qui était employé dans les bureaux de la guerre auprès de Carnot. Ses instructions furent signées le 26 brumaire (16 novembre). Mais il fallait du temps pour qu'il se mît en route, qu'il arrivât, qu'il fût reçu et écouté; et, pendant ce temps, les événemens se succédaient en Italie avec une singulière rapidité.
Le 11 brumaire (1er novembre) le maréchal Alvinzy ayant jeté des ponts sur la Piave, s'était avancé sur la Brenta. Le plan des Autrichiens, cette fois, était d'attaquer à la fois par les montagnes du Tyrol et par la plaine. Davidovich devait chasser Vaubois de ses positions, et descendre le long des deux rives de l'Adige jusqu'à Vérone. Alvinzy, de son côté, devait passer la Piave et la Brenta, s'avancer sur l'Adige, entrer à Vérone avec le gros de l'armée, et s'y réunir à Davidovich. Les deux armées autrichiennes devaient partir de ce point, pour marcher de concert au déblocus de Mantoue et à la délivrance de Wurmser.
Alvinzy, après avoir passé la Piave, s'avança sur la Brenta, où Masséna était posté avec sa division; celui-ci ayant reconnu la force de l'ennemi, se replia. Bonaparte marcha à son appui avec la division Augereau. Il prescrivit en même temps à Vaubois de contenir Davidovich dans la vallée du Haut-Adige, et de lui enlever, s'il le pouvait, sa position du Lavis. Il marcha lui-même sur Alvinzy, résolu, malgré la disproportion des forces, de l'attaquer impétueusement, et de le rompre dès l'ouverture même de cette nouvelle campagne. Il arriva le 16 brumaire au matin (6 novembre) à la vue de l'ennemi. Les Autrichiens avaient pris position en avant de la Brenta, depuis Carmignano jusqu'à Bassano; leurs réserves étaient restées en arrière, au-delà de la Brenta. Bonaparte porta sur eux toutes ses forces. Masséna attaqua Liptai et Provera devant Carmignano; Augereau attaqua Quasdanovich devant Bassano. L'affaire fut chaude et sanglante; les troupes déployèrent une grande bravoure. Liptai et Provera furent rejetés au-delà de la Brenta par Masséna; Quasdanovich fut repoussé sur Bassano par Augereau. Bonaparte aurait voulu entrer le jour même dans Bassano, mais l'arrivée des réserves autrichiennes l'en empêcha. Il fallut remettre l'attaque au lendemain. Malheureusement il apprit dans la nuit que Vaubois venait d'essuyer un revers sur le Haut-Adige. Ce général avait bravement attaqué les positions de Davidovich, et avait obtenu un commencement de succès; mais une terreur panique s'était emparée de ses troupes malgré leur bravoure éprouvée, et elles avaient fui en désordre. Il les avait enfin ralliées dans ce fameux défilé de Calliano, où l'armée avait déployé tant d'audace dans l'invasion du Tyrol; il espérait s'y maintenir, lorsque Davidovich, dirigeant un corps sur l'autre rive de l'Adige, avait débordé Calliano, et tourné la position. Vaubois annonçait qu'il se retirait pour n'être pas coupé, et exprimait la crainte que Davidovich ne l'eût devancé aux importantes positions de la Corona et de Rivoli, qui couvrent la route du Tyrol, entre l'Adige et le lac de Garda.
Bonaparte sentit dès lors le danger de s'engager davantage contre Alvinzy, lorsque Vaubois, qui était avec sa gauche dans le Tyrol, pouvait perdre la Corona, Rivoli, et même Vérone, et être rejeté dans la plaine. Bonaparte eût alors été coupé de son aile principale, et placé avec quinze ou seize mille hommes entre Davidovich et Alvinzy. En conséquence il résolut de se replier sur-le-champ. Il ordonna à un officier de confiance de voler à Vérone, d'y réunir tout ce qu'il pourrait trouver de troupes, de les porter à Rivoli et à la Corona, afin d'y prévenir Davidovich et de donner à Vaubois le temps de s'y retirer.
Le lendemain 17 brumaire (7 novembre), il rebroussa chemin, et traversa la ville de Vicence, qui fut étonnée de voir l'armée française se retirer après le succès de la veille. Il se rendit à Vérone, où il laissa toute son armée. Il remonta seul à Rivoli et à la Corona, où très heureusement il trouva les troupes de Vaubois ralliées, et en mesure de tenir tête à une nouvelle attaque de Davidovich. Il voulut donner une leçon aux trente-neuvième et quatre-vingt-cinquième demi-brigades, qui avaient cédé à une terreur panique. Il fit assembler toute la division, et, s'adressant à ces deux demi-brigades, il leur reprocha leur indiscipline et leur fuite. Il dit ensuite au chef d'état-major: «Faites écrire sur les drapeaux que la trente-neuvième et la quatre-vingt-cinquième ne font plus partie de l'armée d'Italie.» Ces expressions causèrent aux soldats de ces deux demi-brigades le plus violent chagrin; ils entourèrent Bonaparte, lui dirent qu'ils s'étaient battus un contre trois, et lui demandèrent à être envoyés à son avant-garde, pour faire voir s'ils n'étaient plus de l'armée d'Italie. Bonaparte les dédommagea de sa sévérité par quelques paroles bienveillantes, qui les transportèrent, et les laissa disposés à venger leur honneur par une bravoure désespérée.
Il ne restait plus à Vaubois que huit mille hommes, sur les douze mille qu'il avait avant cette échauffourée. Bonaparte les distribua le mieux qu'il put dans les positions de la Corona et de Rivoli, et, après s'être assuré que Vaubois pourrait tenir là quelques jours, et couvrir notre gauche et nos derrières, il retourna à Vérone pour opérer contre Alvinzy. La chaussée qui conduit de la Brenta à Vérone, en suivant le pied des montagnes, passe par Vicence, Montebello, Villa-Nova et Caldiero. Alvinzy, étonné de voir Bonaparte se replier le lendemain d'un succès, l'avait suivi de loin en loin, se doutant que les progrès de Davidovich avaient pu seuls le ramener en arrière. Il espérait que son plan de jonction à Vérone allait se réaliser. Il s'arrêta à trois lieues à peu près de Vérone, sur les hauteurs de Caldiero, qui en dominent la route. Ces hauteurs présentaient une excellente position pour tenir tête à l'armée qui sortait de Vérone. Alvinzy s'y établit, y plaça des batteries, et n'oublia rien pour s'y rendre inexpugnable. Bonaparte en fit la reconnaissance, et résolut de les attaquer sur-le-champ; car la situation de Vaubois à Rivoli était très précaire, et ne lui laissait pas beaucoup de temps pour agir sur Alvinzy. Il marcha contre lui le 21 au soir (11 novembre), repoussa son avant-garde, et bivouaqua avec les divisions Masséna et Augereau au pied de Caldiero. A la pointe du jour, il s'aperçut qu'Alvinzy, fortement retranché, acceptait la bataille. La position était abordable d'un côté, celui qui appuyait aux montagnes, et qui n'avait pas été assez soigneusement défendu par Alvinzy. Bonaparte y dirigea Masséna, et chargea Augereau d'attaquer le reste de la ligne. L'action fut vive. Mais la pluie tombait par torrens, ce qui donnait un grand avantage à l'ennemi, dont l'artillerie était placée d'avance sur de bonnes positions, tandis que la nôtre, obligée de se mouvoir dans des chemins devenus impraticables, ne pouvait pas être portée sur les points convenables, et manquait tout son effet. Néanmoins Masséna parvint à gravir la hauteur négligée par Alvinzy. Mais tout à coup la pluie se changea en une grelasse froide, qu'un vent violent portait dans le visage de nos soldats. Au même instant, Alvinzy fit marcher sa réserve sur la position que Masséna lui avait enlevée, et reprit tous ses avantages. Bonaparte voulut en vain renouveler ses efforts, il ne put réussir. Les deux armées passèrent la nuit en présence. La pluie ne cessa pas de tomber, et de mettre nos soldats dans l'état le plus pénible. Le lendemain 23 brumaire (13 novembre), Bonaparte rentra dans Vérone.
La situation de l'armée devenait désespérante. Après avoir inutilement poussé l'ennemi au-delà de la Brenta, et sacrifié sans fruit une foule de braves; après avoir perdu à la gauche le Tyrol et quatre mille hommes, après avoir livré une bataille malheureuse à Caldiero, pour éloigner Alvinzy de Vérone, et s'être encore affaibli sans succès, toute ressource semblait perdue. La gauche, qui n'était plus que de huit mille hommes, pouvait à chaque instant être culbutée de la Corona et de Rivoli, et alors Bonaparte se trouvait enveloppé à Vérone. Les deux divisions Masséna et Augereau, qui formaient l'armée active opposée à Alvinzy, étaient réduites, par deux batailles, à quatorze ou quinze mille hommes. Que pouvaient quatorze ou quinze mille soldats contre près de quarante mille? L'artillerie, qui nous avait toujours servi à contre-balancer la supériorité de l'ennemi, ne pouvait plus se mouvoir au milieu des boues; il n'y avait donc aucun espoir de lutter avec quelque chance de succès. L'armée était dans la consternation. Ces braves soldats, éprouvés par tant de fatigues et de dangers, commençaient à murmurer. Comme tous les soldats intelligens, ils étaient sujets à de l'humeur, parce qu'ils étaient capables de juger. «Après avoir détruit, disaient-ils, deux armées dirigées contre nous, il nous a fallu détruire encore celles qui étaient opposées aux troupes du Rhin. A Beaulieu a succédé Wurmser; à Wurmser succède Alvinzy: la lutte se renouvelle chaque jour. Nous ne pouvons pas faire la tâche de tous. Ce n'est pas à nous à combattre Alvinzy, ce n'était pas à nous à combattre Wurmser. Si chacun avait fait sa tâche comme nous, la guerre serait finie. Encore, ajoutaient-ils, si on nous donnait des secours proportionnés à nos périls! mais on nous abandonne au fond de l'Italie, on nous laisse seuls aux prises avec deux armées innombrables. Et quand, après avoir versé notre sang dans des milliers de combats, nous serons ramenés sur les Alpes, nous reviendrons sans honneur et sans gloire, comme des fugitifs qui n'auraient pas fait leur devoir.» C'étaient là les discours des soldats dans leurs bivouacs. Bonaparte, qui partageait leur humeur et leur mécontentement, écrivait au directoire le même jour 24 brumaire (14 novembre): «Tous nos officiers supérieurs, tous nos généraux d'élite sont hors de combat; l'armée d'Italie, réduite à une poignée de monde, est épuisée. Les héros de Millesimo, de Lodi, de Castiglione, de Bassano, sont morts pour leur patrie, ou sont à l'hôpital: il ne reste plus aux corps que leur réputation et leur orgueil. Joubert, Lannes, Lamare, Victor, Murat, Charlot, Dupuis, Rampon, Pigeon, Ménard, Chabrand, sont blessés. Nous sommes abandonnés au fond de l'Italie: ce qui me reste de braves voit la mort infaillible, au milieu de chances si continuelles, et avec des forces si inférieures. Peut-être l'heure du brave Augereau, de l'intrépide Masséna, est près de sonner… Alors! alors que deviendront ces braves gens? Cette idée me rend réservé, je n'ose plus affronter la mort, qui serait un sujet de découragement pour qui est l'objet de mes sollicitudes. Si j'avais reçu la quatre-vingt-troisième, forte de trois mille cinq cents hommes connus à l'armée, j'aurais répondu de tout! Peut-être sous peu de jours, ne sera-ce pas assez de quarante mille hommes!—Aujourd'hui, ajoutait Bonaparte, repos aux troupes; demain, selon les mouvemens de l'ennemi, nous agirons.»
Cependant, tandis qu'il adressait ces plaintes amères au gouvernement, il affectait la plus grande sécurité aux yeux de ses soldats; il leur faisait répéter, par ses officiers, qu'il fallait faire un effort, et que cet effort serait le dernier; qu'Alvinzy détruit, les moyens de l'Autriche seraient épuisés pour jamais, l'Italie conquise, la paix assurée, et la gloire de l'armée immortelle. Sa présence, ses paroles relevaient les courages. Les malades, dévorés par la fièvre, en apprenant que l'armée était en péril, sortaient en foule des hôpitaux, et accouraient prendre leur place dans les rangs. La plus vive et la plus profonde émotion était dans tous les coeurs. Les Autrichiens s'étaient approchés le jour même de Vérone, et montraient les échelles qu'ils avaient préparées pour escalader les murs. Les Véronais laissaient éclater leur joie en croyant voir, sous quelques heures, Alvinzy réuni dans leur ville à Davidovich, et les Français détruits. Quelques-uns d'entre eux, compromis pour leur attachement à notre cause, se promenaient tristement en comptant le petit nombre de nos braves.
L'armée attendait avec anxiété les ordres du général, et espérait à chaque instant qu'il commanderait un mouvement. Cependant la journée du 24 s'était écoulée, et, contre l'usage, l'ordre du jour n'avait rien annoncé. Mais Bonaparte n'avait point perdu de temps; et, après avoir médité sur le champ de bataille, il venait de prendre une de ces résolutions que le désespoir inspire au génie. Vers la nuit, l'ordre est donné à toute l'armée de prendre les armes; le plus grand silence est recommandé; on se met en marche; mais au lieu de se porter en avant, on rétrograde, on repasse l'Adige sur les ponts de Vérone, et on sort de la ville par la porte qui conduit à Milan. L'armée croit qu'on bat en retraite, et qu'on renonce à garder l'Italie: la tristesse règne dans les rangs. Cependant à quelque distance de Vérone, on fait un à-gauche; au lieu de continuer à s'éloigner de l'Adige, on se met à le longer, et à descendre son cours. On le suit pendant quatre lieues. Enfin, après quelques heures de marche, on arrive à Ronco, où un pont de bateaux avait été jeté par les soins du général; on repasse le fleuve; et, à la pointe du jour, on se trouve de nouveau au-delà de l'Adige, qu'on croyait avoir abandonné pour toujours. Le plan du général était extraordinaire; il allait étonner les deux armées. L'Adige, en sortant de Vérone, cesse un instant de couler perpendiculairement des montagnes à la mer, et il oblique vers le levant: dans ce mouvement oblique, il se rapproche de la route de Vérone à la Brenta, sur laquelle était campé Alvinzy. Bonaparte, arrivé à Ronco, se trouvait donc ramené sur les flancs et presque sur les derrières des Autrichiens. Au moyen de ce pont, il se trouvait placé au milieu des vastes marais. Ces marais étaient traversés par deux chaussées, dont l'une à gauche, remontant l'Adige par Porcil et Gombione, allait rejoindre Vérone; dont l'autre, à droite, passait sur une petite rivière, qu'on appelle l'Alpon, au village d'Arcole, et allait rejoindre la route de Vérone vers Villa-Nova sur les derrières de Caldiero.
Bonaparte tenait donc à Ronco deux chaussées, qui toutes deux allaient rejoindre la grande route occupée par les Autrichiens, l'une entre Caldiero et Vérone, l'autre entre Caldiero et Villa-Nova. Voici quel avait été son calcul: au milieu de ces marais, l'avantage du nombre était tout à fait annulé; on ne pouvait se déployer que sur les chaussées, et sur les chaussées le courage des têtes de colonnes devait décider de tout. Par la chaussée de gauche qui allait rejoindre la route entre Vérone et Caldiero, il pouvait tomber sur les Autrichiens, s'ils tentaient d'escalader Vérone. Par celle de droite, qui passe l'Alpon au pont d'Arcole, et aboutit à Villa-Nova, il débouchait sur les derrières d'Alvinzy, il pouvait enlever ses parcs et ses bagages, et intercepter sa retraite. Il était donc inattaquable à Ronco, et il étendait ses deux bras autour de l'ennemi. Il avait fait fermer les portes de Vérone, et y avait laissé Kilmaine avec quinze cents hommes, pour résister à un premier assaut. Cette combinaison si audacieuse et si profonde frappa l'armée, qui sur-le-champ en devina l'intention, et en fut remplie d'espérance.
Bonaparte plaça Masséna sur la digue de gauche pour remonter sur Gombione et Porcil, et prendre l'ennemi en queue, s'il marchait sur Vérone. Il dirigea Augereau à droite pour déboucher sur Villa-Nova. On était à la pointe du jour. Masséna se mit en observation sur la digue de gauche; Augereau, pour parcourir celle de droite, avait à franchir l'Alpon sur le pont d'Arcole. Quelques bataillons croates s'y trouvaient détachés pour surveiller le pays. Ils bordaient la rivière, et avaient leur canon braqué sur le pont. Ils accueillirent l'avant-garde d'Augereau par une vive fusillade, et la forcèrent à se replier. Augereau accourut et ramena ses troupes en avant; mais le feu du pont et de la rive opposée les arrêta de nouveau. Il fut obligé de céder devant cet obstacle, et de faire halte.
Pendant ce temps, Alvinzy, qui avait les yeux fixés sur Vérone, et qui croyait que l'armée française s'y trouvait encore, était surpris d'entendre un feu très-vif au milieu des marais. Il ne supposait pas que le général Bonaparte pût choisir un pareil terrain, et il croyait que c'était un corps détaché de troupes légères. Mais bientôt sa cavalerie revient l'informer que l'engagement est grave, et que des coups de fusil sont partis de tous les côtés. Sans être éclairci encore, il envoie deux divisions; l'une sous Provera suit la digue de gauche, l'autre sous Mitrouski suit la digue de droite, et s'avance sur Arcole. Masséna, voyant approcher les Autrichiens, les laisse avancer sur cette digue étroite, et quand il les juge assez engagés, il fond sur eux au pas de course, les refoule, les rejette dans les marais, en tue, en noie un grand nombre. La division Mitrouski arrive à Arcole, débouche par le pont et suit la digue comme celle de Provera. Augereau fond sur elle, l'enfonce, et en jette une partie dans les marais. Il la poursuit, et veut passer le pont après elle; mais le pont était encore mieux gardé que le matin; une nombreuse artillerie en défendait l'approche, et tout le reste de la ligne autrichienne était déployé sur la rive de l'Alpon, fusillant sur la digue, et la prenant en travers. Augereau saisit un drapeau et le porte sur le pont; ses soldats le suivent, mais un feu épouvantable les ramène en arrière. Les généraux Lannes, Verne, Bon, Verdier, sont gravement blessés. La colonne se replie, et les soldats descendent à côté de la digue, pour se mettre à couvert du feu.
Bonaparte voyait de Ronco s'ébranler toute l'armée ennemie, qui, avertie enfin du danger, se hâtait de quitter Caldiero pour n'être pas prise par derrière à Villa-Nova. Il voyait avec douleur de grands résultats lui échapper. Il avait bien envoyé Guyeux avec une brigade, pour essayer de passer l'Alpon au-dessous d'Arcole; mais il fallait plusieurs heures pour l'exécution de cette tentative; et cependant il était de la dernière importance de franchir Arcole sur-le-champ, afin d'arriver à temps sur les derrières d'Alvinzy, et d'obtenir un triomphe complet: le sort de l'Italie en dépendait. Il n'hésite pas, il s'élance au galop, arrive près du pont, se jette à bas de cheval, s'approche des soldats qui s'étaient tapis sur le bord de la digue, leur demande s'ils sont encore les vainqueurs de Lodi, les ranime par ses paroles, et, saisissant un drapeau, leur crie: «Suivez votre général!» A sa voix un certain nombre de soldats remontent sur la chaussée, et le suivent; malheureusement le mouvement ne peut pas se communiquer à toute la colonne dont le reste demeure derrière la digue. Bonaparte s'avance, le drapeau à la main, au milieu d'une grêle de balles et de mitraille. Tous ses généraux l'entourent. Lannes, blessé déjà de deux coups de feu dans la journée, est atteint d'un troisième. Le jeune Muiron, aide-de-camp du général, veut le couvrir de son corps, et tombe mort à ses pieds. Cependant la colonne est près de franchir le pont, lorsqu'une dernière décharge l'arrête, et la rejette en arrière. La queue abandonne la tête. Alors les soldats restés auprès du général le saisissent, l'emportent au milieu du feu et de la fumée, et veulent le faire remonter à cheval. Une colonne autrichienne, qui débouche sur eux, les pousse en désordre dans le marais. Bonaparte y tombe, et y enfonce jusqu'au milieu du corps. Aussitôt les soldats s'aperçoivent de son danger: En avant! s'écrient-ils, pour sauver le général. Ils courent à la suite de Béliard et Vignolles, pour le délivrer. On l'arrache du milieu de la fange, on le remet à cheval, et il revient à Ronco.
Dans ce moment, Guyeux était parvenu à passer au-dessous d'Arcole, et à enlever le village par l'autre rive. Mais il était trop tard. Alvinzy avait déjà fait filer ses parcs et ses bagages; il était déployé dans la plaine, et en mesure de prévenir les desseins de Bonaparte. Tant d'héroïsme et de génie étaient donc devenus inutiles. Bonaparte aurait bien pu s'éviter l'obstacle d'Arcole, en jetant un pont sur l'Adige un peu au-dessous de Ronco, c'est-à-dire à Albaredo, point où l'Alpon est réuni à l'Adige. Mais alors il débouchait en plaine, ce qu'il importait d'éviter; et il n'était pas en mesure de voler par la digue gauche au secours de Vérone. Il avait donc eu raison de faire ce qu'il avait fait; et, quoique le succès ne fût pas complet, d'importans résultats étaient obtenus. Alvinzy avait quitté sa redoutable position de Caldiero; il était redescendu dans la plaine; il ne menaçait plus Vérone; il avait perdu beaucoup de monde dans les marais. Les deux digues étaient devenues le seul champ de bataille intermédiaire entre les deux armées, ce qui assurait l'avantage à la bravoure et l'enlevait au nombre. Enfin les soldats français, animés par la lutte, avaient recouvré toute leur confiance.
Bonaparte, qui avait à songer à tous les périls à la fois, devait s'occuper de sa gauche, laissée à la Corona et à Rivoli. Comme à chaque instant elle pouvait être culbutée, il voulait être en mesure de voler à son secours. Il pensa donc qu'il fallait se replier de Gombione et d'Arcole, repasser l'Adige à Ronco, et bivouaquer en deçà du fleuve, pour être à portée de secourir Vaubois, si, dans la nuit, on apprenait sa défaite. Telle fut cette première journée du 25 brumaire (15 novembre).
La nuit se passa sans mauvaise nouvelle. On sut que Vaubois tenait encore à Rivoli. Les exploits de Castiglione couvraient Bonaparte de ce côté. Davidovich, qui commandait un corps dans l'affaire de Castiglione, avait reçu une telle impression de cet événement, qu'il n'osait avancer avant d'avoir des nouvelles certaines d'Alvinzy. Ainsi le prestige du génie de Bonaparte était là où il n'était pas lui-même. La journée du 26 (16 novembre) commence; on se rencontre sur les deux digues. Les Français chargent à la baïonnette, enfoncent les Autrichiens, en jettent un grand nombre dans les marais, et font beaucoup de prisonniers. Ils prennent des drapeaux et du canon. Bonaparte fait tirailler encore sur la rive de l'Alpon, mais ne tente aucun effort décisif pour le passer. La nuit arrivée, il replie encore ses colonnes, les ramène de dessus les digues, et les rallie sur l'autre rive de l'Adige, content d'avoir épuisé l'ennemi toute la journée, en attendant des nouvelles plus certaines de Vaubois. La seconde nuit se passe encore de même: les nouvelles de Vaubois sont rassurantes. On peut consacrer une troisième journée à lutter définitivement contre Alvinzy. Enfin le soleil se lève pour la troisième fois sur cet épouvantable théâtre de carnage. C'était le 27 (17 novembre 1796). Bonaparte calcule que l'ennemi, en morts, blessés, noyés ou prisonniers, doit avoir perdu près d'un tiers de son armée. Il le juge harassé, découragé, et il voit ses soldats pleins d'enthousiasme; il se décide alors à quitter ces digues, et à porter le champ de bataille dans la plaine, au-delà de l'Alpon. Comme les jours précédens, les Français, débouchant de Ronco, rencontrent les Autrichiens sur les digues. Masséna occupe toujours la digue gauche; sur celle de droite, c'est le général Robert qui est chargé d'attaquer, tandis qu'Augereau va passer l'Alpon près de son embouchure dans l'Adige. Masséna éprouve d'abord une vive résistance, mais il met son chapeau à la pointe de son épée, et marche ainsi à la tête des soldats. Comme les jours précédens, beaucoup d'ennemis sont tués, noyés ou pris. Sur la digue de droite, le général Robert s'avance d'abord avec succès; mais il est tué, sa colonne est repoussée presque jusque sur le pont de Ronco.
Bonaparte, qui voit le danger, place la trente-deuxième dans un bois de saules qui longe la digue. Tandis que la colonne ennemie, victorieuse de Robert, s'avance, la trente-deuxième sort tout à coup de son embuscade, la prend en flanc, et la jette dans un désordre épouvantable. C'étaient trois mille Croates; le plus grand nombre sont tués ou prisonniers. Les digues ainsi balayées, Bonaparte se décide à franchir l'Alpon: Augereau l'avait passé à l'extrême droite. Bonaparte ramène Masséna de la digue gauche sur la digue droite, le dirige sur Arcole, qui était évacué, et porte ainsi toute son armée en plaine devant celle d'Alvinzy. Bonaparte, avant d'ordonner la charge, veut semer l'épouvante au moyen d'un stratagème. Un marais, plein de roseaux, couvrait l'aile gauche de l'ennemi: il ordonne au chef de bataillon Hercule de prendre avec lui vingt-cinq de ses guides, de filer à travers les roseaux, et de charger à l'improviste avec un grand bruit de trompettes. Ces vingt-cinq braves s'apprêtent à exécuter l'ordre, Bonaparte donne alors le signal à Masséna et à Augereau. Ceux-ci chargent vigoureusement la ligne autrichienne, qui résiste; mais tout à coup on entend un grand bruit de trompettes; les Autrichiens, croyant être chargés par toute une division de cavalerie, cèdent le terrain. Au même instant, la garnison de Legnago, que Bonaparte avait fait sortir pour circuler sur leurs derrières, se montre au loin, et ajoute à leurs inquiétudes. Alors ils se retirent; et, après soixante-douze heures de cet épouvantable combat, découragés, accablés de fatigue, ils cèdent la victoire à l'héroïsme de quelques mille braves, et au génie d'un grand capitaine.
Les deux armées, épuisées de leurs efforts, passèrent la nuit dans la plaine. Dès le lendemain matin, Bonaparte fit recommencer la poursuite sur Vicence. Arrivé à la hauteur de la chaussée qui mène de la Brenta à Vérone, en passant par Villa-Nova, il laissa à la cavalerie seule le soin de poursuivre l'ennemi, et songea à rentrer à Vérone par la route de Villa-Nova et de Caldiero, afin de venir au secours de Vaubois. Bonaparte apprit en route que Vaubois avait été obliger d'abandonner la Corona et Rivoli, et de se replier à Castel-Novo. Il redoubla de célérité, et arriva le soir même à Vérone, en passant sur le champ de bataille qu'avait occupé Alvinzy. Il entra dans la ville, par la porte opposée à celle par laquelle il en était sorti. Quand les Véronais virent cette poignée d'hommes, qui étaient sortis en fugitifs par la porte de Milan, rentrer en vainqueurs par la porte de Venise, ils furent saisis de surprise. Amis et ennemis ne purent contenir leur admiration pour le général et les soldats qui venaient de changer si glorieusement le destin de la guerre. Dès ce moment, il n'entra plus dans les craintes ni dans les espérances de personne, qu'on pût chasser les Français de l'Italie. Bonaparte fit marcher sur-le-champ Masséna à Castel-Novo, et Augereau sur Dolce, par la rive gauche de l'Adige. Davidovich, attaqué de toutes parts, fut promptement ramené dans le Tyrol, avec perte de beaucoup de prisonniers. Bonaparte se contenta de faire réoccuper les positions de la Corona et de Rivoli, sans vouloir remonter jusqu'à Trente et rentrer en possession du Tyrol. L'armée française était singulièrement affaiblie par cette dernière lutte. L'armée autrichienne avait perdu cinq mille prisonniers, huit ou dix mille morts et blessés, et se trouvait encore forte de plus de quarante mille hommes, compris le corps de Davidovich. Elle se retirait dans le Tyrol et sur la Brenta pour s'y reposer, elle était loin d'avoir souffert comme les armées de Wurmser et de Beaulieu. Les Français, épuisés, n'avaient pu que la repousser sans la détruire. Il fallait donc renoncer à la poursuivre, tant que les renforts promis ne seraient pas arrivés. Bonaparte se contenta d'occuper l'Adige de Dolce à la mer.
Cette nouvelle victoire causa en Italie et en France une joie extrême. On admirait de toutes parts ce génie opiniâtre qui, avec quatorze ou quinze mille hommes, devant quarante mille, n'avait pas songé à se retirer; ce génie inventif et profond, qui avait su découvrir dans les digues de Ronco un champ de bataille tout nouveau qui annulait le nombre, et donnait dans les flancs de l'ennemi. On célébrait surtout l'héroïsme déployé au pont d'Arcole, et partout on représentait le jeune général, un drapeau à la main, au milieu du feu et de la fumée. Les deux conseils, en déclarant, suivant l'usage, que l'armée d'Italie avait encore bien mérité de la patrie, décidèrent de plus que les drapeaux pris par les généraux Bonaparte et Augereau sur le pont d'Arcole, leur seraient donnés pour être conservés dans leurs familles: belle et noble récompense, digne d'un âge héroïque, et bien plus glorieuse que le diadème décerné plus tard par la faiblesse au génie tout puissant!