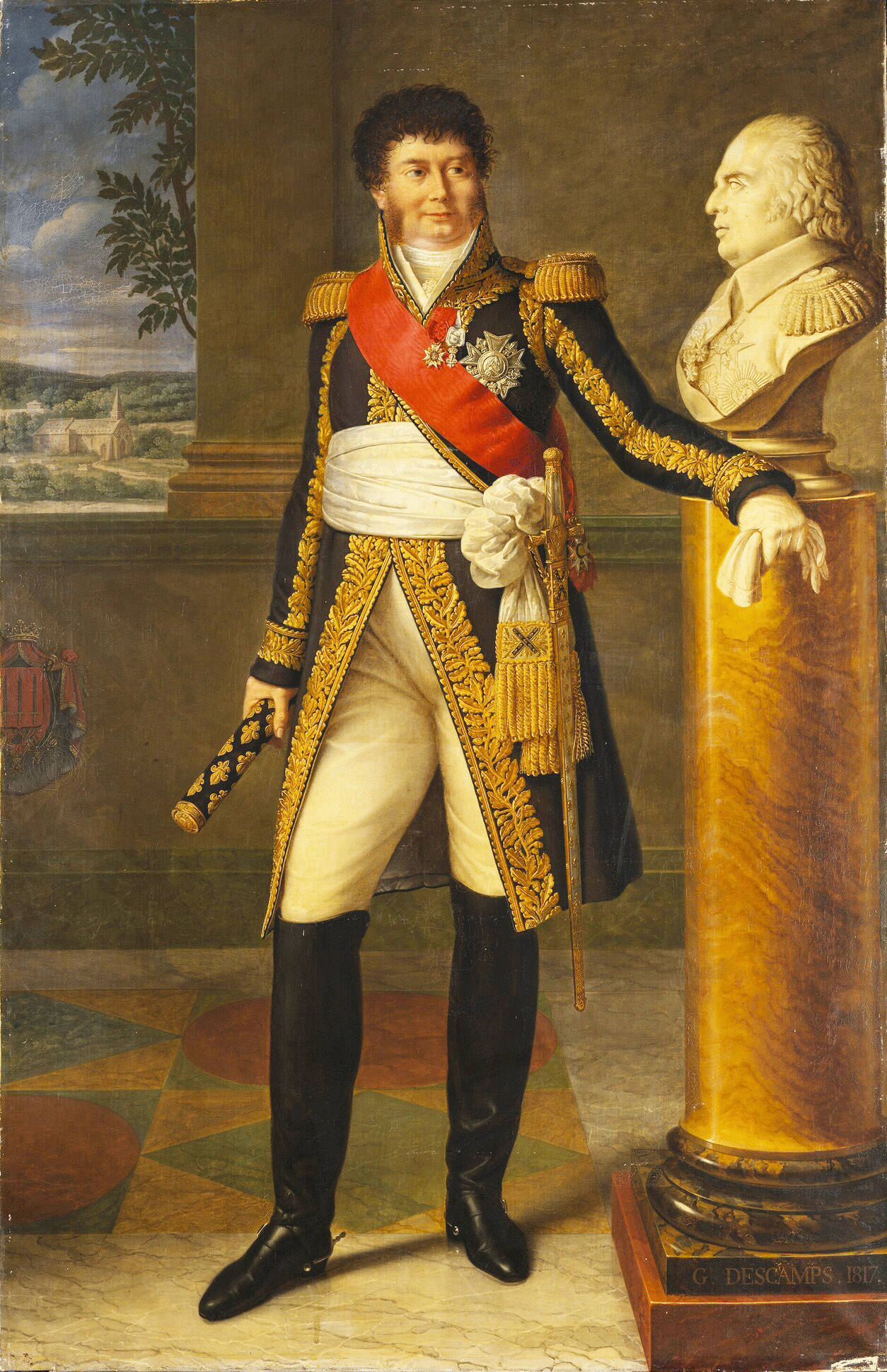HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. |
CLARKE AU QUARTIER-GÉNÉRAL DE L'ARMÉE D'ITALIE.— RUPTURE DES NÉGOCIATIONS AVEC LE CABINET ANGLAIS. DÉPART DE MALMESBURY.— EXPÉDITION D'IRLANDE.— TRAVAUX ADMINISTRATIFS DU DIRECTOIRE DANS L'HIVER DE L'AN V. ÉTAT DES FINANCES. RECETTES ET DÉPENSES.— CAPITULATION DE KEHL.— DERNIÈRES TENTATIVES DE L'AUTRICHE SUR L'ITALIE. VICTOIRES DE RIVOLI ET DE LA FAVORITE. PRISE DE MANTOUE.— FIN DE LA MÉMORABLE CAMPAGNE DE 1796.
Le général Clarke venait d'arriver au quartier-général de l'armée d'Italie, d'où il devait partir pour se rendre à Vienne. Sa mission avait perdu son objet essentiel, car la bataille d'Arcole rendait l'armistice inutile. Bonaparte, que le général Clarke avait ordre de consulter, désapprouvait tout à fait l'armistice et ses conditions. Les raisons qu'il donnait étaient excellentes. L'armistice ne pouvait plus avoir qu'un objet, celui de sauver le fort de Kehl sur le Rhin, que l'archiduc Charles assiégeait avec une grande vigueur; et pour cet objet très accessoire, il sacrifiait Mantoue. Kehl n'offrait qu'une tête de pont qui n'était point indispensable pour déboucher en Allemagne. La prise de Mantoue au contraire entraînait la conquête définitive de l'Italie, et permettait d'exiger en retour Mayence et toute la ligne du Rhin. L'armistice compromettait évidemment cette conquête; car Mantoue, remplie de malades, et réduite à la demi-ration, ne pouvait pas différer plus d'un mois d'ouvrir ses portes. Les vivres qu'on y ferait entrer rendraient à la garnison la santé et les forces. La quantité n'en pourrait pas être exactement fixée, et Wurmser, en faisant des économies, se ménagerait des approvisionnemens pour recommencer sa résistance, en cas d'une reprise d'hostilités. La suite de batailles livrées pour couvrir le blocus de Mantoue deviendraient donc inutiles, et il faudrait recommencer sur nouveaux frais. Ce n'était pas tout. Le pape ne pouvait manquer d'être compris dans l'armistice par l'Autriche, et alors on perdait le moyen de le punir, et de lui arracher vingt ou trente millions, dont on avait besoin pour l'armée, et qui serviraient à faire une nouvelle campagne. Bonaparte enfin, perçant dans l'avenir, conseillait, au lieu de suspendre les hostilités, de les continuer au contraire avec vigueur, mais de porter la guerre sur son véritable théâtre, et d'envoyer en Italie un renfort de trente mille hommes. Il promettait à ce prix de marcher sur Vienne, et d'avoir en deux mois la paix, la ligne du Rhin, et une république en Italie. Sans doute, cette combinaison plaçait dans ses mains toutes les opérations militaires et politiques de la guerre; mais, qu'elle fût intéressée ou non, elle était juste et profonde, et l'avenir en prouva la sagesse.
Cependant, par obéissance pour le directoire, on écrivit aux généraux autrichiens sur le Rhin et l'Adige, pour leur proposer l'armistice, et pour obtenir à Clarke des passeports. L'archiduc Charles répondit à Moreau qu'il ne pouvait entendre aucune proposition d'armistice, que ses pouvoirs ne le lui permettaient pas, et qu'il fallait en référer au conseil aulique. Alvinzy répondit de même, et fit partir un courrier pour Vienne. Le ministère autrichien, secrètement dévoué à l'Angleterre, était peu disposé à écouter les propositions de la France. Le cabinet de Londres lui avait fait part de la mission de lord Malmesbury; il s'était efforcé de lui persuader que l'empereur obtiendrait bien plus d'avantages en prenant part à la négociation ouverte à Paris, qu'en faisant des conquêtes séparées, puisque les conquêtes anglaises dans les deux Indes étaient sacrifiées pour lui procurer la restitution des Pays-Bas. Outre les insinuations de l'Angleterre, le cabinet de Vienne avait d'autres raisons de repousser les propositions du directoire. Il se flattait de s'emparer du fort de Kehl sous très peu de temps; les Français, contenus le long du Rhin, ne pourraient plus alors le franchir; on pourrait donc sans danger en retirer de nouveaux détachemens, pour les porter sur l'Adige. Ces détachemens, joints à de nouvelles levées qui se faisaient dans toute l'Autriche avec une merveilleuse activité, permettraient encore un effort sur l'Italie; et peut-être cette terrible armée, qui avait tant anéanti de bataillons autrichiens, finirait par succomber sous des efforts réitérés.
La constance allemande ne se démentait donc pas ici, et, malgré tant de revers, elle ne renonçait pas encore à la belle Italie. En conséquence, il fut résolu de refuser l'entrée de Vienne à Clarke. On craignait d'ailleurs un observateur au milieu de la capitale de l'empire, et on ne voulait pas de négociation directe. Quant à l'armistice, on aurait consenti à l'admettre sur l'Adige, mais non sur le Rhin. On répondit à Clarke que, s'il voulait se rendre à Vicence, il y trouverait le baron de Vincent, et qu'il pourrait y conférer avec lui. La réunion eut lieu en effet à Vicence. Le ministre autrichien prétendit que l'empereur ne pouvait recevoir un envoyé de la république, parce que c'était la reconnaître; et, quant à l'armistice, il déclara qu'on ne pouvait l'admettre qu'en Italie. Cette proposition était ridicule, et on ne conçoit pas que le ministère autrichien pût la faire, car elle sauvait Mantoue sans sauver Kehl, et il fallait supposer les Français bien sots pour l'accepter. Cependant le ministère autrichien, qui voulait au besoin se ménager le moyen d'une négociation séparée, fit déclarer par son envoyé que si le commissaire français avait des propositions à faire relativement à la paix, il n'avait qu'à se rendre à Turin, et les communiquer à l'ambassadeur autrichien auprès du Piémont. Ainsi, grâce aux suggestions de l'Angleterre et aux folles espérances de la cour de Vienne, ce dangereux projet d'armistice fut écarté. Clarke s'en alla à Turin, pour profiter au besoin de l'intermédiaire qui lui était offert auprès de la cour de Sardaigne. Il avait encore une autre mission: c'était celle d'observer le général Bonaparte. Le génie de ce jeune homme avait paru si extraordinaire, son caractère si absolu, si énergique, que sans aucun motif précis, on lui supposa de l'ambition. Il avait voulu conduire la guerre à son gré, et avait offert sa démission quand on lui traça un plan qui n'était pas le sien; il avait agi souverainement en Italie, accordant aux princes la paix ou la guerre, sous prétexte des armistices; il s'était plaint avec hauteur de ce que les négociations avec le pape n'avaient pas été conduites par lui seul, et il avait exigé qu'on lui en remît le soin; il traitait fort durement les commissaires Gareau et Salicetti, quand ils se permettaient des mesures qui lui déplaisaient, et il les avait obligés de quitter le quartier-général; il s'était permis d'envoyer des fonds aux différentes armées sans se faire autoriser par le gouvernement, et sans l'intermédiaire indispensable de la trésorerie. Tous ces faits annonçaient un homme qui aimait à faire seul ce qu'il croyait être seul capable de bien faire. Ce n'était encore que l'impatience du génie, qui n'aime pas à être contrarié dans ses oeuvres; mais c'est par cette impatience que commence à se manifester une volonté despotique. En le voyant soulever la Haute-Italie contre ses anciens maîtres, et créer ou détruire des états, on disait qu'il voulait se faire duc de Milan. On pressentait-son ambition, et il en pressentait lui-même le reproche. Il se plaignait d'être accusé, puis se justifiait lui-même, sans qu'un seul mot du directoire lui en eût fourni l'occasion.
Clarke avait donc, outre la mission de négocier, celle de l'observer. Bonaparte en fut averti, et agissant ici avec la hauteur et l'adresse qui lui étaient ordinaires, il lui laissa voir qu'il connaissait l'objet de sa mission, le subjugua bientôt par son ascendant et sa grâce, aussi puissante, dit-on, que son génie, et en fit un homme dévoué. Clarke avait de l'esprit, trop de vanité pour être un espion adroit et souple. Il resta en Italie, tantôt à Turin, tantôt au quartier-général, et bientôt il appartint plus à Bonaparte qu'au directoire. A Paris, le cabinet anglais faisait, autant qu'il le pouvait, traîner en longueur la négociation; mais le cabinet français par des réponses promptes et claires, obligea enfin lord Malmesbury à s'expliquer. Ce ministre, comme on l'a vu, avait posé d'abord le principe d'une négociation générale, et de la compensation des conquêtes; de son côté, le directoire avait exigé des pouvoirs de tous les alliés, et une explication plus claire du principe des compensations. Le ministre anglais avait mis dix-neuf jours à répondre; il avait répondu enfin que les pouvoirs étaient demandés, mais qu'avant de les obtenir, il fallait que le gouvernement français admît positivement le principe des compensations. Le directoire avait alors demandé qu'on lui énonçât sur-le-champ les objets sur lesquels porteraient les compensations. Tel est le point où la négociation en était restée. Lord Malmesbury écrivit de nouveau à Londres, et après douze jours, répondit, le 6 frimaire (26 novembre), que sa cour n'avait rien à ajouter à ce qu'elle avait dit, et qu'elle ne pouvait pas s'expliquer davantage, tant que le gouvernement français n'admettrait pas formellement le principe proposé. C'était là une subtilité; car, en demandant l'énonciation des objets qui seraient compensés, la France admettait évidemment le principe des compensations. Écrire à Londres, et employer encore douze jours pour cette subtilité, c'était se jouer du directoire. Il répondit, comme il faisait toujours, le lendemain même, et par une note de quatre lignes il dit que sa précédente note impliquait nécessairement l'admission du principe des compensations, mais que du reste il l'admettait formellement, et demandait sur-le-champ la désignation des objets sur lesquels ce principe devait porter. Le directoire s'informait en outre si à chaque question lord Malmesbury serait obligé d'écrire à Londres. Lord Malmesbury répondit vaguement qu'il serait obligé d'écrire toutes les fois que la question exigerait des instructions nouvelles. Il écrivit encore, et resta vingt jours avant de répondre. Il était évident cette fois qu'il fallait sortir du vague où l'on s'était enfermé, et aborder enfin la redoutable question des Pays-Bas. S'expliquer sur cet objet, c'était rompre la négociation, et on conçoit que le cabinet anglais mît les plus longs délais possibles à la rompre. Enfin, le 28 frimaire (18 décembre), lord Malmesbury eut une entrevue avec le ministre Delacroix, et lui remit une note dans laquelle les prétentions du cabinet anglais étaient exposées. Il voulait que la France restituât aux puissances du continent tout ce qu'elle avait conquis; qu'elle rendît à l'Autriche la Belgique et le Luxembourg, à l'Empire les états allemands de la rive gauche; qu'elle évacuât toute l'Italie, et la replaçât dans le statu quo ante bellum; qu'elle restituât à la Hollande certaines portions de territoire, telles que la Flandre maritime, par exemple, afin de la rendre indépendante; et enfin, que des changemens fussent faits à sa constitution actuelle. Le cabinet anglais ne promettait de rendre les colonies de la Hollande que dans le cas du rétablissement du stathoudérat; encore ne les rendrait-il jamais toutes: il devait en garder quelques-unes comme indemnité de guerre; le Cap était du nombre. Pour tous ces sacrifices, il offrait de rendre deux ou trois îles que la guerre nous avait fait perdre dans les Antilles, la Martinique, Sainte-Lucie, Tobago,et à condition encore que Saint-Domingue ne nous resterait pas en entier. Ainsi la France, après une guerre inique, où elle avait eu toute justice de son côté, où elle avait dépensé des sommes énormes, et dont elle était sortie victorieuse, la France n'aurait pas gagné une seule province, tandis que les puissances du Nord venaient de se partager un royaume, et que l'Angleterre venait de faire dans l'Inde des acquisitions immenses! La France, qui occupait encore la ligne du Rhin, et qui était maîtresse de l'Italie, aurait évacué le Rhin et l'Italie sur la simple sommation de l'Angleterre! De pareilles conditions étaient absurdes et inadmissibles; la seule proposition en était offensante, et elles ne devaient pas être écoutées. Le ministre Delacroix les écouta cependant avec une politesse qui frappa le ministre anglais, et qui lui fit même espérer qu'on pourrait poursuivre la négociation.
Delacroix donna une raison qui était mauvaise, c'est que les Pays-Bas étaient déclarés territoire national par la constitution; et le ministre anglais lui répondit par une raison qui ne valait pas mieux, c'est que le traité d'Utrecht les attribuait à l'Autriche. La constitution pouvait être obligatoire pour la nation française, mais elle ne concernait ni n'obligeait les nations étrangères. Le traité d'Utrecht était, comme tous les traités du monde, un arrangement de la force, que la force pouvait changer. La seule raison que le ministre français devait donner, c'est que la réunion des Pays-Bas à la France était juste, fondée sur toutes les convenances naturelles et politiques, et légitimée par la victoire. Après une longue discussion sur tous les points accessoires de la négociation, les deux ministres se séparèrent. Le ministre Delacroix vint en référer au directoire, qui, s'irritant à bon droit, résolut de répondre au ministre anglais comme il le méritait. La note du ministre anglais n'était pas signée, elle était seulement contenue dans une lettre signée. Le directoire exigea, le jour même, qu'elle fût revêtue des formes nécessaires, et lui demanda son ultimatum sous vingt-quatre heures. Lord Malmesbury, embarrassé, répondit que la note était suffisamment authentique, puisqu'elle était contenue dans une lettre signée, et que quant à un ultimatum, il était contre tous les usages de l'exiger aussi brusquement. Le lendemain, 29 frimaire (19 décembre), le directoire lui fit déclarer qu'il n'écouterait jamais aucune proposition contraire aux lois et aux traités qui liaient la république; il fit ajouter que lord Malmesbury ayant besoin de recourir à chaque instant à son gouvernement, et remplissant un rôle purement passif dans la négociation, sa présence à Paris était inutile; qu'en conséquence il avait ordre de se retirer, lui et toute sa suite, sous quarante-huit heures; que d'ailleurs des courriers suffiraient pour négocier, si le gouvernement anglais adoptait les bases posées par la république française.
Ainsi finit cette négociation, dans laquelle le directoire, loin de manquer aux formes, comme on l'a dit, donna un véritable exemple de franchise dans ses rapports avec les puissances ennemies. Il n'y eut point ici d'usage violé. Les communications des puissances portent, comme toutes les relations entre les hommes, le caractère du temps, de la situation, des individus qui gouvernent. Un gouvernement fort et victorieux parle autrement qu'un gouvernement faible et vaincu; et il convenait à une république, appuyée sur la justice et la victoire, de rendre son langage prompt, net, et public.
Pendant cet intervalle, le grand projet de Hoche sur l'Irlande s'effectuait. C'était là ce que redoutait l'Angleterre, et ce qui pouvait, en effet, la mettre dans un grand péril. Malgré les bruits adroitement semés d'une expédition en Portugal ou en Amérique, l'Angleterre avait bien compris l'objet des préparatifs qui se faisaient à Brest. Pitt avait fait lever les milices, armer les côtes, et donner l'ordre de tout évacuer dans l'intérieur, si les Français débarquaient.
L'Irlande, à laquelle on destinait l'expédition, était dans une situation propre à inspirer de graves inquiétudes. Les partisans de la réforme parlementaire et les catholiques présentaient dans cette île une masse suffisante pour opérer un soulèvement. Ils auraient volontiers adopté un gouvernement républicain, sous la garantie de la France, et ils avaient envoyé des agens secrets à Paris pour s'entendre avec le directoire. Ainsi tout présageait qu'une expédition pourrait causer de cruels embarras à l'Angleterre, et la réduire à accepter une toute autre paix que celle qu'elle venait d'offrir. Hoche, qui avait consumé les deux plus belles années de sa vie dans la Vendée, et qui voyait les grands théâtres de la guerre occupés par Bonaparte, Moreau et Jourdan, brillait de s'en ouvrir un en Irlande. L'Angleterre était un aussi noble adversaire que l'Autriche, et il n'y avait pas moins d'honneur à la combattre et à la vaincre. Une république nouvelle s'élevait en Italie, et allait y devenir le foyer de la liberté. Hoche croyait beau et possible d'en élever une pareille en Irlande, à côté de l'aristocratie anglaise. Il s'était lié beaucoup avec l'amiral Truguet, ministre de la marine, et ministre à grandes vues. Ils s'étaient promis tous deux de donner une haute importance à la marine, et de faire de grandes choses; car alors toutes les têtes étaient en travail, toutes méditaient des prodiges pour la gloire et la félicité de leur patrie. L'alliance offensive et défensive conclue avec l'Espagne à Saint-Ildefonse, offrait de grandes ressources, et permettait de vastes projets. En réunissant la flotte de Toulon aux flottes de l'Espagne, en les concentrant dans la Manche avec celle que la France avait dans l'Océan, on pouvait rassembler des forces formidables, et tenter de délivrer les mers par une bataille décisive; on pouvait du moins jeter un incendie en Irlande, et aller interrompre les succès de l'Angleterre dans l'Inde. L'amiral Truguet, qui sentait l'importance de porter de rapides secours dans l'Inde, voulait que l'escadre de Brest, sans attendre la réunion des flottes française et espagnole dans la Manche, mît à la voile sur-le-champ, jetât l'armée de Hoche en Irlande, gardât quelques mille hommes à bord, fît voile ensuite pour l'Ile-de-France, allât y prendre les bataillons de noirs qu'on y organisait, et transportât ces secours dans l'Inde pour soutenir Tippo-Saïb. Cette grande expédition avait l'inconvénient de ne porter en Irlande qu'une partie de l'armée d'expédition, et de la laisser exposée à de grandes chances, en attendant la réunion très éventuelle de l'escadre de l'amiral Villeneuve qui devait partir de Toulon, de l'escadre espagnole qui était dispersée dans les ports d'Espagne, et de l'escadre de Richery qui revenait d'Amérique. Cette expédition ne fut pas exécutée. On attendit l'arrivée d'Amérique de Richery, et on fit, malgré l'état des finances, des efforts extraordinaires pour achever l'armement de l'escadre de Brest. Elle se trouva en frimaire (décembre) en état de mettre à la voile. Elle se composait de quinze vaisseaux de haut bord, de vingt frégates, de six gabares, et cinquante bâtimens de transport. Elle pouvait porter vingt-deux mille hommes. Hoche ne pouvant s'entendre avec l'amiral Villaret-Joyeuse, on remplaça ce dernier par Morard-de-Galles. L'expédition dut débarquer dans la baie de Bantry. On assigna à chaque capitaine de vaisseau, dans un ordre cacheté, la direction qu'il devait suivre, et le mouillage qu'il devait choisir en cas d'accident.
L'expédition mit à la voile le 26 frimaire (16 décembre). Hoche et Morard-de-Galles étaient montés sur une frégate. L'escadre française, grâce à une brume épaisse, échappa aux croisières anglaises, et traversa la mer sans être aperçue. Mais, dans la nuit du 26 au 27, une tempête affreuse la dispersa. Un vaisseau fut englouti. Cependant le contre-amiral Bouvet manoeuvra pour rallier l'escadre, et après deux jours, parvint à la réunir tout entière, à l'exception d'un vaisseau et de trois frégates. Malheureusement la frégate qui portait Hoche et Morard-de-Galles était du nombre de ces dernières. L'escadre cingla vers le cap Clear, et manoeuvra là plusieurs jours pour attendre les deux chefs. Enfin, le 4 nivôse (24 décembre), elle entra dans la baie de Bantry. Un conseil de guerre décida le débarquement; mais il devint impossible par l'effet du mauvais temps; l'escadre fut de nouveau éloignée des côtes d'Irlande. Le contre-amiral Bouvet, effrayé par tant d'obstacles, craignant de manquer de vivres, et séparé de ses chefs, crut devoir regagner les côtes de France. Hoche et Morard-de-Galles arrivèrent enfin dans la baie de Bantry, et apprirent là le retour de l'escadre française. Ils revinrent à travers des périls inouïs. Battus par la mer, poursuivis par les Anglais, ils ne furent rendus aux rivages de France que par une espèce de miracle. Le vaisseau les Droits de l'homme, capitaine La Crosse, se trouva séparé de l'escadre, et fit des prodiges: attaqué par deux vaisseaux anglais, il en détruisit un, échappa à l'autre; mais, tout mutilé, privé de mâts et de voiles, il succomba à la violence de la mer. Une partie de l'équipage fut engloutie, l'autre fut sauvée à grand'peine.
Ainsi finit cette expédition, qui jeta une grande alarme en Angleterre, et qui révéla son point vulnérable. Le directoire ne renonça pas à revenir plus tard à ce projet, et tourna dans le moment toutes ses idées du côté du continent, pour se hâter de faire déposer les armes à l'Autriche. Les troupes de l'expédition avaient peu souffert; elles furent débarquées. On laissa sur les côtes les forces nécessaires pour faire la police du pays, et on achemina vers le Rhin la majeure partie de l'armée qui avait porté le titre d'armée de l'Océan. Les deux Vendées et la Bretagne étaient, du reste, tout à fait soumises, par les soins et la présence continuelle de Hoche. On préparait à ce général un grand commandement, pour le récompenser de ses ingrats et pénibles travaux. La démission de Jourdan, que la mauvaise issue de la campagne avait dégoûté, et qu'on avait provisoirement remplacé par Beurnonville, permettait d'offrir à Hoche un dédommagement qui, depuis long-temps, était dû à son patriotisme et à ses talens.
L'hiver, déjà fort avancé (on était en nivôse,—janvier 1797), n'avait point interrompu cette campagne mémorable. Sur le Rhin, l'archiduc Charles assiégeait Kehl et la tête de pont d'Huningue; sur l'Adige, Alvinzy préparait un nouvel et dernier effort contre Bonaparte. L'intérieur de la république était assez calme: les partis avaient les yeux fixés sur les différens théâtres de la guerre. La considération et la force du gouvernement augmentaient ou diminuaient selon les chances de la campagne. La dernière victoire d'Arcole avait répandu un grand éclat et réparé le mauvais effet produit par la retraite des armées du Rhin. Mais cependant cet effort d'une bravoure désespérée ne rassurait pas entièrement sur la possession de l'Italie. On savait qu'Alvinzy se renforçait, et que le pape faisait des armemens; les malveillans disaient que l'armée d'Italie était épuisée; que son général, accablé par les travaux d'une campagne sans exemple, et consumé par une maladie extraordinaire, ne pouvait plus tenir à cheval. Mantoue n'était pas encore prise, et on pouvait concevoir des inquiétudes pour le mois de nivôse (janvier).
Les journaux des deux partis, profitant sans mesure de la liberté de la presse, continuaient à se déchaîner. Ceux de la contre-révolution, voyant approcher le printemps, époque des élections, tâchaient de remuer l'opinion, et de la disposer en leur faveur. Depuis les désastres des royalistes de la Vendée, il devenait clair que leur dernière ressource était de se servir de la liberté elle-même pour la détruire, et d'envahir la république en s'emparant des élections. Le directoire, en voyant leur déchaînement, était saisi de ces mouvemens d'impatience dont le pouvoir même le plus éclairé ne peut pas toujours se défendre. Quoique fort habitué à la liberté, il s'effrayait du langage qu'elle prenait dans certains journaux; il ne comprenait pas encore assez qu'il faut laisser tout dire, que le mensonge n'est jamais à redouter, quelque publicité qu'il acquière, qu'il s'use par sa violence, et qu'un gouvernement périt par la vérité seule, et surtout par la vérité comprimée. Il demanda aux deux conseils des lois sur les abus de la presse. On se récria; on prétendit que, les élections approchant, il voulait en gêner la liberté; on lui refusa les lois qu'il demandait. On accorda seulement deux dispositions: l'une, relative à la répression de la calomnie privée; l'autre, aux crieurs de journaux, qui, dans les rues, au lieu de les annoncer par leur titre, les annonçaient par des phrases détachées, et souvent fort inconvenantes. Ainsi on vendait un pamphlet, en criant dans les rues: Rendez-nous nos myriagrammes, et f….-nous le camp, si vous ne pouvez faire le bonheur du peuple. Il fut décidé, pour éviter ce scandale, qu'on ne pourrait plus crier les journaux et les écrits que par un simple titre. Le directoire aurait voulu l'établissement d'un journal officiel du gouvernement. Les cinq-cents y consentirent; les anciens s'y opposèrent. La loi du 3 brumaire, mise une seconde fois en discussion en vendémiaire, et devenue le prétexte de la ridicule attaque des patriotes sur le camp de Grenelle, avait été maintenue après une discussion solennelle. Elle était en quelque sorte le poste autour duquel ne cessaient de se rencontrer les deux partis. C'était surtout la disposition qui excluait les parens des émigrés des fonctions publiques, que le côté droit voulait détruire, et que les républicains voulaient conserver. Après une troisième attaque, il fut décidé que cette disposition serait maintenue. On ne fit qu'un seul changement à cette loi. Elle excluait de l'amnistie générale, accordée aux délits révolutionnaires, les délits qui se rattachaient au 13 vendémiaire; cet événement était déjà trop loin pour ne pas amnistier les individus qui avaient pu y prendre part, et qui, d'ailleurs, étaient tous impunis de fait: l'amnistie fut donc appliquée aux délits de vendémiaire, comme à tous les autres faits purement révolutionnaires.
Ainsi le directoire, et tous ceux qui voulaient la république directoriale, conservaient la majorité dans les conseils, malgré les cris de quelques patriotes follement emportés, et de quelques intrigans vendus à la contre-révolution.
L'état des finances avait l'effet ordinaire de la misère dans les familles, il troublait l'union domestique du directoire avec le corps législatif. Le directoire se plaignait de ne pas voir ses mesures toujours accueillies par les conseils; il leur adressa un message alarmant, et il le publia, comme pour faire retomber sur eux les malheurs publics, s'ils ne s'empressaient d'adopter ses propositions. Ce message du 25 frimaire (15 décembre) était conçu en ces termes: «Toutes les parties du service sont en souffrance. La solde des troupes est arriérée; les défenseurs de la patrie sont livrés aux horreurs de la nudité, leur courage est énervé par le sentiment douloureux de leurs besoins; le dégoût, qui en est la suite, entraîne la désertion. Les hôpitaux manquent de fournitures, de feu, de médicamens. Les établissemens de bienfaisance, en proie au même dénuement, repoussent l'indigent et l'infirme dont ils étaient la seule ressource. Les créanciers de l'état, les entrepreneurs qui, chaque jour, contribuent à fournir aux besoins des armées, n'arrachent que de faibles parcelles des sommes qui leur sont dues; leur détresse écarte des hommes qui pourraient faire les mêmes services avec plus d'exactitude, ou à de moindres bénéfices. Les routes sont bouleversées, les communications interrompues. Les fonctionnaires publics sont sans salaires; d'un bout à l'autre de la république, on voit les juges, les administrateurs, réduits à l'horrible alternative, ou de traîner dans la misère leur existence et celle de leur famille, ou de se déshonorer en se vendant à l'intrigue. Partout la malveillance s'agite; dans bien des lieux l'assassinat s'organise, et la police sans activité, sans force, parce qu'elle est dénuée de moyens pécuniaires, ne peut arrêter ce désordre.»
Les conseils furent irrités de la publication de ce message, qui semblait faire retomber sur eux les malheurs de l'état, et censurèrent vivement l'indiscrétion du directoire. Cependant ils se mirent à examiner sur-le-champ ses propositions. Le numéraire abondait partout, excepté dans les coffres de l'état. L'impôt, actuellement percevable en numéraire ou en papier au cours, ne rentrait que lentement. Les biens nationaux soumissionnés étaient payés en partie; les paiemens restant à faire n'étaient pas échus. On vivait d'expédiens, on donnait aux fournisseurs des ordonnances de ministres, des bordereaux de liquidation, espèces de valeurs d'attente, qui n'étaient reçues que pour une valeur inférieure, et qui faisaient monter considérablement le prix des marchés. C'était donc toujours la même situation que nous avons déjà exposée si souvent.
De grandes améliorations furent apportées aux finances pour l'an V. On divisa le budget en deux parties, comme on a déjà vu: la dépense ordinaire de 450 millions, et la dépense extraordinaire de 550. La contribution foncière, portée à 250 millions, la contribution somptuaire et personnelle à 50, les douanes, le timbre, l'enregistrement à 150, durent fournir les 450 millions de la dépense ordinaire. L'extraordinaire dut être couvert par l'arriéré de l'impôt et par le produit des biens nationaux. L'impôt était désormais entièrement exigible en numéraire. Il restait encore quelques mandats et quelques assignats, qui furent annulés sur-le-champ, et reçus au cours pour le paiement de l'arriéré. De cette manière on fit cesser totalement les désordres du papier-monnaie. L'emprunt forcé fut définitivement fermé. Il avait produit à peine 400 millions valeur effective. Les impositions arriérées durent être entièrement acquittées avant le 15 frimaire de l'année actuelle (5 décembre). Les garnisaires furent institués pour hâter la perception. On ordonna la confection des rôles, pour percevoir sur-le-champ le quart des impôts de l'an V. Restait à savoir comment on userait de la valeur des biens nationaux, n'ayant plus le papier-monnaie pour la mettre d'avance en circulation. On avait encore à toucher le dernier sixième sur les biens soumissionnés. On décida que, pour devancer ce dernier paiement, on exigerait des acquéreurs des obligations payables en numéraire, échéant à l'époque même à laquelle la loi les obligeait de s'acquitter, et entraînant, en cas de protêt, l'expropriation du bien vendu. Cette mesure pouvait faire rentrer quatre-vingts et quelques millions d'obligations, dont les fournisseurs annonçaient qu'ils se paieraient volontiers. On n'avait plus de confiance dans l'état, mais on en avait dans les particuliers; et les 80 millions de ce papier personnel avaient une valeur que n'aurait pas eue un papier émis et garanti par la république. On décida que les biens vendus à l'avenir se paieraient comme il suit: un dixième comptant en numéraire; cinq dixièmes comptant, en ordonnances des ministres, ou en bordereaux de liquidation délivrés aux fournisseurs; quatre dixièmes enfin, en quatre obligations, payables une par an.
Ainsi, n'ayant plus de crédit public, on se servait du crédit privé; ne pouvant plus émettre du papier-monnaie hypothéqué sur les biens, on exigeait des acquéreurs de ces biens une espèce de papier qui, portant leur signature, avait une valeur individuelle; enfin on permettait aux fournisseurs de se payer de leurs services sur les biens eux-mêmes.
Ces dispositions faisaient donc espérer un peu d'ordre et quelques rentrées. Pour suffire aux besoins pressans du ministère de la guerre, on lui adjugea sur-le-champ, pour les mois de nivôse, pluviôse, ventôse et germinal, mois consacrés, aux préparatifs de la nouvelle campagne, la somme de 120 millions, dont 33 millions devaient être pris sur l'ordinaire, et 87 sur l'extraordinaire. L'enregistrement, les postes, les douanes, les patentes, la contribution foncière allaient fournir ces 33 millions: les 87 de l'extraordinaire devaient se composer du produit des bois, de l'arriéré des contributions militaires, et des obligations des acquéreurs de biens nationaux. Ces valeurs étaient assurées, et allaient rentrer sur-le-champ. On paya tous les fonctionnaires publics en numéraire. On décida de payer les rentiers de la même manière; mais ne pouvant encore leur donner de l'argent, on leur donna des billets au porteur, recevables en paiement des biens nationaux, comme les ordonnances des ministres et les bordereaux de liquidation délivrés aux fournisseurs.
Tels furent les travaux administratifs du directoire pendant l'hiver de l'an V (1796 à 1797), et les moyens qu'il se prépara pour suffire à la campagne suivante. La campagne actuelle n'était pas terminée, et tout annonçait que malgré dix mois de combats acharnés, malgré les glaces et les neiges, on allait voir encore de nouvelles batailles. L'archiduc Charles s'opiniâtrait à enlever les têtes de pont de Kehl et d'Huningue, comme si, en les enlevant, il eût à jamais interdit aux Français le retour sur la rive droite. Le directoire avait une excellente raison de l'y occuper, c'était de l'empêcher de se porter en Italie. Il passa près de trois mois devant le fort de Kehl. De part et d'autre, les troupes s'illustrèrent par un courage héroïque, et les généraux divisionnaires déployèrent un grand talent d'exécution. Desaix surtout s'immortalisa par sa bravoure, son sang-froid, et ses savantes dispositions autour de ce fort misérablement retranché. La conduite des deux généraux en chef fut loin d'être aussi approuvée que celle de leurs lieutenans. On reprocha à Moreau de n'avoir pas su profiter de la force de son armée, et de n'avoir pas débouché sur la rive droite pour tomber sur l'armée de siége. On blâma l'archiduc d'avoir dépensé tant d'efforts contre une tête de pont. Moreau rendit Kehl le 20 nivôse an V (9 janvier 1797); c'était une légère perte. Notre longue résistance prouvait la solidité de la ligne du Rhin. Les troupes avaient peu souffert; Moreau avait employé le temps à perfectionner leur organisation; son armée présentait un aspect superbe. Celle de Sambre-et-Meuse, passée sous les ordres de Beurnonville, n'avait pas été employée utilement pendant ces derniers mois, mais elle s'était reposée, et renforcée de détachemens nombreux venus de la Vendée; elle avait reçu un chef illustre, Hoche, qui était enfin appelé à une guerre digne de ses talens. Ainsi, quoiqu'il ne possédât pas encore Mayence, et qu'il fût privé de Kehl, le directoire pouvait se regarder comme puissant sur le Rhin. Les Autrichiens, de leur côté, étaient fiers d'avoir pris Kehl, et ils dirigeaient maintenant tous leurs efforts sur la tête de pont d'Huningue. Mais tous les voeux de l'empereur et de ses ministres se portaient sur l'Italie. Les travaux de l'administration pour renforcer l'armée d'Alvinzy, et pour essayer une dernière lutte, étaient extraordinaires. On avait fait partir les troupes en poste. Toute la garnison de Vienne avait été acheminée sur le Tyrol. Les habitans de la capitale, pleins de dévouement pour la maison impériale, avaient fourni quatre mille volontaires, qui furent enrégimentés, sous le nom de volontaires de Vienne. L'impératrice leur donna des drapeaux brodés de ses mains. On avait fait une nouvelle levée en Hongrie, et on avait tiré du Rhin quelques mille hommes des meilleures troupes de l'empire. Grâce à cette activité, digne des plus grands éloges, l'armée d'Alvinzy se trouva renforcée d'une vingtaine de mille hommes, et portée à plus de soixante mille. Elle était reposée et réorganisée; et quoique renfermant quelques recrues, elle se composait en majeure partie de troupes aguerries. Le bataillon des volontaires de Vienne était formé de jeunes gens, étrangers, il est vrai, à la guerre, mais appartenant à de bonnes familles, animés de sentiments élevés, très dévoués à la maison impériale, et prêts à déployer la plus grande bravoure.
Les ministres autrichiens s'étaient entendus avec le pape, et l'avaient engagé à résister aux menaces de Bonaparte. Ils lui avaient envoyé Colli et quelques officiers pour commander son armée, en lui recommandant de la porter le plus près possible de Bologne et de Mantoue. Ils avaient annoncé à Wurmser un prochain secours, avec ordre de ne pas se rendre, et s'il était réduit à l'extrémité, de sortir de Mantoue avec tout ce qu'il aurait de troupes, et surtout d'officiers, de se jeter à travers le Bolonais et le Ferrarais dans les états romains, pour se réunir à l'armée papale, qu'il organiserait et porterait sur les derrières de Bonaparte. Ce plan, fort bien conçu, pouvait réussir avec un général aussi brave que Wurmser. Ce vieux maréchal tenait toujours dans Mantoue avec une grande fermeté, quoique sa garnison n'eût plus à manger que de la viande de cheval salée et de la poulenta.
Bonaparte s'attendait à cette dernière lutte, qui allait décider pour jamais du sort de l'Italie, et il s'y préparait. Comme le répandaient à Paris les malveillans qui souhaitaient l'humiliation de nos armes, il était malade d'une gale mal traitée, et prise devant Toulon en chargeant un canon de ses propres mains. Cette maladie, mal connue, jointe aux fatigues inouïes de cette campagne, l'avait singulièrement affaibli. Il pouvait à peine se tenir à cheval; ses joues étaient caves et livides; sa personne paraissait chétive; ses yeux seuls, toujours aussi vifs et aussi perçants, annonçaient que le feu de son ame n'était pas éteint. Ses proportions physiques formaient même avec son génie et sa renommée un contraste singulier et piquant pour des soldats à la fois gais et enthousiastes. Malgré le délabrement de ses forces, ses passions extraordinaires le soutenaient, et lui communiquaient une activité qui se portait sur tous les objets à la fois. Il avait commencé ce qu'il appelait la guerre aux voleurs. Les intrigans de toute espèce étaient accourus en Italie, pour s'introduire dans l'administration des armées, et y profiter de la richesse de cette belle contrée. Tandis que la simplicité et l'indigence régnaient dans les armées du Rhin, le luxe s'était introduit dans celle d'Italie; il y était aussi grand que la gloire. Les soldats, bien vêtus, bien nourris, bien accueillis par les belles Italiennes, y vivaient dans les plaisirs et l'abondance. Les officiers, les généraux participaient à l'opulence générale, et commençaient leur fortune. Quant aux fournisseurs, ils déployaient un faste scandaleux, et ils achetaient avec le prix de leurs exactions les faveurs des plus belles actrices de l'Italie. Bonaparte, qui avait en lui toutes les passions, mais qui, dans le moment, était livré à une seule, la gloire, vivait d'une manière simple et sévère, ne cherchait de délassement qu'auprès de sa femme, qu'il aimait avec tendresse, et qu'il avait fait venir à son quartier-général. Indigné des désordres de l'administration, il portait un regard sévère sur les moindres détails, vérifiait lui-même la gestion des compagnies, faisait poursuivre les administrateurs infidèles, et les dénonçait impitoyablement. Il leur reprochait surtout de manquer de courage, et d'abandonner l'armée les jours de péril. Il recommandait au directoire de choisir des hommes d'une énergie éprouvée; il voulait l'institution d'un syndicat, qui jugeant comme un jury, pût, sur sa simple conviction, punir des délits qui n'étaient jamais prouvables matériellement. Il pardonnait volontiers à ses soldats et à ses généraux des jouissances qui n'étaient pas pour eux les délices de Capoue; mais il avait une haine implacable pour tous ceux qui s'enrichissaient aux dépens de l'armée, sans la servir de leurs exploits ou de leurs soins.
Il avait apporté la même attention et la même activité dans ses relations avec les puissances italiennes. Dissimulant toujours avec Venise, dont il voyait les armemens dans les lagunes et les montagnes du Bergamasque, il différa toute explication jusqu'après la reddition de Mantoue. Provisoirement il fit occuper par ses troupes le château de Bergame, qui avait garnison vénitienne, et donna pour raison qu'il ne le croyait pas assez bien gardé pour résister à un coup de main des Autrichiens. Il se mit ainsi à l'abri d'une perfidie, et imposa aux nombreux ennemis qu'il avait dans Bergame. Dans la Lombardie et la Cispadane, il continua à favoriser l'esprit de liberté, réprimant le parti autrichien et papal, et modérant le parti démocratique, qui, dans tous les pays, a besoin d'être contenu. Il se maintint en amitié avec le roi de Piémont et le duc de Parme. Il se transporta de sa personne à Bologne, pour terminer une négociation avec le duc de Toscane, et imposer à la cour de Rome. Le duc de Toscane était incommodé par la présence des Français à Livourne; de vives discussions s'étaient élevées avec le commerce livournais sur les marchandises appartenant aux négocians ennemis de la France. Ces contestations produisaient beaucoup d'animosité; d'ailleurs les marchandises, qu'on arrachait avec peine, étaient ensuite mal vendues, et par une compagnie qui venait de voler cinq à six millions à l'armée. Bonaparte aima mieux transiger avec le grand-duc. Il fut convenu que, moyennant deux millions, il évacuerait Livourne. Il y trouva de plus l'avantage de rendre disponible la garnison de cette ville. Son projet était de prendre les deux légions formées par la Cispadane, de les réunir à la garnison de Livourne, d'y ajouter trois mille hommes de ses troupes, et d'acheminer cette petite armée vers la Romagne, et la Marche d'Ancône. Il voulait s'emparer encore de deux provinces de l'état romain, y mettre la main sur les propriétés du pape, y arrêter les impôts, se payer par ce moyen de la contribution qui n'avait pas été acquittée, prendre des otages choisis dans le parti ennemi de la France, et établir ainsi une barrière entre les états de l'Église et Mantoue. Par là, il rendait impossible le projet de jonction entre Wurmser et l'armée papale; il pouvait imposer au pape, et l'obliger enfin à se soumettre aux conditions de la république. Dans son humeur contre le Saint-Siége, il ne songeait même plus à lui pardonner, et voulait faire une division toute nouvelle de l'Italie. On aurait rendu la Lombardie à l'Autriche; on aurait composé une république puissante, en ajoutant au Modénois, au Boulonnais et au Ferrarais, la Romagne, la Marche d'Ancône, le duché de Parme, et on aurait donné Rome au duc de Parme, ce qui aurait fait grand plaisir à l'Espagne, et aurait compromis la plus catholique de toutes les puissances. Déjà il avait commencé à exécuter son projet; il s'était porté à Bologne avec trois mille hommes de troupes, et de là il menaçait le Saint-Siége, qui avait déjà formé un noyau d'armée. Mais le pape, certain maintenant d'une nouvelle expédition autrichienne, espérant communiquer par le Bas-Pô avec Wurmser, bravait les menaces du général français, et témoignait même le désir de le voir s'avancer encore davantage dans ses provinces. Le saint-père, disait-on au Vatican, quittera Rome, s'il le faut, pour se réfugier à l'extrémité de ses états. Plus Bonaparte s'avancera, et s'éloignera de l'Adige, plus il se mettra en danger, et plus les chances deviendront favorables à la cause sainte. Bonaparte, qui était tout aussi prévoyant que le Vatican, n'avait garde de marcher sur Rome; il ne voulait que menacer, et il avait toujours l'oeil sur l'Adige, s'attendant à chaque instant à une nouvelle attaque. Le 19 nivôse (8 janvier 1797), en effet, il apprit qu'un engagement avait eu lieu sur tous ses avant-postes; il repassa le Pô sur-le-champ avec deux mille hommes, et courut de sa personne à Vérone.
Son armée avait reçu depuis Arcole les renforts qu'elle aurait dû recevoir avant cette bataille. Ses malades étaient sortis des hôpitaux avec l'hiver; il avait environ quarante-cinq mille hommes présens sous les armes. Leur distribution était toujours la même. Dix mille hommes à peu près bloquaient Mantoue sous Serrurier; trente mille étaient en observation sur l'Adige. Augereau gardait Legnago, Masséna Vérone; Joubert, qui avait succédé à Vaubois, gardait Rivoli et la Corona. Rey, avec une division de réserve, était à Dezenzano, au bord du lac de Garda. Les quatre à cinq mille hommes restans étaient, soit dans les châteaux de Bergame et de Milan, soit dans la Cispadane. Les Autrichiens s'avançaient avec soixante et quelques mille hommes, et en avaient vingt dans Mantoue, dont douze mille au moins sous les armes. Ainsi, dans cette lutte, comme dans les précédentes, la proportion de l'ennemi était du double. Les Autrichiens avaient cette fois un nouveau projet. Ils avaient essayé de toutes les routes pour attaquer la double ligne du Mincio et de l'Adige. Lors de Castiglione, ils étaient descendus le long des deux rives du lac de Garda, par les deux vallées de la Chiesa et de l'Adige. Plus tard, ils avaient débouché par la vallée de l'Adige et par celle de la Brenta, attaquant par Rivoli et Vérone. Maintenant ils avaient modifié leur plan conformément à leurs projets avec le pape. L'attaque principale devait se faire par le Haut-Adige, avec quarante-cinq mille hommes sous les ordres d'Alvinzy. Une attaque accessoire, et indépendante de la première, devait se faire avec vingt mille hommes à peu près, sous les ordres de Provera, par le Bas-Adige, dans le but de communiquer avec Mantoue, avec la Romagne, avec l'armée du pape.
L'attaque d'Alvinzy était la principale; elle était assez forte pour faire espérer un succès sur ce point, et elle devait être poussée sans aucune considération de ce qui arriverait à Provera. Nous avons décrit ailleurs les trois routes qui sortent des montagnes du Tyrol. Celle qui tournait derrière le lac de Garda avait été négligée depuis l'affaire de Castiglione; on suivait maintenant les deux autres. L'une circulant entre l'Adige et le lac de Garda, passait à travers les montagnes qui séparent le lac du fleuve, et y rencontrait la position de Rivoli; l'autre longeait extérieurement le fleuve, et allait déboucher dans la plaine de Vérone, en dehors de la ligne française. Alvinzy choisit celle qui passait entre le fleuve et le lac, et qui pénétrait dans la ligne française. C'est donc sur Rivoli que devaient se diriger ses coups. Voici quelle est cette position à jamais célèbre. La chaîne du Monte-Baldo sépare le lac de Garda et l'Adige. La grande route circule entre l'Adige et le pied des montagnes, dans l'étendue de quelques lieues. A Incanale, l'Adige vient baigner le pied même des montagnes, et ne laisse plus de place pour longer sa rive. La route alors abandonne les bords du fleuve, s'élève par une espèce d'escalier tournant dans les flancs de la montagne, et débouche sur un vaste plateau, qui est celui de Rivoli. Il domine l'Adige d'un côté, et de l'autre il est entouré par l'amphithéâtre du Monte-Baldo. L'armée qui est en position sur ce plateau menace le chemin tournant par lequel on y monte, et balaie au loin de son feu les deux rives de l'Adige. Ce plateau est difficile à emporter de front, puisqu'il faut gravir un escalier étroit pour y arriver. Aussi ne cherche-t-on pas à l'attaquer par cette seule voie. Avant de parvenir à Incanale, d'autres routes conduisent sur le Monte-Baldo, et, gravissant ses croupes escarpées, viennent aboutir au plateau de Rivoli. Elles ne sont praticables ni à la cavalerie ni à l'artillerie, mais elles donnent un facile accès aux troupes à pied, et peuvent servir à porter des forces considérables d'infanterie sur les flancs et les derrières du corps qui défend le plateau. Le plan d'Alvinzy était d'attaquer la position par toutes les issues à la fois.
Le 23 nivôse (12 janvier), il attaqua Joubert, qui tenait toutes les positions avancées, et le resserra sur Rivoli. Le même jour Provera poussait deux avant-gardes, l'une sur Vérone, l'autre sur Legnago, par Caldiero et Bevilaqua. Masséna, qui était à Vérone, en sortit, culbuta l'avant-garde qui s'était présentée à lui, et fit neuf cents prisonniers. Bonaparte y arrivait de Bologne dans le moment même. Il fit replier toute la division dans Vérone pour la tenir prête à marcher. Dans la nuit, il apprit que Joubert était attaqué et forcé à Rivoli, qu'Augereau avait vu, devant Legnago, des forces considérables. Il ne pouvait pas juger encore le point sur lequel l'ennemi dirigeait sa principale masse. Il tint toujours la division Masséna prête à marcher, et ordonna à la division Rey, qui était à Dezenzano, et qui n'avait vu déboucher aucun ennemi par derrière le lac de Garda, de se porter à Castel-Novo, point le plus central entre le Haut et le Bas-Adige. Le lendemain 24 (13 janvier), les courriers se succédèrent avec rapidité. Bonaparte apprit que Joubert, attaqué par des forces immenses, allait être enveloppé, et qu'il devait à l'opiniâtreté et au bonheur de sa résistance, de conserver encore le plateau de Rivoli. Augereau lui mandait du Bas-Adige, qu'on se fusillait le long des deux rives, sans qu'il se passât aucun événement important. Bonaparte n'avait guère devant lui à Vérone que deux mille Autrichiens. Dès cet instant, il devina le projet de l'ennemi, et vit bien que l'attaque principale se dirigeait sur Rivoli. Il pensait qu'Augereau suffisait pour défendre le Bas-Adige; il le renforça d'un corps de cavalerie, détaché de la division Masséna. Il ordonna à Serrurier, qui bloquait Mantoue, de porter sa réserve à Villa-Franca, pour qu'elle fût placée intermédiairement à tous les points. Il laissa à Vérone un régiment d'infanterie et un de cavalerie; et il partit, dans la nuit du 24 au 25 (13 à 14 janvier), avec les dix-huitième, trente-deuxième, soixante-quinzième demi-brigades de la division Masséna, et deux escadrons de cavalerie. Il manda à Rey de ne pas s'arrêter à Castel-Novo, et de monter tout de suite sur Rivoli. Il devança ses divisions, et arriva de sa personne à Rivoli à deux heures du matin. Le temps, qui était pluvieux les jours précédens, s'était éclairci. Le ciel était pur, le clair de lune éclatant, le froid vif. En arrivant, Bonaparte vit l'horizon embrasé des feux de l'ennemi. Il lui supposa quarante-cinq mille hommes; Joubert en avait dix mille au plus: il était temps qu'un secours arrivât. L'ennemi s'était partagé en plusieurs corps. Le principal, composé d'une grosse colonne de grenadiers, de toute la cavalerie, de toute l'artillerie, des bagages, suivait sous Quasdanovich la grande route, entre le fleuve et le Monte-Baldo, et devait déboucher par l'escalier d'Incanale. Trois autres corps, sous les ordres d'Ocskay, de Koblos et de Liptai, composés d'infanterie seulement, avaient gravi les croupes des montagnes, et devaient arriver sur le champ de bataille en descendant les degrés de l'amphithéâtre que le Monte-Baldo forme autour du plateau de Rivoli. Un quatrième corps, sous les ordres de Lusignan, circulant sur le côté du plateau, devait venir se placer sur les derrières de l'armée française, pour la couper de la route de Vérone. Alvinzy avait enfin détaché un sixième corps, qui, par sa position, était tout à fait en dehors de l'opération. Il marchait de l'autre côté de l'Adige, et suivait la route qui, par Roveredo, Dolce et Vérone, longe le fleuve extérieurement. Ce corps, commandé par Wukassovich, pouvait tout au plus envoyer quelques boulets sur le champ de bataille, en tirant d'une rive à l'autre.
Bonaparte sentit sur-le-champ qu'il fallait garder le plateau à tout prix. Il avait en face l'infanterie autrichienne, descendant l'amphithéâtre, sans une seule pièce de canon; il avait à sa droite les grenadiers, l'artillerie, la cavalerie, longeant la route du fleuve, et venant déboucher par l'escalier d'Incanale sur son flanc droit. A sa gauche, Lusignan tournait Rivoli. Les boulets de Wukassovich, lancés de l'autre rive de l'Adige, arrivaient sur sa tête. Placé sur le plateau, il empêchait la jonction des différentes armes, il foudroyait l'infanterie privée de ses canons; il refoulait la cavalerie et l'artillerie, engagées dans un chemin étroit et tournant. Peu lui importait alors que Lusignan fît effort pour le tourner, et que Wukassovich lui lançât quelques boulets.
Son plan arrêté avec sa promptitude accoutumée, il commença l'opération avant le jour. Joubert avait été obligé de se resserrer pour n'occuper qu'une étendue proportionnée à ses forces; et il était à craindre que l'infanterie, descendant les degrés du Monte-Baldo, ne vînt faire sa jonction avec la tête de la colonne gravissant par Incanale. Bonaparte, bien avant le jour, donna l'éveil aux troupes de Joubert, qui, après quarante-huit heures de combat, prenaient un peu de repos. Il fit attaquer les postes avancés de l'infanterie autrichienne, les replia, et s'étendit plus largement sur le plateau.
L'action devint extrêmement vive. L'infanterie autrichienne, sans canons, plia devant la nôtre, qui était armée de sa formidable artillerie, et recula en demi-cercle vers l'amphithéâtre du Monte-Baldo. Mais un événement fâcheux arrive dans l'instant à notre gauche. Le corps de Liptai, qui tenait l'extrémité du demi-cercle ennemi, donne sur la gauche de Joubert, composée des quatre-vingt-neuvième et vingt-cinquième demi-brigades, les surprend, les rompt, et les oblige à se retirer en désordre. La quatorzième, venant immédiatement après ces deux demi-brigades, se forme en crochet pour couvrir le reste de la ligne, et résiste avec un admirable courage. Les Autrichiens se réunissent contre elle, et sont près de l'accabler. Ils veulent surtout lui enlever ses canons, dont les chevaux ont été tués. Déjà ils arrivent sur les pièces, lorsqu'un officier s'écrie: «Grenadiers de la quatorzième, laisserez-vous enlever vos pièces?» Sur-le-champ cinquante hommes s'élancent à la suite du brave officier, repoussent les Autrichiens, s'attellent aux pièces, et les ramènent.
Bonaparte, voyant le danger, laisse Berthier sur le point menacé, et part au galop pour Rivoli, afin d'aller chercher du secours. Les premières troupes de Masséna arrivaient à peine, après avoir marché toute la nuit. Bonaparte se saisit de la trente-deuxième, devenue fameuse par ses exploits durant la campagne, et la porte à la gauche, pour rallier les deux demi-brigades qui avaient plié. L'intrépide Masséna s'avance à sa tête, rallie derrière lui les troupes rompues, et renverse tout ce qui se présente à sa rencontre. Il repousse les Autrichiens, et vient se placer à côté de la quatorzième, qui n'avait cessé de faire des prodiges de valeur. Le combat se trouve ainsi rétabli sur ce point, et l'armée occupe le demi-cercle du plateau. Mais l'échec momentané de la gauche avait obligé Joubert à se replier avec la droite; il cédait du terrain, et déjà l'infanterie autrichienne se rapprochait une seconde fois du point que Bonaparte avait mis tant d'intérêt à lui faire abandonner; elle allait joindre le débouché par lequel le chemin tournant d'Incanale aboutissait sur le plateau. Dans ce même instant, la colonne composée d'artillerie et de cavalerie, et précédée de plusieurs bataillons de grenadiers, gravissait le chemin tournant, et, avec des efforts incroyables de bravoure, en repoussait la trente-neuvième. Wukassovich, de l'autre rive de l'Adige, lançait une grêle de boulets pour protéger cette espèce d'escalade. Déjà les grenadiers avaient gravi le sommet du défilé, et la cavalerie débouchait à leur suite sur le plateau. Ce n'était pas tout: la colonne de Lusignan, dont on avait vu au loin les feux, et qu'on avait aperçue à la gauche tournant la position des Français, venait se mettre sur leurs derrières, intercepter la route de Vérone, et barrer le chemin à Rey, qui arrivait de Castel-Novo avec la division de réserve. Déjà les soldats de Lusignan, se voyant sur les derrières de l'armée française, battaient des mains, et la croyaient prise. Ainsi sur ce plateau, serré de front par un demi-cercle d'infanterie, tourné à gauche par une forte colonne, escaladé à droite par le gros de l'armée autrichienne, et labouré par les boulets qui portaient de la rive opposée de l'Adige sur ce plateau, Bonaparte était isolé avec les seules divisions Joubert et Masséna, au milieu d'une nuée d'ennemis. Il était avec seize mille hommes enveloppé par quarante au moins.
Dans ce moment si redoutable, il n'est pas ébranlé. Il conserve toute la chaleur et toute la promptitude de l'inspiration. En voyant les Autrichiens de Lusignan, il dit: Ceux-là sont à nous, et il les laisse s'engager sans s'inquiéter de leur mouvement. Les soldats, devinant leur général, partagent sa confiance, et se disent aussi: Ils sont à nous.
Dans cet instant, Bonaparte ne s'occupe que de ce qui se passe devant lui. Sa gauche est couverte par l'héroïsme de la quatorzième et de la trente-deuxième; sa droite est menacée à la fois par l'infanterie qui a repris l'offensive, et par la colonne qui escalade le plateau. Il ordonne sur-le-champ des mouvemens décisifs. Une batterie d'artillerie légère, deux escadrons, sous deux braves officiers, Leclerc et Lasalle, sont dirigés sur le débouché envahi. Joubert, qui, avec l'extrême droite, avait ce débouché à dos, fait volte-face avec un corps d'infanterie légère. Tous chargent à la fois. L'artillerie mitraille d'abord tout ce qui a débouché; la cavalerie et l'infanterie légère chargent ensuite avec vigueur. Joubert a son cheval tué; il se relève plus terrible, et s'élance sur l'ennemi un fusil à la main. Tout ce qui a débouché, grenadiers, cavalerie, artillerie, tout est précipité pêle-mêle dans l'escalier tournant d'Incanale. Un désordre horrible s'y répand; quelques pièces, plongeant dans le défilé, y augmentent l'épouvante et la confusion. A chaque pas on tue, on fait des prisonniers. Après avoir délivré le plateau des assaillans qui l'avaient escaladé, Bonaparte reporte ses coups sur l'infanterie, qui était rangée en demi-cercle devant lui, et jette sur elle Joubert avec l'infanterie légère, Lasalle avec deux cents hussards. A cette nouvelle attaque, l'épouvante se répand dans cette infanterie, privée maintenant de tout espoir de jonction; elle fuit en désordre. Alors toute notre ligne demi-circulaire s'ébranle de la droite à la gauche, jette les Autrichiens contre l'amphithéâtre du Monte-Baldo, et les poursuit à outrance dans les montagnes. Bonaparte se reporte ensuite sur ses derrières, et vient réaliser sa prédiction sur le corps de Lusignan. Ce corps, en voyant les désastres de l'armée autrichienne, s'aperçoit bientôt de son sort. Bonaparte, après l'avoir mitraillé, ordonne à la dix-huitième et à la soixante-quinzième demi-brigade de le charger. Ces braves demi-brigades s'ébranlent en entonnant le Chant du départ, et poussent Lusignan sur la route de Vérone, par laquelle arrivait Rey avec la division de réserve. Le corps autrichien résiste d'abord, puis se retire, et vient donner contre la tête de la division Rey. Epouvanté à cette vue, il invoque la clémence du vainqueur, et met bas les armes, au nombre de quatre mille soldats. On en avait pris déjà deux mille dans le défilé de l'Adige.
Il était cinq heures, et on peut dire que l'armée autrichienne était anéantie. Lusignan était pris; l'infanterie, qui était venue par les montagnes, fuyait à travers des rochers affreux; la colonne principale était engouffrée sur le bord du fleuve; le corps accessoire de Wukassovich assistait inutilement à ce désastre, séparé par l'Adige du champ de bataille. Cette admirable victoire n'étourdit point la pensée de Bonaparte; il songe au Bas-Adige qu'il a laissé menacé; il juge que Joubert, avec sa brave division, et Rey avec la division de réserve, suffiront pour porter les derniers coups à l'ennemi, et pour lui enlever des milliers de prisonniers. Il rallie la division Masséna, qui s'était battue le jour précédent à Vérone, qui avait ensuite marché toute la nuit, s'était battue tout le jour du 25 (14), et il part avec elle pour marcher encore toute la nuit qui va suivre, et voler à de nouveaux combats. Ces braves soldats, le visage joyeux, et comptant sur de nouvelles victoires, semblent ne pas sentir les fatigues. Ils volent plutôt qu'ils ne marchent pour aller couvrir Mantoue, dont quatorze lieues les séparent.
Bonaparte apprend en route ce qui s'est passé sur le Bas-Adige. Provera, se dérobant à Augereau, a jeté un pont à Anghuiari, un peu au-dessus de Legnago: il a laissé Hoënzolern au-delà de l'Adige, et a marché sur Mantoue avec neuf ou dix mille hommes. Augereau, averti trop tard, s'est jeté cependant à sa suite, l'a pris en queue, et lui a fait deux mille prisonniers. Mais avec sept à huit mille soldats, Provera marche sur Mantoue pour se joindre à la garnison. Bonaparte apprend ces détails à Castel-Novo. Il craint que la garnison avertie ne sorte pour donner la main au corps qui arrive, et ne prenne le corps de blocus entre deux feux. Il a marché toute la nuit du 25 au 26 (14-15) avec la division Masséna; il la fait marcher encore tout le jour du 26 (15), pour qu'elle arrive le soir devant Mantoue. Il y dirige en outre les réserves qu'il avait laissées intermédiairement à Villa-Franca, et y vole de sa personne pour y faire ses dispositions.
Ce jour même du 26 (15), Provera était arrivé devant Mantoue. Il se présente au faubourg de Saint-George, dans lequel était placé Miollis avec tout au plus quinze cents hommes. Provera le somme de se rendre. Le brave Miollis lui répond à coups de canon. Provera repoussé se porte du côté de la citadelle, espérant une sortie de Wurmser; mais il trouve Serrurier devant lui. Il s'arrête au palais de la Favorite, entre Saint-George et la citadelle, et lance une barque à travers le lac, pour faire dire à Wurmser de déboucher de la place le lendemain matin. Bonaparte arrive dans la soirée, dispose Augereau sur les derrières de Provera, Victor et Masséna sur ses flancs, de manière à le séparer de la citadelle par laquelle Wurmser doit essayer de déboucher. Il oppose Serrurier à Wurmser. Le lendemain 27 nivôse (16 janvier) à la pointe du jour, la bataille s'engage. Wurmser débouche de la place, et attaque Serrurier avec furie; celui-ci lui résiste avec une bravoure égale, et le contient le long des lignes de circonvallation. Victor, à la tête de la cinquante-septième, qui dans ce jour reçut le nom de la Terrible, s'élance sur Provera, et renverse tout ce qui se présente devant lui. Après un combat opiniâtre, Wurmser est rejeté dans Mantoue. Provera, traqué comme un cerf, enveloppé par Victor, Masséna, Augereau, inquiété par une sortie de Miollis, met bas les armes avec six mille hommes. Les jeunes volontaires de Vienne en font partie. Après une défense honorable, ils rendent leurs armes, et le drapeau brodé par les mains de l'impératrice.
Tel fut le dernier acte de cette immortelle opération, jugée par les militaires une des plus belles et des plus extraordinaires dont l'histoire fasse mention. On apprit que Joubert, poursuivant Alvinzy, lui avait enlevé encore sept mille prisonniers. On en avait pris six le jour même de la bataille de Rivoli, ce qui faisait treize; Augereau en avait fait deux mille; Provera en livrait six mille; on en avait recueilli mille devant Vérone, et encore quelques centaines ailleurs, ce qui portait le nombre, en trois jours, à vingt-deux ou vingt-trois mille. La division Masséna avait marché et combattu sans relâche, depuis quatre journées, marchant la nuit, combattant le jour. Aussi Bonaparte écrivait-il avec orgueil que ses soldats avaient surpassé la rapidité tant vantée des légions de César. On comprend pourquoi il attacha plus tard au nom de Masséna celui de Rivoli. L'action du 25 (14 janvier) s'appela bataille de Rivoli, celle du 27 (16), devant Mantoue, s'appela de la Favorite.
Ainsi, en trois jours encore, Bonaparte avait pris ou tué une moitié de l'armée ennemie, et l'avait comme frappée d'un coup de foudre. L'Autriche avait fait son dernier effort, et maintenant l'Italie était à nous. Wurmser, rejeté dans Mantoue, était sans espoir; il avait mangé tous ses chevaux, et les maladies se joignaient à la famine pour détruire sa garnison. Une plus longue résistance eût été inutile et contraire à l'humanité. Le vieux maréchal avait fait preuve d'un noble courage et d'une rare opiniâtreté, il pouvait songer à se rendre. Il envoya un de ses officiers à Serrurier pour parlementer; c'était Klenau. Serrurier en référa au général en chef, qui se rendit à la conférence. Bonaparte, enveloppé dans son manteau, et ne se faisant pas connaître, écouta les pourparlers entre Klenau et Serrurier. L'officier autrichien dissertait longuement sur les ressources qui restaient à son général, et assurait qu'il avait encore pour trois mois de vivres. Bonaparte, toujours enveloppé, s'approche de la table auprès de laquelle avait lieu cette conférence, saisit le papier sur lequel étaient écrites les propositions de Wurmser, et se met à tracer quelques lignes sur les marges, sans mot dire, et au grand étonnement de Klenau, qui ne comprenait pas l'action de l'inconnu. Puis, se levant et se découvrant, Bonaparte s'approche de Klenau: «Tenez, lui dit-il, voilà les conditions que j'accorde à votre maréchal. S'il avait seulement pour quinze jours de vivres, et qu'il parlât de se rendre, il ne mériterait aucune capitulation honorable. Puisqu'il vous envoie, c'est qu'il est réduit à l'extrémité. Je respecte son âge, sa bravoure et ses malheurs. Portez-lui les conditions que je lui accorde; qu'il sorte de la place demain, dans un mois ou dans six, il n'aura des conditions ni meilleures, ni pires. Il peut rester tant qu'il conviendra à son honneur.»
A ce langage, à ce ton, Klenau reconnut l'illustre capitaine, et courut porter à Wurmser les conditions qu'il lui avait faites. Le vieux maréchal fut plein de reconnaissance, en voyant la générosité dont usait envers lui son jeune adversaire. Il lui accordait la permission de sortir librement de la place avec tout son état-major; il lui accordait même deux cents cavaliers, cinq cents hommes à son choix, et six pièces de canon, pour que sa sortie fût moins humiliante. La garnison dut être conduite à Trieste, pour y être échangée contre des prisonniers français. Wurmser se hâta d'accepter ces conditions; et pour témoigner sa gratitude au général français, il l'instruisit d'un projet d'empoisonnement tramé contre lui dans les États du pape. Il dut sortir de Mantoue le 14 pluviôse (2 février). Sa consolation, en quittant Mantoue, était de remettre son épée au vainqueur lui-même; mais il ne trouva que le brave Serrurier, devant lequel il fut obligé de défiler avec tout son état-major; Bonaparte était déjà parti pour la Romagne, pour aller châtier le pape et punir le Vatican. Sa vanité, aussi profonde que son génie, avait calculé autrement que les vanités vulgaires; il aimait mieux être absent que présent sur le lieu du triomphe.
Mantoue rendue, l'Italie était définitivement conquise, et cette campagne terminée.
Quand on en considère l'ensemble, l'imagination est saisie par la multitude des batailles, la fécondité des conceptions et l'immensité des résultats. Entré en Italie avec trente et quelques mille hommes, Bonaparte sépare d'abord les Piémontais des Autrichiens à Montenotte et Millesimo, achève de détruire les premiers à Mondovi, puis court après les seconds, passe devant eux le Pô à Plaisance, l'Adda à Lodi, s'empare de la Lombardie, s'y arrête un instant, se remet bientôt en marche, trouve les Autrichiens renforcés sur le Mincio, et achève de les détruire à la bataille de Borghetto. Là, il saisit d'un coup d'oeil le plan de ses opérations futures: c'est sur l'Adige qu'il doit s'établir, pour faire front aux Autrichiens; quant aux princes qui sont sur ses derrières, il se contentera de les contenir par des négociations et des menaces. On lui envoie une seconde armée sous Wurmser; il ne peut la battre qu'en se concentrant rapidement, et en frappant alternativement chacune de ses masses isolées en homme résolu, il sacrifie le blocus de Mantoue, écrase Wurmser à Lonato, Castiglione, et le rejette dans le Tyrol. Wurmser est renforcé de nouveau, comme l'avait été Beaulieu; Bonaparte le prévient dans le Tyrol, remonte l'Adige, culbute tout devant lui à Roveredo, se jette à travers la vallée de la Brenta, coupe Wurmser qui croyait le couper lui-même, le terrasse à Bassano, et l'enferme dans Mantoue. C'est la seconde armée autrichienne détruite après avoir été renforcée.
Bonaparte, toujours négociant, menaçant des bords de l'Adige, attend la troisième armée. Elle est formidable, elle arrive avant qu'il ait reçu des renforts, il est forcé de céder devant elle; il est réduit au désespoir, il va succomber, lorsqu'il trouve, au milieu d'un marais impraticable, deux lignes débouchant dans les flancs de l'ennemi, et s'y jette avec une incroyable audace. Il est vainqueur encore à Arcole. Mais l'ennemi est arrêté, et n'est pas détruit; il revient une dernière fois, et plus puissant que les premières. D'une part, il descend des montagnes; de l'autre, il longe le Bas-Adige. Bonaparte découvre le seul point où les colonnes autrichiennes, circulant dans un pays montagneux, peuvent se réunir, s'élance sur le célèbre plateau de Rivoli, et, de ce plateau, foudroie la principale armée d'Alvinzy; puis, reprenant son vol vers le Bas-Adige, enveloppe tout entière la colonne qui l'avait franchi. Sa dernière opération est la plus belle, car ici, le bonheur est uni au génie. Ainsi, en dix mois, outre l'armée piémontaise, trois armées formidables, trois fois renforcées, avaient été détruites par une armée qui, forte de trente et quelques mille hommes à l'entrée de la campagne n'en avait guère reçu que vingt pour réparer ses pertes. Ainsi, cinquante-cinq mille Français avaient battu plus de deux cent mille Autrichiens, en avaient pris plus de quatre-vingt mille, tué ou blessé plus de vingt mille; ils avaient livré douze batailles rangées, plus de soixante combats, passé plusieurs fleuves, en bravant les flots et les feux ennemis. Quand la guerre est une routine purement mécanique, consistant à pousser et à tuer l'ennemi qu'on a devant soi, elle est peu digne de l'histoire; mais quand une de ces rencontres se présente, où l'on voit une masse d'hommes mue par une seule et vaste pensée, qui se développe au milieu des éclats de la foudre avec autant de netteté que celle d'un Newton ou d'un Descartes dans le silence du cabinet, alors le spectacle est digne du philosophe, autant que de l'homme d'état et du militaire: et, si cette identification de la multitude avec un seul individu, qui produit la force à son plus haut degré, sert à protéger, à défendre une noble cause, celle de la liberté, alors la scène devient aussi morale qu'elle est grande.
Bonaparte courait maintenant à de nouveaux projets; il se dirigeait vers Rome, pour terminer les tracasseries de cette cour de prêtres, et pour revenir, non plus sur l'Adige, mais sur Vienne. Il avait, par ses succès, ramené la guerre sur son véritable théâtre, celui de l'Italie, d'où l'on pouvait fondre sur les états héréditaires de l'empereur. Le gouvernement, éclairé par ses exploits, lui envoyait des renforts, avec lesquels il pouvait aller à Vienne dicter une paix glorieuse, au nom de la république française. La fin de la campagne avait relevé toutes les espérances que son commencement avait fait naître.
Les triomphes de Rivoli mirent le comble à la joie des patriotes. On parlait de tous côtés de ces vingt-deux mille prisonniers, et on citait le témoignage des autorités de Milan, qui les avaient passés en revue, et qui en avaient certifié le nombre, pour répondre à tous les doutes de la malveillance. La reddition de Mantoue vint mettre le comble à la satisfaction. Dès cet instant, on crut la conquête de l'Italie définitive. Le courrier qui portait ces nouvelles arriva le soir à Paris. On assembla sur-le-champ la garnison, et on les publia à la lueur des torches, au son des fanfares, au milieu des cris de joie de tous les Français attachés à leur pays. Jours à jamais célèbres et à jamais regrettables pour nous! A quelle époque notre patrie fut-elle plus belle et plus grande? Les orages de la révolution paraissaient calmés; les murmures des partis retentissaient comme les derniers bruits de la tempête. On regardait ces restes d'agitation comme la vie d'un état libre. Le commerce et les finances sortaient d'une crise épouvantable; le sol entier, restitué à des mains industrielles, allait être fécondé. Un gouvernement composé de bourgeois, nos égaux, régissait la république avec modération; les meilleurs étaient appelés à leur succéder. Toutes les voies étaient libres. La France, au comble de la puissance, était maîtresse de tout le sol qui s'étend du Rhin aux Pyrénées, de la mer aux Alpes. La Hollande, l'Espagne, allaient unir leurs vaisseaux aux siens, et attaquer de concert le despotisme maritime. Elle était resplendissante d'une gloire immortelle. D'admirables armées faisaient flotter ses trois couleurs à la face des rois qui avaient voulu l'anéantir. Vingt héros, divers de caractère et de talent, pareils seulement par l'âge et le courage, conduisaient ses soldats à la victoire. Hoche, Kléber, Desaix, Moreau, Joubert, Masséna, Bonaparte, et une foule d'autres encore s'avançaient ensemble. On pesait leurs mérites divers; mais aucun oeil encore, si perçant qu'il pût être, ne voyait dans cette génération de héros les malheureux ou les coupables; aucun oeil ne voyait celui qui allait expirer à la fleur de l'âge, atteint d'un mal inconnu, celui qui mourrait sous le poignard musulman, ou sous le feu ennemi, celui qui opprimerait la liberté, purs, heureux, pleins d'avenir! Ce ne fut là qu'un moment; mais il n'y a que des momens dans la vie des peuples, comme dans celle des individus. Nous allions retrouver l'opulence avec le repos; quant à la liberté et à la gloire, nous les avions!… «Il faut, a dit un ancien, que la patrie soit non seulement heureuse, mais suffisamment glorieuse.» Ce voeu était accompli. Français, qui avons vu depuis notre liberté étouffée, notre patrie envahie, nos héros fusillés ou infidèles à leur gloire, n'oublions jamais ces jours immortels de liberté, de grandeur et d'espérance!