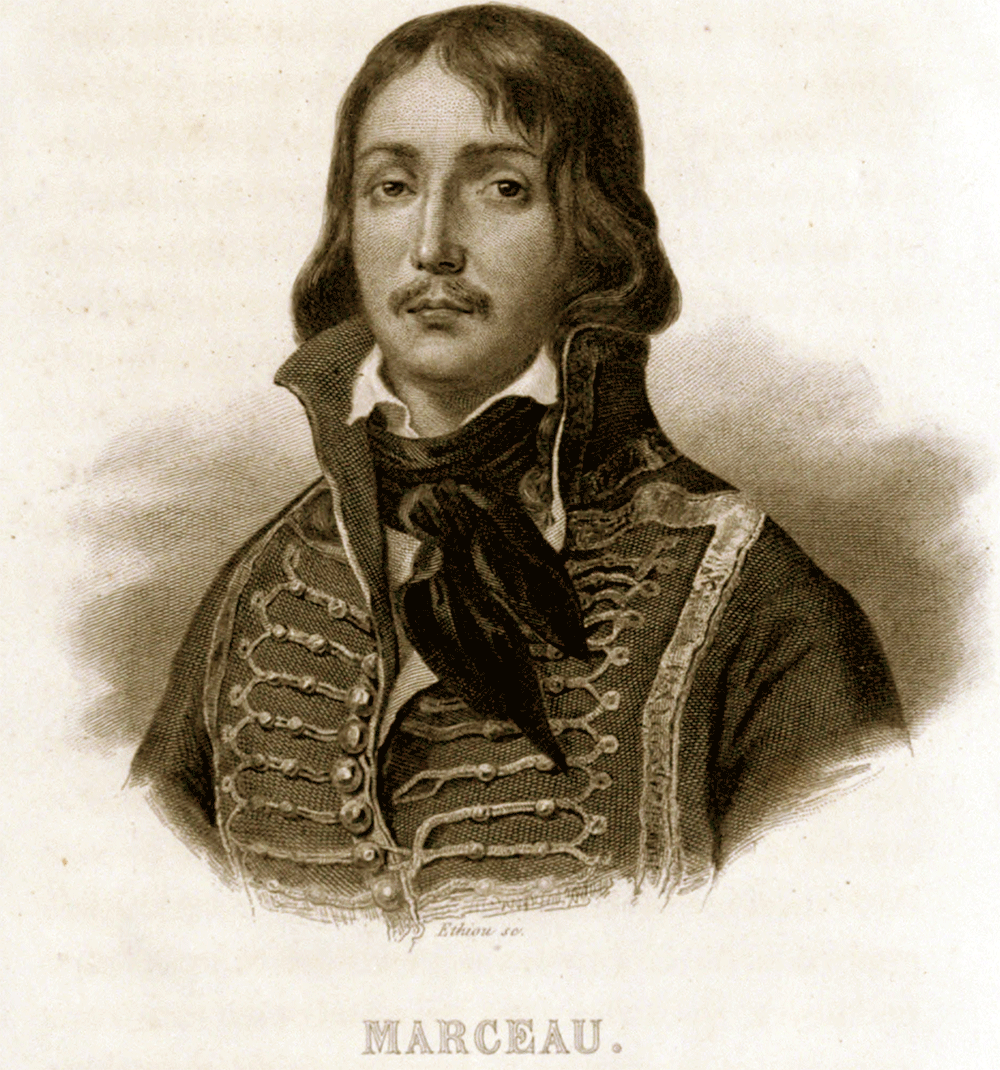HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. |
CHAPITRE IV. ÉTAT INTÉRIEUR DE LA FRANCE VERS LE MILIEU DE L'ANNÉE 1796 (AN IV).— EMBARRAS FINANCIERS DU GOUVERNEMENT, CHUTE DES MANDATS ET DU PAPIER-MONNAIE.— ATTAQUE DU CAMP DE GRENELLE PAR LES JACOBINS.— RENOUVELLEMENT DU PACTE DE FAMILLE AVEC L'ESPAGNE, ET PROJET DE QUADRUPLE ALLIANCE.— PROJET D'UNE EXPÉDITION EN IRLANDE.— NÉGOCIATIONS EN ITALIE.— CONTINUATION DES HOSTILITÉS; ARRIVÉE DE WURMSER SUR L'ADIGE; VICTOIRES DE LONATO ET DE CASTIGLIONE.— OPÉRATIONS SUR LE DANUBE; BATAILLE DE NERESHEIM; MARCHE DE L'ARCHIDUC CHARLES CONTRE JOURDAN.— MARCHE DE BONAPARTE SUR LA BRENTA; BATAILLES DE ROVEREDO, BASSANO ET SAINT-GEORGE; RETRAITE DE WURMSER DANS MANTOUE. RETOUR DE JOURDAN SUR LE MEIN; BATAILLE DE WURTZBOURG; RETRAITE DE MOREAU.
La France n'avait jamais paru plus grande au dehors que pendant cet été de 1796; mais sa situation intérieure était loin de répondre à son éclat extérieur. Paris offrait un spectacle singulier: les patriotes, furieux depuis l'arrestation de Baboeuf, de Drouet et de leurs autres chefs, exécraient le gouvernement, et ne souhaitaient plus les victoires de la république, depuis qu'elles profitaient au directoire. Les ennemis déclarés de la révolution les niaient obstinément; les hommes fatigués d'elle n'avaient pas l'air d'y croire. Quelques nouveaux riches, qui devaient leurs trésors à l'agiotage ou aux fournitures, étalaient un luxe effréné, et montraient la plus grande indifférence pour cette révolution qui avait fait leur fortune; Cet état moral était le résultat inévitable d'une fatigue générale dans la nation, de passions invétérées chez les partis, et de la cupidité excitée par une crise financière. Mais il y avait encore beaucoup de Français républicains et enthousiastes, dont les sentimens étaient conservés, dont nos victoires réjouissaient l'âme, qui, loin de les nier, en accueillaient au contraire la nouvelle avec transport, et qui prononçaient avec affection et admiration les noms de Hoche, Jourdan, Moreau et Bonaparte. Ceux-là voulaient qu'on fît de nouveaux efforts, qu'on obligeât les malveillans et les indifférens à contribuer de tous leurs moyens à la gloire et à la grandeur de la république.
Pour obscurcir l'éclat de nos conquêtes, les partis s'attachaient à décrier les généraux. Ils s'étaient surtout acharnés contre le plus jeune et le plus brillant, contre Bonaparte, dont le nom, en deux mois, était devenu si glorieux. Il avait fait au 13 vendémiaire une grande peur aux royalistes, et ils le traitaient peu favorablement dans leurs journaux. On savait qu'il avait déployé un caractère assez impérieux en Italie; on était frappé de la manière dont il en agissait avec les états de cette contrée, accordant ou refusant à son gré des armistices, qui décidaient de la paix ou de la guerre; on savait que, sans prendre l'intermédiaire de la trésorerie, il avait envoyé des fonds à l'armée du Rhin. On se plaisait donc à dire malicieusement qu'il était indocile, et qu'il allait être destitué. C'était un grand général perdu pour la république, et une gloire importune arrêtée tout à coup. Aussi les malveillans s'empressèrent-ils de répandre les bruits les plus absurdes; ils allèrent jusqu'à prétendre que Hoche, qui était alors à Paris, allait partir pour arrêter Bonaparte au milieu de son armée. Le gouvernement écrivit à Bonaparte une lettre qui démentait tous ces bruits, et dans laquelle il lui renouvelait le témoignage de toute sa confiance. Il fit publier la lettre dans tous les journaux. Le brave Hoche, incapable d'aucune basse jalousie contre un rival qui, en deux mois, s'était placé au-dessus des premiers généraux de la république, écrivit de son côté pour démentir le rôle qu'on lui prêtait. Il faut citer cette lettre si honorable pour ces deux jeunes héros; elle était adressée au ministre de la police, et fut rendue publique.
«Citoyen ministre, des hommes qui, cachés ou ignorés pendant les premières années de la fondation de la république, n'y pensent aujourd'hui que pour chercher les moyens de la détruire, et n'en parlent que pour calomnier ses plus fermes appuis, répandent depuis quelques jours les bruits les plus injurieux aux armées et à l'un des officiers-généraux qui les commandent. Ne leur est-il donc plus suffisant, pour parvenir à leur but, de correspondre ouvertement avec la horde conspiratrice résidante à Hambourg? Faut-il que, pour obtenir la protection des maîtres qu'ils veulent donner à la France, ils avilissent les chefs des armées? Pensent-ils que ceux-ci, aussi faibles qu'au temps passé, se laisseront injurier sans oser répondre, et accuser sans se défendre? Pourquoi Bonaparte se trouve-t-il donc l'objet des fureurs de ces messieurs? Est-ce parce qu'il a battu leurs amis et eux-mêmes en vendémiaire? est-ce parce qu'il dissout les armées des rois, et qu'il fournit à la république les moyens de terminer glorieusement cette honorable guerre? Ah! brave jeune homme, quel est le militaire républicain qui ne brûle du désir de t'imiter? Courage, Bonaparte! conduis à Naples, à Vienne, nos armées victorieuses; réponds à tes ennemis personnels en humiliant les rois, en donnant à nos armes un lustre nouveau; et laisse-nous le soin de ta gloire!
«J'ai ri de pitié en voyant un homme, qui d'ailleurs a beaucoup d'esprit, annoncer des inquiétudes, qu'il n'a pas sur les pouvoirs accordés aux généraux français. Vous les connaissez à peu près tous, citoyen ministre. Quel est celui qui, en lui supposant même assez de pouvoir sur son armée pour la faire marcher sur le gouvernement, quel est celui, dis-je, qui jamais entreprendrait de la faire, sans être, sur-le-champ accablé par ses compagnons? A peine les généraux se connaissent-ils, à peine correspondent-ils ensemble! leur nombre doit rassurer, sur les desseins que l'on prête gratuitement à l'un d'eux. Ignore-t-on ce que peuvent sur les hommes, l'envie, l'ambition, la haine, je puis ajouter, je pense, l'amour de la patrie et l'honneur? Rassurez-vous donc, républicains modernes.
«Quelques journalistes ont poussé l'absurdité au point de me faire aller en Italie pour arrêter un homme que j'estime, et dont le gouvernement a le plus à se louer. On peut assurer qu'au temps où nous vivons, peu d'officiers généraux se chargeraient de remplir les fonctions de gendarmes, bien que beaucoup soient disposés à combattre les factions et les factieux.
«Depuis mon séjour à Paris, j'ai vu des hommes de toutes les opinions: j'ai pu en apprécier quelques-uns à leur juste valeur. Il en est qui pensent que le gouvernement ne peut marcher sans eux: ils crient pour avoir des places. D'autres, quoique personne ne s'occupe d'eux, croient qu'on a juré leur perte: ils crient pour se rendre intéressans. J'avais vu des émigrés, plus Français que royalistes, pleurer de joie au récit de nos victoires; j'ai vu des Parisiens les révoquer en doute. Il m'a semblé qu'un parti audacieux, mais sans moyens, voulait renverser le gouvernement actuel, pour y substituer l'anarchie; qu'un second, plus dangereux, plus adroit, et qui compte des amis partout, tendait au bouleversement de la république, pour rendre à la France la constitution boiteuse de 1791, et une guerre civile de trente années; qu'un troisième enfin, s'il sait mépriser les deux autres, et prendre sur eux l'empire que lui donnent les lois, les vaincra, parce qu'il est composé de républicains vrais, laborieux et probes, dont les moyens sont les talens et les vertus, parce qu'il compte au nombre de ses partisans tous les bons citoyens, et les armées, qui n'auront sans doute pas vaincu depuis cinq ans pour laisser asservir la patrie.»
Ces deux lettres firent taire tous les bruits, et imposèrent silence aux malveillans.
Au milieu de sa gloire, le gouvernement faisait pitié par son indigence. Le nouveau papier-monnaie s'était soutenu peu de temps, et sa chute privait le directoire d'une importante ressource. On se souvient que le 26 ventôse (16 mars) 2 milliards 400 millions de mandats avaient été créés, et hypothéqués sur une valeur correspondante de biens. Une partie de ces mandats avait été consacrée à retirer les 24 milliards d'assignats restant en circulation, et le reste à pourvoir à de nouveaux besoins. C'était en quelque sorte, comme nous l'avons dit, une réimpression de l'ancien papier, avec un nouveau titre et un nouveau chiffre. Les 24 milliards d'assignats étaient remplacés par 800 millions de mandats; et au lieu de créer encore 48 autres milliards d'assignats, on créait 1600 millions de mandats. La différence était donc dans le titre et le chiffre. Elle était aussi dans l'hypothèque; car les assignats, par l'effet des enchères, ne représentaient pas une valeur déterminée de biens; les mandats, au contraire, devant procurer les biens sur l'offre simple du prix de 1790, en représentaient bien exactement la somme de 2 milliards 400 millions. Tout cela n'empêcha pas leur chute, qui fut le résultat de différentes causes. La France ne voulait plus de papier, et était décidée à n'y plus croire. Or, quelque grandes que soient les garanties, quand on n'y veut plus regarder, elles sont comme si elles n'étaient pas. Ensuite le chiffre du papier, quoique réduit, ne l'était pas assez. On convertissait 24 milliards d'assignats en 800 millions de mandats; on réduisait donc l'ancien papier au trentième, et il aurait fallu le réduire au deux-centième pour être dans la vérité; car 24 milliards valaient tout au plus 120 millions. Les reproduire dans la circulation pour 800 millions, en les convertissant en mandats, c'était une erreur. Il est vrai qu'on leur affectait une pareille valeur de biens; mais une terre qui en 1790 valait 100 mille francs, ne se vendait aujourd'hui que 30 ou 25 mille francs; par conséquent le papier portant ce nouveau titre et ce nouveau chiffre, eût-il même représenté exactement les biens, ne pouvait valoir comme eux que le tiers de l'argent. Or, vouloir le faire circuler au pair, c'était encore soutenir un mensonge. Ainsi, quand même il y aurait eu possibilité de rendre la confiance au papier, la supposition exagérée de sa valeur devait toujours le faire tomber. Aussi, bien que sa circulation fût forcée partout, on ne l'accepta qu'un instant. Les mesures violentes qui avaient pu imposer en 1793, étaient impuissantes aujourd'hui. Personne ne traitait plus qu'en argent. Ce numéraire, qu'on avait cru enfoui ou exporté à l'étranger, remplissait la circulation. Celui qui était caché se montrait, celui qui était sorti de France y rentrait. Les provinces méridionales étaient remplies de piastres, qui venaient d'Espagne, appelées chez nous par le besoin. L'or et l'argent vont, comme toutes les marchandises, là où la demande les attire; seulement leur prix est plus élevé, et se maintient jusqu'à ce que la quantité soit suffisante, et que le besoin soit satisfait. Il se commettait bien encore quelques friponneries, par les remboursemens en mandats, parce que les lois donnant cours forcé de monnaie au papier, permettaient de l'employer à l'acquittement des engagemens écrits; mais on ne l'osait guère, et quant à toutes les stipulations, elles se faisaient en numéraire. Dans tous les marchés on ne voyait que l'argent ou l'or; les salaires du peuple ne se payaient pas autrement. On aurait dit qu'il n'existait point de papier en France. Les mandats ne se trouvaient plus que dans les mains des spéculateurs, qui les recevaient du gouvernement, et les revendaient aux acquéreurs de biens nationaux.
De cette manière, la crise financière, quoique existant encore pour l'état, avait presque cessé pour les particuliers. Le commerce et l'industrie, profitant d'un premier moment de repos, et de quelques communications rouvertes avec le continent, par l'effet de nos victoires, commençaient à reprendre quelque activité.
Il ne faut point, comme les gouvernemens ont la vanité de le dire, encourager la production pour qu'elle prospère; il faut seulement ne pas la contrarier. Elle profite du premier moment pour se développer avec une activité merveilleuse. Mais si les particuliers recouvraient un peu d'aisance, le gouvernement, c'est-à-dire, ses chefs, ses agens de toute espèce, militaires, administrateurs ou magistrats, ses créanciers étaient réduits à une affreuse détresse. Les mandats qu'on leur donnait étaient inutiles dans leurs mains; ils n'en pouvaient faire qu'un seul usage, c'était de les passer aux spéculateurs sur le papier, qui prenaient 100 francs pour cinq ou six, et qui revendaient ensuite ces mandats aux acquéreurs de biens nationaux. Aussi les rentiers mouraient de faim; les fonctionnaires donnaient leur démission; et, contre l'usage, au lieu de demander des emplois, on les résignait. Les armées d'Allemagne et d'Italie vivant chez l'ennemi, étaient à l'abri de la misère commune; mais les armées de l'intérieur étaient dans une détresse affreuse. Hoche ne faisait vivre ses soldats que de denrées perçues dans les provinces de l'Ouest, et il était obligé d'y maintenir le régime militaire, pour avoir le droit de lever en nature les subsistances. Quant aux officiers et à lui-même, ils n'avaient pas de quoi se vêtir. Le service des étapes établi dans la France, pour les troupes qui la parcouraient, avait manqué souvent, parce que les fournisseurs ne voulaient plus rien avancer. Les détachemens partis des côtes de l'Océan pour renforcer l'armée d'Italie, étaient arrêtés en route. On avait vu même des hôpitaux fermés, et les malheureux soldats qui les remplissaient, expulsés de l'asile que la république devait à leurs infirmités, parce qu'on ne pouvait plus leur fournir ni remèdes ni alimens. La gendarmerie était entièrement désorganisée. N'étant ni vêtue, ni équipée, elle ne faisait presque plus son service. Les gendarmes, voulant ménager leurs chevaux qu'on ne remplaçait pas, ne protégeaient plus les routes; les brigands, qui abondent à la suite des guerres civiles, les infestaient. Ils pénétraient dans les campagnes, et souvent dans les villes, et y commettaient le vol et l'assassinat avec une audace inouïe.
Tel était donc l'état intérieur de la France. Le caractère particulier de cette nouvelle crise, c'était la misère du gouvernement au milieu d'un retour d'aisance chez les particuliers. Le directoire ne vivait que des débris du papier, et de quelques millions que ses armées lui envoyaient de l'étranger. Le général Bonaparte lui avait déjà envoyé 30 millions, et cent beaux chevaux de voiture pour contribuer un peu à ses pompes.
Il s'agissait de détruire maintenant tout l'échafaudage du papier-monnaie. Il fallait pour cela que le cours n'en fût plus forcé, et que l'impôt fût reçu en valeur réelle. On déclara donc, le 28 messidor (16 juillet), que tout le monde pourrait traiter comme il lui plairait, et stipuler en monnaie de son choix; que les mandats ne seraient plus reçus qu'au cours réel, et que ce cours serait tous les jours constaté et publié par la trésorerie. On osa enfin déclarer que les impôts seraient perçus en numéraire ou en mandats au cours; on ne fit d'exception que pour la contribution foncière. Depuis la création des mandats on avait voulu la percevoir en papier, et non plus en nature. On sentit qu'il aurait mieux valu la percevoir toujours en nature, parce qu'au milieu des variations du papier, on aurait au moins recueilli des denrées. On décida donc, après de longues discussions, et plusieurs projets successivement rejetés chez les anciens, que, dans les départemens frontières ou voisins des armées, la perception pourrait être exigée en nature; que dans les autres elle aurait lieu en mandats aux cours des grains. Ainsi, on évaluait le blé en 1790 à 10 fr. le quintal; on l'évaluait aujourd'hui à 80 fr. en mandats. Chaque dix francs de cotisation, représentant un quintal de blé, devait se payer aujourd'hui 80 fr. en mandats. Il eût été bien plus simple d'exiger le paiement en numéraire ou mandats au cours; mais on ne l'osa pas encore; on commençait donc à revenir à la réalité, mais en hésitant.
L'emprunt forcé n'était point encore recouvré. L'autorité n'avait plus l'énergie d'arbitraire qui aurait pu assurer la prompte exécution d'une pareille mesure. Il restait près de 300 millions à percevoir. On décida qu'en acquittement de l'emprunt et de l'impôt, les mandats seraient reçus au pair, et les assignats à cent capitaux pour un, mais pendant quinze jours seulement; et qu'après ce terme, le papier ne serait plus reçu qu'au cours. C'était une manière d'encourager les retardataires à s'acquitter.
La chute des mandats étant déclarée, il n'était plus possible de les recevoir en paiement intégral des biens nationaux qui leur étaient affectés; et la banqueroute qu'on leur avait prédite comme aux assignats, devenait inévitable. On avait annoncé, en effet, que les mandats émis pour 2 milliards 400 millions, tombant fort au-dessous de cette valeur, et ne valant plus que 2 à 3 cents millions, l'état ne voudrait plus donner la valeur promise des biens, c'est-à-dire 2 milliards 400 millions. On avait soutenu le contraire dans l'espoir que les mandats se maintiendraient à une certaine valeur; mais 100 francs tombant à 5 ou 6 fr., l'état ne pouvait plus donner une terre de 100 francs, en 1790, et de 30 à 40 francs aujourd'hui, pour 5 ou 6 fr. C'était là l'espèce de banqueroute qu'avaient subie les assignats, et dont nous avons expliqué plus haut la nature. L'état faisait là ce que fait aujourd'hui une caisse d'amortissement qui rachète au cours de la place, et qui, dans le cas d'une baisse extraordinaire, rachèterait peut-être à 50 ce qui aurait été émis à 80 ou 90. En conséquence, il fut décidé le 8 thermidor (26 juillet) que le dernier quart des domaines nationaux soumissionnés depuis la loi du 26 ventôse (celle qui créait les mandats), serait acquitté en mandats au cours, et en six paiemens égaux. Comme il avait été soumissionné pour 800 millions de biens, ce quart était de 200 millions.
On touchait donc à la fin du papier-monnaie. On se demandera pourquoi on fit ce second essai des mandats, qui eurent si peu de durée et de succès. En général on juge trop les mesures de ce genre indépendamment des circonstances qui les ont commandées. La crainte de manquer de numéraire avait sans doute contribué à la création des mandats; et, si on n'avait pas eu d'autre raison, on aurait eu grand tort, car le numéraire ne peut pas manquer; mais on avait été poussé surtout par la nécessité impérieuse de vivre avec les biens et d'anticiper sur leur vente. Il fallait mettre leur prix en circulation avant de l'avoir retiré, et pour cela l'émettre en forme de papier. Sans doute la ressource n'avait pas été grande, puisque les mandats étaient si vite tombés, mais enfin on avait vécu encore quatre ou cinq mois. Et n'est-ce rien que cela? Il faut considérer les mandats comme un nouvel escompte de la valeur des biens nationaux, comme un expédient, en attendant que ces biens pussent être vendus. On va voir que de momens de détresse le gouvernement eut encore à traverser, avant de pouvoir en réaliser la vente en numéraire.
Le trésor ne manquait pas de ressources prochainement exigibles; mais il en était de ces ressources comme des biens nationaux: il fallait les rendre actuelles. Il avait encore à recevoir 300 millions de l'emprunt forcé; 300 millions de la contribution foncière de l'année, c'est-à-dire toute la valeur de cette contribution; 25 millions de la contribution mobilière; tout le fermage des biens nationaux, et l'arriéré de ce fermage s'élevant en tout à 60 millions; différentes contributions militaires; le prix du mobilier des émigrés; divers arriérés; enfin 80 millions de papier sur l'étranger. Toutes ces ressources, jointes aux 200 millions du dernier quart du prix des biens, s'élevaient à 1100 millions, somme énorme, mais difficile à réaliser. Il ne lui fallait, pour achever son année, c'est-à-dire pour aller jusqu'au 1er vendémiaire, que 400 millions; il était sauvé s'il pouvait les réaliser immédiatement sur les 1100. Pour l'année suivante, il avait les contributions ordinaires qu'on espérait percevoir toutes en numéraire, et qui, s'élevant à 500 et quelques millions, couvraient ce qu'on appelait la dépense ordinaire. Pour les dépenses de la guerre, dans le cas d'une nouvelle campagne, il avait le reste des 1100 millions dont il ne devait absorber cette année que 400 millions; il avait enfin les nouvelles soumissions des biens nationaux. Mais le difficile était toujours la rentrée de ces sommes. Le comptant ne se compose jamais que des produits de l'année; or, il était difficile de tout prendre à la fois par l'emprunt forcé, par la contribution foncière et mobilière, par la vente des biens. On se mit de nouveau à travailler à la perception des contributions, et on donna au directoire la faculté extraordinaire d'engager des biens belges pour cent millions de numéraire. Les rescriptions, espèces de bons royaux, ayant pour but d'escompter les rentrées de l'année, avaient partagé le sort de tout le papier. Ne pouvant pas faire usage de cette ressource, le ministre payait les fournisseurs en ordonnances de liquidation, qui devaient être acquittées sur les premières recettes.
Telles étaient les misères de ce gouvernement si glorieux au dehors. Les partis n'avaient pas cessé de s'agiter intérieurement. La soumission de la Vendée avait beaucoup réduit les espérances de la faction royaliste; mais les agens de Paris n'en étaient que plus convaincus du mérite de leur ancien plan, qui consistait à ne pas employer la guerre civile, mais à corrompre les opinions, à s'emparer peu à peu des conseils et des autorités. Ils y travaillaient par leurs journaux. Quant aux patriotes, ils étaient arrivés au plus haut point d'indignation. Ils avaient favorisé l'évasion de Drouet, qui était parvenu à s'échapper de prison, et ils méditaient de nouveaux complots, malgré la découverte de celui de Baboeuf. Beaucoup d'anciens conventionnels et de thermidoriens, liés naguère au gouvernement qu'ils avaient formé eux-mêmes le lendemain du 13 vendémiaire, commençaient à être mécontens. Une loi ordonnait, comme on a vu, aux ex-conventionnels non réélus, et à tous les fonctionnaires destitués, de sortir de Paris. La police, par erreur, envoya des mandats d'amener à quatre conventionnels, membres du corps législatif. Ces mandats furent dénoncés avec amertume aux cinq-cents. Tallien, qui, lors de la découverte du complot de Baboeuf, avait hautement exprimé son adhésion au système du gouvernement, s'éleva avec aigreur contre la police du directoire, et contre les défiances dont les patriotes étaient l'objet. Son adversaire habituel, Thibaudeau, lui répondit, et, après une discussion assez vive et quelques récriminations, chacun se renferma dans son humeur. Le ministre Cochon, ses agens, ses mouchards, étaient surtout l'objet de la haine des patriotes, qui avaient été les premiers atteints par sa surveillance. La marche du gouvernement était du reste parfaitement tracée; et s'il était tout à fait prononcé contre les royalistes, il était tout aussi séparé des patriotes, c'est-à-dire de cette portion du parti révolutionnaire qui voulait revenir à une république plus démocratique, et qui trouvait le régime actuel trop doux pour les aristocrates. Mais, sauf l'état des finances, cette situation du directoire, détaché de tous les partis, les contenant d'une main forte, et s'appuyant sur d'admirables armées, était assez rassurante et assez belle.
Les patriotes avaient déjà fait deux tentatives, et subi deux répressions, depuis l'installation du directoire. Ils avaient voulu recommencer le club des jacobins au Panthéon, et l'avaient vu fermer par le gouvernement. Ils avaient ensuite essayé un complot mystérieux sous la direction de Baboeuf; ils avaient été découverts par la police, et privés de leurs nouveaux chefs. Ils s'agitaient cependant encore, et songeaient à faire une dernière tentative. L'opposition, en attaquant encore une fois la loi du 3 brumaire, excita chez eux un redoublement de colère, et les poussa à un dernier éclat. Ils cherchaient à corrompre la légion de police. Cette légion avait été dissoute, et changée en un régiment qui était le 21e de dragons. Ils voulaient tenter la fidélité de ce régiment, et ils espéraient, en l'entraînant, entraîner toute l'année de l'intérieur, campée dans la plaine de Grenelle. Ils se proposaient en même temps d'exciter un mouvement, en tirant des coups de fusil dans Paris, en jetant des cocardes blanches dans les rues, en criant Vive le Roi! et en faisant croire ainsi que les royalistes s'armaient pour détruire la république. Ils auraient alors profité de ce prétexte, pour accourir en armes, s'emparer du gouvernement, et faire déclarer en leur faveur le camp de Grenelle.
Le 12 fructidor (29 août), ils exécutèrent une partie de leurs projets, tirèrent des pétards, et jetèrent quelques cocardes blanches dans les rues. Mais la police avertie avait pris de telles précautions, qu'ils furent réduits à l'impossibilité de faire aucun mouvement. Ils ne se découragèrent pas, et, quelques jours après, le 22 (9 septembre), ils décidèrent de consommer leur complot. Trente des principaux se réunirent au Gros-Caillou, et résolurent de former dans la nuit même un rassemblement dans le quartier de Vaugirard. Ce quartier, voisin du camp de Grenelle, était plein de jardins, et coupé de murailles; il présentait des lignes derrière lesquelles ils pourraient se réunir, et faire résistance, dans le cas où ils seraient attaqués. Le soir, en effet, ils se trouvèrent réunis au nombre de sept ou huit cents, armés de fusils, de pistolets, de sabres, de cannes à épée. C'était tout ce que le parti renfermait de plus déterminé. Il y avait parmi eux quelques officiers destitués, qui se trouvaient à la tête du rassemblement avec leurs uniformes et leurs épaulettes. Il s'y trouvait aussi quelques ex-conventionnels en costume de représentans, et même, dit-on, Drouet, qui était resté caché dans Paris depuis son évasion. Un officier de la garde du directoire, à la tête de dix cavaliers, faisait patrouille dans Paris, lorsqu'il fut averti du rassemblement formé à Vaugirard. Il y accourut à la tête de ce faible détachement; mais à peine arrivé, il fut accueilli par une décharge de coups de fusil, et assailli par deux cents hommes armés, qui l'obligèrent à se retirer à toute bride. Il alla sur-le-champ faire mettre sous les armes la garde du directoire, et envoya un officier au camp de Grenelle pour y donner l'éveil. Les patriotes ne perdirent pas de temps, et, l'éveil donné, se rendirent en toute hâte à la plaine de Grenelle, au nombre de quelques cents. Ils se dirigèrent vers le quartier du vingt-et-unième de dragons, ci-devant légion de police, et essayèrent de le gagner, en disant qu'ils venaient fraterniser avec lui. Le chef d'escadron Malo, qui commandait ce régiment, sortit aussitôt de sa tente, se lança à cheval, moitié habillé, réunit autour de lui quelques officiers et les premiers dragons qu'il rencontra, et chargea à coups de sabre ceux qui lui proposaient de fraterniser. Cet exemple décida les soldats; ils coururent à leurs chevaux, fondirent sur le rassemblement, et l'eurent bientôt dispersé. Ils tuèrent ou blessèrent un grand nombre d'individus, et en arrêtèrent cent trente-deux. Le bruit de ce combat éveilla tout le camp, qui se mit aussitôt sous les armes, et jeta l'alarme dans Paris. Mais on fut bientôt rassuré en apprenant le résultat et la folie de la tentative. Le directoire fit aussitôt enfermer les prisonniers, et demanda aux deux conseils l'autorisation de faire des visites domiciliaires pour saisir, dans certains quartiers, beaucoup de séditieux que leurs blessures avaient empêchés de quitter Paris. Ayant fait partie d'un rassemblement armé, ils étaient justiciables des tribunaux militaires, et furent livrés à une commission, qui commença à en faire fusiller un certain nombre. L'organisation de la haute-cour nationale n'était point encore achevée; on en pressa de nouveau l'installation, pour commencer le procès de Baboeuf.
Cette échauffourée fut prise pour ce qu'elle valait, c'est-à-dire pour une de ces imprudences qui caractérisent un parti expirant. Les ennemis seuls de la révolution affectèrent d'y attacher une grande importance, pour avoir une nouvelle occasion de crier à la terreur, et de répandre des alarmes. On fut peu épouvanté en général, et cette vaine attaque prouva mieux encore que tous les autres succès du directoire, que son établissement était définitif, et que les partis devaient renoncer à le détruire.
Tels étaient les événemens qui se passaient à l'intérieur.
Pendant qu'au dehors on allait livrer de nouveaux combats, d'importantes négociations se préparaient en Europe. La république française était en paix avec plusieurs puissances, mais n'avait d'alliance avec aucune. Les détracteurs qui avaient dit qu'elle ne serait jamais reconnue, disaient maintenant qu'elle serait à jamais sans alliés. Pour répondre à ces insinuations malveillantes, le directoire songeait à renouveler le pacte de famille avec l'Espagne, et projetait une quadruple alliance entre la France, l'Espagne, Venise et la Porte. Par ce moyen, la quadruple alliance, composée de toutes les puissances du Midi, contre celles du Nord, dominerait la Méditerranée et l'Orient, donnerait des inquiétudes à la Russie, menacerait les derrières de l'Autriche, et susciterait une nouvelle ennemie maritime à l'Angleterre. De plus, elle procurerait de grands avantages à l'armée d'Italie, en lui assurant l'appui des escadres vénitiennes et trente mille Esclavons.
L'Espagne était parmi les puissances la plus facile à décider. Elle avait contre l'Angleterre des griefs qui dataient du commencement de la guerre. Les principaux étaient la conduite des Anglais à Toulon, et le secret gardé à l'amiral espagnol lors de l'expédition en Corse. Elle avait des griefs plus grands encore, depuis la paix avec la France; les Anglais avaient insulté ses vaisseaux, arrêté des munitions qui lui étaient destinées, violé son territoire, pris des postes menaçans pour elle en Amérique, violé les lois de douanes dans ses colonies, et cherché ouvertement à les soulever. Ces mécontentemens joints aux offres brillantes du directoire, qui lui faisait espérer des possessions en Italie, et aux victoires qui permettaient de croire à l'accomplissement de ses offres, décidèrent enfin l'Espagne à signer, le 2 fructidor (19 août), un traité d'alliance offensive et défensive avec la France, sur les bases du pacte de famille. D'après ce traité, ces deux puissances se garantissaient mutuellement toutes leurs possessions en Europe et dans les Indes; elles se promettaient réciproquement un secours de dix-huit mille hommes d'infanterie, et de six mille chevaux, de quinze vaisseaux de haut bord, de quinze vaisseaux de 74 canons, de six frégates et quatre corvettes. Ce secours devait être fourni à la première réquisition de celle des deux puissances qui était en guerre.
Des instructions furent envoyées à nos ambassadeurs, pour faire sentir à la Porte et à Venise les avantages qu'il y aurait pour elles à concourir à une pareille alliance.
La république française n'était donc plus isolée, et elle avait suscité à l'Angleterre une nouvelle ennemie. Tout annonçait que la déclaration de guerre de l'Espagne à l'Angleterre allait bientôt suivre le traité d'alliance avec la France.
Le directoire préparait en même temps à Pitt des embarras d'une autre nature. Hoche était à la tête de cent mille hommes, répandus sur les côtes de l'Océan. La Vendée et la Bretagne étant soumises, il brûlait d'employer ces forces d'une manière plus digne de lui, et d'ajouter de nouveaux exploits à ceux de Wissembourg et de Landau. Il suggéra au gouvernement un projet qu'il méditait depuis long-temps, celui d'une expédition en Irlande. Maintenant, disait-il, qu'on avait repoussé la guerre civile des côtes de France, il fallait reporter ce fléau sur les côtes de l'Angleterre, et lui rendre, en soulevant les catholiques d'Irlande, les maux qu'elle nous avait faits en soulevant les Poitevins et les Bretons. Le moment était favorable: les Irlandais étaient plus indisposés que jamais contre l'oppression du gouvernement anglais; le peuple des trois royaumes souffrait horriblement de la guerre, et une invasion, s'ajoutant aux autres maux qu'il endurait déjà, pouvait le porter au dernier degré d'exaspération. Les finances de Pitt étaient chancelantes; et l'entreprise dirigée par Hoche pouvait avoir les plus grandes conséquences. Le projet fut aussitôt accueilli. Le ministre de la marine Truguet, républicain excellent, et ministre capable, le seconda de toutes ses forces. Il rassembla une escadre dans le port de Brest, et fit pour l'armer convenablement tous les efforts que permettait l'état des finances. Hoche réunit tout ce qu'il avait de meilleures troupes dans son armée, et les rapprocha de Brest, pour les embarquer. On eut soin de répandre différens bruits, tantôt d'une expédition à Saint-Domingue, tantôt d'une descente à Lisbonne, pour chasser les Anglais du Portugal, de concert avec l'Espagne.
L'Angleterre, qui se doutait du but de ces préparatifs, était dans de sérieuses alarmes. Le traité d'alliance offensive et défensive entre l'Espagne et la France lui présageait de nouveaux dangers; et les défaites de l'Autriche lui faisaient craindre la perte de son puissant et dernier allié. Ses finances étaient surtout dans un grand état de détresse; la Banque avait resserré ses escomptes; les capitaux commençaient à manquer, et on avait arrêté l'emprunt ouvert pour l'empereur, afin de ne pas faire sortir de nouveaux fonds de Londres. Les ports d'Italie étaient fermés aux vaisseaux anglais; ceux d'Espagne allaient l'être; ceux de l'Océan l'étaient jusqu'au Texel. Ainsi le commerce de la Grande-Bretagne se trouvait singulièrement menacé. A toutes ces difficultés se joignaient celles d'une élection générale; car le parlement, touchant à sa septième année, était à réélire tout entier. Les élections se faisaient au milieu des cris de malédiction contre Pitt et contre la guerre.
L'empire avait abandonné presque en entier la cause de la coalition. Les États de Bade et de Wurtemberg venaient de signer la paix définitive, en permettant aux armées belligérantes le passage sur leur territoire. L'Autriche était dans les alarmes, en voyant deux armées françaises sur le Danube, et une troisième sur l'Adige, qui semblait fermer l'Italie. Elle avait envoyé Wurmser, avec trente mille hommes, pour recueillir plusieurs réserves dans le Tyrol, rallier et réorganiser les débris de l'armée de Beaulieu, et descendre en Lombardie avec soixante mille soldats. De ce côté, elle se croyait moins en danger, et était rassurée; mais elle était fort effrayée pour le Danube, et y portait toute son attention. Pour empêcher les bruits alarmans, le conseil aulique avait défendu à Vienne de parler des événemens politiques; il avait organisé une levée de volontaires, et travaillait avec une activité remarquable à équiper et armer de nouvelles troupes. Catherine, qui promettait toujours et ne tenait jamais, rendit un seul service: elle garantit les Gallicies à l'Autriche, ce qui permit d'en retirer les troupes qui s'y trouvaient, pour les acheminer vers les Alpes et le Danube.
Ainsi, la France effrayait partout ses ennemis, et on attendait avec impatience ce qu'allait décider le sort des armes le long du Danube et de l'Adige. Sur la ligne immense qui s'étend de la Bohême à l'Adriatique, trois armées allaient se choquer contre trois autres, et décider du sort de l'Europe.
En Italie, on avait négocié en attendant la reprise des hostilités. On avait fait la paix avec le Piémont, et depuis deux mois un traité avait succédé à l'armistice. Ce traité stipulait la cession définitive du duché de Savoie et du comté de Nice à la France; la destruction des forts de Suze et de la Brunette, placés au débouché des Alpes; l'occupation, pendant la guerre, des places de Coni, Tortone et Alexandrie; le libre passage, pour les troupes françaises, dans les états du Piémont, et la fourniture de ce qui était nécessaire à ces troupes pendant le trajet. Le directoire, à l'instigation de Bonaparte, aurait voulu de plus une alliance offensive et défensive avec le roi de Piémont, pour avoir dix ou quinze mille hommes de son armée. Mais ce prince, en retour, demandait la Lombardie, dont la France ne pouvait pas disposer encore, et dont elle songeait toujours à se servir comme équivalent des Pays-Bas. Cette concession étant refusée, le roi ne voulut pas consentir à une alliance.
Le directoire n'avait encore rien terminé avec Gênes; on disputait toujours sur le rappel des familles exilées, sur l'expulsion des familles feudadataires de l'Autriche et de Naples, et sur l'indemnité pour la frégate la Modeste.
Avec la Toscane, les relations étaient amicales; cependant, les moyens qu'on avait employés à l'égard des négocians livournais, pour obtenir la déclaration des marchandises appartenant aux ennemis de la France, semaient des germes de mécontentement. Naples et Rome avaient envoyé des agens à Paris, conformément aux termes de l'armistice; mais la négociation de la paix souffrait de grands retards. Il était évident que les puissances attendaient, pour conclure, la suite des événemens de la guerre. Les peuples de Bologne et de Ferrare étaient toujours aussi exaltés pour la liberté, qu'ils avaient reçue provisoirement. La régence de Modène et le duc de Parme étaient immobiles. La Lombardie attendait avec anxiété le résultat de la campagne. On avait fait de vives instances auprès du sénat de Venise, dans le double but de le faire concourir au projet de quadruple alliance, et de procurer un utile auxiliaire à l'armée d'Italie. Outre les ouvertures directes, nos ambassadeurs à Constantinople et à Madrid en avaient fait d'indirectes, et avaient fortement insisté auprès des légations de Venise, pour leur démontrer les avantages du projet; mais toutes ces démarches avaient été inutiles. Venise détestait les Français, depuis qu'elle les voyait sur son territoire, et que leurs idées se répandaient dans les populations. Elle ne s'en tenait plus à la neutralité désarmée; elle armait au contraire avec activité. Elle avait donné ordre aux commandans des îles d'envoyer dans les lagunes les vaisseaux et les troupes disponibles; elle faisait venir des régimens esclavons de l'Illyrie. Le provéditeur de Bergame armait secrètement les paysans superstitieux et braves du Bergamasque. Des fonds étaient recueillis par la double voie des contributions et des dons volontaires.
Bonaparte pensa que, dans le moment, il fallait dissimuler avec tout le monde, traîner les négociations en longueur, ne rien chercher à conclure, paraître ignorer toutes les démarches hostiles, jusqu'à ce que de nouveaux combats eussent décidé en Italie, ou notre établissement ou notre expulsion. Il fallait ne plus agiter les questions qu'on avait à traiter avec Gênes, et lui persuader qu'on était content des satisfactions obtenues, afin de la retrouver amie en cas de retraite. Il fallait ne pas mécontenter le duc de Toscane par la conduite qu'on tenait à Livourne. Bonaparte ne croyait pas sans doute qu'il convînt de laisser un frère de l'empereur dans ce duché, mais il ne voulait point l'alarmer encore. Les commissaires du directoire, Garreau et Sallicetti, ayant rendu un arrêté pour faire partir les émigrés français des environs de Livourne, Bonaparte leur écrivit une lettre, où, sans égard pour leur qualité, il les réprimandait sévèrement d'avoir enfreint leurs pouvoirs, et d'avoir mécontenté le duc de Toscane en usurpant dans ses états l'autorité souveraine. A l'égard de Venise, il voulait aussi garder le statu quo. Seulement il se plaignait très hautement de quelques assassinats commis sur les routes, et des préparatifs qu'il voyait faire autour de lui. Son but, en entretenant querelle ouverte, était de continuer à se faire nourrir, et de se ménager un motif de mettre la république à l'amende de quelques millions, s'il triomphait des Autrichiens. «Si je suis vainqueur, écrivait-il, il suffirai d'une simple estafette pour terminer toutes les difficultés qu'on me suscite.»
Le château de Milan était tombé en son pouvoir. La garnison s'était rendue prisonnière; toute l'artillerie avait été transportée devant Mantoue, où il avait réuni un matériel considérable. Il aurait voulu achever le siége de cette place, avant que la nouvelle armée autrichienne arrivât pour la secourir; mais il avait peu d'espoir d'y réussir, il n'employait au blocus que le nombre de troupes indispensablement nécessaire, à cause des fièvres qui désolaient les environs. Cependant il serrait la place de très près, et il allait essayer une de ces surprises qui, suivant ses expressions, dépendent d'une oie ou d'un chien; mais la baisse des eaux du lac empêcha le passage des bateaux qui devaient porter des troupes déguisées. Dès lors, il renonça pour le moment à se rendre maître de Mantoue; d'ailleurs Wurmser arrivait, et il fallait courir au plus pressant.
L'armée, entrée en Italie avec trente et quelques mille hommes environ, n'avait reçu que de faibles renforts pour réparer ses pertes. Neuf mille hommes lui étaient arrivés des Alpes. Les divisions tirées de l'armée de Hoche n'avaient point encore pu traverser la France. Grâce à ce renfort de neuf mille hommes, et aux malades qui étaient sortis des dépôts de la Provence et du Var, l'armée avait réparé les effets du feu, et s'était même renforcée. Elle comptait à peu près quarante-cinq mille hommes, répandus sur l'Adige et autour de Mantoue, au moment où Bonaparte revint de sa marche dans la Péninsule. Les maladies que gagnèrent les soldats devant Mantoue la réduisirent à quarante ou quarante-deux mille hommes environ. C'était là sa force au milieu de thermidor (fin de juillet). Bonaparte n'avait laissé que des dépôts à Milan, Tortone, Livourne. Il avait déjà mis hors de combat deux armées, une de Piémontais et une d'Autrichiens; et maintenant il avait à en combattre une troisième, plus formidable que les précédentes.
Wurmser arrivait à la tête de soixante mille hommes. Trente mille étaient tirés du Rhin, et se composaient de troupes excellentes. Le reste était formé des débris de Beaulieu, et de bataillons venus de l'intérieur de l'Autriche. Plus de dix mille hommes étaient enfermés dans Mantoue, sans compter les malades. Ainsi l'armée entière se composait de plus de soixante-dix mille hommes. Bonaparte en avait près de dix mille autour de Mantoue, et n'en pouvait opposer qu'environ trente mille aux soixante qui allaient déboucher du Tyrol. Avec une pareille inégalité de forces, il fallait une grande bravoure dans les soldats, et un génie bien fécond dans le général, pour rétablir la balance.
La ligne de l'Adige, à laquelle Bonaparte attachait tant de prix, allait devenir le théâtre de la lutte. Nous avons déjà donné les raisons pour lesquelles Bonaparte la préférait à toute autre. L'Adige n'avait pas la longueur du Pô, ou des fleuves qui, se rendant dans le Pô, confondent leur ligne avec la sienne; il descendait directement dans la mer, après un cours de peu d'étendue; il n'était pas guéable, et ne pouvait être tourné par le Tyrol, comme la Brenta, la Piave, et les fleuves plus avancés vers l'extrémité de la Haute-Italie. Ce fleuve a été le théâtre de si magnifiques événemens, qu'il faut en décrire le cours avec quelque soin.
Les eaux du Tyrol forment deux lignes, celle du Mincio et celle de l'Adige, presque parallèles, et s'appuyant l'une l'autre. Une partie de ces eaux forme dans les montagnes un lac vaste et allongé, qu'on appelle le lac de Garda; elles en sortent à Peschiera pour traverser la plaine du Mantouan, deviennent le Mincio, forment ensuite un nouveau lac autour de Mantoue, et vont se jeter enfin dans le Bas-Pô. L'Adige, formé des eaux des hautes vallées du Tyrol, coule au-delà de la ligne précédente; il descend à travers les montagnes parallèlement au lac de Garda, débouche dans la plaine aux environs de Vérone, court alors parallèlement au Mincio, se creuse un lit large et profond jusqu'à Legnago, et, à quelques lieues de cette ville, cesse d'être encaissé, et peut se changer en inondations impraticables, qui interceptent tout l'espace compris entre Legnago et l'Adriatique. Trois routes s'offraient à l'ennemi: l'une, franchissant l'Adige à la hauteur de Roveredo, avant la naissance du lac de Garda, tournait autour de ce lac, et venait aboutir sur ses derrières à Salo, Gavardo et Brescia. Deux autres routes partant de Roveredo, suivaient les deux rives de l'Adige, dans son cours le long du lac de Garda. L'une, longeant la rive droite, circulait entre ce fleuve et le lac, passait à travers des montagnes, et venait déboucher dans la plaine entre le Mincio et l'Adige. L'autre, suivant la rive gauche, débouchait dans la plaine vers Vérone, et aboutissait ainsi sur le front de la ligne défensive. La première des trois, celle qui franchit l'Adige avant la naissance du lac de Garda, présentait davantage de tourner à la fois les deux lignes du Mincio et de l'Adige, et de conduire sur les derrières de l'armée qui les gardait. Mais elle n'était pas très praticable; elle n'était accessible qu'à l'artillerie de montagne, et dès lors pouvait servir à une diversion, mais non à une opération principale. La seconde, descendant des montagnes entre le lac et l'Adige, passait le fleuve à Rivalta ou à Dolce, point où il était peu défendu; mais elle circulait dans les montagnes, à travers des positions faciles à défendre, telles que celles de la Corona et de Rivoli. La troisième enfin, circulant au-delà du fleuve jusqu'au milieu de la plaine, débouchait extérieurement, et venait tomber vers la partie la mieux défendue de son cours, de Vérone à Legnago. Ainsi les trois routes présentaient des difficultés fort grandes. La première ne pouvait être occupée que par un détachement; la seconde, passant entre le lac et le fleuve, rencontrait les positions de la Corona et de Rivoli; la troisième venait donner contre l'Adige, qui, de Vérone à Legnago, a un lit large et profond, et est défendu par deux places, à huit lieues l'une de l'autre.
Bonaparte avait placé le général Sauret avec trois mille hommes à Salo, pour garder la route qui débouche sur les derrières du lac de Garda. Masséna, avec douze mille, interceptait la route qui passe entre le lac de Garda et l'Adige, et occupait les positions de la Corona et de Rivoli. Despinois, avec cinq mille, était dans les environs de Vérone; Augereau, avec huit mille, à Legnago; Kilmaine, avec deux mille chevaux et l'artillerie légère, était en réserve dans une position centrale, à Castel-Novo. C'est là que Bonaparte avait placé son quartier-général, pour être à égale distance de Salo, Rivoli et Vérone. Comme il tenait beaucoup à Vérone, qui renfermait trois ponts sur l'Adige, et qu'il se défiait des intentions de Venise, il songea à en faire sortir les régimens esclavons. Il prétendit qu'ils étaient en hostilité avec les troupes françaises, et, sous prétexte de prévenir les rixes, il les fit sortir de la place. Le provéditeur obéit, et il ne resta dans Vérone que la garnison française.
Wurmser avait porté son quartier-général à Trente et Roveredo. Il détacha vingt mille hommes sous Quasdanovich, pour prendre la route qui tourne le lac de Garda et vient déboucher sur Salo. Il en prit quarante mille avec lui, et les distribua sur les deux routes qui longent l'Adige. Les uns devaient attaquer la Corona et Rivoli, les autres déboucher sur Vérone. Il croyait envelopper ainsi l'armée française, qui, étant attaquée à la fois sur l'Adige, et par derrière le lac de Garda, se trouvait exposée à être forcée sur son front, et à être coupée de sa ligne de retraite.
La renommée avait devancé l'arrivée de Wurmser. Dans toute l'Italie on attendait sa venue, et le parti ennemi de l'indépendance italienne se montrait plein de joie et de hardiesse. Les Vénitiens laissèrent éclater une satisfaction qu'ils ne pouvaient plus contenir. Les soldats esclavons couraient les places publiques, et, tendant la main aux passans, demandaient le prix du sang français qu'ils allaient répandre. A Rome, les agens de la France furent insultés; le pape, enhardi par l'espoir d'une délivrance prochaine, fit rétrograder les voitures portant le premier à-compte de la contribution qui lui était imposée; il renvoya même son légat à Ferrare et Bologne. Enfin, la cour de Naples, toujours aussi insensée, foulant aux pieds les conditions de l'armistice, fit marcher des troupes sur les frontières des États romains. La plus cruelle anxiété régnait au contraire dans les villes dévouées à la France et à la liberté. On attendait avec impatience les nouvelles de l'Adige. L'imagination italienne, qui grossit tout, avait exagéré la disproportion des forces. On disait que Wurmser arrivait avec deux armées, l'une de soixante, et l'autre de quatre-vingt mille hommes. On se demandait comment ferait cette poignée de Français pour résister à une si grande masse d'ennemis; on se répétait le fameux proverbe, que l'Italie était le tombeau des Français.
Le 11 thermidor an IV (29 juillet), les Autrichiens se trouvèrent en présence de nos postes et les surprirent tous. Le corps qui avait tourné le lac de Garda arriva sur Salo, d'où il repoussa le général Sauret. Le général Guyeux y resta seul avec quelques cents hommes, et s'enferma dans un vieux bâtiment, d'où il refusa de sortir, quoiqu'il n'eût ni pain ni eau, et à peine quelques munitions. Sur les deux routes qui longent l'Adige, les Autrichiens s'avancèrent avec le même avantage; ils forcèrent l'importante position de la Corona, entre l'Adige et le lac de Garda; ils franchirent également la troisième route, et vinrent déboucher devant Vérone. Bonaparte, à son quartier-général de Castel-Novo, recevait toutes ces nouvelles. Les courriers se succédaient sans relâche, et dans la journée du lendemain, 12 thermidor (30 juillet), il apprit que les Autrichiens s'étaient portés de Salo sur Brescia, et qu'ainsi sa retraite sur Milan était fermée, que la position de Rivoli était forcée comme celle de la Corona, et que les Autrichiens allaient passer l'Adige partout. Dans cette situation alarmante, ayant perdu sa ligne défensive et sa ligne de retraite, il était difficile qu'il ne fût pas ébranlé. C'était la première épreuve du malheur. Soit qu'il fût saisi par l'énormité du péril, soit que, prêt à prendre une détermination téméraire, il voulût partager la responsabilité avec ses généraux, il leur demanda leur avis pour la première fois, et assembla un conseil de guerre. Tous opinèrent pour la retraite. Sans point d'appui devant eux, ayant perdu l'une des deux routes de France, il n'en était aucun qui crût prudent de tenir. Augereau seul, dont ces journées furent les plus belles de sa vie, insista fortement pour tenter la fortune des armes. Il était jeune, ardent; il avait appris dans les faubourgs à bien parler le langage des camps, et il déclara qu'il avait de bons grenadiers qui ne se retireraient pas sans combattre. Peu capable de juger les ressources qu'offraient encore la situation des armées et la nature du terrain, il n'écoutait que son courage, et il échauffa de son ardeur guerrière le génie de Bonaparte. Celui-ci congédia ses généraux sans exprimer son avis, mais son plan était arrêté. Quoique la ligne de l'Adige fût forcée, et que celle du Mincio et du lac de Garda fût tournée, le terrain était si heureux, qu'il présentait encore des ressources à un homme de génie résolu.
Les Autrichiens, partagés en deux corps, descendaient le long des deux rives du lac de Garda: leur jonction s'opérait à la pointe du lac, et, arrivés là, ils avaient soixante mille hommes pour en accabler trente. Mais, en se concentrant à la pointe du lac, on empêchait leur jonction. En formant assez rapidement une masse principale, on pouvait accabler les vingt mille qui avaient tourné le lac, et revenir aussitôt après vers les quarante mille qui avaient filé entre le lac et l'Adige. Mais pour occuper la pointe du lac, il fallait y ramener toutes les troupes du Bas-Adige et du Bas-Mincio; il fallait retirer Augereau de Legnago, et Serrurier de Mantoue, car on ne pouvait plus tenir une ligne aussi étendue. C'était un grand sacrifice, car on assiégeait Mantoue depuis deux mois, on y avait transporté un grand matériel; la place allait se rendre, et en la laissant ravitailler, on perdait le fruit de longs travaux et une proie presque assurée. Bonaparte cependant n'hésita pas, et, entre deux buts importans, sut saisir le plus important et y sacrifier l'autre; résolution simple, et qui décèle non pas le grand capitaine, mais le grand homme. Ce n'est pas à la guerre seulement, c'est aussi en politique, et dans toutes les situations de la vie qu'on trouve deux buts, qu'on veut les tenir l'un et l'autre, et qu'on les manque tous les deux. Bonaparte eut cette force si grande et si rare du choix et du sacrifice. En voulant garder tout le cours du Mincio, depuis la pointe du lac de Garda jusqu'à Mantoue, il eût été percé; en se concentrant sur Mantoue pour la couvrir, il aurait eu soixante-dix mille hommes à combattre à la fois, dont soixante mille de front, et dix mille à dos. Il sacrifia Mantoue, et se concentra à la pointe du lac de Garda. Ordre fut donné sur-le-champ à Augereau de quitter Legnago, à Serrurier de quitter Mantoue, pour se concentrer vers Valeggio et Peschiera, sur le Haut-Mincio. Dans la nuit du 13 thermidor (31 juillet), Serrurier brûla ses affûts, encloua ses canons, enterra ses projectiles, et jeta ses poudres à l'eau, pour aller joindre l'armée active.
Bonaparte, sans perdre un seul instant, voulut marcher d'abord sur le corps ennemi le plus engagé, et le plus dangereux par la position qu'il avait prise. C'étaient les vingt mille hommes de Quasdanovich, qui avaient débouché par Salo, Gavardo et Brescia, sur les derrières du lac de Garda, et qui menaçaient la communication avec Milan. Le jour même où Serrurier abandonnait Mantoue, le 13 (31 juillet), Bonaparte rétrograda pour aller tomber sur Quasdanovich, et repassa le Mincio, à Peschiera, avec la plus grande partie de son armée. Augereau le repassa à Borghetto, à ce même pont témoin d'une action glorieuse au moment de la première conquête. On laissa des arrière-gardes pour surveiller la marche de l'ennemi, qui avait passé l'Adige. Bonaparte ordonna au général Sauret d'aller dégager le général Guyeux, qui était enfermé dans un vieux bâtiment avec dix-sept cents hommes, sans avoir ni pain ni eau, et qui se battait héroïquement depuis deux jours. Il résolut de marcher lui-même sur Lonato, où Quasdanovich venait déjà de pousser une division, et il ordonna à Augereau de se porter sur Brescia, pour rouvrir la communication avec Milan. Sauret réussit en effet à dégager le général Guyeux, repoussa les Autrichiens dans les montagnes, et leur fit quelques cents prisonniers. Bonaparte, avec la brigade d'Allemagne, n'eut pas le temps d'attaquer les Autrichiens à Lonato; il fut prévenu. Après un combat des plus vifs, il repoussa l'ennemi, entra à Lonato, et fit six cents prisonniers: Augereau, pendant ce temps, marchait sur Brescia; il y entra le lendemain 14 (1er août), sans coup férir, délivra quelques prisonniers qu'on nous y avait faits, et força les Autrichiens à rebrousser vers les montagnes. Quasdanovich, qui croyait arriver sur les derrières de l'armée française et la surprendre, fut étonné de trouver partout des masses imposantes, et faisant front avec tant de vigueur. Il avait perdu peu de monde, tant à Salo qu'à Lonato; mais il crut devoir faire halte, et ne pas s'engager davantage avant de savoir ce que devenait Wurmser avec la principale masse autrichienne. Il s'arrêta.
Bonaparte s'arrêta aussi de son côté. Le temps était précieux: sur ce point il ne fallait pas pousser un succès plus qu'il ne convenait. C'était assez d'avoir imposé à Quasdanovich; il fallait revenir maintenant pour faire face à Wurmser. Il rétrograda avec les divisions Masséna et Augereau. Le 15 (2 août), il plaça la division Masséna à Pont-San-Marco, et la division Augereau à Monte-Chiaro. Les arrière-gardes qu'il avait laissées sur le Mincio devinrent ses avant-gardes. Il était temps d'arriver; car les quarante mille hommes de Wurmser avaient franchi non-seulement l'Adige, mais le Mincio. La division Bayalitsch ayant masqué Peschiera par un détachement, et passé le Mincio, s'avançait sur la route de Lonato. La division Liptai avait franchi le Mincio à Borghetto, et repoussé de Castiglione le général Valette. Wurmser était allé, avec deux divisions d'infanterie et une de cavalerie, débloquer Mantoue. En voyant nos affûts en cendres, nos canons encloués, et les traces d'une extrême précipitation, il n'y vit point le calcul du génie, mais un effet de l'épouvante; il fut plein de joie, et entra en triomphe dans la place qu'il venait délivrer: c'était le 15 thermidor (2 août).
Bonaparte, revenu à Pont-San-Marco et à Monte-Chiaro, ne s'arrêta pas un instant. Ses troupes n'avaient cessé de marcher: lui-même avait toujours été à cheval; il résolut de les faire battre dès le lendemain matin. Il avait devant lui Bayalitsch à Lonato, Liptai à Castiglione, présentant à eux un front de vingt-cinq mille hommes. Il fallait les attaquer avant que Wurmser revînt de Mantoue. Sauret venait une seconde fois d'abandonner Salo; Bonaparte y envoya de nouveau Guyeux, pour reprendre la position et contenir toujours Quasdanovich. Après ces précautions sur sa gauche et ses derrières, il résolut de marcher devant lui à Lonato, avec Masséna, et de jeter Augereau sur les hauteurs de Castiglione, abandonnées la veille par le général Valette. Il destitua ce général devant l'armée, pour faire à tous ses lieutenans un devoir de la fermeté. Le lendemain 16 (3 août), toute l'armée s'ébranla; Guyeux rentra à Salo, ce qui rendit encore plus impossible toute communication de Quasdanovich avec l'armée autrichienne. Bonaparte s'avança sur Lonato, mais son avant-garde fut culbutée, quelques pièces furent prises, et le général Pigeon resta prisonnier. Bayalitsch, fier de ce succès, s'avança avec confiance, et étendit ses ailes autour de la division française. Il avait deux buts en faisant cette manoeuvre, d'abord d'envelopper Bonaparte, et puis de s'étendre par sa droite, pour entrer en communication avec Quasdanovich, dont il entendait le canon à Salo. Bonaparte, ne s'effrayant point pour ses derrières, se laisse envelopper avec un imperturbable sang-froid; il jette quelques tirailleurs sur ses ailes menacées, puis il saisit les dix-huitième et trente-deuxième demi-brigades d'infanterie, les range en colonne serrée, les fait appuyer par un régiment de dragons, et fond, tête baissée, sur le centre de l'ennemi, qui s'était affaibli pour s'étendre. Il renverse tout avec cette brave infanterie, et perce ainsi la ligne des Autrichiens. Ceux-ci, coupés en deux corps, perdent aussitôt la tête; une partie de cette division Bayalitsch se replie en toute hâte vers le Mincio; mais l'autre, qui s'était étendue pour communiquer avec Quasdanovich, se trouve rejetée vers Salo, où Guyeux se trouvait dans le moment. Bonaparte la fait poursuivre sans relâche, pour la mettre entre deux feux. Il lance Junot à sa poursuite avec un régiment de cavalerie. Junot se précipite au galop, tue six cavaliers de sa main, et tombe blessé de plusieurs coups de sabre. La division fugitive, prise entre le corps qui était à Salo et celui qui la poursuivait de Lonato, s'éparpille, se met en déroute, et laisse à chaque pas des milliers de prisonniers. Pendant qu'on achevait la poursuite, Bonaparte se porte sur sa droite, à Castiglione, où Augereau combattait depuis le matin avec une admirable bravoure. Il lui fallait enlever des hauteurs où la division Liptai s'était placée. Après un combat opiniâtre plusieurs fois recommencé, il en était enfin venu à bout, et Bonaparte, en arrivant, trouva l'ennemi qui se retirait de toutes parts. Telle fut la bataille dite de Lonato, livrée le 16 thermidor (3 août).
Les résultats en étaient considérables. On avait pris vingt pièces de canon, fait trois mille prisonniers à la division coupée et rejetée sur Salo, et l'on poursuivait les restes épars dans les montagnes. On avait fait mille ou quinze cents prisonniers à Castiglione; on avait tué ou blessé trois mille hommes; donné l'épouvante à Quasdanovich, qui, trouvant l'armée française devant lui à Salo, et l'entendant au loin à Lonato, la croyait partout. On avait ainsi presque désorganisé les divisions Bayalitsch et Liptai, qui se repliaient sur Wurmser. Ce général arrivait en ce moment avec quinze mille hommes, pour rallier à lui les deux divisions battues, et commençait à s'étendre dans les plaines de Castiglione. Bonaparte le vit, le lendemain matin 17 (4 août), se mettre en ligne pour recevoir le combat. Il résolut de l'aborder de nouveau, et de lui livrer une dernière bataille, qui devait décider du sort de l'Italie. Mais pour cela il fallait réunir à Castiglione toutes les troupes disponibles. Il remit donc au lendemain 18 (5 août) cette bataille décisive. Il repartit au galop pour Lonato, afin d'activer lui-même le mouvement de ses troupes. Il avait en quelques jours crevé cinq chevaux. Il ne s'en fiait à personne de l'exécution de ses ordres; il voulait tout voir, tout vérifier de ses yeux, tout animer de sa présence. C'est ainsi qu'une grande âme se communique à une vaste masse, et la remplit de son feu. Il arriva à Lonato au milieu du jour. Déjà ses ordres s'exécutaient; une partie des troupes était en marche sur Castiglione; les autres se portaient vers Salo et Gavardo. Il restait tout au plus mille hommes à Lonato. A peine Bonaparte y est-il entré, qu'un parlementaire autrichien se présente, et vient le sommer de se rendre. Le général surpris ne comprend pas d'abord comment il est possible qu'il soit en présence des Autrichiens. Cependant il se l'explique bientôt. La division coupée la veille à la bataille de Lonato, et rejetée sur Salo, avait été prise en partie; mais un corps de quatre mille hommes à peu près avait erré toute la nuit dans les montagnes, et voyant Lonato presque abandonné, cherchait à y rentrer pour s'ouvrir une issue sur le Mincio. Bonaparte n'avait qu'un millier d'hommes à lui opposer, et surtout n'avait pas le temps de livrer un combat. Sur-le-champ il fait monter à cheval tout ce qu'il avait d'officiers autour de lui. Il ordonne qu'on amène le parlementaire, et qu'on lui débande les yeux. Celui-ci est saisi d'étonnement en voyant ce nombreux état-major. «Malheureux, lui dit Bonaparte, vous ne savez donc pas que vous êtes en présence du général en chef, et qu'il est ici avec toute son armée! Allez dire à ceux qui vous envoient, que je leur donne cinq minutes pour se rendre, ou que je les ferai passer au fil de l'épée, pour les punir de l'outrage qu'ils osent me faire.» Sur-le-champ il fait approcher son artillerie, menaçant de faire feu sur les colonnes qui s'avancent. Le parlementaire va rapporter cette réponse, et les quatre mille hommes mettent bas les armes devant mille. Bonaparte, sauvé par cet acte de présence d'esprit, donna ses ordres pour la lutte qui allait se livrer. Il joignit de nouvelles troupes à celles qui étaient déjà dirigées sur Salo. La division Despinois fut réunie à la division Sauret, et toutes deux profitant de l'ascendant de la victoire, durent attaquer Quasdanovich, et le rejeter définitivement dans les montagnes. Il ramena tout le reste à Castiglione. Il y revint dans la nuit, ne prit pas un instant de repos, et après avoir changé de cheval, courut sur le champ de bataille, afin de faire ses dispositions. Cette journée allait décider du destin de l'Italie.
C'était dans la plaine de Castiglione qu'on allait combattre. Une suite de hauteurs, formées par les derniers bancs des Alpes, se prolongent de la Chiesa au Mincio, par Lonato, Castiglione, Solférino. Au pied de ces hauteurs s'étend la plaine qui allait servir de champ de bataille. Les deux armées y étaient en présence, perpendiculairement à la ligne des hauteurs, à laquelle toutes deux appuyaient une aile. Bonaparte y appuyait sa gauche, Wurmser sa droite. Bonaparte avait vingt-deux mille hommes au plus; Wurmser en comptait trente mille. Ce dernier avait encore un autre avantage; son aile qui était dans la plaine, était couverte par une redoute placée sur le mamelon de Medolano. Ainsi il était appuyé des deux côtés. Pour balancer les avantages du nombre et de la position, Bonaparte comptait sur l'ascendant de la victoire, et sur ses manoeuvres. Wurmser devait tendre à se prolonger par sa droite, qui s'appuyait à la ligne des hauteurs, pour s'ouvrir une communication vers Lonato et Salo. C'est ainsi qu'avait fait Bayalitsch l'avant-veille, et c'est ainsi que devait faire Wurmser, dont tous les voeux devaient avoir pour but la réunion avec son grand détachement. Bonaparte résolut de favoriser ce mouvement dont il espérait tirer un grand parti. Il avait maintenant sous sa main la division Serrurier, qui, poursuivie par Wurmser depuis qu'elle avait quitté Mantoue, n'avait pu jusqu'ici entrer en ligne. Elle arrivait par Guidizzolo. Bonaparte lui ordonna de déboucher vers Cauriana, sur les derrières de Wurmser. Il attendait son feu pour commencer le combat.
Dès la pointe du jour, les deux armées entrèrent en action. Wurmser, impatient d'attaquer, ébranla sa droite le long des hauteurs; Bonaparte, pour favoriser ce mouvement, replia sa gauche, qui était formée par la division Masséna; il maintint son centre immobile dans la plaine. Bientôt il entendit le feu de Serrurier. Alors, tandis qu'il continuait à replier sa gauche, et que Wurmser continuait à prolonger sa droite, il fit attaquer la redoute de Medolano. Il dirigea d'abord vingt pièces d'artillerie légère sur cette redoute, et, après l'avoir vivement canonnée, il détacha le général Verdier, avec trois bataillons de grenadiers, pour l'emporter. Ce brave général s'avança, appuyé par un régiment de cavalerie, et enleva la redoute. Le flanc gauche des Autrichiens fut alors découvert, à l'instant même où Serrurier, arrivé à Cauriana, répandait l'alarme sur leurs derrières. Wurmser jeta aussitôt une partie de sa seconde ligne à sa gauche, privée d'appui, et la plaça en potence pour faire face aux Français qui débouchaient de Medolano. Il porta le reste de sa seconde ligne en arrière, pour couvrir Cauriana, et continua ainsi à faire tête à l'ennemi. Mais Bonaparte, saisissant le moment avec sa promptitude accoutumée, cesse aussitôt de refuser sa gauche et son centre; il donne à Masséna et Augereau le signal qu'ils attendaient impatiemment. Masséna, avec la gauche, Augereau, avec le centre, fondent sur la ligne affaiblie des Autrichiens, et la chargent avec impétuosité. Attaquée si brusquement sur tout son front, menacée sur sa gauche et ses derrières, elle commence à céder le terrain. L'ardeur des Français redouble. Wurmser, voyant son armée compromise, donne alors le signal de la retraite. On le poursuit en lui faisant des prisonniers. Pour le mettre dans une déroute complète, il fallait redoubler de célérité, et le pousser en désordre sur le Mincio. Mais, depuis six jours, les troupes marchaient et se battaient sans relâche; elles ne pouvaient plus avancer, et couchèrent sur le champ de bataille. Wurmser n'avait perdu que deux mille hommes ce jour-là, mais il n'en avait pas moins perdu l'Italie.
Le lendemain Augereau se porta au pont de Borghetto, et Masséna devant Peschiera. Augereau engagea une canonnade qui fut suivie de la retraite des Autrichiens; et Masséna livra un combat d'arrière-garde à la division qui avait masqué Peschiera. Le Mincio fut abandonné par Wurmser; il reprit la route de Rivoli, entre l'Adige et le lac de Garda, pour rentrer dans le Tyrol. Masséna le suivit à Rivoli, à la Corona, et reprit ses anciennes positions. Augereau se présenta devant Vérone. Le provéditeur vénitien, pour donner aux Autrichiens le temps d'évacuer la ville et de sauver leurs bagages, demandait deux heures de temps avant d'ouvrir les portes; Bonaparte les fit enfoncer à coups de canon. Les Véronais, qui étaient dévoués à la cause de l'Autriche, et qui avaient manifesté hautement leurs sentimens au moment de la retraite des Français, craignaient le courroux du vainqueur; mais il fit observer à leur égard les plus grands ménagemens.
Du côté de Salo et de la Chiesa, Quasdanovich faisait une retraite pénible par derrière le lac de Garda. Il voulut s'arrêter et défendre le défilé dit la Rocca-d'Anfo; mais il fut battu, et perdit douze cents hommes. Bientôt les Français eurent repris toutes leurs anciennes positions.
Cette campagne avait duré six jours; et dans ce court espace de temps, trente et quelques mille hommes en avaient mis soixante mille hors de combat. Wurmser avait perdu vingt mille hommes, dont sept à huit mille tués ou blessés, et douze ou treize mille prisonniers. Il était rejeté dans les montagnes, et réduit à l'impossibilité de tenir la campagne. Ainsi s'était évanouie cette formidable expédition, devant une poignée de braves. Ces résultats extraordinaires et inouïs dans l'histoire étaient dus à la promptitude et à la vigueur de résolution du jeune chef. Tandis que deux armées redoutables couvraient les deux rives du lac de Garda, et que tous les courages étaient ébranlés, il avait su réduire toute la campagne à une seule question, la jonction de ces deux armées à la pointe du lac de Garda; il avait su faire un grand sacrifice, celui du blocus de Mantoue, pour se concentrer au point décisif; et, frappant alternativement des coups terribles sur chacune des masses ennemies, à Salo, à Lonato, à Castiglione, il les avait successivement désorganisées et rejetées dans les montagnes d'où elles étaient sorties.
Les Autrichiens étaient saisis d'effroi; les Français transportés d'admiration pour leur jeune chef. La confiance et le dévouement en lui étaient au comble. Un bataillon pouvait en faire fuir trois. Les vieux soldats qui l'avaient nommé caporal à Lodi, le firent sergent à Castiglione. En Italie la sensation fut profonde. Milan, Bologne, Ferrare, les villes du duché de Modène, et tous les amis de la liberté, furent transportés de joie. La douleur se répandit dans les couvens et chez toutes les vieilles aristocraties. Les gouvernemens qui avaient fait des imprudences, Venise, Rome, Naples, étaient épouvantés.
Bonaparte, jugeant sainement sa position, ne crut pas la lutte terminée, quoiqu'il eût enlevé à Wurmser vingt mille hommes. Le vieux maréchal se retirait dans les Alpes avec quarante mille. Il allait les reposer, les rallier, les recruter, et il était à présumer qu'il fondrait encore une fois sur l'Italie. Bonaparte avait perdu quelques mille hommes, prisonniers, tués ou blessés; il en avait beaucoup dans les hôpitaux: il jugea qu'il fallait temporiser encore, avoir toujours les yeux sur le Tyrol, et les pieds sur l'Adige, et se contenter d'imposer aux puissances italiennes, en attendant qu'il eût le temps de les châtier. Il se contenta d'apprendre aux Vénitiens qu'il était instruit de leurs armemens, et continua à se faire nourrir à leurs frais, ajournant encore les négociations pour une alliance. Il avait appris l'arrivée à Ferrare d'un légat du pape, qui était venu pour reprendre possession des légations; il le manda à son quartier-général. Ce légat, qui était le cardinal Mattei, tomba à ses pieds en disant: Peccavi. Bonaparte le mit aux arrêts dans un séminaire. Il écrivit à M. d'Azara, qui était son intermédiaire auprès des cours de Rome et de Naples; il se plaignit à lui de l'imbécillité et de la mauvaise foi du gouvernement papal, et lui annonça son intention de revenir bientôt sur ses derrières, si on l'y obligeait. Quant à la cour de Naples, il prit le langage le plus menaçant. «Les Anglais, dit-il à M. d'Azara, ont persuadé au roi de Naples qu'il était quelque chose; moi, je lui prouverai qu'il n'est rien. S'il persiste, au mépris de l'armistice, à se mettre sur les rangs, je prends l'engagement, à la face de l'Europe, de marcher contre ses prétendus soixante-dix mille hommes avec six mille grenadiers, quatre mille chevaux, et cinquante pièces de canon.»
Il écrivit une lettre polie, mais ferme, au duc de Toscane, qui avait laissé occuper aux Anglais Porto-Ferrajo, et lui dit que la France pourrait le punir de cette négligence en occupant ses états, mais qu'elle voulait bien n'en rien faire, en considération d'une ancienne amitié. Il changea la garnison de Livourne, afin d'imposer à la Toscane par un mouvement de troupes. Il se tut avec Gênes. Il écrivit une lettre vigoureuse au roi de Piémont, qui souffrait les Barbets dans ses états, et fit partir une colonne de douze cents hommes avec une commission militaire ambulante, pour saisir et fusiller les Barbets trouvés sur les routes. Le peuple de Milan avait montré les dispositions les plus amicales aux Français. Il lui adressa une lettre délicate et noble, pour le remercier. Ses dernières victoires lui donnant des espérances plus fondées de conserver l'Italie, il crut pouvoir s'engager davantage avec les Lombards; il leur accorda des armes, et leur permit de lever une légion à leur solde, dans laquelle s'enrôlèrent en foule les Italiens attachés à la liberté, et les Polonais errans en Europe depuis le dernier partage. Bonaparte témoigna sa satisfaction aux peuples de Bologne et de Ferrare. Ceux de Modène demandaient à être affranchis de la régence établie par leur duc; Bonaparte avait déjà quelques motifs de rompre l'armistice, car la régence avait fait passer des vivres à la garnison de Mantoue. Il voulut attendre encore. Il demanda des secours au directoire pour réparer ses pertes, et se tint à l'entrée des gorges du Tyrol, prêt à fondre sur Wurmser, et à détruire les restes de son armée, dès qu'il apprendrait que Moreau avait passé le Danube.
Pendant que ces grands événemens se passaient en Italie, il s'en préparait d'autres sur le Danube. Moreau avait poussé l'archiduc pied à pied, et était arrivé dans le milieu de thermidor (premiers jours d'août) sur le Danube. Jourdan se trouvait sur la Naab, qui tombe dans ce fleuve. La chaîne de l'Alb, qui sépare le Necker du Danube, se compose de montagnes de moyenne hauteur, terminées en plateaux, traversées par des défilés étroits comme des fissures de rochers. C'est par ces défilés que Moreau avait débouché sur le Danube, dans un pays inégal, coupé de ravins et couvert de bois. L'archiduc, qui nourrissait le dessein de se concentrer sur le Danube, et de reprendre force sur cette ligne puissante, forma tout à coup une résolution qui faillit compromettre ses sages projets. Il apprenait que Wartensleben, au lieu de se replier sur lui, le plus près possible de Donawert, se repliait vers la Bohême, dans la sotte pensée de la couvrir; il craignait que, profitant de ce faux mouvement, qui découvrait le Danube, l'armée de Sambre-et-Meuse ne voulût en tenter le passage. Il voulait donc le passer lui-même, pour filer rapidement sur l'autre rive, et aller faire tête à Jourdan. Mais le fleuve était encombré de ses magasins, et il lui fallait encore du temps pour les faire évacuer; il ne voulait pas d'ailleurs exécuter le passage sous les yeux de Moreau et trop près de ses coups, et il songea à l'éloigner en lui livrant la bataille avec le Danube à dos: mauvaise pensée dont il s'est blâmé sévèrement depuis, car elle l'exposait à être jeté dans le fleuve, ou du moins à ne pas y arriver entier, condition indispensable pour le succès de ses projets ultérieurs.
Le 24 thermidor (11 août), il s'arrêta devant les positions de Moreau, pour lui livrer une attaque générale. Moreau était à Neresheim, tenant les positions de Dunstelkingen et de Dischingen par sa droite et son centre, et celle de Nordlingen par sa gauche. L'archiduc, voulant d'abord l'écarter du Danube, puis le couper, s'il était possible, des montagnes par lesquelles il avait débouché, et enfin l'empêcher de communiquer avec Jourdan, l'attaqua, pour arriver à toutes ses fins, sur tous les points à la fois. Il parvint à tourner la droite de Moreau, en dispersant ses flanqueurs; il s'avança jusqu'à Heidenheim, presque sur ses derrières, et y jeta une telle alarme, que tous les parcs rétrogradèrent. Au centre, il tenta une attaque vigoureuse, mais qui ne fut pas assez décisive. A la gauche, vers Nordlingen, il fit des démonstrations menaçantes. Moreau ne s'intimida ni des démonstrations faites à sa gauche, ni de l'excursion derrière sa droite; et, jugeant avec raison que le point essentiel était au centre, fit le contraire de ce que font les généraux ordinaires, toujours alarmés lorsqu'on menace de les déborder; il affaiblit ses ailes au profit du centre. Sa prévision était juste; car l'archiduc, redoublant d'efforts au centre vers Dunstelkingen, fut repoussé avec perte. On coucha de part et d'autre sur le champ de bataille.
Le lendemain, Moreau se trouva fort embarrassé par le mouvement rétrograde de ses parcs, qui le laissait sans munitions. Cependant il pensa qu'il fallait payer d'audace, et faire mine de vouloir attaquer. Mais l'archiduc, pressé de repasser le Danube, n'avait nulle envie de recommencer le combat: il fit sa retraite avec beaucoup de fermeté sur le fleuve, le repassa sans être inquiété par Moreau, et en coupa les ponts jusqu'à Donawerth. Là, il apprit ce qui s'était passé entre les deux armées qui avaient opéré par le Mein. Wartensleben ne s'était pas jeté en Bohême comme il le craignait, il était resté sur la Naab, en présence de Jourdan. Le jeune prince autrichien forma une résolution très belle, qui était la conséquence de sa longue retraite, et qui était propre à décider la campagne. Son but, en se repliant sur le Danube, avait été de s'y concentrer, pour être en mesure d'agir sur l'une ou sur l'autre des deux armées françaises, avec une masse supérieure de forces. La bataille de Neresheim aurait pu compromettre ce plan, si, au lieu d'être incertaine, elle avait été tout à fait malheureuse. Mais s'étant retiré entier sur le Danube, il pouvait maintenant profiter de l'isolement des armées françaises, et tomber sur l'une des deux. En conséquence, il résolut de laisser le général Latour avec trente-six mille hommes pour occuper Moreau, et de se porter de sa personne avec vingt-cinq mille vers Wartensleben, afin d'accabler Jourdan par cette réunion de forces. L'armée de Jourdan était la plus faible des deux. A une aussi grande distance de sa base, elle ne comptait guère plus de quarante-cinq mille hommes. Il était évident qu'elle ne pourrait pas résister, et qu'elle allait même se trouver exposée à de grands désastres. Jourdan, étant battu et ramené sur le Rhin, Moreau, de son côté, ne pouvait rester en Bavière, et l'archiduc pouvait même se porter sur le Necker et le prévenir sur sa ligne de retraite. Cette conception si juste a été regardée comme la plus belle dont puissent s'honorer les généraux autrichiens pendant ces longues guerres; comme celles qui dans le moment signalaient le génie de Bonaparte en Italie, elle appartenait à un jeune homme.
L'archiduc partit d'Ingolstadt le 29 thermidor (16 août), cinq jours après la bataille de Neresheim. Jourdan, placé sur la Naab, entre Naabourg et Schwandorff, ne s'attendait pas à l'orage qui se préparait sur sa tête. Il avait détaché le général Bernadotte à Neumark, sur sa droite, de manière à se mettre en communication avec Moreau; objet impossible à remplir, et pour lequel un corps détaché était inutilement compromis. Ce fut contre ce détachement que l'archiduc, arrivant du Danube, devait donner nécessairement. Le général Bernadotte, attaqué par des forces supérieures, fit une résistance honorable, mais fut obligé de repasser rapidement les montagnes par lesquelles l'armée avait débouché de la vallée du Mein dans celle du Danube. Il se retira à Nuremberg. L'archiduc, après avoir jeté un corps à sa poursuite, se porta avec le reste de ses forces sur Jourdan. Celui-ci, prévenu de l'arrivée d'un renfort, averti du danger qu'avait couru Bernadotte, et de sa retraite sur Nuremberg, se disposa à repasser aussi les montagnes. Au moment où il se mettait en marche, il fut attaqué à la fois par l'archiduc et par Wartensleben; il eut un combat difficile à soutenir à Amberg, et perdit sa route directe vers Nuremberg. Jeté avec ses parcs, sa cavalerie et son infanterie, dans des routes de traverse, il courut de grands dangers, et fit, pendant huit jours, une retraite des plus difficiles et des plus honorables pour les troupes et pour lui. Il se retrouva sur le Mein, à Schweinfurt, le 12 fructidor (29 août), se proposant de se diriger sur Wurtzbourg, pour y faire halte, y rallier ses corps, et tenter de nouveau le sort des armes.
Pendant que l'archiduc exécutait ce beau mouvement sur l'armée de Sambre-et-Meuse, il fournissait à Moreau l'occasion d'en exécuter un pareil, aussi beau et aussi décisif. L'ennemi ne tente jamais une hardiesse sans se découvrir, et sans ouvrir de belles chances à son adversaire. Moreau, n'ayant plus que trente-huit mille hommes devant lui, pouvait facilement les accabler, en agissant avec un peu de vigueur. Il pouvait mieux (au jugement de Napoléon et de l'archiduc Charles), il pouvait tenter un mouvement dont les résultats auraient été immenses. Il devait lui-même suivre la marche de l'ennemi, se rabattre sur l'archiduc, comme ce prince se rabattait sur Jourdan, et arriver à l'improviste sur ses derrières. L'archiduc, pris entre Jourdan et Moreau, eût couru des dangers incalculables. Mais, pour cela, il fallait exécuter un mouvement très étendu, changer tout à coup sa ligne d'opération, se jeter du Necker sur le Mein; il fallait surtout manquer aux instructions du directoire, qui prescrivaient de s'appuyer au Tyrol, afin de déborder les flancs de l'ennemi et de communiquer avec l'armée d'Italie. Le jeune vainqueur de Castiglione n'aurait pas hésité à faire cette marche hardie, et à commettre une désobéissance, qui aurait décidé la campagne d'une manière victorieuse; mais Moreau était incapable d'une pareille détermination. Il resta plusieurs jours sur les bords du Danube, ignorant le départ de l'archiduc, et explorant lentement un terrain qui était alors peu connu. Ayant appris enfin le mouvement qui venait de s'opérer, il conçut des inquiétudes pour Jourdan; mais, n'osant prendre aucune détermination vigoureuse, il se décida à franchir le Danube, et à s'avancer en Bavière, pour essayer par là de ramener l'archiduc à lui, tout en restant fidèle au plan du directoire. Il était cependant aisé de juger que l'archiduc ne quitterait pas Jourdan avant de l'avoir mis hors de combat, et ne se laisserait pas détourner de l'exécution d'un vaste plan, par une excursion en Bavière. Moreau n'en passa pas moins le Danube, à la suite de Latour, et s'approcha du Lech. Latour fit mine de disputer le passage du Lech; mais, trop étendu pour s'y soutenir, il fut obligé de l'abandonner, après avoir essuyé un combat malheureux à Friedberg. Moreau s'approcha ensuite de Munich; il se trouvait le 15 fructidor (1er septembre) à Dachau, Pfaffenhofen et Geisenfeld.
Ainsi la fortune commençait à nous être moins favorable en Allemagne, par l'effet d'un plan vicieux qui, séparant nos armées, les exposait à être battues isolément. D'autres résultats se préparaient encore en Italie.
On a vu que Bonaparte, après avoir rejeté les Autrichiens dans le Tyrol, et repris ses anciennes positions sur l'Adige, méditait de nouveaux projets contre Wurmser, auquel il n'était pas content d'avoir détruit vingt mille hommes, et dont il voulait ruiner entièrement l'armée. Cette opération était indispensable pour l'exécution de tous ses desseins en Italie. Wurmser détruit, il pourrait faire une pointe jusqu'à Trieste, ruiner ce point si important pour l'Autriche, revenir ensuite sur l'Adige, faire la loi à Venise, à Rome et à Naples, dont la malveillance était toujours aussi manifeste, et donner enfin le signal de la liberté en Italie, en constituant la Lombardie, les légations de Bologne et de Ferrare, peut-être même le duché de Modène, en république indépendante. Il résolut donc, pour accomplir tous ces projets, de monter dans le Tyrol, certain aujourd'hui d'être secondé par la présence de Moreau sur l'autre versant des Alpes.
Pendant que les troupes françaises employaient une vingtaine de jours à se reposer, Wurmser réorganisait et renforçait les siennes. De nouveaux détachemens venus de l'Autriche, et les milices tyroliennes, lui permirent de porter son armée à près de cinquante mille hommes. Le conseil aulique lui envoya un autre chef d'état-major, le général du génie Laüer, avec de nouvelles instructions sur le plan à suivre pour enlever la ligne de l'Adige. Wurmser devait laisser dix-huit ou vingt mille hommes sous Davidovich, pour garder le Tyrol, et descendre avec le reste, par la vallée de la Brenta, dans les plaines du Vicentin et du Padouan. La Brenta prend naissance non loin de Trente, s'éloigne de l'Adige en forme de courbe, redevient parallèle à ce fleuve dans la plaine, et va finir dans l'Adriatique. Une chaussée, partant de Trente, conduit dans la vallée de la Brenta, et vient aboutir, par Bassano, dans les plaines du Vicentin et du Padouan. Wurmser devait parcourir cette vallée pour déboucher dans la plaine, et venir tenter le passage de l'Adige, entre Vérone et Legnago. Ce plan n'était pas mieux conçu que le précédent, car il avait toujours l'inconvénient de diviser les forces en deux corps, et de mettre Bonaparte au milieu.
Wurmser entrait en action, dans le même moment que Bonaparte. Celui-ci ignorant les projets de Wurmser, mais prévoyant avec une sagacité rare, que, pendant son excursion au fond du Tyrol, il serait possible que l'ennemi vînt tâter la ligne de l'Adige, de Vérone à Legnago, laissa le général Kilmaine à Vérone avec une réserve de près de trois mille hommes, et avec tous les moyens de résister pendant deux jours au moins. Le général Sahuguet resta avec une division de huit mille hommes devant Mantoue. Bonaparte partit avec vingt-huit mille, et remonta par les trois routes du Tyrol, celle qui circule derrière le lac de Garda, et les deux qui longent l'Adige. Le 17 fructidor (3 septembre), la division Sauret, devenue division Vaubois, après avoir circulé par derrière le lac de Garda, et livré plusieurs combats, arriva à Torbole, la pointe supérieure du lac. Le même jour, les divisions Masséna et Augereau, qui longeaient d'abord les deux rives de l'Adige, et qui s'étaient ensuite réunies sur la même rive par le pont de Golo, arrivèrent devant Seravalle. Elles livrèrent un combat d'avant-garde, et firent quelques prisonniers à l'ennemi.
Les Français avaient à remonter maintenant une vallée étroite et profonde: à leur gauche était l'Adige, à leur droite des montagnes élevées. Souvent le fleuve, serrant le pied des montagnes, ne laissait que la largeur de la chaussée, et formait ainsi d'affreux défilés à franchir. Il y en avait plus d'un de ce genre, pour pénétrer dans le Tyrol. Mais les Français, audacieux et agiles, étaient aussi propres à cette guerre qu'à celle qu'ils venaient de faire dans les vastes plaines du Mantouan.
Davidovich avait placé deux divisions, l'une au camp de Mori, sur la rive droite de l'Adige, pour faire tête à la division Vaubois qui remontait la chaussée de Salo à Roveredo, par derrière le lac de Garda: l'autre à San-Marco, sur la rive gauche, pour garder le défilé contre Masséna et Augereau. Le 18 fructidor (4 septembre), on se trouva en présence. C'était la division Wukassovich qui défendait le défilé de San-Marco. Bonaparte, saisissant sur-le-champ le genre de tactique convenable aux lieux, forme deux corps d'infanterie légère, et les distribue à droite et à gauche, sur les hauteurs environnantes; puis, quand il a fatigué quelque temps les Autrichiens, il forme la dix-huitième demi-brigade en colonne serrée par bataillons, et ordonne au général Victor de percer avec elle le défilé. Un combat violent s'engage; les Autrichiens résistent d'abord; mais Bonaparte décide l'action, en ordonnant au général Dubois de charger à la tête des hussards. Ce brave général fond sur l'infanterie autrichienne, la rompt, et tombe percé de trois balles. On l'emporte expirant. «Avant que je meure, dit-il à Bonaparte, faites-moi savoir si nous sommes vainqueurs. » De toutes parts les Autrichiens fuient et se retirent à Roveredo, situé à une lieue de Marco; on les poursuit au pas de course. Roveredo est à une certaine distance de l'Adige; Bonaparte dirige Rampon, avec la trente-deuxième, vers l'espace qui sépare le fleuve de la ville; il porte Victor, avec la dix-huitième, sur la ville même. Celui-ci entre au pas de charge dans la grande rue de Roveredo, balaie les Autrichiens devant lui, et arrive à l'autre extrémité de la ville, à l'instant où Rampon en achevait le circuit extérieur. Pendant que l'armée principale emportait ainsi San-Marco et Roveredo, la division Vaubois arrivait à Roveredo par l'autre rive de l'Adige. La division autrichienne de Reuss lui avait disputé le camp de Mori, mais Vaubois venait de l'emporter à l'instant même, et toutes les divisions se trouvaient réunies maintenant au milieu du jour à la hauteur de Roveredo, sur les deux rives du fleuve. Mais le plus difficile restait à faire.
Davidovich avait rallié ses deux divisions sur sa réserve, dans le défilé de Calliano, défilé redoutable et bien autrement dangereux que celui de Marco. Sur ce point, l'Adige, serrant les montagnes, ne laissait, entre son lit et leur pied, que la largeur de la chaussée. L'entrée du défilé était fermée par le château de la Pietra, qui joignait la montagne au fleuve, et qui était couronné d'artillerie.
Bonaparte, persistant dans sa tactique, distribue son infanterie légère à droite, sur les escarpemens de la montagne, et à gauche, sur les bords du fleuve. Ses soldats, nés sur les bords du Rhône, de la Seine ou de la Loire, égalent l'agilité et la hardiesse des chasseurs des Alpes. Les uns gravissent de rochers en rochers, atteignent le sommet de la montagne, et font un feu plongeant sur l'ennemi; les autres, non moins intrépides, se glissent le long du fleuve, appuient le pied partout où ils peuvent se soutenir, et tournent le château de la Pietra. Le général Dammartin place avec bonheur une batterie d'artillerie légère qui fait le meilleur effet; le château est enlevé. Alors l'infanterie le traverse, et fond en colonne serrée sur l'armée autrichienne amassée dans le défilé. Artillerie, cavalerie, infanterie, se confondent, et fuient dans un désordre épouvantable. Le jeune Lamarois, aide-de-camp du général en chef, veut prévenir la fuite des Autrichiens; il se précipite au galop à la tête de cinquante hussards, traverse dans toute sa longueur la masse autrichienne, et, tournant bride sur-le-champ, fait effort pour en arrêter la tête. Il est renversé de cheval, mais il répand la terreur dans les rangs autrichiens, et donne le temps à la cavalerie, qui accourait, de recueillir plusieurs mille prisonniers. Là finit cette suite de combats, qui valurent à l'armée française les défilés du Tyrol, la ville de Roveredo, toute l'artillerie autrichienne, quatre mille prisonniers, sans compter les morts et les blessés. Bonaparte appela cette journée bataille de Roveredo.
Le lendemain 19 fructidor (5 septembre), les Français entrèrent à Trente, capitale du Tyrol italien. L'évêque avait fui. Bonaparte, pour calmer les Tyroliens, qui étaient fort attachés à la maison d'Autriche, leur adressa une proclamation, dans laquelle il les invitait à poser les armes, et à ne point commettre d'hostilités contre son armée, leur promettant qu'à ce prix leurs propriétés et leurs établissements publics seraient respectés. Wurmser n'était plus à Trente. Bonaparte l'avait surpris à l'instant où il se mettait en marche pour exécuter son plan. En voyant les Français s'engager dans le Tyrol pour communiquer peut-être avec l'Allemagne, Wurmser n'en fut que plus disposé à descendre par la Brenta, pour emporter l'Adige pendant leur absence. Il espérait même, par ce circuit rapide, qui allait l'amener à Vérone, enfermer les Français dans la haute vallée de l'Adige, et, tout à la fois, les envelopper et les couper de Mantoue. Il était parti l'avant-veille et devait être déjà rendu à Bassano; Bonaparte forme sur-le-champ une résolution des plus hardies: il va laisser Vaubois à la garde du Tyrol, et se jeter à travers les gorges de la Brenta, à la suite de Wurmser. Il ne peut emmener avec lui que vingt mille hommes, et Wurmser en a trente; il peut être enfermé dans ces gorges épouvantables, si Wurmser lui tient tête; il peut aussi arriver trop tard pour tomber sur les derrières de Wurmser, et celui-ci peut avoir eu le temps de forcer l'Adige: tout cela est possible. Mais ses vingt mille hommes en valent trente; mais si Wurmser veut lui tenir tête et l'enfermer dans les gorges, il lui passera sur le corps; mais s'il a vingt lieues à faire, il les fera en deux jours, et arrivera dans la plaine aussitôt que Wurmser. Alors il le rejettera ou sur Trieste, ou sur l'Adige. S'il le rejette sur Trieste, il le poursuivra et ira brûler ce port sous ses yeux; s'il le rejette sur l'Adige, il l'enfermera entre son armée et ce fleuve, et enveloppera ainsi l'ennemi, qui croyait le prendre dans les gorges du Tyrol.
Ce jeune homme, dont la pensée et la volonté sont aussi promptes que la foudre, ordonne à Vaubois, le jour même de son arrivée à Trente, de se porter sur le Lavis, pour enlever cette position à l'arrière-garde de Davidovich. Il fait exécuter cette opération sous ses yeux, indique à Vaubois la position qu'il doit garder avec ses dix mille hommes, et part ensuite avec les vingt autres, pour se jeter à travers les gorges de la Brenta.
Il part le 20 au matin (6 septembre); il couche le soir à Levico. Le lendemain 21 (7), il se remet en marche le matin, et arrive devant un nouveau défilé, dit de Primolano, où Wurmser avait placé une division. Bonaparte emploie les mêmes manoeuvres, jette des tirailleurs sur les hauteurs et sur le bord de la Brenta, puis fait charger en colonne sur la route. On enlève le défilé. Un petit fort se trouvait au delà, on l'entoure et on s'en rend maître. Quelques soldats intrépides courant sur la route, y devancent les fugitifs, les arrêtent, et donnent à l'armée le temps d'arriver pour les prendre. On fait trois mille prisonniers. On arrive le soir à Cismone, après avoir fait vingt lieues en deux jours. Bonaparte voudrait avancer encore, mais les soldats n'en peuvent plus; lui-même est accablé de fatigue. Il a devancé son quartier-général, il n'a ni suite ni vivres; il partage le pain de munition d'un soldat, et se couche, en attendant avec impatience le lendemain.
Cette marche foudroyante et inattendue frappe Wurmser d'étonnement. Il ne conçoit pas que son ennemi se soit jeté dans ces gorges, au risque d'y être enfermé; il se propose de profiter de la position de Bassano qui les ferme, et d'en barrer le passage avec toute son armée. S'il réussit à y tenir, Bonaparte est pris dans la courbe de la Brenta. Déjà il avait envoyé la division De Mezaros pour tâter Vérone, mais il la rappelle pour lutter ici avec toutes ses forces; cependant il n'est pas probable que l'ordre arrive à temps. La ville de Bassano est située sur la rive gauche de la Brenta. Elle communique avec la rive droite par un pont. Wurmser place les deux divisions Sebottendorff et Quasdanovich sur les deux rives de la Brenta, en avant de la ville. Il dispose six bataillons en avant garde dans les défilés qui précèdent Bassano, et qui ferment la vallée.
Le 22 (8 septembre), au matin, Bonaparte part de Cismone, et s'avance sur Bassano; Masséna marche sur la rive droite, Augereau sur la gauche. On emporte les défilés, et on débouche en présence de l'armée ennemie, rangée sur les deux rives de la Brenta. Les soldats de Wurmser, déconcertés par l'audace des Français, ne résistent pas avec le courage qu'ils ont montré en tant d'occasions; ils s'ébranlent, se rompent, et entrent dans Bassano. Augereau se présente à l'entrée de la ville. Masséna, qui est sur la rive opposée, veut pénétrer par le pont; il l'enlève en colonne serrée, comme celui de Lodi, et entre en même temps qu'Augereau. Wurmser, dont le quartier-général était encore dans la ville, n'a que le temps de se sauver, en nous laissant quatre mille prisonniers et un matériel immense. Le plan de Bonaparte était donc réalisé; il avait débouché dans la plaine aussitôt que Wurmser, et il lui restait maintenant à l'envelopper, en l'acculant sur l'Adige.
Wurmser, dans le désordre d'une action si précipitée, se trouve séparé des restes de la division Quasdanovich. Cette division se retire vers le Frioul, et lui, se voyant pressé par les divisions Masséna et Augereau, qui lui ferment la route du Frioul et le replient vers l'Adige, forme la résolution de passer l'Adige de vive force, et d'aller se jeter dans Mantoue. Il avait rallié à lui la division De Mezaros, qui venait de faire de vains efforts pour emporter Vérone. Il ne comptait plus que quatorze mille hommes, dont huit d'infanterie et six de cavalerie excellente. Il longe l'Adige, et fait chercher partout un passage. Heureusement pour lui, le poste qui gardait Legnago avait été transporté à Vérone, et un détachement, qui devait venir occuper cette place, n'était point encore arrivé. Wurmser, profitant de ce hasard, s'empare de Legnago. Certain maintenant de pouvoir regagner Mantoue, il accorde quelque repos à ses troupes, qui étaient abîmées de fatigue.
Bonaparte le suivait sans relâche: il fut cruellement déçu en apprenant la négligence qui sauvait Wurmser; cependant il ne désespéra pas encore de le prévenir à Mantoue. Il porta la division Masséna sur l'autre rive de l'Adige par le bac de Ronco, et la dirigea sur Sanguinetto, pour barrer le chemin de Mantoue, il dirigea Augereau vers Legnago même. L'avant-garde de Masséna, devançant sa division, entra dans Céréa le 25 (11 septembre), au moment où Wurmser y arrivait de Legnago avec tout son corps d'armée. Cette avant-garde de cavalerie et d'infanterie légère, commandée par les généraux Murat et Pigeon, fit une résistance des plus héroïques, mais fut culbutée: Wurmser lui passa sur le corps, et continua sa marche. Bonaparte arrivait seul au galop au moment de cette action: il manqua être pris, et se sauva en toute hâte.
Wurmser passa à Sanguinetto; puis, apprenant que tous les ponts de la Molinella étaient rompus, excepté celui de Villimpenta, il descendit jusqu'à ce pont, y franchit la rivière, et marcha sur Mantoue. Le général Charton voulut lui résister avec trois cents hommes formés en carré; ces braves gens furent sabrés ou pris. Wurmser arriva ainsi à Mantoue le 27 (13). Ces légers avantages étaient un adoucissement aux malheurs du vieux et brave maréchal. Il se répandit dans les environs de Mantoue, et tint un moment la campagne, grâce à sa nombreuse et belle cavalerie.
Bonaparte arrivait à perte d'haleine, furieux contre les officiers négligens qui lui avaient fait manquer une si belle proie. Augereau était rentré dans Legnago, et avait fait prisonnière la garnison autrichienne, forte de seize cents hommes. Bonaparte ordonna à Augereau de se porter à Governolo, sur le Bas-Mincio. Il livra ensuite de petits combats à Wurmser, pour l'attirer hors de la place; et, dans la nuit du 28 au 29 (14-15 septembre), il prit une position en arrière, pour engager Wurmser à se montrer en plaine. Le vieux général, alléché par ses petits succès, se déploya en effet hors de Mantoue, entre la citadelle et le faubourg de Saint-George. Bonaparte l'attaqua le troisième jour complémentaire an IV (19 septembre). Augereau, venant de Governolo, formait la gauche; Masséna, partant de Due-Castelli, formait le centre, et Sahuguet, avec le corps de blocus, formait la droite. Wurmser avait encore vingt-un mille hommes en ligne. Il fut enfoncé partout, et rejeté dans la place avec une perte de deux mille hommes. Quelques jours après, il fut entièrement renfermé dans Mantoue. La nombreuse cavalerie qu'il avait ramenée ne lui servait à rien, et ne faisait qu'augmenter le nombre des bouches inutiles; il fit tuer et saler tous les chevaux. Il avait vingt et quelques mille hommes de garnison, dont plusieurs mille aux hôpitaux.
Ainsi, quoique Bonaparte eût perdu en partie le fruit de sa marche audacieuse sur la Brenta, et qu'il n'eût pas fait mettre bas les armes au maréchal, il avait entièrement ruiné et dispersé son armée. Quelques mille hommes étaient rejetés dans le Tyrol sous Davidovich; quelques mille fuyaient en Frioul sous Quasdanovich. Wurmser, avec douze ou quatorze mille, s'était enfermé dans Mantoue. Treize ou quatorze mille étaient prisonniers, six ou sept mille tués ou blessés. Ainsi cette armée venait des perdre encore une vingtaine de mille hommes en dix jours, outre un matériel considérable. Bonaparte en avait perdu sept ou huit mille, dont quinze cents prisonniers, et le reste tué, blessé, ou malade. Ainsi, aux armées de Colli et de Beaulieu, détruites en entrant en Italie, il fallait ajouter celle de Wurmser, détruite en deux fois, d'abord dans les plaines de Castiglione, et ensuite sur les rives de la Brenta. Aux trophées de Montenotte, de Lodi, de Borghetto, de Lonato, de Castiglione, il fallait donc joindre ceux de Roveredo, de Bassano et de Saint-George. A quelle époque de l'histoire avait-on vu de si grands résultats, tant d'ennemis tués, tant de prisonniers, de drapeaux, de canons enlevés! Ces nouvelles répandirent de nouveau la joie dans la Lombardie, et la terreur dans le fond de la péninsule. La France fut transportée d'admiration pour le général de l'armée d'Italie.
Nos armes étaient moins heureuses sur les autres théâtres de la guerre. Moreau s'était avancé sur le Lech, comme on l'a vu, dans l'espoir que ses progrès en Bavière ramèneraient l'archiduc et dégageraient Jourdan. Cet espoir était peu fondé, et l'archiduc aurait mal jugé de l'importance de son mouvement, s'il se fût détourné de son exécution pour revenir vers Moreau. Toute la campagne dépendait de ce qui allait se passer sur le Mein. Jourdan battu, et ramené sur le Rhin, les progrès de Moreau ne faisaient que le compromettre davantage, et l'exposer à perdre sa ligne de retraite. L'archiduc se contenta donc de renvoyer le général Nauendorff, avec deux régimens de cavalerie et quelques bataillons, pour renforcer Latour, et continua sa poursuite de l'armée de Sambre-et-Meuse.
Cette brave armée se retirait avec le plus vif regret, et en conservant tout le sentiment de ses forces. C'est elle qui avait fait les plus grandes et les plus belles choses, pendant les premières années de la révolution; c'est elle qui avait vaincu à Watignies, à Fleurus, aux bords de l'Ourthe et de la Roër. Elle avait beaucoup d'estime pour son général, et une grande confiance en elle-même. Cette retraite ne l'avait point découragée, et elle était persuadée qu'elle ne cédait qu'à des combinaisons supérieures, et à la masse des forces ennemies. Elle désirait ardemment une occasion de se mesurer avec les Autrichiens et de rétablir l'honneur de son drapeau. Jourdan le désirait aussi. Le directoire lui écrivait qu'il fallait à tout prix se maintenir en Franconie, sur le Haut-Mein, pour prendre ses quartiers d'hiver en Allemagne, et surtout pour ne pas découvrir Moreau, qui s'était avancé jusqu'aux portes de Munich. Moreau, de son côté, venait d'apprendre à Jourdan, à la date du 8 fructidor (25 août), sa marche au-delà du Lech, les avantages qu'il y avait remportés, et le projet qu'il avait de s'avancer toujours davantage pour ramener l'archiduc. Toutes ces raisons décidèrent Jourdan à tenter le sort des armes, quoiqu'il eût devant lui des forces très supérieures. Il aurait cru manquer à l'honneur s'il eût quitté la Franconie sans combattre, et s'il eût laissé son collègue en Bavière. Trompé d'ailleurs par le mouvement du général Nauendorff, Jourdan croyait que l'archiduc venait de partir pour regagner les bords du Danube. Il s'arrêta donc à Wurtzbourg, place dont il jugeait la conservation importante, mais dont les Français n'avaient conservé que la citadelle. Il y donna quelque repos à ses troupes, fit quelques changemens dans la distribution et le commandement de ses divisions, et annonça l'intention de combattre. L'armée montra la plus grande ardeur à enlever toutes les positions que Jourdan croyait utile d'occuper avant d'engager la bataille. Il avait sa droite appuyée à Wurtzbourg, et le reste de sa ligne sur une suite de positions qui s'étendent le long du Mein jusqu'à Schveinfurt. Le Mein le séparait de l'ennemi. Une partie seulement de l'armée autrichienne avait franchi ce fleuve, ce qui le confirmait dans l'idée que l'archiduc avait rejoint le Danube. Il laissa à l'extrémité de sa ligne la division Lefebvre, à Schveinfurt, pour assurer sa retraite sur la Saale et Fulde, dans le cas où la bataille lui ferait perdre la route de Francfort. Il se privait ainsi d'une seconde ligne et d'un corps de réserve; mais il crut devoir ce sacrifice à la nécessité d'assurer sa retraite. Il se décida à attaquer, le 17 fructidor (3 septembre), au matin.
Dans la nuit du 16 au 17, l'archiduc, averti du projet de son adversaire, fit rapidement passer le reste de son armée au-delà du Mein, et déploya aux yeux de Jourdan des forces très supérieures. La bataille s'engagea d'abord avec succès pour nous; mais notre cavalerie, assaillie dans les plaines qui s'étendent le long du Mein par une cavalerie formidable, fut rompue, se rallia, fut rompue de nouveau, et ne trouva d'abri que derrière les lignes et les feux bien nourris de notre infanterie. Jourdan, si sa réserve n'avait pas été si éloignée de lui, aurait pu remporter la victoire; il envoya à Lefebvre des officiers qui ne purent percer à travers les nombreux escadrons ennemis. Il espérait cependant que Lefebvre, voyant que Schveinfurt n'était pas menacé, marcherait au lieu du péril; mais il attendit vainement, et replia son armée pour la dérober à la redoutable cavalerie de l'ennemi. La retraite se fit en bon ordre sur Arnstein. Jourdan, victime du mauvais plan du directoire, et de son dévouement à son collègue, dut dès lors se replier sur la Lahn. Il continua sa marche sans aucun relâche, donna ordre à Marceau de se retirer de devant Mayence, et arriva derrière la Lahn le 24 fructidor (10 septembre). Son armée, dans cette marche pénible jusqu'aux frontières de la Bohême, n'avait guère perdu que cinq à six mille hommes. Elle fit une perte sensible par la mort du jeune Marceau, qui fut frappé d'une balle par un chasseur tyrolien, et qu'on ne put emporter du champ de bataille. L'archiduc Charles le fit entourer de soins; mais il expira bientôt. Ce jeune héros, regretté des deux armées, fut enseveli au bruit de leur double artillerie.
Pendant que ces choses se passaient sur le Mein, Moreau, toujours au-delà du Danube et du Lech, attendait impatiemment des nouvelles de Jourdan. Aucun des officiers détachés pour lui en donner n'était arrivé. Il tâtonnait sans oser prendre un parti. Dans l'intervalle, sa gauche, sous les ordres de Desaix, eut un combat des plus rudes à soutenir contre la cavalerie de Latour, qui, réunie à celle de Nauendorff, déboucha à l'improviste par Langenbruck. Desaix fit des dispositions si justes et si promptes, qu'il repoussa les nombreux escadrons ennemis, et les dispersa dans la plaine après leur avoir fait subir une perte considérable. Moreau, toujours dans l'incertitude, se décida enfin, après une vingtaine de jours, à tenter un mouvement pour aller à la découverte. Il résolut de s'approcher du Danube, pour étendre son aile gauche jusqu'à Nuremberg, et avoir des nouvelles de Jourdan, ou lui apporter des secours. Le 24 fructidor (10 septembre), il fit repasser le Danube à sa gauche et à son centre, et laissa sa droite seule au-delà de ce fleuve, vers Zell. La gauche, sous Desaix, s'avança jusqu'à Aichstett. Dans cette situation singulière, il étendait sa gauche vers Jourdan, qui dans le moment était à soixante lieues de lui; il avait son centre sur le Danube, et sa droite au-delà, exposant l'un des corps à être détruits, si Latour avait su profiter de leur isolement. Tous les militaires ont reproché à Moreau ce mouvement, comme un de ces demi-moyens qui ont tous les dangers des grands moyens, sans en avoir les avantages. Moreau n'ayant pas, en effet, saisi l'occasion de se rabattre vivement sur l'archiduc, lorsque celui-ci se rabattait sur Jourdan, ne pouvait plus que se compromettre en se plaçant ainsi à cheval sur le Danube.
Enfin, après quatre jours d'attente dans cette position singulière, il en sentit le danger, se reporta au-delà du Danube, et songea à le remonter pour se rapprocher de sa base d'opération. Il apprit alors la retraite forcée de Jourdan sur la Lahn, et ne douta plus qu'après avoir ramené l'armée de Sambre-et-Meuse, l'archiduc ne volât sur le Necker, pour fermer le retour à l'armée du Rhin. Il apprit aussi une tentative faite par la garnison de Manheim sur Kehl, pour détruire le pont par lequel l'armée française avait débouché en Allemagne. Dans cet état de choses, il n'hésita plus à se mettre en marche pour regagner la France. Sa position était périlleuse. Engagé au milieu de la Bavière, obligé de repasser les Montagnes-Noires pour revenir sur le Rhin, ayant en tête Latour avec quarante mille hommes, et exposé à trouver l'archiduc Charles avec trente mille sur ses derrières, il pouvait prévoir des dangers extrêmes. Mais s'il était dépourvu du vaste et ardent génie que son émule déployait en Italie, il avait une âme ferme et inaccessible à ce trouble dont les âmes vives sont quelquefois saisies. Il commandait une superbe armée, forte de soixante et quelques mille hommes, dont le moral n'avait été ébranlé par aucune défaite, et qui avait dans son chef une extrême confiance. Appréciant une pareille ressource, il ne s'effraya pas de sa position, et résolut de reprendre tranquillement sa route. Pensant que l'archiduc, après avoir replié Jourdan, reviendrait probablement sur le Necker, il craignit de trouver ce fleuve déjà occupé; il remonta donc la vallée du Danube, pour aller joindre directement celle du Rhin, par la route des villes forestières. Ces passages étant les plus éloignés du point où se trouvait actuellement l'archiduc, lui parurent les plus sûrs.
Il resta au-delà du Danube, et le remonta tranquillement, en appuyant une de ses ailes au fleuve. Ses parcs, ses bagages marchaient devant lui, sans confusion, et tous les jours ses arrière-gardes repoussaient bravement les avant-gardes ennemies. Latour, au lieu de passer le Danube, et de tâcher de prévenir Moreau à l'entrée des défilés, se contentait de le suivre pas à pas, sans oser l'entamer. Arrivé auprès du lac de Fédersée, Moreau crut devoir s'arrêter. Latour s'était partagé en trois corps: il en avait donné un à Nauendorff, et l'avait envoyé à Tubingen, sur le Haut-Necker, par où Moreau ne voulait pas passer; il était lui-même avec le second à Biberach; et le troisième se trouvait fort loin, à Schussenried. Moreau, qui approchait du Val-d'Enfer, par où il voulait se retirer, qui ne voulait pas être trop pressé au passage de ce défilé, qui voyait devant lui Latour isolé, et qui sentait ce qu'une victoire devait donner de fermeté à ses troupes pour le reste de la retraite, s'arrêta le 11 vendémiaire an V (2 octobre) aux environs du lac de Fédersée, non loin de Biberach. Le pays était montueux, boisé, et coupé de vallées. Latour était rangé sur différentes hauteurs, qu'on pouvait isoler et tourner, et qui, de plus, avaient à dos un ravin profond, celui de la Riss. Moreau l'attaqua sur tous les points, et, sachant pénétrer avec art à travers ses positions, abordant les unes de front, tournant les autres, l'accula sur la Riss, le jeta dedans, et lui fit quatre mille prisonniers. Cette victoire importante, dite de Biberach, rejeta Latour fort loin, et raffermit singulièrement le moral de l'armée française. Moreau reprit sa marche et s'approcha des défilés. Il avait déjà dépassé les routes qui traversent la vallée du Necker pour déboucher dans celle du Rhin; il lui restait celle qui, passant par Tuttlingen et Rottweil, vers les sources même du Necker, suit la vallée de la Kintzig, et vient aboutir à Kehl; mais Nauendorff l'avait déjà occupée. Les détachemens sortis de Manheim s'étaient joints à ce dernier, et l'archiduc s'en approchait. Moreau aima mieux remonter un peu plus haut, et passer par le Val-d'Enfer, qui, traversant la Forêt-Noire, formait un coude plus long, mais aboutissait à Brissach, beaucoup plus loin de l'archiduc. En conséquence, il plaça Desaix et Férino avec la gauche et la droite vers Tuttlingen et Rottweil, pour se couvrir du côté des débouchés, où se trouvaient les principales forces autrichiennes, et il envoya son centre, sous Saint-Cyr, pour forcer le Val-d'Enfer. En même temps, il fit filer ses grands parcs sur Huningue, par la route des villes forestières. Les Autrichiens l'avaient entouré d'une nuée de petits corps, comme s'ils avaient espéré l'envelopper, et ne s'étaient mis nulle part en mesure de lui résister. Saint-Cyr trouva à peine un détachement au Val-d'Enfer, passa sans peine à Neustadt, et arriva à Fribourg. Les deux ailes le suivirent immédiatement, et débouchèrent à travers cet affreux défilé, dans la vallée du Rhin, plutôt avec l'attitude d'une armée victorieuse qu'avec celle d'une armée en retraite. Moreau était rendu dans la vallée du Rhin le 21 vendémiaire (12 octobre). Au lieu de repasser le Rhin au pont de Brissach, et de remonter, en suivant la rive française, jusqu'à Strasbourg, il voulut remonter la rive droite jusqu'à Kehl, en présence de toute l'armée ennemie. Soit qu'il voulût faire un retour plus imposant, soit qu'il espérât se maintenir sur la rive droite, et couvrir Kehl en s'y portant directement, ces raisons ont paru insuffisantes pour hasarder une bataille. Il pouvait, en repassant le Rhin à Brissach, remonter librement à Strasbourg, et déboucher de nouveau par Kehl. Cette tête de pont pouvait résister assez longtemps pour lui donner le temps d'arriver. Vouloir marcher au contraire en face de l'armée ennemie, qui venait de se réunir tout entière sous l'archiduc, et s'exposer ainsi à une bataille générale, avec le Rhin à dos, était une imprudence inexcusable, maintenant qu'on n'avait plus le motif, ni de l'offensive à prendre, ni d'une retraite à protéger. Le 28 vendémiaire (19 octobre), les deux armées se trouvèrent en présence sur les bords de l'Elz, de Valdkirch à Emmendingen. Après un combat sanglant et varié, Moreau sentit l'impossibilité de percer jusqu'à Kehl, en suivant la rive droite, et résolut de passer sur le pont de Brissach. Ne croyant pas néanmoins pouvoir faire passer toute son armée sur ce pont, de peur d'encombrement, et voulant envoyer au plus tôt des forces à Kehl, il fit repasser Desaix avec la gauche par Brissach, et retourna vers Huningue avec le centre et la droite. Cette détermination a été jugée non moins imprudente que celle de combattre à Emmendingen; car Moreau, affaibli d'un tiers de son armée, pouvait être très compromis. Il comptait, il est vrai, sur une très belle position, celle de Schliengen, qui couvre le débouché d'Huningue, et sur laquelle il pouvait s'arrêter et combattre, pour rendre son passage plus tranquille et plus sûr. Il s'y replia en effet, s'y arrêta le 3 brumaire (24 octobre), et livra un combat opiniâtre et balancé. Après avoir, par cette journée de combat, donné à ses bagages le temps de passer, il évacua la position pendant la nuit, repassa sur la rive gauche, et s'achemina vers Strasbourg.
Ainsi finit cette campagne célèbre, et cette retraite plus célèbre encore. Le résultat indique assez le vice du plan. Si, comme l'ont démontré Napoléon, l'archiduc Charles et le général Jomini, si au lieu de former deux armées, s'avançant en colonnes isolées, sous deux généraux différens, dans l'intention mesquine de déborder les flancs de l'ennemi, le directoire eût formé une seule armée de cent soixante mille hommes, dont un détachement de cinquante mille aurait assiégé Mayence, et dont cent dix mille, réunis en un seul corps, auraient envahi l'Allemagne par la vallée du Rhin, le Val-d'Enfer et la Haute-Bavière, les armées impériales auraient été réduites à se retirer toujours, sans pouvoir se concentrer avec avantage contre une masse trop supérieure. Le beau plan du jeune archiduc serait devenu impossible, et le drapeau républicain aurait été porté jusqu'à Vienne. Avec le plan donné, Jourdan était une victime forcée. Aussi sa campagne, toujours malheureuse, fut toute de dévouement, soit lorsqu'il franchit le Rhin la première fois, pour attirer à lui les forces de l'archiduc, soit lorsqu'il s'avança jusqu'en Bohême et qu'il combattit à Wurtzbourg. Moreau seul, avec sa belle armée, pouvait réparer en partie les vices du plan, soit en se hâtant d'écraser tout ce qui était devant lui, au moment où il déboucha par Kehl, soit en se rabattant sur l'archiduc Charles, lorsque celui-ci se porta sur Jourdan. Il n'osa ou ne sut rien faire de tout cela; mais s'il ne montra pas une étincelle de génie, si à une manoeuvre décisive et victorieuse il préféra une retraite, du moins il déploya dans cette retraite un grand caractère et une rare fermeté. Sans doute elle n'était pas aussi difficile qu'on l'a dit, mais elle fut conduite néanmoins de la manière la plus imposante.
Le jeune archiduc dut au vice du plan français une belle pensée, qu'il exécuta avec prudence; mais, comme Moreau, il manqua de cette ardeur, de cette audace, qui pouvaient rendre la faute du gouvernement français mortelle pour ses armées. Conçoit-on ce qui serait arrivé, si d'un côté ou de l'autre s'était trouvé le génie impétueux qui venait de détruire trois armées au-delà des Alpes! Si les soixante-dix mille hommes de Moreau, à l'instant où ils débouchèrent de Kehl, si les Impériaux, à l'instant où ils quittèrent le Danube pour se rabattre sur Jourdan, avaient été conduits avec l'impétuosité déployée en Italie, certainement la guerre eût été terminée sur-le-champ, d'une manière désastreuse pour l'une des deux puissances.
Cette campagne valut en Europe une grande réputation au jeune archiduc. En France, on sut un gré infini à Moreau d'avoir ramené saine et sauve l'armée compromise en Bavière. On avait eu sur cette armée des inquiétudes extrêmes, surtout depuis le moment où Jourdan s'étant replié, où le pont de Kehl ayant été menacé, où une nuée de petits corps ayant intercepté les communications par la Souabe, on ignorait ce qu'elle était devenue et ce qu'elle allait devenir. Mais quand, après de vives inquiétudes, on la vit déboucher dans la vallée du Rhin, avec une si belle attitude, on fut enchanté du général qui l'avait si heureusement ramenée. Sa retraite fut exaltée comme un chef-d'oeuvre de l'art, et comparée sur-le-champ à celle des Dix mille. On n'osait rien mettre sans doute à côté des triomphes si brillans de l'armée d'Italie; mais comme il y a toujours une foule d'hommes que le génie supérieur, que la grande fortune offusquent, et que le mérite moins éclatant rassure davantage, ceux-là se rangeaient tous pour Moreau, vantaient sa prudence, son habileté consommée, et la préféraient au génie ardent du jeune Bonaparte. Dès ce jour-là, Moreau eut pour lui tout ce qui préfère les facultés secondaires aux facultés supérieures; et, il faut l'avouer, dans une république on pardonne presque à ces ennemis du génie, quand on voit de quoi le génie peut se rendre coupable envers la liberté qui l'a enfanté, nourri, et porté au comble de la gloire.