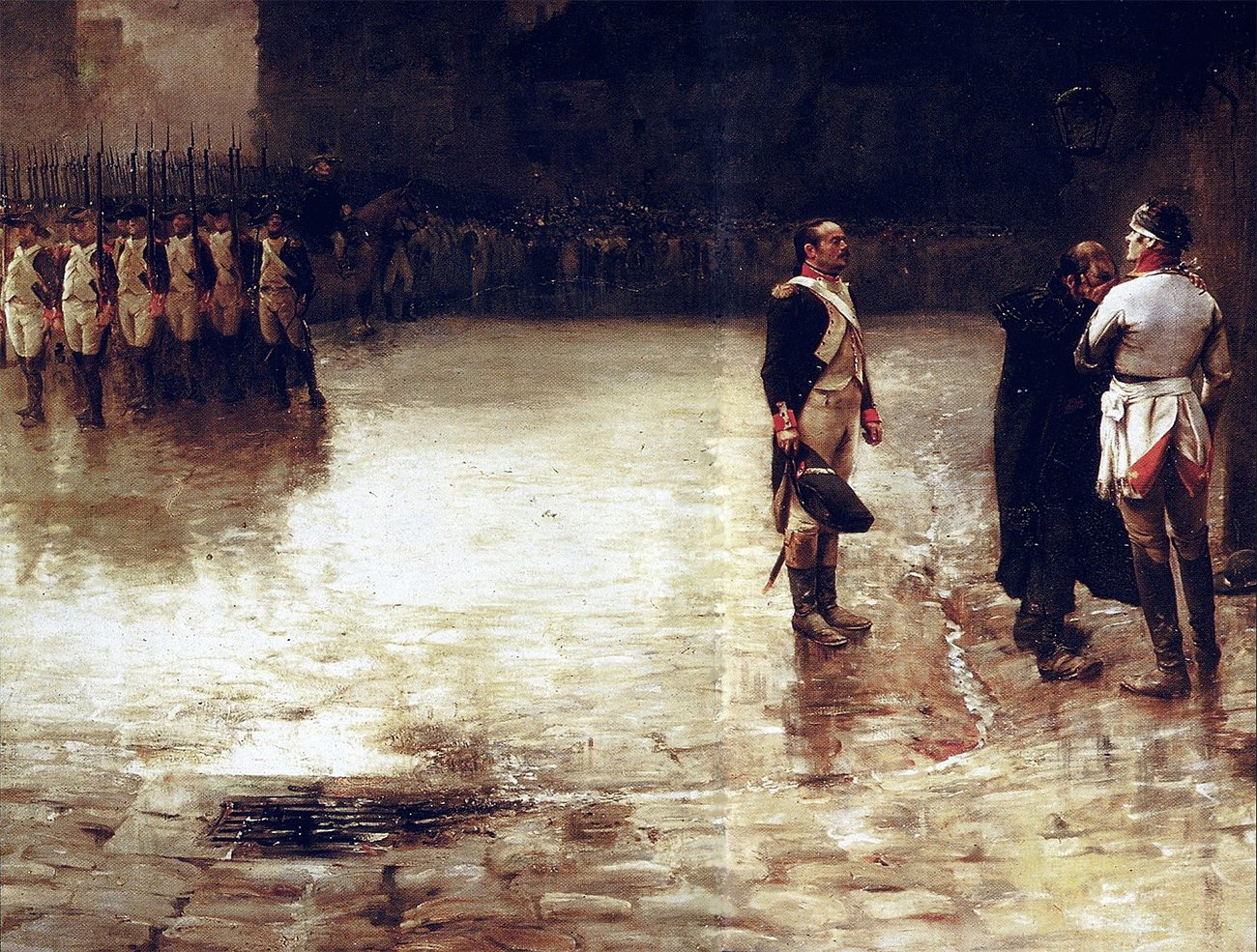HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. |
CHAPITRE II.
CONTINUATION DES TRAVAUX ADMINISTRATIFS DU DIRECTOIRE.—LES PARTIS SE PRONONCENT DANS LE SEIN DU CORPS LÉGISLATIF.—INSTITUTION D'UNE FÊTE ANNIVERSAIRE DU 21 JANVIER.—RETOUR DE L'EX-MINISTRE DE LA GUERRE BEURNONVILLE, ET DES REPRÉSENTANS QUINETTE, CAMUS, BANCAL, LAMARQUE ET DROUET, LIVRÉS A L'ENNEMI PAR DUMOURIEZ.—MÉCONTENTEMENT DES JACOBINS. JOURNAL DE BABOEUF.—INSTITUTION DU MINISTÈRE DE LA POLICE.—NOUVELLES MOEURS.—EMBARRAS FINANCIERS; CRÉATION DES MANDATS.—CONSPIRATION DE BABOEUF.—SITUATION MILITAIRE. PLANS DU DIRECTOIRE.—PACIFICATION DE LA VENDÉE; MORT DE STOFFLET ET DE CHARETTE.
Le gouvernement républicain était rassuré et affermi par les événemens qui venaient de terminer la campagne. La convention, en réunissant la Belgique à la France, et en la comprenant dans le territoire constitutionnel, avait imposé à ses successeurs l'obligation de ne pactiser avec l'ennemi qu'à la condition de la ligne du Rhin. Il fallait de nouveaux efforts, il fallait une nouvelle campagne, plus décisive que les précédentes, pour contraindre la maison d'Autriche et d'Angleterre à consentir à notre agrandissement. Pour parvenir à ce but, le directoire travaillait avec énergie à compléter les armées, à rétablir les finances, et à réprimer les factions.
Il mettait le plus grand soin à l'exécution des lois relatives aux jeunes réquisitionnaires; et les obligeait à rejoindre les armées, avec la dernière rigueur. Il avait fait annuler tous les genres d'exceptions, et avait formé dans chaque canton des commissions de médecins, pour juger les cas d'infirmité. Une foule de jeunes gens s'étaient fourrés dans les administrations, où ils pillaient la république, et montraient le plus mauvais esprit. Les ordres les plus sévères furent donnés pour ne souffrir dans les bureaux que des hommes qui n'appartinssent pas à la réquisition. Les finances attiraient surtout l'attention du directoire: il faisait percevoir l'emprunt forcé de 600 millions avec une extrême activité. Mais il fallait attendre les rentrées de cet emprunt, l'aliénation du produit des forêts nationales, la vente des biens de trois cents arpens, la perception des contributions arriérées, et, en attendant, il fallait pourtant suffire aux dépenses, qui malheureusement se présentaient toutes à la fois, parce que l'installation du gouvernement nouveau était l'époque à laquelle on avait ajourné toutes les liquidations, et parce que l'hiver était le moment destiné aux préparatifs de campagne. Pour devancer l'époque de toutes ces rentrées, le directoire avait été obligé d'user de la ressource qu'on avait tenu à lui laisser, celle des assignats. Mais il en avait déjà émis en un mois près de 12 ou 15 milliards, pour se procurer quelques millions en numéraire; et il était déjà arrivé au point de ne pouvoir les faire accepter nulle part. Il imagina d'émettre un papier courant et à prochaine échéance, qui représentât les rentrées de l'année, comme on fait en Angleterre avec les bons de l'échiquier, et comme nous faisons aujourd'hui avec les bons royaux. Il émit en conséquence, sous le titre de rescriptions, des bons au porteur, payables à la trésorerie avec le numéraire qui allait rentrer incessamment, soit par l'emprunt forcé, qui, dans la Belgique, était exigible en numéraire, soit par les douanes, soit par suite des premiers traités conclus avec les compagnies qui se chargeraient de l'exploitation des forêts. Il émit d'abord pour 30 millions de ces rescriptions, et les porta bientôt à 60, en se servant du secours des banquiers.
Les compagnies financières n'étaient plus prohibées. Il songea à les employer pour la création d'une banque qui manquait au crédit, surtout dans un moment où l'on se figurait que le numéraire était sorti tout entier de France. Il forma une compagnie, et proposa de lui abandonner une certaine quantité de biens nationaux qui servirait de capital à une banque. Cette banque devait émettre des billets, qui auraient des terres pour gage, et qui seraient payables à vue, comme tous les billets de banque. Elle devait en prêter à l'état pour une somme proportionnée à la quantité des biens donnés en gage. C'était, comme on le voit, une autre manière de tirer sur la valeur des biens nationaux; au lieu d'employer le moyen des assignats, on employait celui des billets de banque.
Le succès était peu probable; mais dans sa situation malheureuse, le gouvernement usait de tout, et avait raison de le faire. Son opération la plus méritoire fut de supprimer les rations, et de rendre les subsistances au commerce libre. On a vu quels efforts il en coûtait au gouvernement pour se charger lui-même de faire arriver les grains à Paris, et quelle dépense il en résultait pour le trésor, qui payait les grains en valeur réelle, et qui les donnait au peuple de la capitale pour des valeurs nominales. Il rentrait à peine la deux-centième partie de la dépense, et ainsi, à très-peu de chose près, la république nourrissait la population de Paris.
Le nouveau ministre de l'intérieur, Benezech, qui avait senti l'inconvénient de ce système, et qui croyait que les circonstances permettaient d'y renoncer, conseilla au directoire d'en avoir le courage. Le commerce commençait à se rétablir; les grains reparaissaient dans la circulation; le peuple se faisait payer ses salaires en numéraire; et il pouvait dès lors atteindre au prix du pain, qui, en numéraire, était modique. En conséquence, le ministre Benezech proposa au directoire de supprimer les distributions de rations, qui ne se payaient qu'en assignats, de ne les conserver qu'aux indigens, ou aux rentiers et aux fonctionnaires publics dont le revenu annuel ne s'élevait pas au-dessus de mille écus. Excepté ces trois classes, toutes les autres devaient se pourvoir chez les boulangers par la voie du commerce libre.
Cette mesure était hardie, et exigeait un véritable courage. Le directoire la mit sur-le-champ à exécution, sans craindre les fureurs qu'elle pouvait exciter chez le peuple, et les moyens de trouble qu'elle pouvait fournir aux deux factions conjurées contre le repos de la république.
Outre ces mesures, il en imagina d'autres qui ne devaient pas moins blesser les intérêts, mais qui étaient aussi nécessaires. Ce qui manquait surtout aux armées, ce qui leur manque toujours après de longues guerres, ce sont les chevaux. Le directoire demanda aux deux conseils l'autorisation de lever tous les chevaux de luxe, et de prendre, en le payant, le trentième cheval de labour et de roulage. Le récépissé du cheval devait être pris en paiement des impôts. Cette mesure, quoique dure, était indispensable, et fut adoptée.
Les deux conseils secondaient le directoire, et montraient le même esprit, sauf l'opposition toujours mesurée de la minorité. Quelques discussions s'y étaient élevées sur la vérification des pouvoirs, sur la loi du 3 brumaire, sur les successions des émigrés, sur les prêtres, sur les événemens du Midi, et les partis avaient commencé à se prononcer.
La vérification des pouvoirs ayant été renvoyée à une commission qui avait de nombreux renseignemens à prendre, relativement aux membres dont l'éligibilité pouvait être contestée, son rapport ne put être fait que fort tard, et après plus de deux mois de législature. Il donna lieu à beaucoup de contestations sur l'application de la loi du 3 brumaire. Cette loi, comme on sait, amnistiait tous les délits commis pendant la révolution, excepté les délits relatifs au 13 vendémiaire; elle excluait des fonctions publiques les parens d'émigrés, et les individus qui, dans les assemblées électorales, s'étaient mis en rébellion contre les décrets des 5 et 13 fructidor. Elle avait été le dernier acte d'énergie du parti conventionnel, et elle blessait singulièrement les esprits modérés, et les contre-révolutionnaires qui se cachaient derrière eux. Il fallait l'appliquer à plusieurs députés, et notamment à un nommé Job Aymé, député de la Drôme, qui avait soulevé l'assemblée électorale de son département, et qu'on accusait d'appartenir aux compagnies de Jésus. Un membre des cinq-cents osa demander l'abrogation de la loi même. Cette proposition fit sortir tous les partis de la réserve qu'ils avaient observée jusque-là. Une dispute, semblable à celles qui divisèrent si souvent la convention, s'éleva dans les cinq-cents. Louvet, toujours fidèle à la cause révolutionnaire, s'élança à la tribune pour défendre la loi. Tallien, qui jouait un rôle si grand depuis le 9 thermidor, et que le défaut de considération personnelle avait empêché d'arriver au directoire, Tallien se montra ici le constant défenseur de la révolution, et prononça un discours qui fit une grande sensation. On avait rappelé les circonstances dans lesquelles la loi de brumaire fut rendue; on avait paru insinuer qu'elle était un abus de la victoire de vendémiaire à l'égard des vaincus; on avait beaucoup parlé des jacobins et de leur nouvelle audace. «Qu'on cesse de nous effrayer, s'écria Tallien, en parlant de terreur, en rappelant des époques toutes différentes de celles d'aujourd'hui, en nous faisant craindre leur retour. Certes, les temps sont bien changés: aux époques dont on affecte de nous entretenir, les royalistes ne levaient pas une tête audacieuse; les prêtres fanatiques, les émigrés rentrés n'étaient pas protégés; les chefs de chouans n'étaient point acquittés. Pourquoi donc comparer des circonstances qui n'ont rien de commun? Il est trop évident qu'on veut faire le procès au 13 vendémiaire, aux mesures qui ont suivi cette journée mémorable, aux hommes qui, dans ces grands périls, ont sauvé la république. Eh bien! que nos ennemis montent à cette tribune; les amis de la république nous y défendront. Ceux mêmes qui, dans ces désastreuses circonstances, ont poussé devant les canons une multitude égarée, voudraient nous reprocher les efforts qu'il nous a fallu faire pour la repousser; ils voudraient faire révoquer les mesures que le danger le plus pressant vous a forcés de prendre; mais non, ils ne réussiront pas! La loi du 3 brumaire, la plus importante de ces mesures, sera maintenue par vous, car elle est nécessaire à la constitution, et certainement vous voulez maintenir la constitution.» Oui, oui, nous le voulons! s'écrièrent une foule de voix. Tallien proposa ensuite l'exclusion de Job Aymé. Plusieurs membres du nouveau tiers voulurent combattre cette exclusion. La discussion devint des plus vives; la loi du 3 brumaire fut de nouveau sanctionnée; Job Aymé fut exclu, et on continua de rechercher ceux des membres du nouveau tiers auxquels les mêmes dispositions étaient applicables.
Il fut ensuite question des émigrés, et de leurs droits à des successions non encore ouvertes. Une loi de la convention, pour empêcher que les émigrés ne reçussent des secours, saisissait leurs patrimoines, et déclarait les successions auxquelles ils avaient droit, ouvertes par avance, et acquises à la république. En conséquence le séquestre avait été mis sur les biens des parens des émigrés. Une résolution fut proposée aux cinq-cents pour autoriser le partage, et le prélèvement de la part acquise aux émigrés, afin de lever le séquestre. Une opposition assez vive s'éleva dans le nouveau tiers. On voulut combattre cette mesure, qui était toute révolutionnaire, par des raisons tirées du droit ordinaire; on prétendit qu'il y avait violation de la propriété. Cependant cette résolution fut adoptée. Aux anciens, il n'en fut pas de même. Ce conseil, par l'âge de ses membres, par son rôle d'examinateur suprême, avait plus de mesure que celui des cinq-cents. Il en partageait moins les passions opposées; il était moins révolutionnaire que la majorité, et beaucoup plus que la minorité. Comme tout corps intermédiaire, il avait un esprit moyen, et il rejeta la mesure, parce qu'elle entraînait l'exécution d'une loi qu'il regardait comme injuste. Les conseils décrétèrent ensuite que le directoire serait juge suprême des demandes en radiation de la liste des émigrés. Ils renouvelèrent toutes les lois contre les prêtres qui n'avaient pas prêté le serment, ou qui l'avaient rétracté, et contre ceux que les administrations des départemens avaient condamnés à la déportation. Ils décrétèrent que ces prêtres seraient traités comme émigrés rentrés s'ils reparaissaient sur le territoire. Ils consentirent seulement à mettre en réclusion ceux qui étaient infirmes et qui ne pouvaient s'expatrier.
Un sujet agita beaucoup les conseils, et y provoqua une explosion. Fréron continuait sa mission dans le Midi, et y composait les administrations et les tribunaux de révolutionnaires ardens. Les membres des compagnies de Jésus, les contre-révolutionnaires de toute espèce qui avaient assassiné depuis le 9 thermidor, se voyaient à leur tour exposés à de nouvelles représailles, et jetaient les hauts cris. Le député Siméon avait déjà élevé des réclamations mesurées. Le député Jourdan d'Aubagne, homme ardent, l'ex-girondin Isnard, élevèrent, aux cinq-cents, des réclamations violentes, et remplirent plusieurs séances de leurs déclamations. Les deux partis en vinrent aux mains. Jourdan et Talot se prirent de querelle dans la séance même, et se permirent presque des voies de fait. Leurs collègues intervinrent et les séparèrent. On nomma une commission pour faire un rapport sur l'état du Midi.
Ces différentes scènes portèrent les partis à se prononcer davantage. La majorité était grande dans les conseils, et tout acquise au directoire. La minorité, quoique annulée, devenait chaque jour plus hardie, et montrait ouvertement son esprit de réaction. C'était la continuation du même esprit qui s'était manifesté depuis le 9 thermidor, et qui d'abord avait attaqué justement les excès de la terreur, mais qui, de jour en jour plus sévère et plus passionné, finissait par faire le procès à la révolution tout entière. Quelques membres des deux tiers conventionnels votaient avec la minorité, et quelques membres du nouveau tiers avec la majorité. Les conventionnels saisirent l'occasion qu'allait leur fournir l'anniversaire du 21 janvier, pour mettre leurs collègues suspects de royalisme à une pénible épreuve. Ils proposèrent une fête, pour célébrer, tous les 21 janvier, la mort du dernier roi, et ils firent décider que, ce jour, chaque membre des deux conseils et du directoire prêterait serment de haine à la royauté. Cette formalité du serment, si souvent employée par les partis, n'a jamais pu être regardée comme une garantie; elle n'a jamais été qu'une vexation des vainqueurs, qui ont voulu se donner le plaisir de forcer les vaincus au parjure. Le projet fut adopté par les deux conseils.
Les conventionnels attendaient avec impatience la séance du 1er pluviôse an IV (21 janvier), pour voir défiler à la tribune leurs collègues du nouveau tiers. Chaque conseil siégea ce jour-là avec un grand appareil. Une fête était préparée dans Paris; le directoire et toutes les autorités devaient y assister. Quand il fallut prononcer le serment, quelques-uns des nouveaux élus parurent embarrassés. L'ex-constituant Dupont (de Nemours), qui était membre des anciens, qui conservait dans un âge avancé une grande vivacité d'humeur, et montrait l'opposition la plus hardie au gouvernement actuel, Dupont (de Nemours) laissa voir quelque dépit, et, en prononçant les mots, je jure haine à la royauté, ajouta ceux-ci, et à toute espèce de tyrannie. C'était une manière de se venger, et de jurer haine au directoire sous des mots détournés. Une grande rumeur s'éleva, et on obligea Dupont (de Nemours) à s'en tenir à la formule officielle. Aux cinq cents, un nommé André voulut recourir aux mêmes expressions que Dupont (de Nemours); mais on le rappela de même à la formule. Le président du directoire prononça un discours énergique, et le gouvernement entier fit ainsi la profession de foi la plus révolutionnaire.
A cette époque arrivèrent les députés qui avaient été échangés contre la fille de Louis XVI. C'étaient Quinette, Bancal, Camus, Lamarque, Drouet et l'ex-ministre de la guerre Beurnonville. Ils firent le rapport de leur captivité; on l'écouta avec une vive indignation, on leur donna de justes marques d'intérêt, et ils prirent, au milieu de la satisfaction générale, la place que la convention leur avait assurée dans les conseils. Il avait été décrété, en effet, qu'ils seraient de droit membres du corps législatif.
Ainsi marchaient le gouvernement et les partis, pendant l'hiver de l'an IV (1795 à 1796).
La France, qui souhaitait un gouvernement et le rétablissement des lois, commençait à goûter le nouvel état de choses, et l'aurait même approuvé tout à fait, sans les efforts qu'on exigeait d'elle pour le salut de la république. L'exécution rigoureuse des lois sur la réquisition, l'emprunt forcé, la levée du trentième cheval, l'état misérable des rentiers payés en assignats, étaient de graves sujets de plaintes; sans tous ces motifs, elle aurait trouvé le nouveau gouvernement excellent. Il n'y a que l'élite d'une nation qui soit sensible à la gloire, à la liberté, aux idées nobles et généreuses, et qui consente à leur faire des sacrifices. La masse veut du repos, et demande à faire le moins de sacrifices possible. Il est des momens où cette masse entière se réveille, mue de passions grandes et profondes: on le vit, en 1789, quand il avait fallu conquérir la liberté, et, en 1793, quand il avait fallu la défendre. Mais, épuisée par ces efforts, la grande majorité de la France n'en voulait plus faire. Il fallait un gouvernement habile et vigoureux pour obtenir d'elle les ressources nécessaires au salut de la république. Heureusement la jeunesse, toujours prête à une vie aventurière, présentait de grandes ressources pour recruter les armées. Elle montrait d'abord beaucoup de répugnance à quitter ses foyers; mais elle cédait après quelque résistance. Transportée dans les camps, elle prenait un goût décidé pour la guerre, et y faisait des prodiges de valeur. Les contribuables, dont on exigeait des sacrifices d'argent, étaient bien plus difficiles à soumettre et à concilier au gouvernement.
Les ennemis de la révolution prenaient texte des sacrifices nouveaux imposés à la France, et déclamaient dans leurs journaux contre la réquisition, l'emprunt forcé, la levée forcée des chevaux, l'état des finances, le malheur des rentiers, et la sévère exécution des lois à l'égard des émigrés et des prêtres. Ils affectaient de considérer le gouvernement comme étant encore un gouvernement révolutionnaire, et en ayant l'arbitraire et la violence. Suivant eux, on ne pouvait pas se fier encore à lui, et se livrer avec sécurité à l'avenir. Ils s'élevaient surtout contre le projet d'une nouvelle campagne; ils prétendaient qu'on sacrifiait le repos, la fortune, la vie des citoyens, à la folie des conquêtes; et semblaient fâchés que la révolution eût l'honneur de donner la Belgique à la France. Du reste, il n'était point étonnant, disaient-ils, que le gouvernement eût un pareil esprit et de tels projets, puisque le directoire et les conseils étaient remplis des membres d'une assemblée qui s'était souillée de tous les crimes.
Les patriotes, qui, en fait de reproches et de récriminations, n'étaient jamais en demeure, trouvaient au contraire le gouvernement trop faible, et se montraient déjà tout prêts à l'accuser de condescendance pour les contre-révolutionnaires. Suivant eux, on laissait rentrer les émigrés et les prêtres; on acquittait chaque jour les conspirateurs de vendémiaire; les jeunes gens de la réquisition n'étaient pas assez sévèrement ramenés aux armées; l'emprunt forcé était perçu avec mollesse. Ils désapprouvaient surtout le système financier qu'on semblait disposé à adopter. Déjà on a vu que l'idée de supprimer les assignats les avait irrités, et qu'ils avaient demandé sur-le-champ les moyens révolutionnaires qui, en 1793, ramenèrent le papier au pair. Le projet de recourir aux compagnies financières et d'établir une banque réveilla tous leurs préjugés. Le gouvernement allait, disaient-ils, se remettre dans les mains des agioteurs; il allait, en établissant une banque, ruiner les assignats, et détruire le papier-monnaie de la république, pour y substituer un papier privé, de la création des agioteurs. La suppression des rations les indigna. Rendre les subsistances au commerce libre, ne plus nourrir la ville de Paris, était une attaque à la révolution: c'était vouloir affamer le peuple et le pousser au désespoir. Sur ce point, les journaux du royalisme semblèrent d'accord avec ceux du jacobinisme, et le ministre Benezech fut accablé d'invectives par tous les partis.
Une mesure mit le comble à la colère des patriotes contre le gouvernement. La loi du 3 brumaire, en amnistiant tous les faits relatifs à la révolution, exceptait cependant les crimes particuliers, comme vols et assassinats, lesquels étaient toujours passibles de l'application des lois. Ainsi les poursuites commencées pendant les derniers temps de la convention contre les auteurs des massacres de septembre, furent continuées comme poursuites ordinaires contre l'assassinat. On jugeait en même temps les conspirateurs de vendémiaire, et ils étaient presque tous acquittés. L'instruction contre les auteurs de septembre était au contraire extrêmement rigoureuse. Les patriotes furent révoltés. Le nommé Baboeuf, jacobin forcené, déjà enfermé en prairial, et qui se trouvait libre maintenant par l'effet de la loi d'amnistie, avait commencé un journal, à l'imitation de Marat, sous le titre du Tribun du Peuple. On comprend ce que pouvait être l'imitation d'un modèle pareil. Plus violent que celui de Marat, le journal de Baboeuf n'était pas cynique, mais plat. Ce que des circonstances extraordinaires avaient provoqué, était réduit ici en système, et soutenu avec une sottise et une frénésie encore inconnues. Quand des idées qui ont préoccupé les esprits touchent à leur fin, elles restent dans quelques têtes, et s'y changent en manie et en imbécillité. Baboeuf était le chef d'une secte de malades qui soutenaient que le massacre de septembre avait été incomplet, qu'il faudrait le renouveler en le rendant général, pour qu'il fût définitif. Ils prêchaient publiquement la loi agraire, ce que les hébertistes eux-mêmes n'avaient pas osé, et se servaient d'un nouveau mot, le bonheur commun, pour exprimer le but de leur système. L'expression seule caractérisait en eux le dernier terme de l'absolutisme démagogique. On frémit en lisant les pages de Baboeuf. Les esprits de bonne foi en eurent pitié; les alarmistes feignirent de croire à l'approche d'une nouvelle terreur, et il est vrai de dire que les séances de la société du Panthéon fournissaient un prétexte spécieux à leurs craintes. C'est dans le vaste local de Sainte-Geneviève que les jacobins avaient recommencé leur club, comme nous avons dit. Plus nombreux que jamais, ils étaient près de quatre mille, vociférant à la fois, bien avant dans la nuit. Insensiblement ils avaient outrepassé la constitution, et s'étaient donné tout ce qu'elle défendait, c'est-à-dire un bureau, un président et des brevets; en un mot, ils avaient repris le caractère d'une assemblée politique. Là, ils déclamaient contre les émigrés et les prêtres, les agioteurs, les sangsues du peuple, les projets de banque, la suppression des rations, l'abolition des assignats, et les procédures instruites contre les patriotes.
Le directoire, qui de jour en jour se sentait mieux établi, et redoutait moins la contre révolution, commençait à rechercher l'approbation des esprits modérés et raisonnables. Il crut devoir sévir contre ce déchaînement de la faction jacobine. Il en avait les moyens dans la constitution et dans les lois existantes; il résolut de les employer. D'abord, il fit saisir plusieurs numéros du journal de Baboeuf, comme provoquant au renversement de la constitution; ensuite il fit fermer la société du Panthéon, et plusieurs autres formées par la jeunesse dorée, dans lesquelles on dansait et où on lisait les journaux; ces dernières étaient situées au Palais-Royal et au boulevart des Italiens, sous le titre de Société des Échecs, Salon des Princes, Salon des Arts. Elles étaient peu redoutables, et ne furent comprises dans la mesure que pour montrer de l'impartialité. L'arrêté fut publié et exécuté le 8 ventôse (27 février 1796). Une résolution demandée aux cinq-cents ajouta une condition à toutes celles que la constitution imposait déjà aux sociétés populaires: elles ne purent être composées de plus de soixante membres.
Le ministre Benezech, accusé par les deux partis, voulut demander sa démission. Le directoire refusa de l'accepter, et lui écrivit une lettre pour le féliciter de ses services. La lettre fut publiée. Le nouveau système des subsistances fut maintenu; les indigens, les rentiers et les fonctionnaires publics qui n'avaient pas mille écus de revenu, obtinrent seuls des rations. On songea aussi aux malheureux rentiers qui étaient toujours payés en papier. Les deux conseils décrétèrent qu'ils recevraient dix capitaux pour un en assignats; augmentation bien insuffisante, car les assignats n'avaient plus que la deux-centième partie de leur valeur.
Le directoire ajouta aux mesures qu'il venait de prendre, celle de rappeler enfin les députés conventionnels en mission. Il les remplaça par des commissaires du gouvernement. Ces commissaires auprès des armées et des administrations, représentaient le directoire, et surveillaient l'exécution des lois. Ils n'avaient plus comme autrefois des pouvoirs illimités auprès des armées; mais, dans un cas pressant, où le pouvoir du général était insuffisant, comme une réquisition de vivres ou de troupes, ils pouvaient prendre une décision d'urgence, qui était provisoirement exécutée, et soumise ensuite à l'approbation du directoire. Des plaintes s'étant élevées contre beaucoup de fonctionnaires choisis par le directoire dans le premier moment de son installation, il enjoignit à ses commissaires civils de les surveiller, de recueillir les plaintes qui s'élèveraient contre eux, et de lui désigner ceux dont le remplacement serait convenable.
Pour surveiller les factions, qui, obligées maintenant de se cacher, allaient agir dans l'ombre, le directoire imagina la création d'un ministère spécial de la police.
La police est un objet important dans les temps de troubles. Les trois assemblées précédentes lui avaient consacré un comité nombreux; le directoire ne crut pas devoir la laisser parmi les attributions accessoires du ministère de l'intérieur, et proposa aux deux conseils d'ériger un ministère spécial. L'opposition prétendit que c'était une institution inquisitoriale, ce qui était vrai, et ce qui malheureusement était inhérent à un temps de factions, et surtout de factions obstinées et obligées de comploter secrètement. Le projet fut approuvé. On appela le député Cochon aux fonctions de ce nouveau ministère. Le directoire aurait voulu encore des lois sur la liberté de la presse. La constitution la déclarait illimitée, sauf les dispositions qui pourraient devenir nécessaires pour en réprimer les écarts. Les deux conseils, après une discussion solennelle, rejetèrent tout projet de loi répressive. Les rôles furent encore intervertis dans cette discussion. Les partisans de la révolution, qui devaient être partisans de la liberté illimitée, demandaient des moyens de répression; et l'opposition, dont la pensée secrète inclinait plutôt à la monarchie qu'à la république, vota pour la liberté illimitée; tant les partis sont gouvernés par leur intérêt! Du reste, la décision était sage. La presse peut être illimitée sans danger: il n'y a que la vérité de redoutable; le faux est impuissant; plus il s'exagère, plus il s'use. Il n'y a pas de gouvernement qui ait péri par le mensonge. Qu'importe qu'un Baboeuf célébrât la loi agraire, qu'une Quotidienne rabaissât la grandeur de la révolution, calomniât ses héros et cherchât à relever les princes bannis! Le gouvernement n'avait qu'à laisser déclamer: huit jours d'exagération et de mensonge usent toutes les plumes des pamphlétaires et des libellistes. Mais il faut bien du temps et de la philosophie à un gouvernement pour qu'il admette ces vérités. Il n'était peut-être pas temps pour la convention de les entendre. Le directoire, qui était plus tranquille et plus assis, aurait dû commencer à les comprendre et à les pratiquer.
Les dernières mesures du directoire, telles que la clôture de la société du Panthéon, le refus d'accepter la démission du ministre Benezech, le rappel des conventionnels en mission, le changement de certains fonctionnaires, produisirent le meilleur effet; elles rassurèrent ceux qui craignaient véritablement la terreur, condamnèrent au silence ceux qui affectaient de la craindre, et satisfirent les esprits sages qui voulaient que le gouvernement se plaçât au-dessus de tous les partis. La suite, l'activité des travaux du directoire, ne contribuèrent pas moins que tout le reste à lui concilier l'estime. On commençait à espérer le repos et à supposer de la durée au régime actuel. Les cinq directeurs s'étaient entourés d'un certain appareil. Barras, homme de plaisir, faisait les honneurs du Luxembourg. C'est lui, en quelque sorte, qui représentait pour ses collègues. La société avait à peu près le même aspect que l'année précédente; elle présentait un mélange singulier de conditions, une grande liberté de moeurs, un goût effréné pour les plaisirs, un luxe extraordinaire. Les salons du directeur étaient pleins de généraux dont l'éducation et la fortune s'étaient faites en deux ans, de fournisseurs et de gens d'affaires qui s'étaient enrichis par les spéculations et les rapines, d'exilés qui rentraient et cherchaient à se rattacher au gouvernement, d'hommes à grands talens, qui, commençant à croire à la république, désiraient y prendre place, d'intrigans enfin qui couraient après la faveur. Des femmes de toute origine venaient déployer leurs charmes dans ces salons, et user de leur influence, dans un moment où tout était à demander et à obtenir. Si quelquefois les manières manquaient de cette décence et de cette dignité dont on fait tant de cas en France, et qui sont le fruit d'une société polie, tranquille et exclusive, il y régnait une extrême liberté d'esprit, et cette grande abondance d'idées positives que suggèrent la vue et la pratique des grandes choses. Les hommes qui composaient cette société étaient affranchis de toute espèce de routine; ils ne répétaient pas d'insignifiantes traditions; ce qu'ils savaient ils l'avaient appris par leur propre expérience. Ils avaient vu les plus grands événemens de l'histoire, ils y avaient pris, ils y prenaient part encore; et il est aisé de se figurer ce qu'un tel spectacle devait réveiller d'idées chez des esprits jeunes, ambitieux et pleins d'espérance. Là brillait au premier rang le jeune Hoche, qui, de simple soldat aux gardes-françaises, était devenu en une campagne général en chef, et s'était donné en deux ans l'éducation la plus soignée. Beau, plein de politesse, renommé comme un des premiers capitaines de son temps, et âgé à peine de vingt-sept ans, il était l'espoir des républicains, et l'idole de ces femmes éprises de la beauté, du talent et de la gloire. A côté de lui, on remarquait déjà le jeune Bonaparte, qui n'avait point encore de renommée, mais dont les services à Toulon et au 13 vendémiaire étaient connus, dont le caractère et la personne étonnaient par leur singularité, et dont l'esprit était frappant d'originalité et de vigueur. Dans cette société, où madame Tallien étalait sa beauté, madame Beauharnais sa grâce, madame de Staël déployait tout l'éclat de son esprit, agrandi par les circonstances et la liberté.
Ces jeunes hommes appelés à dominer dans l'état choisissaient leurs épouses, quelquefois parmi des femmes d'ancienne condition, qui se trouvaient honorées de leur choix, quelquefois dans les familles des enrichis du temps, qui voulaient ennoblir la fortune par la réputation. Bonaparte venait d'épouser la veuve de l'infortuné général Beauharnais. Chacun songeait à faire sa destinée, et la prévoyait grande. Une foule de carrières étaient ouvertes. La guerre sur le continent, la guerre sur la mer, la tribune, les magistratures, une grande république en un mot à défendre et à gouverner, c'étaient là de grands buts, dignes d'enflammer les esprits! Le gouvernement avait fait récemment une acquisition précieuse, celle d'un écrivain ingénieux et profond, qui consacrait son jeune talent à concilier les esprits à la nouvelle république. M. Benjamin Constant venait de publier une brochure intitulée: De la Force du gouvernement, qui avait produit une grande sensation. Il y démontrait la nécessité de se rattacher à un gouvernement qui était le seul espoir de la France et de tous les partis.
C'était toujours le soin des finances qui occupait le plus le gouvernement. Les dernières mesures n'étaient qu'un ajournement de la difficulté. On avait donné au gouvernement une certaine quantité de biens à vendre, la faculté d'engager les grandes forêts, l'emprunt forcé, et on lui avait laissé la planche aux assignats comme ressource extrême. Pour devancer le produit de ces différentes ressources, il avait, comme on a vu, créé 60 millions de rescriptions, espèces de bons de l'échiquier, ou de bons royaux, acquittables avec le premier numéraire qui rentrerait dans les caisses. Mais ces rescriptions n'avaient obtenu cours que très difficilement. Les banquiers réunis pour concerter un projet de banque territoriale, fondée sur les biens nationaux, s'étaient retirés en entendant les cris poussés par les patriotes contre les agioteurs et les traitans. L'emprunt forcé se percevait beaucoup plus lentement qu'on ne l'avait cru. La répartition portait sur des bases extrêmement arbitraires, puisque l'emprunt devait être frappé sur les classes les plus aisées; chacun réclamait, et chaque part de l'emprunt à percevoir occasionnait une contestation aux percepteurs. A peine un tiers était rentré en deux mois. Quelques millions en numéraire et quelques milliards en papier avaient été perçus. Dans l'insuffisance de cette ressource, on avait eu encore recours au moyen extrême, laissé au gouvernement pour suppléer à tous les autres, la planche aux assignats. Les émissions avaient été portées depuis les deux derniers mois, à la somme inouïe de 45 milliards: 20 milliards avaient à peine fourni 100 millions, car les assignats ne valaient plus que le deux-centième de leur titre. Décidément le public n'en voulait plus du tout, car ils n'étaient plus bons à rien. Ils ne pouvaient servir au remboursement des créances, qui était suspendu; ils ne pouvaient solder que la moitié des fermages et de l'impôt, car l'autre moitié se payait en nature; ils étaient refusés dans les marchés ou reçus d'après leur valeur réduite; enfin, on ne les prenait dans la vente des biens qu'au taux même des marchés, les enchères faisant toujours monter l'offre à proportion de l'avilissement du papier. On n'en pouvait donc faire aucun emploi capable de leur donner quelque valeur. Une émission dont on ne connaissait pas le terme, faisait prévoir encore des chiffres extraordinaires qui rendraient les sommes les plus modiques. Les milliards signifiaient tout au plus des millions. Cette chute, dont nous avons parlé lorsqu'on refusa d'interdire les enchères dans la vente des biens, était réalisée.
Les esprits dans lesquels la révolution avait laissé ses préjugés, car tous les systèmes et toutes les puissances en laissent, voulaient qu'on relevât les assignats, en affectant une grande quantité de biens à leur hypothèque, et en employant des mesures violentes pour les faire circuler. Mais il n'y a rien au monde de plus impossible à rétablir que la réputation d'une monnaie: il fallait donc renoncer aux assignats.
On se demande pourquoi on n'abolissait pas tout de suite le papier-monnaie, en le réduisant à sa valeur réelle, qui était de 20 millions au plus, et en exigeant le paiement des impôts et des biens nationaux, soit en numéraire, soit en assignats au cours? Le numéraire en effet reparaissait, et avec quelque abondance, surtout dans les provinces; ainsi c'était une véritable erreur que de craindre sa rareté; car le papier comptait pour 200 millions dans la circulation: mais une autre raison empêcha de renoncer au papier-monnaie. La seule richesse, il faut le dire toujours, consistait dans les biens nationaux. Leur vente ne paraissait ni assurée ni prochaine. Ne pouvant donc attendre que leur valeur vînt spontanément au trésor par les ventes, il fallait la représenter d'avance en papier, et l'émettre pour la retirer ensuite; en un mot, il fallait dépenser le prix avant de l'avoir reçu. Cette nécessité de dépenser avant d'avoir vendu fit songer à la création d'un nouveau papier.
Les cédules, qui étaient une hypothèque spéciale sur chaque bien, entraînaient de longs délais, car il fallait qu'elles portassent l'enonciation de chaque domaine; d'ailleurs elles dépendaient de la volonté du preneur, et ne levaient pas la véritable difficulté. On imagina un papier qui, sous le nom de mandats, représentait une valeur fixe de bien. Tout domaine devait être délivré sans enchère et sur simple procès-verbal, pour prix en mandats, égal à celui de 1790 (vingt-deux fois le revenu). On devait créer 2 milliards 400 millions de ces mandats, et leur affecter sur-le-champ 2 milliards 400 millions de biens, estimation de 1790. Ainsi, ces mandats ne pouvaient subir d'autre variation que celle des biens eux-mêmes, puisqu'ils en représentaient une quantité fixe. Ils ne pouvaient pas à la vérité se trouver au pair de l'argent, car les biens ne valaient pas ce qu'ils valaient en 1790; mais ils devaient avoir la valeur même des biens.
On résolut d'employer une partie de ces mandats à retirer les assignats. La planche des assignats fut brisée le 30 pluviôse an IV (19 février). 45 milliards 500 millions avaient été émis. Par les différentes rentrées, soit de l'emprunt, soit de l'arriéré, la quantité circulante avait été réduite à 36 milliards, et devait l'être bientôt à 24. Ces 24 milliards, en les réduisant au trentième, représentaient 800 millions: on décréta qu'ils seraient échangés contre 800 millions de mandats, ce qui était une liquidation de l'assignat au trentième de sa valeur nominale; 400 millions de mandats devaient être émis en outre pour le service public, et les 1,200 millions restans enfermés dans la caisse à trois clés, pour en sortir par décret, au fur et à mesure des besoins.
Cette création des mandats était une réimpression des assignats, avec un chiffre moindre, une autre dénomination, et une valeur déterminée par rapport aux biens. C'était comme si on eût créé, outre les 24 milliards devant rester en circulation, 48 autres milliards, ce qui aurait fait 72; c'était comme si on eût décidé que ces 72 milliards seraient reçus en paiement des biens, pour trente fois la valeur de 1790, ce qui supposait 2 milliards 400 millions de biens affectés en hypothèque. Ainsi, le chiffre était réduit, le rapport aux biens fixé, et le nom changé.
Les mandats furent créés le 26 ventôse (16 mars). Les biens durent être mis sur-le-champ en vente, et délivrés aux porteurs de mandats sur simple procès-verbal. La moitié du prix devait être payée dans la première décade, le reste dans trois mois. Les forêts nationales étaient mises à part; et les 2 milliards 400 millions de biens étaient pris sur les biens de moins de trois cents arpens. Sur-le-champ on prit les mesures que nécessite l'adoption d'un papier-monnaie. Le mandat était la monnaie de la république, tout devait être payé en mandats. Les créances stipulées en numéraire, les baux, les fermages, les intérêts des capitaux, les impôts, excepté l'impôt arriéré, les rentes sur l'état, les pensions, les appointemens des fonctionnaires publics, durent être payés en mandats. Il y eut de grandes discussions sur la contribution foncière. Ceux qui prévoyaient que les mandats pourraient tomber comme l'assignat, voulaient que, pour assurer à l'état une rentrée certaine, on continuât de payer la contribution foncière en nature. On leur objecta les difficultés de la perception, et on décida qu'elle aurait lieu en mandats, ainsi que celle des douanes, des droits d'enregistrement, de timbre, des postes, etc. On ne s'en tint pas là; on crut devoir accompagner la création du nouveau papier des sévérités ordinaires qui accompagnent l'emploi des valeurs forcées; on déclara que l'or et l'argent ne seraient plus considérés comme marchandises, et qu'on ne pourrait plus vendre le papier contre l'or, ni l'or contre le papier. Après les expériences qu'on avait faites, cette mesure était misérable. On venait d'en prendre en même temps une autre qui ne l'était pas moins, et qui nuisit dans l'opinion au directoire: ce fut la clôture de la Bourse. Il aurait dû savoir que la clôture d'un marché public n'empêchait pas qu'il s'en établît des milliers ailleurs.
En faisant des mandats la monnaie nouvelle, et en les mettant partout à la place du numéraire, le gouvernement commettait une erreur grave. Même en se soutenant, le mandat ne pouvait jamais égaler le taux de l'argent. Le mandat valait, si l'on veut, autant que la terre, mais il ne pouvait valoir davantage. Or, la terre ne valait pas la moitié du prix de 1790; un bien, même patrimonial, de 100,000 francs, ne se serait pas payé 50,000 en argent. Comment 100,000 francs en mandats en auraient-ils valu 100,000 en numéraire? Il aurait donc fallu admettre au moins cette différence. Le gouvernement devait donc, indépendamment de toutes les autres causes de dépréciation, trouver un premier mécompte provenant de la dépréciation des biens.
On était si pressé, qu'on fit circuler des promesses de mandats, en attendant que les mandats eux-mêmes fussent prêts à être émis. Sur-le-champ ces promesses circulèrent à une valeur très-inférieure à leur valeur nominale. On fut extrêmement alarmé, et on se dit que le nouveau papier, duquel on espérait tant, allait tomber comme les assignats, et laisser la république sans aucune ressource. Cependant il y avait une cause de cette chute anticipée, et on pouvait bientôt la lever. Il fallait rédiger des instructions à l'usage des administrations locales, pour régler les cas extrêmement compliqués que ferait naître la vente des biens sur simple procès-verbal; et ce travail exigeait beaucoup de temps et retardait l'ouverture des ventes. Pendant cet intervalle, le mandat tombait, et on disait que sa valeur baisserait si rapidement, que l'état ne voudrait pas ouvrir les ventes et abandonner les biens pour une valeur nulle; qu'il allait arriver aux mandats ce qui était arrivé aux assignats; qu'ils se réduiraient successivement à rien, et qu'alors on les recevrait en paiement des biens, non à leur valeur d'émission, mais à leur valeur réduite. Les malveillans faisaient entendre ainsi que le nouveau papier était un leurre, que jamais les biens ne seraient aliénés, et que la république voulait se les réserver comme un gage apparent et éternel de toutes les espèces de papier qu'il lui plairait d'émettre. Cependant les ventes s'ouvrirent. Les souscriptions furent nombreuses. Le mandat de 100 fr. était tombé à 15 fr. Il remonta successivement à 30, 40, et en quelques lieux à 88 francs. On espéra donc un instant le succès de la nouvelle opération.
C'était au milieu des factions secrètement conjurées contre lui que le directoire se livrait à ces travaux. Les agens de la royauté continuaient leurs secrètes menées. La mort de Lemaître ne les avait pas dispersés. Brottier, acquitté, était devenu le chef de l'agence. Duverne de Presle, Laville-Heurnois, Despomelles, s'étaient réunis à lui, et formaient secrètement le comité royal. Ces misérables brouillons n'avaient pas plus d'influence que par le passé; ils intriguaient, demandaient de l'argent à grands cris, écrivaient de nombreuses correspondances, et promettaient merveilles. Ils étaient toujours les intermédiaires entre le prétendant et la Vendée, où ils avaient de nombreux agens. Ils persistaient dans leurs idées, et voyant l'insurrection comprimée par Hoche, et prête à expirer sous ses coups, ils se confirmaient toujours davantage dans le système de tout faire à Paris, même par un mouvement de l'intérieur. Ils se vantaient, comme du temps de la convention, d'être en rapport avec plusieurs députés du nouveau tiers, et ils prétendaient qu'il fallait temporiser, travailler l'opinion par des journaux, déconsidérer le gouvernement, et tout préparer pour que les élections de l'année suivante amenassent un nouveau tiers de députés entièrement contre-révolutionnaires. Ils se flattaient ainsi de détruire la constitution républicaine par les moyens de la constitution même. Ce plan était certainement le moins chimérique, et c'est celui qui donne l'idée la plus favorable de leur intelligence.
Les patriotes de leur côté préparaient des complots, mais autrement dangereux par les moyens qu'ils avaient à leur disposition. Chassés du Panthéon, condamnés tout à fait par le gouvernement, qui s'était séparé d'eux, et qui leur retirait leurs emplois, ils s'étaient déclarés contre lui, et étaient devenus ses ennemis irréconciliables. Se voyant poursuivis et observés avec un grand soin, ils n'avaient plus trouvé d'autre ressource que de conspirer très-secrètement, et de manière à ce que les chefs de la conspiration restassent tout à fait inconnus. Ils s'étaient choisis quatre pour former un directoire secret de salut public; Baboeuf et Drouet étaient du nombre. Le directoire secret devait communiquer avec douze agens principaux qui ne se connaissaient pas les uns les autres, et chargés d'organiser des sociétés de patriotes dans tous les quartiers de Paris. Ces douze agens, agissant ainsi chacun de leur côté, avaient défense de nommer les quatre membres du directoire secret; ils devaient parler et se faire obéir au nom d'une autorité mystérieuse et suprême, qui était instituée pour diriger les efforts des patriotes vers ce qu'ils appelaient le bonheur commun. De cette manière les fils de la conspiration étaient presque insaisissables; car, en supposant qu'on en saisît un, les autres restaient toujours inconnus. Cette organisation s'établit, en effet, comme l'avait projeté Baboeuf; des sociétés de patriotes existaient dans tout Paris, et, par l'intermédiaire des douze agens principaux, recevaient l'impulsion d'une autorité inconnue.
Baboeuf et ses collègues cherchaient quel serait le mode employé pour opérer ce qu'ils appelaient la délivrance, et à qui on remettrait l'autorité, quand on aurait égorgé le directoire, dispersé les conseils, et mis le peuple en possession de sa souveraineté. Ils se défiaient déjà beaucoup trop des provinces et de l'opinion pour courir la chance d'une élection, et appeler une assemblée nouvelle. Ils voulaient tout simplement en nommer une composée de jacobins d'élite, pris dans chaque département. Ils devaient faire ce choix eux-mêmes, et compléter cette assemblée en y ajoutant tous les montagnards de l'ancienne convention qui n'avaient pas été réélus. Encore ces montagnards ne leur semblaient pas donner de suffisantes garanties, car beaucoup avaient adhéré, dans les derniers temps de la convention, à ce qu'ils appelaient les mesures liberticides, et avaient même accepté des fonctions du directoire. Cependant ils avaient fini par tomber d'accord sur l'admission dans la nouvelle assemblée de soixante-huit d'entre eux, qui passaient pour les plus purs. Cette assemblée devait s'emparer de tous les pouvoirs, jusqu'à ce que le bonheur commun fût assuré.
Il fallait s'entendre avec les conventionnels non réélus, dont la plupart étaient à Paris. Baboeuf et Drouet entrèrent en communication avec eux. Il y eut de grandes discussions sur le choix des moyens. Les conventionnels trouvaient trop extraordinaires ceux que proposait le directoire insurrecteur. Ils voulaient le rétablissement de l'ancienne convention, avec l'organisation prescrite par la constitution de 1793. Enfin on s'entendit, et l'insurrection fut préparée pour le mois de floréal (avril-mai). Les moyens dont le directoire secret se proposait d'user, étaient vraiment effrayans. D'abord il s'était mis en correspondance avec les principales villes de France, pour que la révolution fût simultanée et semblable partout. Les patriotes devaient partir de leurs quartiers en portant des guidons sur lesquels seraient écrits ces mots: Liberté, Égalité, Constitution de 1793, Bonheur commun. Quiconque résisterait au peuple souverain serait mis à mort. On devait égorger les cinq directeurs, certains membres des cinq-cents, le général de l'armée de l'intérieur; on devait s'emparer du Luxembourg, de la Trésorerie, du télégraphe, des arsenaux et du dépôt d'artillerie de Meudon. Pour engager le peuple à se soulever et ne plus le payer de vaines promesses, on devait obliger tous les habitans aisés de loger, héberger et nourrir chaque homme qui aurait pris part à l'insurrection. Les boulangers, les marchands de vin seraient tenus de fournir du pain et des boissons au peuple, moyennant une indemnité que leur paierait la république, et sous peine d'être pendus à la lanterne en cas de refus. Tout soldat qui passerait du côté de l'insurrection aurait son équipement en propriété, recevrait une somme d'argent, et aurait la faculté de retourner dans ses foyers. On espérait gagner ainsi tous ceux qui servaient à regret. Quant aux soldats de métier qui avaient pris goût à la guerre, on leur donnait à piller les maisons des royalistes. Pour tenir les armées au complet, et remplacer ceux qui rentreraient dans leurs foyers, on se proposait d'accorder aux soldats des avantages tels, qu'on ferait lever spontanément une multitude de nouveaux volontaires.
On voit quelles combinaisons terribles et insensées avaient conçues ces esprits désespérés. Ils désignèrent Rossignol, l'ex-général de la Vendée, pour commander l'armée parisienne d'insurrection. Ils avaient pratiqué des intelligences dans cette légion de police qui faisait partie de l'armée de l'intérieur, et toute composée de patriotes, de gendarmes des tribunaux, d'anciens gardes-françaises. Elle se mutina en effet, mais trop tôt, et fut dissoute par le directoire. Le ministre de la police Cochon, qui suivait les progrès de la conspiration, qui lui fut dénoncée par un officier de l'armée de l'intérieur qu'on avait voulu enrôler, la laissa se continuer pour en saisir tous les fils. Le 20 floréal (9 mai), Baboeuf, Drouet, et les autres chefs et agens devaient se réunir rue Bleue, chez un menuisier. Des officiers de police, apostés dans les environs, saisirent les conspirateurs, et les conduisirent sur-le-champ en prison. On arrêta en outre les ex-conventionnels Laignelot, Vadier, Amar, Ricard, Choudieu, le Piémontais Buonarotti, l'ex-membre de l'assemblée législative Antonelle, Pelletier (de Saint-Fargeau), frère de celui qui avait été assassiné. On demanda aussitôt aux deux conseils la mise en accusation de Drouet, qui était membre des cinq-cents, et on les envoya tous devant la haute cour nationale, qui n'était pas encore organisée, et qu'on se mit à organiser sur-le-champ. Baboeuf, dont la morgue égalait le fanatisme, écrivit au directoire une lettre singulière, et qui peignait le délire de son esprit. «Je suis une puissance, écrivait-il aux cinq directeurs; ne craignez donc pas de traiter avec moi d'égal à égal. Je suis le chef d'une secte formidable que vous ne détruirez pas en m'envoyant à la mort, et qui, après mon supplice, n'en sera que plus irritée et plus dangereuse. Vous n'avez qu'un seul fil de la conspiration; ce n'est rien d'avoir arrêté quelques individus; les chefs renaîtront sans cesse. Épargnez-vous de verser du sang inutile; vous n'avez pas encore fait beaucoup d'éclat, n'en faites pas davantage, traitez avec les patriotes; ils se souviennent que vous fûtes autrefois des républicains sincères; ils vous pardonneront, si vous voulez concourir avec eux au salut de la république.»
Le directoire ne fit aucun cas de cette lettre extravagante, et ordonna l'instruction du procès. Cette instruction devait être longue, car on voulait procéder dans toutes les formes. Ce dernier acte de vigueur acheva de consolider le directoire dans l'opinion générale. La fin de l'hiver approchait; les factions étaient surveillées et contenues; l'administration était dirigée avec zèle et avec soin; le papier-monnaie renouvelé donnait seul des inquiétudes; il avait fourni cependant des ressources momentanées pour faire les premiers préparatifs de la campagne qui allait s'ouvrir. En effet, la saison des opérations militaires était arrivée. Le ministère anglais, toujours astucieux dans sa politique, avait tenté auprès du gouvernement français la démarche dont l'opinion publique lui faisait un devoir. Il avait chargé son agent en Suisse, Wickam, d'adresser des questions insignifiantes au ministre de France, Barthélémy. Cette ouverture, faite le 17 ventôse (7 mars 1796), avait pour but de demander si la France était disposée à la paix, si elle consentirait à un congrès pour en discuter les conditions, si elle voulait faire connaître à l'avance les bases principales sur lesquelles elle était résolue à traiter. Une pareille démarche n'était qu'une vaine satisfaction donnée par Pitt à sa nation, afin d'être autorisé par un refus de la France à demander de nouveaux sacrifices. Si en effet Pitt avait été sincère, il n'aurait pas chargé de cette ouverture un agent sans pouvoirs; il n'aurait pas demandé un congrès européen, qui, par la complication des questions, ne pouvait rien terminer, et que la France d'ailleurs avait déjà refusé à l'Autriche par l'intermédiaire du Danemarck; enfin il n'aurait pas demandé sur quelles bases la négociation devait s'ouvrir, puisqu'il savait que, d'après la constitution, les Pays-Bas étaient devenus partie du territoire français, et que le gouvernement actuel ne pouvait consentir à les en détacher. Le directoire, qui ne voulait pas être pris pour dupe, fit répondre à Wickam que ni la forme ni l'objet de cette démarche n'étaient de nature à faire croire à sa sincérité; que, du reste, pour démontrer ses intentions pacifiques, il consentait à faire une réponse à des questions qui n'en méritaient pas, et qu'il déclarait vouloir traiter sur les bases seules fixées par la constitution. C'était annoncer d'une manière définitive que la France ne renoncerait jamais à la Belgique. La lettre du directoire, écrite avec convenance et fermeté, fut aussitôt publiée avec celle de Wickam. C'était le premier exemple d'une diplomatie franche et ferme sans jactance.
Chacun approuva le directoire, et de part et d'autre on se prépara en Europe à recommencer les hostilités. Pitt demanda au parlement un nouvel emprunt de 7 millions sterling, et il s'efforça d'en négocier un autre de 3 millions pour l'empereur. Il avait beaucoup travaillé auprès du roi de Prusse pour le tirer de sa neutralité et le faire rentrer dans la lutte; il lui offrit des fonds, et lui représenta qu'arrivant à la fin de la guerre, lorsque tous les partis étaient épuisés, il aurait une supériorité assurée. Le roi de Prusse, ne voulant pas retomber dans ses premières fautes, ne se laissa pas abuser et persista dans sa neutralité. Une partie de son armée, stationnée en Pologne, veillait à l'incorporation des nouvelles conquêtes; l'autre, rangée le long du Rhin, était prête à défendre la ligne de neutralité contre celle des puissances qui la violerait, et à prendre sous sa protection ceux des états de l'Empire qui réclameraient la médiation prussienne. La Russie, toujours féconde en promesses, n'envoyait pas encore de troupes, et s'occupait à organiser la part de territoire qui lui était échue en Pologne.
L'Autriche, enflée de ses succès à la fin de la campagne précédente, se préparait à la guerre avec ardeur, et se livrait aux espérances les plus présomptueuses. Le général auquel elle devait ce léger retour de fortune, avait cependant été destitué, malgré tout l'éclat de sa gloire. Clerfayt, ayant déplu au conseil aulique, fut remplacé dans le commandement de l'armée du Bas-Rhin par le jeune archiduc Charles, dont on espérait beaucoup sans cependant prévoir encore ses talens. Il avait montré dans les campagnes précédentes les qualités d'un bon officier. Wurmser commandait toujours l'armée du Haut-Rhin. Pour décider le roi de Sardaigne à continuer la guerre, on avait envoyé un renfort considérable à l'armée impériale qui se battait en Piémont; et on lui avait donné le général Beaulieu, qui s'était acquis beaucoup de réputation dans les Pays-Bas. L'Espagne, commençant à jouir de la paix, était attentive à la nouvelle lutte qui allait s'ouvrir, et, maintenant mieux éclairée sur ses véritables intérêts, faisait des voeux pour la France.
Le directoire, zélé comme un gouvernement nouveau, et jaloux d'illustrer son administration, méditait de grands projets. Il avait mis ses armées dans un état de force respectable; mais il n'avait pu que leur envoyer des hommes, sans leur fournir les approvisionnemens nécessaires. Toute la Belgique avait été mise à contribution pour nourrir l'armée de Sambre-et-Meuse; des efforts extraordinaires avaient été faits pour faire vivre celle du Rhin au milieu des Vosges. Cependant on n'avait pu ni leur procurer des moyens de transport, ni remonter leur cavalerie. L'armée des Alpes avait vécu des magasins pris aux Autrichiens après la bataille de Loano; mais elle n'était ni vêtue, ni chaussée, et le prêt était arriéré. La victoire de Loano était ainsi demeurée sans résultat. Les armées des provinces de l'Ouest se trouvaient, grâce aux soins de Hoche, dans un meilleur état que toutes les autres, sans être cependant pourvues de tout ce dont elles avaient besoin. Mais, malgré cette pénurie, nos armées, habituées à souffrir, à vivre d'expédiens, et d'ailleurs aguerries par leurs belles campagnes, étaient disposées à de grandes choses.
Le directoire méditait, disons-nous, de vastes projets. Il voulait finir dès le printemps la guerre de la Vendée, et prendre ensuite l'offensive sur tous les points. Son but était de porter les armées du Rhin en Allemagne pour bloquer et assiéger Mayence, achever la soumission des princes de l'Empire, isoler l'Autriche, transporter le théâtre de la guerre au sein des états héréditaires, et faire vivre ses troupes aux dépens de l'ennemi dans les riches vallées du Mein et du Necker. Quant à l'Italie, il nourrissait de plus vastes pensées encore, suggérées par le général Bonaparte. Comme on n'avait pas profité de la victoire de Loano, il fallait, suivant ce jeune officier, en remporter une seconde, décider le roi de Piémont à la paix, ou lui enlever ses états, franchir ensuite le Pô, et venir enlever à l'Autriche le plus beau fleuron de sa couronne, la Lombardie. Là était le théâtre des opérations décisives; là on allait porter les coups les plus sensibles à l'Autriche, conquérir des équivalens pour payer les Pays-Bas, décider la paix, et peut-être affranchir la belle Italie. D'ailleurs on allait nourrir et restaurer la plus pauvre de nos armées, au milieu de la contrée la plus fertile de la terre.
Le directoire, s'arrêtant à ces idées, fit quelques changemens dans le commandement de ses armées. Jourdan conserva le commandement qu'il avait si bien mérité à la tête de l'armée de Sambre-et-Meuse. Pichegru, qui avait trahi sa patrie, et dont le crime était déjà soupçonné, fut remplacé par Moreau, qui commandait en Hollande. On offrit à Pichegru l'ambassade en Suède, qu'il refusa. Beurnonville, venu récemment de captivité, remplaça Moreau dans le commandement de l'armée française en Hollande. Schérer, dont on était mécontent pour n'avoir pas su profiter de la victoire de Loano, fut remplacé. On voulait un jeune homme entreprenant pour essayer une campagne hardie. Bonaparte, qui s'était déjà distingué à l'armée d'Italie, qui d'ailleurs paraissait si pénétré des avantages d'une marche au-delà des Alpes, parut l'homme le plus propre à remplacer Schérer. Il fut promu du commandement de l'armée de l'intérieur à celui de l'armée d'Italie. Il partit sur-le-champ pour se rendre à Nice. Plein d'ardeur et de joie, il dit en partant, que dans un mois il serait à Milan ou à Paris. Cette ardeur paraissait téméraire; mais chez un jeune homme, et dans une entreprise hasardeuse, elle était de bon augure.
Des changemens pareils furent opérés dans les trois armées qui gardaient les provinces insurgées. Hoche, mandé à Paris pour concerter avec le directoire un plan qui mît fin à la guerre civile, y avait obtenu la plus juste faveur, et reçu les plus grands témoignages d'estime. Le directoire, reconnaissant la sagesse de ses plans, les avait tous approuvés; et pour que personne n'en pût contrarier l'exécution, il avait réuni les trois armées des côtes de Cherbourg, dés côtes de Brest et de l'Ouest, en une seule, sous le titre d'armée des côtes de l'Océan, et lui en avait donné le commandement supérieur. C'était la plus grande armée de la république, car elle s'élevait à cent mille hommes, s'étendait sur plusieurs provinces, et exigeait dans le chef une réunion de pouvoirs civils et militaires tout à fait extraordinaires. Un commandement aussi vaste était la plus grande preuve de confiance qu'on pût donner à un général. Hoche la méritait certainement. Possédant à vingt-sept ans une réunion de qualités militaires et civiles, qui deviennent souvent dangereuses à la liberté, nourrissant même une grande ambition, il n'avait pas cette coupable audace d'esprit qui peut porter un capitaine illustre à ambitionner plus que la qualité de citoyen; il était républicain sincère, et égalait Jourdan en patriotisme et en probité. La liberté pouvait applaudir sans crainte à ses succès, et lui souhaiter des victoires.
Hoche n'avait guère passé qu'un mois à Paris. Il était retourné sur-le-champ dans l'Ouest, afin d'avoir achevé la pacification de la Vendée à la fin de l'hiver ou au commencement du printemps. Son plan de désarmement et de pacification fut rédigé en articles, et converti en arrêté par le directoire. Il était convenu, d'après ce plan, qu'un cordon de désarmement envelopperait toutes les provinces insurgées, et les parcourrait successivement. En attendant leur complète pacification, elles étaient soumises au régime militaire. Toutes les villes étaient déclarées en état de siége. Il était reconnu en principe que l'armée devait vivre aux dépens du pays insurgé; par conséquent Hoche était autorisé à percevoir l'impôt et l'emprunt forcé soit en nature, soit en espèces, comme il lui conviendrait, et à former des magasins et des caisses pour l'entretien de l'armée. Les villes aux quelles les campagnes faisaient la guerre des subsistances, en cherchant à les affamer, devaient être approvisionnées militairement par des colonnes attachées aux principales d'entre elles. Le pardon était accordé à tous les rebelles qui déposeraient leurs armes. Quant aux chefs, ceux qui seraient pris les armes à la main devaient être fusillés; ceux qui se soumettraient seraient ou détenus ou en surveillance dans des villes désignées, ou conduits hors de France. Le directoire, approuvant le projet de Hoche, qui consistait à pacifier d'abord la Vendée avant de songer à la Bretagne, l'autorisait à terminer ses opérations sur la rive gauche de la Loire, avant de ramener ses troupes sur la rive droite. Dès que la Vendée serait entièrement soumise, une ligne de désarmement devait embrasser toute la Bretagne, depuis Granville jusqu'à la Loire, et s'avancer ainsi, en parcourant la péninsule bretonne, jusqu'à l'extrémité du Finistère. C'était à Hoche à fixer le moment où ces provinces, lui paraissant soumises, seraient affranchies du régime militaire et rendues au système constitutionnel.
Hoche, arrivé à Angers vers la fin de nivôse (mi-janvier), trouva ses opérations fort dérangées par son absence. Le succès de son plan, dépendant surtout de la manière dont il serait exécuté, exigeait indispensablement sa présence. Le général Willot l'avait mal suppléé. La ligne de désarmement faisait peu de progrès. Charette l'avait franchie, et avait repassé sur les derrières. Le système régulier d'approvisionnement étant mal suivi, et l'armée ayant souvent manqué du nécessaire, elle s'était livrée de nouveau à l'indiscipline, et avait commis des actes capables d'aliéner les habitans. Sapinaud, après avoir fait, comme on l'a vu, une tentative hostile sur Montaigu, avait obtenu du général Willot une paix ridicule, à laquelle Hoche ne pouvait pas consentir. Enfin Stofflet, jouant toujours le prince, et Bernier le premier ministre, se renforçaient des déserteurs qui abandonnaient Charette, et faisaient des préparatifs secrets. Les villes de Nantes et d'Angers manquaient de vivres. Les patriotes réfugiés des pays environnans s'y étaient amassés, et se livraient, dans des clubs, à des déclamations furibondes et dignes des jacobins. Enfin on répandait que Hoche n'avait été rappelé à Paris que pour perdre son commandement. Les uns le disaient destitué comme royaliste, les autres comme jacobin.
Son retour dissipa tous les bruits, et répara les maux causés par son absence. Il fit recommencer le désarmement, remplir les magasins, approvisionner les villes; il les déclara toutes en état de siége; et, autorisé dès lors à y exercer la dictature militaire, il ferma les clubs jacobins formés par les réfugiés, et surtout une société connue à Nantes sous le titre de Chambre ardente. Il refusa de ratifier la paix accordée à Sapinaud; il fit occuper son pays, et lui laissa à lui la faculté de sortir de France, ou de courir les bois, sous peine d'être fusillé s'il était pris. Il fit resserrer Stofflet plus étroitement que jamais, et recommencer les poursuites contre Charette. il confia à l'adjudant-général Travot, qui joignait à une grande intrépidité toute l'activité d'un partisan, le soin de poursuivre Charette avec plusieurs colonnes d'infanterie légère et de cavalerie, de manière à ne lui laisser ni repos, ni espoir.
Charette, en effet, poursuivi jour et nuit, n'avait plus aucun moyen d'échapper. Les habitans du Marais, désarmés, surveillés, ne pouvaient plus lui être d'aucun secours. Ils avaient livré déjà plus de sept mille fusils, quelques pièces de canon, quarante barils de poudre, et ils étaient dans l'impossibilité de reprendre les armes. L'auraient-ils pu d'ailleurs, ils ne l'auraient pas voulu, parce qu'ils se sentaient heureux du repos dont ils jouissaient, et qu'ils craignaient de s'exposer à de nouvelles dévastations. Les paysans venaient dénoncer aux officiers républicains les chemins où Charette passait, les retraites où il allait reposer un instant sa tête; et quand ils pouvaient s'emparer de quelques-uns de ceux qui l'accompagnaient, ils les livraient à l'armée. Charette, à peine escorté d'une centaine de serviteurs dévoués, et suivi de quelques femmes qui servaient à ses plaisirs, ne songeait pas cependant à se rendre. Plein de défiance, il faisait quelquefois massacrer ses hôtes, quand il craignait d'en être trahi. Il fit, dit-on, mettre à mort un curé qu'il soupçonnait de l'avoir dénoncé aux républicains. Travot le rencontra plusieurs fois, lui tua une soixantaine d'hommes, plusieurs de ses officiers, et entre autres son frère. Il ne lui resta plus que quarante ou cinquante hommes.
Pendant que Hoche le faisait harceler sans relâche, et poursuivait son projet de désarmement, Stofflet se voyait avec effroi entouré de toutes parts, et sentait bien que Charette, Sapinaud, détruits, et tous les chouans soumis, on ne souffrirait pas long-temps l'espèce de principauté qu'il s'était arrogée dans le Haut-Anjou. Il pensa qu'il ne fallait pas attendre, pour agir, que tous les royalistes fussent exterminés; alléguant pour prétexte un règlement de Hoche, il leva de nouveau l'étendard de la révolte, et reprit les armes. Hoche était en ce moment sur les bords de la Loire, et il fallait se rendre dans le Calvados pour juger de ses yeux l'état de la Normandie et de la Bretagne. Il ajourna aussitôt son départ, et fit ses préparatifs pour enlever Stofflet avant que sa révolte pût acquérir quelque importance. Hoche, du reste, était charmé que Stofflet lui fournît lui-même l'occasion de rompre la pacification. Cette guerre l'embarrassait peu, et lui permettait de traiter l'Anjou comme le Marais et la Bretagne. Il fit partir ses colonnes de plusieurs points à la fois, de la Loire, du Layon et de la Sèvre Nantaise. Stofflet, assailli de tous les côtés, ne put tenir nulle part. Les paysans de l'Anjou étaient encore plus sensibles aux douceurs de la paix que ceux du Marais; ils n'avaient point répondu à l'appel de leur ancien chef, et l'avaient laissé commencer la guerre avec les mauvais sujets du pays et les émigrés dont son camp était rempli. Deux rassemblemens qu'il avait formés furent dispersés, et lui-même se vit obligé de courir, comme Charette, à travers les bois. Mais il n'avait ni l'opiniâtreté, ni la dextérité de ce chef, et son pays n'était pas aussi heureusement disposé pour cacher une troupe de maraudeurs. Il fut livré par ses propres affidés. Attiré dans une ferme, sous prétexte d'une conférence, il fut saisi, garrotté et abandonné aux républicains. On assure que son fidèle ministre, l'abbé Bernier, prit part à cette trahison. La prise de ce chef était d'une grande importance par l'effet moral qu'elle devait produire sur ces contrées. Il fut conduit à Angers, et après avoir subi un interrogatoire, il fut fusillé le 7 ventôse (26 février), en présence d'un peuple immense.
Cette nouvelle causa une joie des plus vives, et fit présager que bientôt la guerre civile finirait dans ces malheureuses contrées. Hoche, au milieu des soins si pénibles de ce genre de guerre, était abreuvé de dégoûts de toute espèce. Les royalistes l'appelaient naturellement un scélérat, un buveur de sang, quoiqu'il s'appliquât à les détruire par les voies les plus loyales; mais les patriotes eux-mêmes le tourmentaient de leurs calomnies. Les réfugiés de la Vendée et de la Bretagne, dont il réprimait les fureurs, et dont il contrariait la paresse, en cessant de les nourrir dès qu'il y avait sûreté pour eux sur leurs terres, le dénonçaient au directoire. Les administrations des villes qu'il mettait en état de siége, réclamaient contre l'établissement du système militaire, et le dénonçaient aussi. Des communes soumises à des amendes, ou à la perception militaire de l'impôt, se plaignaient à leur tour. C'était un concert continuel de plaintes et de réclamations. Hoche, dont le caractère était irritable, fut plusieurs fois poussé au désespoir, et demanda formellement sa démission. Mais le directoire la refusa, elle consola par de nouveaux témoignages d'estime et de confiance. Il lui fit un don national de deux beaux chevaux, don qui n'était pas seulement une récompense, mais un secours indispensable. Ce jeune général, qui aimait les plaisirs, qui était à la tête d'une armée de cent mille hommes, et qui disposait du revenu de plusieurs provinces, manquait cependant quelquefois du nécessaire. Ses appointemens payés en papier, se réduisaient à rien. Il manquait de chevaux, de selles, de brides, et il demandait l'autorisation de prendre, en les payant, six selles, six brides, des fers de cheval, quelques bouteilles de rhum, et quelques pains de sucre, dans les magasins laissés par les Anglais à Quiberon: exemple admirable de délicatesse, que nos généraux républicains donnèrent souvent, et qui allait devenir tous les jours plus rare, à mesure que nos invasions allaient s'étendre, et que nos moeurs guerrières allaient se corrompre par l'effet des conquêtes et des moeurs de cour!
Encouragé par le gouvernement, Hoche continua ses efforts pour finir son ouvrage dans la Vendée. La pacification complète ne dépendait plus que de la prise de Charette. Ce chef, réduit aux abois, fit demander à Hoche la permission de passer en Angleterre. Hoche y consentit, d'après l'autorisation qu'il en trouvait dans l'arrêté du directoire, relatif aux chefs qui feraient leur soumission. Mais Charette n'avait fait cette demande que pour obtenir un peu de répit, et il n'en voulait pas profiter. De son côté, le directoire ne voulait pas faire grâce à Charette, parce qu'il pensait a que ce chef fameux serait toujours un épouvantail pour la contrée. Il écrivit à Hoche de ne lui accorder aucune transaction. Mais lorsque Hoche reçut ces nouveaux ordres, Charette avait déjà déclaré que sa demande n'était qu'une feinte pour obtenir quelques momens de repos, et qu'il ne voulait pas du pardon des républicains. Il s'était mis de nouveau à courir les bois.
Charette ne pouvait pas échapper plus longtemps aux républicains. Poursuivi à la fois par des colonnes d'infanterie et de cavalerie, observé par des troupes de soldats déguisés, dénoncé par les habitans, qui voulaient sauver leur pays de la dévastation, traqué dans les bois comme une bête fauve, il tomba le 2 germinal (22 mars) dans une embuscade qui lui fut tendue par Travot. Armé jusqu'aux dents, et entouré de quelques braves qui s'efforçaient de le couvrir de leurs corps, il se défendit comme un lion, et tomba enfin frappé de plusieurs coups de sabre. Il ne voulut remettre son épée qu'au brave Travot, qui le traita avec tous les égards dus à un si grand courage. Il fut conduit au quartier républicain, et admis à table auprès du chef de l'état-major Hédouville. Il s'entretint avec une grande sérénité, et ne montra nulle affliction du sort qui l'attendait. Traduit d'abord à Angers, il fut ensuite transporté à Nantes, pour y terminer sa vie aux mêmes lieux qui avaient été témoins de son triomphe. Il subit un interrogatoire auquel il répondit avec beaucoup de calme et de convenance. On le questionna sur les prétendus articles secrets du traité de La Jaunaye, et il avoua qu'il n'en existait point. Il ne chercha ni à pallier sa conduite, ni à excuser ses motifs; il avoua qu'il était serviteur de la royauté, et qu'il avait travaillé de toutes ses forces à renverser la république. Il montra de la dignité et une grande impassibilité. Conduit au supplice au milieu d'un peuple immense, qui n'était point assez généreux pour lui pardonner les maux de la guerre civile, il conserva toute son assurance. Il était tout sanglant; il avait perdu trois doigts dans son dernier combat, et portait le bras en écharpe. Sa tête était enveloppée d'un mouchoir. Il ne voulut ni se laisser bander les yeux, ni se mettre à genoux. Resté debout, il détacha son bras de son écharpe, et donna le signal. Il tomba mort sur-le-champ. C'était le 9 germinal (29 mars.) Ainsi finit cet homme célèbre, dont l'indomptable courage causa tant de maux à son pays, et méritait de s'illustrer dans une autre carrière. Compromis par la dernière tentative de débarquement qui avait été faite sur ses côtes, il ne voulut plus reculer, et finit en désespéré. Il exhala, dit-on, un vif ressentiment contre les princes qu'il avait servis, et dont il se regardait comme abandonné.
La mort de Charette causa autant de joie que la plus belle victoire sur les Autrichiens. Sa mort décidait la fin de la guerre civile. Hoche, croyant n'avoir plus rien à faire dans la Vendée, en retira le gros de ses troupes, pour les porter au-delà de la Loire, et désarmer la Bretagne. Il y laissa néanmoins des forces suffisantes pour réprimer les brigandages isolés, qui suivent d'ordinaire les guerres civiles, et pour achever le désarmement du pays. Avant de passer en Bretagne, il eut à comprimer un mouvement de révolte qui éclata dans le voisinage de l'Anjou, vers le Berry. Ce fut l'occupation de quelques jours; il se porta ensuite avec vingt mille hommes en Bretagne, et, fidèle à son plan, l'embrassa d'un vaste cordon de la Loire à Granville. Les malheureux chouans ne pouvaient pas tenir contre un effort aussi grand et aussi bien concerté; Scépeaux, entre la Vilaine et la Loire, demanda le premier à se soumettre. Il remit un nombre considérable d'armes. A mesure qu'ils étaient refoulés vers l'Océan, les chouans devenaient plus opiniâtres. Privés de munitions, ils se battaient corps à corps, à coups de poignard et de baïonnette. Enfin on les accula tout à fait à la mer. Le Morbihan, qui depuis long-temps s'était séparé de Puisaye, rendit ses armes. Les autres divisions suivirent cet exemple les unes après les autres. Bientôt toute la Bretagne fut soumise à son tour, et Hoche n'eut plus qu'à distribuer ses cent mille hommes en une multitude de cantonnemens pour surveiller le pays, et les faire vivre plus aisément. Le travail qui lui restait à faire ne consistait plus qu'en des soins d'administration et de police; il lui fallait quelques mois encore d'un gouvernement doux et habile pour calmer les haines, et rétablir la paix. Malgré les cris furieux de tous les partis, Hoche était craint, chéri, respecté dans la contrée, et les royalistes commençaient à pardonner à une république si dignement représentée. Le clergé surtout, dont il avait su capter la confiance, lui était entièrement dévoué, et le tenait exactement instruit de ce qu'il avait intérêt à connaître. Tout présageait la paix et la fin d'horribles calamités. L'Angleterre ne pouvait plus compter sur les provinces de l'Ouest pour attaquer la république dans son propre sein. Elle voyait, au contraire, dans ces pays cent mille hommes, dont cinquante mille devenaient disponibles, et pouvaient être employés à quelque entreprise fatale pour elle. Hoche, en effet, nourrissait un grand projet, qu'il réservait pour le milieu de la belle saison. Le gouvernement, charmé des services qu'il venait de rendre, et voulant le dédommager de la tâche dégoûtante qu'il avait su remplir, fit déclarer pour lui, comme pour les armées qui remportaient de grandes victoires, que l'armée de l'Océan et son chef avaient bien mérité de la patrie.
Ainsi la Vendée était pacifiée dès le mois de germinal, avant qu'aucune des armées fût entrée en campagne. Le directoire pouvait se livrer sans inquiétude à ses grandes opérations, et tirer même des côtes de l'Océan d'utiles renforts.